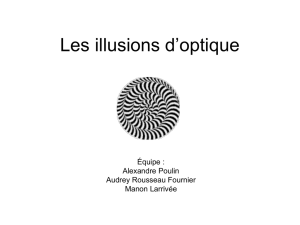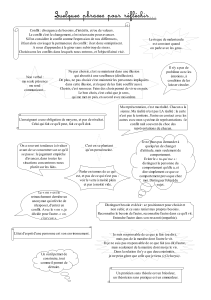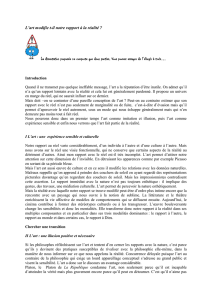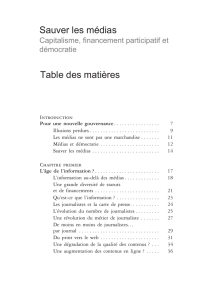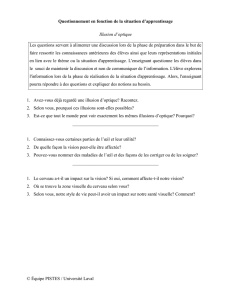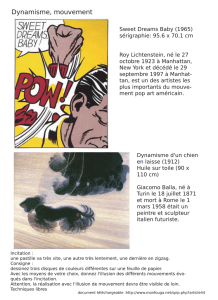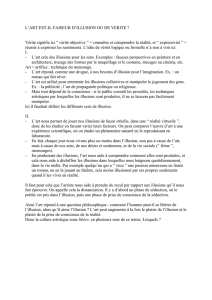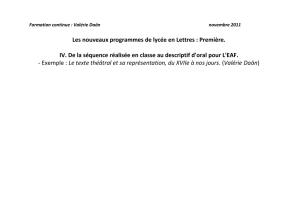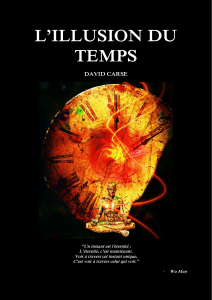Le Septième sceau de Bergman (la mort du comédien)

1
Le Septième sceau de Bergman (la mort du comédien)
Le septième sceau (1957) est un film en noir et blanc du cinéaste suédois Ingmar
Bergman. Scrupuleux observateur des passions humaines sous le scalpel nordique, ayant
mêlé comédies et drames dans une abondante filmographie, il est bien loin de l’univers
lisse et aseptisé que l’on tente de donner de cette partie du monde de nos jours.
Le titre est une référence biblique tirée de l’apocalypse, le septième et dernier sceau qui
permet d'ouvrir le Livre de la révélation (apocalypse voulant dire révélation), et de
connaître les secrets divins qu’il enferme. Seul l'Agneau (le Christ) peut briser ce seau
venant après les six premiers symbolisant les fléaux dont est accablé l'homme (religion
trompeuse, guerre, famine, persécution, pestes ou épidémie, violence, et mort). Ingmar
Bergman propose une interrogation sur l’homme se débattant en vain dans un monde
réel et tragique.
Dans l’extrait proposé, le cinéaste place une scène de comédie en pleine nature, dans une
forêt, l'exact opposé de l'artifice propre à la représentation. Il y a ici un retour aux
sources de l'illusion théâtrale, doublée de l'illusion cinématographique, le cinéaste ayant
été aussi bien réalisateur de films que metteur en scène de théâtre.
Pas de doute, l'homme sort bien de la nature autant qu'il s'en dissocie, et il est à lui tout
seul un théâtre, soit qu'il simule un rôle dans sa vie, soit qu'il l'accomplisse sur une scène
ou devant une caméra. C'est ainsi que l'on parle du monde comme un théâtre. L'homme
est double et dupe de lui-même. Il est joué. Théâtre par le fait que ces hommes et ces
femmes sont des comédiens sans costumes et aussi qu'au lieu de se disputer réellement
dans l’extrait, ils jouent une pièce dans un lieu qui n'est pas leur travail habituel : les
planches. Ce qui donne à cette scène un aspect irréel et théâtral de comédie. Là où on
pensait que le vrai se passait se déroule l’illusion de réalité dans la réalité elle-même.
C'est toute la duplicité qu'installe le cinéaste d'emblée en plaçant ces comédiens en
pleine nature, matrice du monde, dans une scène quotidienne, mais qui n'en continue
pas moins de jouer la mascarade. Comme pour dire, que acteurs ou non, les hommes
n'en continuent pas moins de tenir un rôle à jouer, pions d’un plus vaste échiquier que le
film pose dès le début entre le Chevalier et la Mort. Dès lors, cette petite troupe
itinérante qui représente quelques pièces pour survivre dans un monde hanté par la
mort et la maladie, n'en continue pas moins de jouer, se débattant avec un hypothétique
sens, face à sa misérable condition. Le film emblématise ce point d’indistinction entre
illusion et réalité dans son processus filmique même comme s’il se souvenait de La
tempête de Shakespeare quand celui-ci fait dire : «Nous sommes de l'étoffe dont sont
faits les rêves, et notre petite vie est entourée de sommeil.»
Le dispositif est idyllique : dans une mise en scène toute en distance et simplicité, fait de
plans sobres (en plans américains ou rapprochés poitrine le plus souvent), une troupe de
comédien se chamaille : une jeune femme Kunigunda surgit comme sur une scène et
s’adresse à son mari, Plog, qu’elle a trompé et lui annonce qu’elle n’aime plus son amant,
Skat. Elle a fauté et tente de reconquérir son mari en l'amadouant par la nourriture

2
(« Quand nous rentrons à la maison, je te ferai des boulettes de pâte de porc. ») et en
dénonçant Skat qu'elle qualifie comme étant faux, ce qu'il est, étant acteur, vêtu comme
un bouffon. (« Il n'est que fausse barbe et fausses dents faux partout. ») Le ton badin en
cette occasion en dévoile l’artificiel.
Dénonçant le faux, elle est fausse elle-même et tente d’illusionner son mari sur ses
responsabilités. L’embonpoint de ce dernier montre bien les faiblesses qu’il a au niveau
du ventre pour se laisser berner à ce point par la nourriture (péché de gourmandise). Le
faux ne se cache pas seulement derrière des accessoires, postiches, faux nez et autres
barbes. Plog se laisse illusionner, Kunigunda illusionne pour échapper à son
comportement, elle-même s’étant « fait du cinéma » sur une séduisante aventure
extra-conjugale (péché de chair), illusionnée aussi par le comédien, ce pourquoi ce
dernier est mis en accusation. Le métier de comédien a souvent été vu comme vil, une
occupation d’oisif et de truqueur. Etre séduit n’est-il pas non plus succomber à une
virtualité alléchante, être marié tout en menant une double vie ? L’être humain n’est-il
pas aussi celui qui joue sur deux tableaux (donner une représentation fausse de soi tout
en la trahissant dans les faits) pour remporter la mise ?
Pour ajouter au processus, cette scénette se passe devant les autres comédiens qui
commentent en apartés (comme au théâtre) les tribulations rocambolesques du couple
reconstitué : « Seigneur, pourquoi avez-vous créé la femme ? », « L'acteur joue sur les
émotions. C'est la moitié de la bataille. » disent-ils presque goguenards, révélant non
seulement la duplicité de la séduction féminine et les artifices scéniques employés au
théâtre mais aussi le côté mécanique et prévisible du comportement humain.
Skat va alors redoubler son rôle, d’homme et d’acteur car il n’est pas du tout effrayé en
une telle circonstance par le fait qu’on veuille le tuer, et il en remercie même son futur
auteur. Il va donc jouer le jeu jusqu’au bout par ce qu’il sait faire de mieux pour échapper
à son assassinat : l’acteur. Il va simuler sa mort mais ce sera une mort de théâtre. Il
prend place sur une scène improvisée près d’un arbre, se tue et meurt avec emphase et
ridicule. On ne peut y croire. Les autres comédiens assistent à la scène sans drame et
font comme si elle avait bien eu lieu, le feuillage faisant office de rideau. « Il est mort.
L'acteur le plus mort que j'ai jamais vu. » dit l’un, prononçant le mot d’acteur au lieu
d’homme.
Contre toute attente, en off, on entend la charrette des comédiens s’en aller comme si ce
jeu n’avait pas été si factice que cela. Le couteau se relève, dévoilant l'artifice de théâtre,
Skat se redresse, content de lui (« J'ai bien joué cette scène. »). Il se retrouve seul
comme s'il avait franchi un seuil impalpable, point d’indistinction entre illusion et réalité
indiqué plus haut. Le comédien passe d'une fausse scène réelle à une scène réelle
théâtralisée, celle de sa mort effective.
Seul, Slak doit se protéger des ours, loups et fantômes, rappel de la peur ancestrale de
l’homme face à la nature. Sa mort près de l’arbre annonce sa mort réelle dans l’arbre.
Sauf que la mort, elle, ne joue pas et ne triche pas même si dans ce film, elle est
personnifiée en noir comme il se doit, comme jouant un rôle pour les besoins de la
représentation filmique. A l'inverse des comédiens qui ne sont pas sur une scène mais

3
jouent un rôle à leur insu ou non, cette mort théâtralisée devrait être fictive à tout le
moins. Elle n'en est pas moins réelle, symétriquement inversée à la scène précédente !
Elle n'a pas de faux mais une scie de circonstance.
La Mort apparaît ici comme la doublure du comédien, juste derrière lui. Il s'apprête à
monter dans l'arbre pour trouver refuge, arbre non pas de vie mais de mort, bois qui lui
sert de cercueil, se rendant à sa dernière demeure de son plein gré. Là, où il voulait
échapper à la mort est l'endroit où précisément elle l'attend comme le dit l'histoire de
Samarcande. Le comédien négocie avec la Mort mais on ne joue pas avec elle comme
avec les hommes. On ne peut pas l’illusionner. La mort est douloureusement réelle,
tranchante comme une scie, terreur ultime.
L’opposition dans la mise en scène de Bergman, est radicale, jouxtant plongée et
contre-plongée, haut-bas, donnant une impression de vertige. Effectivement, Skat va
tomber de haut. Quand l'arbre tombe et que le comédien est réellement mort (en
hors-champ), dans un « cri silencieux », grimace qui en dit long sur sa terreur au point
qu’elle le rend muet (il ne joue plus et est sincère à ce moment-là), un écureuil surgit et
monte gracieusement sur le tronc d'arbre scié. Et ce petit animal, si fin et si beau, au
pelage roux et doux, avec sa queue en panache, vient nous jouer un dernier petit tour
comme si, lui aussi, voulait faire parti de la représentation. Il monte comme sur les
planches, image dédramatisée après la tragédie. Ironie légère comme une plume pour
dire peut-être qu’après la mort, il n’y a pas d’au-delà, pas de Dieu, simplement qu’un
petit écureuil. Ce qui n’étonne nullement chez Bergman qui s’est toujours interrogé sur
le silence de Dieu ou son absence. La mort est la seule réalité effective.
Ce plan surprenant vient donner une touche frivole et apaisée en même temps qu'elle
inclut la tragédie que seul l'homme connait à l'avance mais qu’il repousse sans cesse, se
perdant dans un tas d’illusions, ce qu’on appelait auparavant les péchés. Comme pour
signifier que la vie a une seule issue, celle de mourir (la mort contient la vie et non le
contraire), qu’elle est inéluctable dans une nature continuant paisiblement son cycle,
sans se soucier des angoisses humaines. C’est là que prend tout son sens cette phrase
célèbre de Shakespeare dans Macbeth : « La vie est une histoire racontée par un idiot,
pleine de fureur et de bruit, et qui ne signifie rien. »
Joli pied de nez à l’homme qui tente lui d’échapper au réel et à la mort par une
représentation et une duplication de lui-même volontairement fausse et simpliste. Sans
doute que la mort le rappelle à l’humilité face à son indécrottable vanité. La finesse et
l’habilité de Bergman n’est pas de faire de cette mort un drame horrible ou une tragédie
remplie de pathos mais de rappeler qu’elle est naturelle, réelle, hasardeuse, sans morale
aucune, opposée à toute dissimulation. Le cinéma à travers son langage si particulier,
mêlant artifices et émotions à l’inverse de la philosophie, n’est-il pas là pour nous
« apprendre à mourir » pour parodier Montaigne. C’est sans doute la magie réelle du
cinéma que de redonner la complexité et la simplicité du monde (de l’homme face à
celui-ci) à travers sa doublure imagée, ce qu’on appelle simplement la Beauté.

4
Madame Bovary
Le chef d’œuvre de Gustave Flaubert, Madame Bovary, écrit en 1857, la même année
que Les Fleurs du mal de Baudelaire, met en place dans cet extrait l’héroïne Emma
Bovary à l’opéra avec son mari, Charles.
A la suite d’Honoré de Balzac et de Stendhal, Gustave Flaubert est un romancier que l’on
a appelé réaliste, courant littéraire qui étudie avec minutie la réalité en tentant de la
retranscrire le plus fidèlement possible. Cependant, si Flaubert sait mieux que
quiconque qu’un texte ne produit rien de réel mais que du texte, ce dernier n’en dit pas
moins quelque chose de pertinent vis-à-vis du réel, sa compréhension. Son style sobre et
précis ne laisse pas de place aux allusions de l’auteur (pensées, notations, indications)
sur ses personnages ; le narrateur efface les traces de son énonciation ou de sa présence
comme si le lecteur lui-même assistait de plain pied à cette observation minutieuse du
couple Bovary dans le contexte de la province française (le nord) au XIXe siècle.
Le texte est découpé en trois parties avec une conclusion abrupte. D’entrée de jeu, on
note la mise en abyme opérée par Gustave Flaubert puisqu’il décrit une représentation
d’opéra à travers une représentation littéraire, sorte de cadre dans le cadre. Dans son
style précis, sans afféterie, le romancier décrit la représentation musicale au moment
précis où les comédiens jouent avec emphase, et l’on sait que la musique peut dérouler
ses nappes d’émotions fortes pour transporter artificiellement l’auditeur dans ses
sentiments intérieurs. Surtout que Flaubert ne prend pas par hasard la musique
romantique du compositeur Donizetti mettant en scène le livret Lucie de Lammermoor,
une histoire d’amour.
En quelques courtes phrases, le narrateur décrit avec une certaine méchanceté la
représentation de l’opéra, notamment les chanteurs, Lucie avec « sa plainte aiguë », la
basse-taille du ministre qui ronfle « comme un orgue ». Il poursuit dans la même veine :
« Ils étaient tous sur la même ligne à gesticuler ». Ces chanteurs expriment des
sentiments excessifs : la colère, la vengeance, la jalousie, la terreur, la miséricorde, la
stupéfaction, preuve que nous sommes dans un spectacle, rempli de pathos, destiné à
impressionner le spectateur, style lyrique à l’opposé de celui « réaliste » de Flaubert. Il y
a sans doute ici une critique induite de Flaubert envers ce style de représentation
artistique qui tient plus à ensevelir le spectateur sous un déluge d’émotions extrêmes que
de lui faire comprendre ce qui se passe sur scène.
En somme, les chanteurs semblent en faire trop comme si le narrateur indiquait que l’on
ne pouvait pas y croire tellement leurs gestes sont par trop démonstratifs, clinquants,
ampoulés. Ils ont l’air de pantins désarticulés qui tentent de nous faire croire qu’ils sont
vivants. À l’inverse, le spectacle ne peut que plaire à Emma, toute à son rêve, en bonne
romantique qui se ment à elle-même.
Justement, le romancier s’attache ensuite au héros masculin sur lequel l’héroïne va
projeter son idéal. Il ne manque pas d’en décrire le ridicule et de le désigner comme un
« amoureux outragé » qui gesticule dans son habit, qui s’agite encore en « faisant

5
sonner contre les planches les éperons vermeils de ses bottes molles ». Le portrait offert
n’est guère avantageux, c’est le moins que l’on puisse dire.
Ce personnage masculin (sorte de doublure d’Emma en quelque sorte) va nous
permettre de passer à la seconde partie de l’extrait qui met en scène Emma Bovary. En
cohérence avec le style adopté par Flaubert, celui-ci ne décrit pas son héroïne de
l’extérieur mais de l’intérieur, il nous fait glisser subrepticement en elle par la courte
phrase « pensait-elle » : nous passons ainsi de la scène à l’intériorité d’Emma, de la
représentation de l’opéra à celle qu’Emma se fait dans sa tête. Le chanteur semble
tellement convaincant par sa gesticulation que tout de suite l’imagination d’Emma
s’enflamme et pense que ce chanteur doit être nanti d’une forte capacité d’amour pour
l’exprimer si bruyamment sur la scène, sans se rendre compte ou l’ayant oublié qu’un
comédien simule des émotions. C’est bien le drame et c’est dire qu’Emma ne fait plus
trop la différence entre la réalité et la fiction.
D’ailleurs, la phrase simple « entraînée vers l’homme par l’illusion du personnage »
révèle le piège dans lequel tombe Emma, piège qu’elle s’est inoculée elle-même. À la
place de la scène de l’opéra, elle installe une autre scène émanant de son esprit : elle
imagine que cet homme dont elle a oublié le rôle pourrait être un amant extraordinaire,
qu’ils pourraient s’aimer à la folie, voyager à travers les pays, et qu’elle pourrait être une
compagne dévouée. Le dédoublement s’opère peu à peu. Flaubert emploie le
conditionnel pour bien indiquer la fiction que s’invente Emma, comme une projection de
son esprit tourmenté et sentimental.
La troisième partie offre un tournant crucial. « Mais une folie la saisit » indique
qu’Emma a substitué cette fois-ci la réalité à son rêve, à son illusion qui ne peut que la
pousser à un plus grand malheur, à une plus grande insatisfaction, la conduisant non
seulement à une double vie mais à un acte sacrificiel au final : le suicide. Emma ne rêve
plus, elle est persuadée que le comédien la regarde lors de la représentation et s’adresse
directement à elle : « il la regardait, c’est sûr ! » Dans son style réaliste, d’une grande
économie de moyen, Flaubert n’emploie plus le conditionnel mais l’imparfait pour
signifier le changement de condition. Le dédoublement a eu lieu.
La dernière phrase de l’extrait se veut aussi brève et sèche que tranchante et
démystifiante. Une vraie guillotine ! Ce retour à la réalité est un démenti aux illusions
d’Emma comme à ceux de tout lecteur potentiel qui, par le réalisme de Flaubert, fait
comprendre intimement le mécanisme de l’illusion métaphysique doublée d’une illusion
artistique qui ne fait pas saisir le phénomène mais le renforce ou le prolonge. On ne peut
mieux dire ici que Flaubert est un romancier anti-romantique.
Au moment où le rideau se baisse sur la scène, le romancier, par son dispositif narratif
particulier, « lève » le rideau, déchire la toile des idées reçues et des sentiments naïfs.
D’une façon romanesque, il opère une mise en abyme du spectacle dans le spectacle et en
révèle le danger potentiel : celui où le jeu de l’illusion scénique ne devient plus feint à
l’instar de l’illusion métaphysique dans l’esprit d’Emma. En somme, son rêve a remplacé
sa vie. La vie, elle, est concrète et réelle. Le rêve, lui, est illusoire et irréel.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%