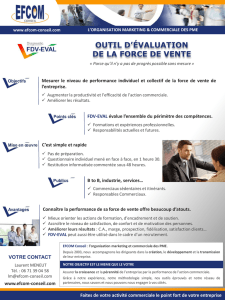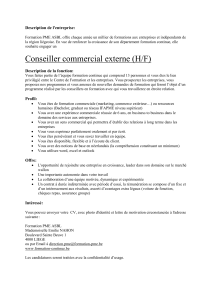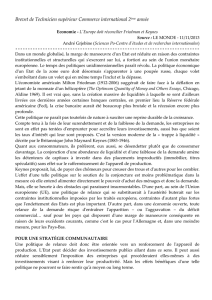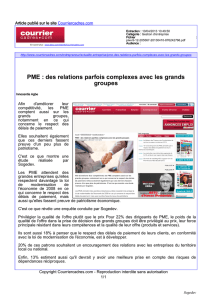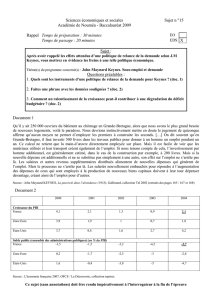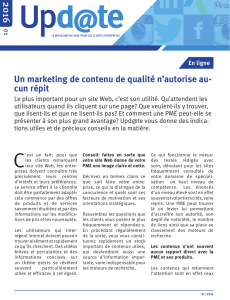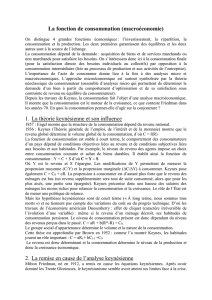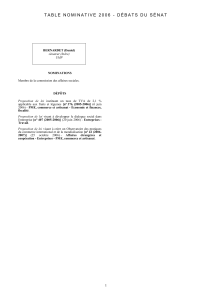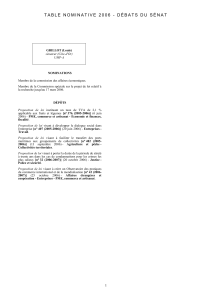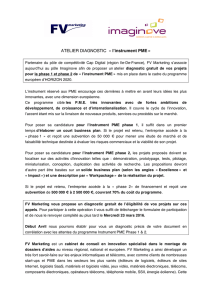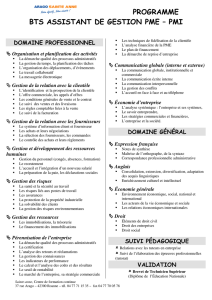specialisation americaine : une strategie de nouveau keynesienne

1
SPECIALISATION AMERICAINE :
UNE STRATEGIE DE NOUVEAU KEYNESIENNE ?
Alain Villemeur
Auteur de « La croissance américaine ou la main de l’Etat » paru aux Editions du Seuil en janvier
2007.
A l’occasion de la mort de Milton Friedman en novembre 2006, le très libéral « Financial
Times » reconnaissait que Keynes et Friedman sortaient tous les deux gagnants de la guerre
d’influence qu’ils se livraient depuis plusieurs décennies1. Simultanément, l’ancien conseiller
du Président W. George Bush, Gregory Mankiw2, estimait que les économistes de l’école
monétariste avaient disparu des sphères de l’administration fédérale et que leurs conceptions
n’avaient plus d’influence pratique.
Quel retournement de situation en faveur de John Maynard Keynes, alors que ses conceptions
économiques étaient jugées dépassées depuis le choc pétrolier de 1973 ! Car, après la célèbre
déclaration en 1971 du Président Nixon « nous sommes tous keynésiens », l’administration
fédérale renonce officiellement, dans la foulée des chocs pétroliers, aux politiques
keynésiennes. La primauté de la lutte contre l’inflation, la confiance absolue dans les
marchés, la recherche de l’Etat minimal, autrement dit le laisser-faire, paraissent signer
irrévocablement la défaite de Keynes la victoire de Friedman, en d’autres termes celle des
néolibéraux. En réalité, il convient de revisiter cette vision naïve et idéologique de l’histoire
économique des Etats-Unis.
La forte croissance américaine depuis le début des années 1990 qui s’oppose durablement à la
croissance moyenne et déclinante de la France et de l’Europe, nous invite aussi à rouvrir le
débat. Depuis 1990, la croissance moyenne annuelle aux Etats-Unis est supérieure de plus de
1 % à celle de l’Europe, ce qui se traduit par une plus forte augmentation du pouvoir d’achat
couplée à un quasi plein-emploi. Ce différentiel de performances dans la durée donne le
vertige. Ces performances exceptionnelles sont-elles à mettre au crédit du néolibéralisme ? Ou
au contraire, ne doivent-elles pas davantage à Keynes et à l’interventionnisme judicieux de
l’Etat qu’au laisser-faire ? On reconnaîtra l’importance de cette interrogation alors que
l’Union Européenne et la zone euro se sont construites en s’inspirant de la pensée de
Friedman.
Rejet du laisser-faire et politique industrielle
L’ouvrage « la croissance américaine ou la main de l’Etat » vise à y répondre en voyageant au
coeur de l’économie américaine et en mettant en évidence, au delà des discours convenus ou
teintés d’idéologie, les réalités des politiques économiques poursuivies. Dans cet article, nous
montrerons que les politiques monétaires et budgétaires sont ouvertement keynésiennes
depuis les années 1990. Nous exposerons la nouvelle politique industrielle qui donne une
place prépondérante à l’innovation ; elle est à mille lieues de l’Etat minimal et du laisser-faire
cher aux néolibéraux. Néanmoins, le nouveau moteur économique de l’innovation, que les
1 Wolf M. (22 novembre 2006), « Keynes contre Friedman : le match n’a fait que des gagnants », Financial
Times.
2 Mankiw G. (2006), The Macroeconomist as Scientist and Engineer, NBER Working Paper, n°12349, june.

2
Etats-Unis savent si bien stimuler, renouvelle la problématique de l’intervention étatique.
Enfin, nous nous interrogerons sur les fondements de ce nouveau rôle de l’Etat, fondements
que l’on trouve chez les grands économistes comme Keynes, Schumpeter et Veblen. Cette
analyse met en valeur le contraste avec les politiques économiques de l’Europe et de la
France.
Des politiques monétaire et budgétaire ouvertement keynésiennes
Pour les néolibéraux, la « révolution monétariste » de Milton Friedman imposait une banque
centrale, complètement indépendante du pouvoir politique et chargée du contrôle de
l’inflation ; la monnaie est alors une affaire jugée trop sérieuse pour être laissée aux mains
d’un gouvernement toujours tenté de financer les déficits publics et de s’accommoder de
l’inflation.
Penchons-nous sur les objectifs actuels de la Réserve Fédérale ? La loi « pour le plein emploi
et la croissance économique »3 les précisent : la Réserve Fédérale doit assurer « la croissance
à long terme des agrégats monétaires et fiduciaires compatibles avec le potentiel
d’augmentation à long terme de la production nationale, afin d’atteindre effectivement les
objectifs de plein emploi, de stabilité des prix et de modération des taux d’intérêts à long
terme ». Derrière le paravent monétariste, on voit que le plein emploi est placé au même rang
que la stabilité des prix et vient même avant dans l’énumération !
L'objectif de croissance et de plein emploi dans les statuts de la Réserve Fédérale a fait l'objet
de nombreux débats récurrents, toujours tranchés en faveur de son maintien. Joseph Stiglitz,
prix Nobel et conseiller du Président Bill Clinton raconte que ce dernier s'était fermement
opposé à une tentative de suppression de l'objectif4. Ainsi, il existe un consensus conscient et
argumenté pour maintenir l'objectif de croissance et de plein emploi. Mais, plus important, cet
objectif a été poursuivi avec ténacité et succès à plusieurs reprises, notamment à des moments
clés de la politique monétaire en 1995 et en 2000, comme illustre l’encadré ci-contre.
Depuis les années 1990, une politique monétaire favorable à la croissance
Après la récession de 1991, l'économie est repartie grâce à la politique de forte baisse des taux
d'intérêt menée par Alan Greenspan. En 1995, la politique monétaire fait l'objet d'un grand débat
et de profondes controverses : faut-il augmenter les taux d’intérêt, pour éviter tout risque
inflationniste, comme le préconise les monétaristes, ou faut-il les maintenir faibles pour
dynamiser l’économie ?
La Réserve Fédérale décide de maintenir cette politique accommodante afin d'asseoir encore
plus solidement la croissance, estimant que le risque de forte inflation est très faible, compte tenu
de la mondialisation en cours et de la révolution technologique qui poussent à la baisse les prix
industriels.
La suite lui donnera amplement raison et on reconnaîtra le coup de génie d'Alan Greenspan. Les
années suivantes sont celles de la « nouvelle économie », avec une croissance annuelle de plus de
4 % et l’élévation rapide du niveau de vie. Sous sa conduite, les États-Unis auront connu de 1992
à 2001 le plus long cycle de croissance de toute leur histoire ! Il y gagne le surnom de « Maestro
» et acquiert une aura sans précédent dans le monde économique.
Le deuxième grand rendez-vous avec l'histoire fut l'effondrement boursier. Dès 2000, Alan
Greenspan fait chuter brutalement les taux d'intérêt, sans l'ombre d'une hésitation. Car il se
souvient des terribles ravages du précédent de 1929 et de la mollesse des réactions d'alors qui
transformèrent un choc boursier en crise économique majeure. Oserait-on affirmer que cette
décision n'est pas motivée par l'urgence de relancer l'économie et par l'effet puissant de
redynamisation des entreprises et de la demande des ménages lié à des taux d'intérêt faibles !
3 Humphrey-Hawkins Full Employment Act de 1978.
4 Stiglitz J. (2004), « Une banque centrale indépendante ou démocratique ? », Le Monde, 27 février.

3
Aux moments clés de ses mandats, Alan Greenspan aura montré qu’il n’était nullement le faire-
valoir d’une théorie monétariste, fusse-t-elle bien ancrée dans les esprits, mais bien le farouche
promoteur de la croissance et du plein emploi.
En définitive, Alan Greenspan réhabilite les préoccupations de relance chère à Keynes pour
contrer un choc boursier majeur. Face au même choc boursier, la BCE, fidèle à sa priorité de
lutte contre l'inflation, décale la chute des taux d'intérêt, quasiment de deux ans. Il faudra
attendre 2003 pour que des taux réellement bas soient atteints alors que l'Allemagne est en
quasi-récession et que la France flirte avec la croissance nulle : quasiment deux ans de perdus
dans l'emploi de l'arme monétaire5. Le comportement de la BCE permet ainsi de mieux
apprécier le caractère peu orthodoxe de celui de la Réserve Fédérale.
L’indépendance de la Réserve Fédérale vis-à-vis du gouvernement américain est sérieusement
tempérée par le pouvoir du Congrès de modifier ses statuts ou par celui du Président qui peut
renouveler ou non le mandat du Président de la Réserve Fédérale. Par contre, côté européen,
la BCE est la seule banque centrale de la planète qui n’ait pas à rendre compte de son action
« devant une instance qui dispose du pouvoir d’en modifier les statuts, même si ce pouvoir est
soigneusement encadré », comme l’a montré Jean-Paul Fitoussi6.
Dans la boîte à outils du parfait néolibéral, il n'est évidemment pas prévu d'utiliser
massivement le budget fédéral, en le poussant vers un large déficit, pour relancer une
économie au bord de la récession, comme le préconisa Keynes pour la première fois. Les
néolibéraux expliquent alors, de manière très savante, que les ménages anticipent
rationnellement une future augmentation des impôts, ce qui conduira à annihiler l'effet
attendu.
C’est ce qui s’est pourtant produit à grande échelle pour relancer l’économie après
l’effondrement boursier. Le Président George W. Bush décide une relance budgétaire
massive, en mettant aussi à profit les énormes excédents de l'ère de son prédécesseur et de la «
nouvelle économie ». Il s'agit d'aider les entreprises et les secteurs sinistrés ; cette relance sera
faite dans la durée, compte tenu des attentats terroristes du 21 septembre 2001 et de la guerre
d'Irak. En 2003, le déficit budgétaire atteint même le record de 5 % du PIB, confirmant par la
même le pragmatisme économique américain
Pendant ce temps, l'Europe en crise entend limiter les déficits à 3 % du PIB pour respecter le
fameux Pacte de Stabilité et de Croissance. Les dirigeants européens ont décidé qu'aucune
circonstance ne pourrait justifier un déficit supérieur !
Refaisons un peu d’histoire. C’est sous la présidence du « très » libéral Président Ronald
Reagan que le déficit fédéral devient quasi permanent, en partie pour financer sa fameuse
« guerre des étoiles ». Ronald Reagan aura pratiqué à grande échelle le déficit américain pour
relancer l’économie au début des années 1980...et en définitive ne plus s'arrêter, jusqu'à ce
que le Président Bill Clinton décide de profiter de la nouvelle économie pour engranger des
excédents. Ainsi, de Reagan à Bush, le consensus le plus total existe pour employer à grande
échelle l'arme budgétaire, conformément à la pure tradition keynésienne.
L’intervention en faveur de l’industrie et de l’innovation
La politique en faveur de l’industrie et de l’innovation revêt d’autant plus d’intérêt qu’un net
décrochage de l’Europe par rapport aux Etats-Unis a été mis en évidence en terme de
5 Les taux d'intérêt réels à court terme sont négatifs aux États-Unis de juillet 2002 jusqu'en 2004 alors qu'ils sont toujours
positifs en Europe. Fitoussi J-P., Le Cacheux J. (2003), Rapport sur l'état de l'Union européenne, Fayard, Presses de
Sciences Po.
6 Fitoussi J.-P. (2002), la Règle et le Choix. De la souveraineté économique en Europe, coédition Seuil/La République des
Idées.

4
spécialisation industrielle, de recherche-développement, de brevets et de renouvellement du
tissu industriel7.
Un lieu commun sur les Etats-Unis veut qu’ils n’aient pas mis en place de politique
industrielle ; ils auraient renoncé, à intervenir sur les marchés, notamment dans le secteur
industriel et feraient totalement confiance à une concurrence quasiment pure et parfaite.
On est là dans l’aveuglement le plus total… Prenons les exemples les plus récents. Face à la
grippe aviaire, le Président George Bush a immédiatement demandé au Congrès plus de 7
milliards de dollars pour subventionner les industries de vaccins aux États-Unis. Celles-ci
sont, on le sait, moins puissantes que l'industrie européenne. Les États-Unis décident de faire
face à une menace et d'en profiter pour bâtir une puissante industrie des vaccins à coups de
massives subventions. Et avec l'espoir que demain ces industries s'emparent d'un marché
mondial !
Les clusters -désormais appelés pôles de compétitivité en France- sont aussi un autre exemple
de politique industrielle de grande envergure. Depuis plusieurs décennies, les pouvoirs
publics ont favorisé ces clusters, c'est-à-dire des zones géographiques concentrant l’industrie,
les centres de recherche et les universités autour d’une même famille de technologies. La
Silicon Valley -à l’origine de l’invention du transistor, du microprocesseur, du
microordinateur, et plus récemment de l’iPod- en est le symbole.
Quelle est la nouvelle manne de la Silicon Valley ? Les fonds gouvernementaux pour financer
de nouvelles technologies antiterroristes8. Les deux laboratoires fédéraux de la région, le
Sandia Lab et le Lawrence Livermore National Lab ont vu leurs budgets exploser. Le budget
R&D du ministère Homeland Security est passé à 2 milliards de dollars en 2006 et doit être
multiplié par 5 dans les prochaines années ! Et les processus de l’innovation, qui ont fait leurs
preuves, sont à l’œuvre : les laboratoires travaillent en étroite association avec les entreprises
technologiques privées et des jeunes pousses ont déjà été créées. Car nombre de ces
technologies seront utilisées dans un environnement quotidien (lieux publics, routes,
magasins…) et le marché mondial s’annonce évidemment des plus prometteurs.
Là aussi, à coups de milliards de dollars les pouvoirs publics financent sans réticence leurs
pôles de compétitivité et sont en train de faire émerger une nouvelle industrie de
l’antiterrorisme qui est à l’heure actuelle sans concurrence en Europe.
L'État intervient tous azimuts à partir du moment où la croissance, l'emploi et la suprématie
technologique américaine sont en jeu. Ici, pour inciter les universités et les entreprises à
collaborer, là pour orienter les recherches sur les sujets d'avenir ou pour soutenir fortement le
déploiement des nouvelles technologies ou pour refuser une OPA jugée contraire aux intérêts
américains9, mais aussi pour inciter les étudiants étrangers à venir faire des thèses, pour
autoriser les brevets logiciels ou ceux sur les organismes vivants, pour protéger la propriété
intellectuelle des entreprises et des universités... Reconnaissons que la croyance dans le
progrès technologique est toujours aussi vive aux Etats-Unis, ce qui facilite ce rôle de l’Etat10.
Le meilleur exemple, chargé de signification, est la loi dénommée « Bayh-Dole Act » adoptée
en 1980 afin de donner aux universités la propriété industrielle de leurs découvertes et le droit
d’organiser les transferts de technologies. Cette loi accorde la préférence aux PME pour les
7 Cohen E., Lorenzi J.-H. (2000), Politiques industrielles pour l’Europe, Conseil d’Analyse Economique, La documentation
Française.
8 Les Echos (2006), « L’antiterrorisme, manne de la Silicon Valley », 20 avril.
9 Citons le refus de la prise de contrôle de la société Unocal (septième compagnie pétrolière américaine) par la compagnie
pétrolière chinoise Cnooc.
10 Lorenzi J.-H., Villemeur A. (2004), « La religion du progrès au coeur de la croissance » in Chevalier J.-M., Mistral J., La
raison du plus fort, les paradoxes de l’économie américaine, Robert Laffont.

5
transferts de technologie et exige que les produits qui en sont issus soient majoritairement
fabriqués aux États-Unis. Par la loi, l’État incite ainsi à la discrimination positive envers les
PME et au patriotisme économique !
Depuis 1980, ce sont 158 universités qui conduisent des actions de transfert de technologies,
soutenant la création de nombreuses jeunes pousses11 (par exemple 400 en 2005) et
contribuant ainsi à la croissance américaine. Dans le cadre de la révolution technologique,
l'État fédéral s'est montré à la pointe pour inciter, voire imposer, la diffusion des Technologies
de l’Information et de la Communication. C'est ainsi que le programme «National Information
Infrastructure »12 (NII) a été mis en place par l'administration Clinton dès 1993 en affichant
clairement l'objectif stratégique de la société de l'information (voir l’encadré).
Les nouvelles technologies : le soutien aux Etats-Unis, l’indifférence en Europe
Le programme « National Information Infrastructure » va fortement inciter, d'une part les
universités et l'enseignement secondaire à acheter des micro-ordinateurs et à se connecter à
Internet, et d'autre part les administrations à s'informatiser et à développer l’e-administration.
Ce faisant, il dope la demande en micro au grand bénéfice des fournisseurs américains de
matériels, en même temps qu'il fera découvrir le réseau Internet à des millions d'Américains,
petits et grands.
Ce programme a ainsi préparé l'avènement de « la nouvelle économie » qui verra un
investissement sans précédent dans les nouvelles technologies, en même temps que la forte
croissance économique paraissait sans fin. A l'évidence, le programme NII a jeté les bases d'une
utilisation massive de ces technologies, à tel point que les Américains battront tous les records, à
la fois comme investisseurs et utilisateurs. Faut-il alors s’étonner de constater un million
d’ordinateurs connectés en 1992, environ 9 millions en 1995 et une future explosion
exponentielle du nombre d'utilisateurs ?
Le parallèle avec l'Europe est saisissant. Car à la même date, en 1993, Jacques Delors, alors
Président de la Commission Européenne, préconise une forte relance économique pour créer des
millions d'emplois et accélérer la diffusion des innovations technologiques. Tout
particulièrement, il recommande de créer des infrastructures dans le secteur de l'information et
de créer des réseaux transeuropéens dans les transports et l'énergie. Peine perdue, le livre blanc
élaboré à cette occasion se heurte à un rejet en bloc. Là encore, les libéraux et les dogmatiques
sont du côté européen. Le livre blanc13 restera lettre morte malgré « la bataille d’Hernani »
livrée par Jacques Delors14 ; on ne peut que regretter vivement cette occasion ratée, au vu du
manque de dynamisme européen.
Pendant ce temps, l’Europe reste indifférente aux enjeux des technologies de l’information et
de la communication. Faut-il s’étonner alors que l’investissement dans ces technologies, soit,
par habitant, deux fois plus grand aux Etats-Unis que dans la zone euro ?
Il n'y a pas que l'État fédéral pour impulser des investissements dans les nouvelles
technologies. Les grandes villes américaines se passionnent actuellement pour l'Internet sans
fil wi-fi et sont en tête dans l’utilisation de cet outil. Au début 2006, une centaine de villes ont
déjà déployé des réseaux wi-fi réservés aux besoins municipaux ou à des besoins de sécurité.
Des grandes villes comme Philadelphie et San Francisco sont en train de déployer des réseaux
à plus grande échelle ; désormais, tout utilisateur pourra alors se connecter gratuitement via
son ordinateur (fixe ou portable) ou tout appareil mobile équipé d'un wi-fi, demain au travers
de son téléphone mobile, pour accéder à tous les services du Net, aux informations locales et
aux services de pompiers et de police.
11 Depuis 1980, on les estime au nombre de 5171.
12 Catinat M. (1998), « La politique communautaire de stimulation de la société de l’information », in Pascal. Petit,
L'économie de l’information, les enseignements des théories économiques, Paris, La Découverte, p. 37-52.
13 Delors J. (1993), Pour entrer dans le XXIe siècle, Michel Lafon, Ramsay, p. IV.
14 Delors J. (2004), Mémoires, Plon : p. 424-427.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%