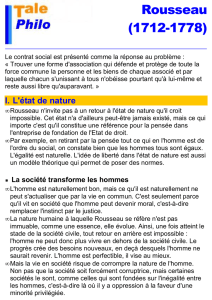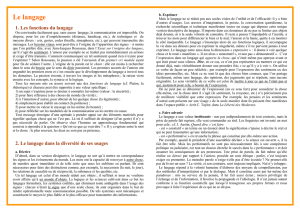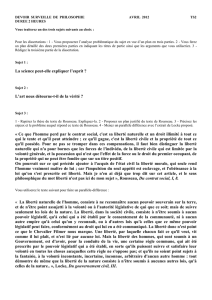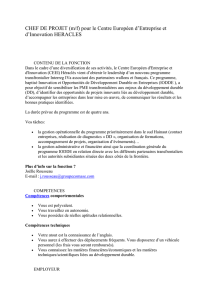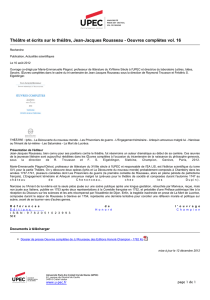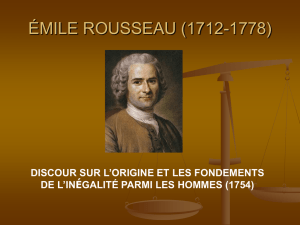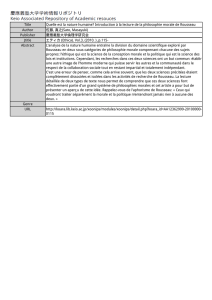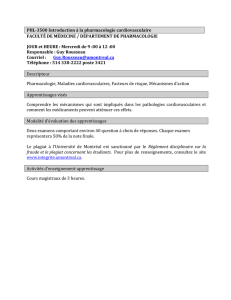Mémoire de synthèse HDR.

0
Bruno Bernardi
Dossier d’habilitation à la direction de recherche.
Note de synthèse.
Autour de Jean-Jacques Rousseau :
sur la formation des concepts politiques.
Septembre 2005

1
SOMMAIRE
Introduction : un parcours de recherche en philosophie politique. p. 3
I. En lisant, en éditant. p. 16
A. La Profession de foi du Vicaire savoyard : commencement par la fin. p. 19
B. Le Discours sur l’économie politique : constitution de la méthode. p. 24
C. Le Contrat social , les Lettres écrites de la Montagne : analytique des principes. p. 27
D. Les Principes du droit de la guerre : l’invention d’une œuvre. p. 32
II. La fabrique des concepts : problèmes méthodiques et travail d'interprétation. p. 36
.
A. Méthode, objet, interprétation : une coïncidence réfléchie. p. 37
B. Les paradigmes chimiques du politique. p. 46
C. D’une conceptualité propre au politique.. p. 52
D. Une nouvelle lecture de la volonté générale p. 60
III. Dimensions collectives de la recherche. p. 65
A. Autour de la chimie : partage du savoir et interdisciplinarité. p. 66
B. Un lieu de recherche commune : le Groupe J.-J. Rousseau. p. 69
C. Réflexions sur une expérience.. p. 72
IV. Recherches présentes et à venir. p. 76
A. Le principe d'obligation. p. 79
B. Pour une histoire du concept de société civile. p. 91
C. Encore Rousseau. p. 96
Bibliographie. p. 98

2
Nota bene : Il n’a pas paru souhaitable d’encombrer l’exposé d’un lourd
appareil référentiel : une liste des publications évoquées dans ces pages est donnée
en annexe de cette note de synthèse. Pour ce qui est des auteurs ou commentateurs
mentionnés, on se reportera aux bibliographies des différents ouvrages et articles.

3
Introduction :
Un parcours de recherche en philosophie politique.
La première tâche de ceux qui veulent se sortir d’une difficulté, c’est de bien
l’explorer. En effet l’issue d’une difficulté, c’est le dénouement des difficultés
d’abord éprouvées. On ne peut pas dénouer une entrave que l’on ignore ; mais la
difficulté qu’éprouve la pensée désigne le noeud dans la chose elle-même : de fait,
lorsque la pensée éprouve une difficulté, elle se trouve dans le même état que des
hommes entravés, il leur est également impossible d’aller de l’avant. Voilà pourquoi
il faut d’abord avoir envisagé tous les sujets d’embarras ; pour ces raisons, mais
aussi parce que ceux qui entreprennent une recherche sans avoir exploré d’abord la
difficulté en question sont pareils à ceux qui partent sans savoir dans quelle
direction il faut marcher; et il leur devient, en plus, impossible de jamais savoir s’ils
ont trouvé, ou non, ce qu’ils cherchaient. Pour celui-ci en effet le but a atteindre
n’est pas clair, qui l’est par contre pour celui qui a d’abord envisagé la difficulté.
Enfin, nécessairement, est mieux en état de juger celui qui a entendu, comme des
parties adverses, tous les plaidoyers contradictoires.
Aristote, Métaphysique B.
Se retourner, pour s’en expliquer et se l’expliquer, sur le chemin qu’on a suivi pousse
immanquablement à transformer les contingences en nécessité et à présenter la succession des
étapes parcourues sous le regard d’une intention qu’on se prête rétrospectivement. Avoir
conscience de ce biais ne permet sans doute pas de l’éviter mais peut donner un autre sens à
l’entreprise : non restituer une vérité toujours déjà présente mais comprendre comment le
retour réflexif sur ce à quoi on a été conduit, souvent malgré soi, peut constituer un projet.
C’est dans cet esprit, en tout cas, qu’est conçu le travail de synthèse présenté ici : en rendant
compte de ce qui fut le primum movens de mon engagement dans la recherche, puis en
présentant mes travaux et l’unité qu’ils constituent (unité à la fois recherchée et reconnue
après-coup), je voudrais surtout faire le point, établir les coordonnées de la position où j’ai été
conduit et, à partir de là, esquisser les directions dans lesquelles il faudrait poursuivre.

4
– I –
Constitution de la problématique
Le politique a précocement été, pour moi, un objet philosophique essentiel et l’est
toujours resté. Ce n’est pourtant que tardivement que j’en ai fait véritablement l’objet de
recherches. Expliquer cette contradiction permettra de présenter à la fois ce qui a initialement
motivé mes travaux et ma façon assez inhabituelle de les conduire.
Jeune étudiant pourtant, j’avais entrepris une thèse de doctorat (doctorat d’État, le seul
encore à cette époque), sous la direction de Jacques D’Hondt, dont l’objet devait être « la
théorie de l’idéologie chez Marx ». Cette thèse devait rester à l’état d’ébauche et être
justement livrée à la « critique rongeuse des souris ». Les raisons en sont assez facilement
assignables : le choix d’un tel sujet, au milieu des années soixante-dix, dans un contexte où le
marxisme se posait encore en horizon indépassable, montrait avant tout que j’ignorais cette
forme particulière de principe d’incertitude dans lequel je vois aujourd’hui la condition même
de la recherche en philosophie. Dans bien des disciplines, c’est plutôt d’un principe
d’ignorance qu’il faudrait parler. Mais, si le terme de recherche doit avoir un sens précis en
philosophie, c’est, me semble-t-il, en ce qu’il implique que la constitution du problème même
que l’on aborde ait perdu son évidence ou qu’on la lui fasse perdre. Il faut pour cela que se
rencontrent les questions que l’on pose aux élaborations que l’on trouve devant soi et celles
que l’on se pose sur son propre horizon de pensée. Il n’est pas certain à cet égard que la
précocité de plus en plus grande du travail de thèse n’ait que des avantages. La recherche
suppose, en tout cas, une espèce d’inquiétude.
Voir ébranlé ce que l’on croyait acquis ne conduit pourtant pas spontanément à une telle
attitude. La dislocation de l’univers de certitudes qui avait pris le nom de marxisme l’a montré
à l’envi : c’est le plus souvent une certitude qui en chasse une autre et les détenteurs de vérité
ne font habituellement que changer de livrée. Je n’ai jamais été tenté par de telles
(re)conversions. Aussi bien, l’enseignement de la philosophie, que je n’ai jamais considéré
comme une tâche subalterne, absorba longtemps mon énergie, d’autant plus qu’il me
permettait de procéder, pour mon propre compte et dans cet espace semi-privé semi-public
qu’est le cours, à une lente mais méthodique révision de ma « conscience philosophique
d’autrefois ». Ce fut plus à mes yeux un temps de maturation qu’un temps perdu.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
1
/
102
100%