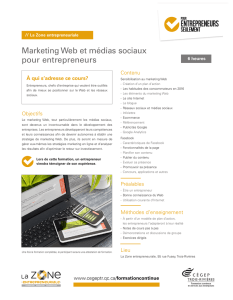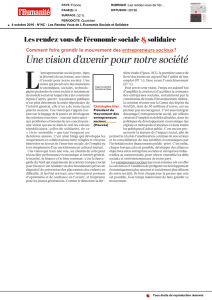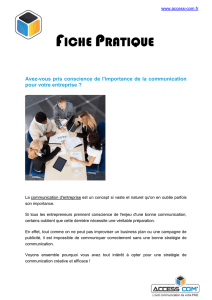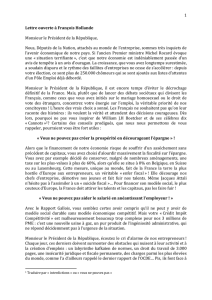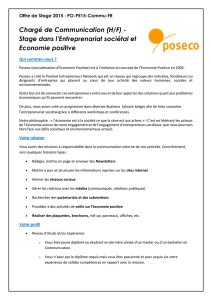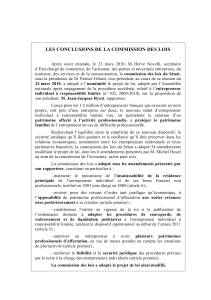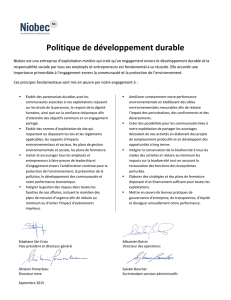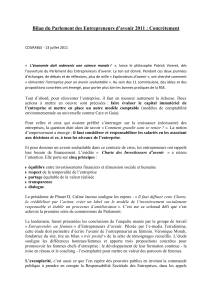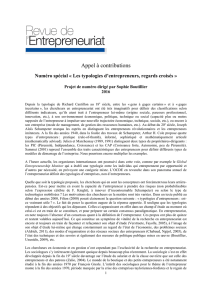« L`ECONOMIE VUE PAR UN ENTREPRENEUR »

1
Communication du 30 juin 2014 de M. Yvon GATTAZ
« L’ECONOMIE VUE PAR UN ENTREPRENEUR »
Le titre de cette communication que m’a proposé notre Président, et que j’ai, bien
entendu, accepté m’a, à la réflexion, plongé dans un abîme de perplexité. En effet,
il sous-entend que l’entrepreneur, ce micro-économiste de terrain a une vision de
l’Economie (avec une majuscule bien sûr) différente de celle des théoriciens
macro-économistes qui volent à une autre altitude et ont de ce fait une vue
panoramique et stratégique fort différente.
Ce serait en quelque sorte la dualité entre théorie et pratique parfois réputée
insoluble, alors qu’elle peut souvent se conclure par une véritable compatibilité.
Notre éminent et regretté confrère, Maurice Allais, aimait raconter ici-même la
plaisanterie d’Einstein qu’il a même consignée dans l’un de ses ouvrages :
- La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne marche,
- La pratique, c’est quand on ne sait rien et que ça marche quand même,
- Moi-même, Albert Einstein, j’ai réuni théorie et pratique car dans mon laboratoire,
rien ne marche et on ne sait pas pourquoi.
Je vais tenter, avec appréhension et modestie, de déceler la zone de compatibilité
entre théories macro-économiques (que je me permettrai de mettre ici au pluriel car
elles ont été nombreuses) et la pratique de terrain ou micro-économie. Et même je
vais inverser le fonctionnement de la longue vue en visant par l’oculaire et en
regardant par l’objectif.
Rappelons tout d’abord l’évidence connue de tous : la macro-économie n’est pas la
somme intégrale des micro-économies, mais elle ne peut s’en passer car les
entreprises sont ses constituants, ses molécules de base. Et la micro a précédé la
macro depuis que les premiers hommes ont vendu ou échangé leurs gibiers et leurs
récoltes.
L’économie est-elle vraiment une science ? Cette question agaçait mon ami Jean
Fourastié (également membre de notre Compagnie) qui me répondait sévèrement :
« Mais bien sûr, mais elle n’est pas une science exacte » et il n’aimait pas, on s’en
doute, qu’on l’appelât « science inexacte » compte tenu des différentes théories qui
ont pu être parfois contradictoires. Mais les sciences humaines, si larges, en sont là.
Contrairement aux historiens qui ne se trompent jamais, cher Jean Tulard, les
entrepreneurs se trompent toujours. Et les meilleurs sont ceux qui se trompent le
moins.

2
Les entrepreneurs connaissent peu l’économie, c’est vrai, mais ils la font !
Contrairement aux politiques qui croient la connaître et la freinent souvent.
Les entrepreneurs sont des chefs d’une entreprise plutôt de taille humaine, parfois
créateurs de l’entreprise elle-même.
J’aborderai dans cette communication les 5 points suivants :
1 - Définitions et terminologie
2 - Les entrepreneurs tentent de comprendre les économistes
3 - L’entrepreneur créateur de richesses et d’emplois
4 - L’économie actuelle : la France nouveau pays « immergent »
5 - L’espoir d’un renflouement.
CHAPITRE I
DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
L’économiste tel qu’on le connaît est un « macro-économiste » qui observe les
étoiles avec sa lunette astronomique, nous l’avons vu. Et le plus petit des
entrepreneurs prétend mieux connaître, non pas l’économie elle-même, mais les
économies quotidiennes qu’il a érigées en dogme.
Les économistes sont des intellectuels de talent et certains d’entre eux peuvent
obtenir le Prix Nobel, consécration suprême, alors que le Prix Nobel de
l’entrepreneuriat se fait attendre. Notons au passage que le substantif enfin retenu
par les acteurs et les observateurs extérieurs est finalement « entrepreneuriat » en
concurrence historique avec « entreprenariat ».
Mais l’entrepreneur, à tout prendre, qu’est-ce ?
Le mot est aussi ambigu que la fonction. En toute simplicité, l’entrepreneur est
celui qui entreprend et, de ce fait, ses fonctions peuvent être innombrables.
La compréhension de l’entrepreneur doit beaucoup à Schumpeter qui le représente
comme celui qui est capable de transformer une idée en une innovation réussie.
Dans les faits, on a longtemps désigné comme entrepreneur le chef d’une
entreprise du Bâtiment ou des Travaux Publics. Et puis, cette notion s’est élargie
jusqu’à désigner tous les chefs d’entreprise de taille humaine.
Si l’on retient la classification des qualités des élites en deux catégories bien
distinctes, les qualités de réception et les qualités d’émission (pour utiliser le

3
langage des électroniciens) on peut attribuer aux meilleurs économistes les quatre
qualités de réception :
- la compréhension rapide (qui constituait l’intelligence au XIXème siècle),
- la faculté d’analyse,
- la capacité de synthèse,
- et la mémoire, cette qualité longtemps réputée marginale alors qu’elle a été
essentielle jusqu’à l’arrivée du cloud computing qui change la donne en exigeant
de nouvelles qualités de rapidité de sélection et d’accès. Mémoire, féminin au
singulier et généralement masculin au pluriel, est une qualité longtemps
considérée comme secondaire et, en réalité, essentielle, et on la juge comme
telle lorsqu’elle s’affaiblit tout doucement. Comment écrire ses mémoires en la
perdant ?
En revanche les entrepreneurs possèdent des qualités d’émission dont les
principales sont :
- l’imagination créatrice (indispensable et rare),
- le goût du risque, cette immense spécificité,
- la ténacité, de plus en plus appréciée,
- la combativité,
- l’enthousiasme,
- le charisme,
- le courage,
- le flair des anticipations,
- le goût du travail en équipe,
- la résistance à l’épreuve,
- le bon sens, lui-même longtemps sous-estimé alors qu’il est capital. Ce bon sens
étant aux qualités d’émission malgré sa modestie, aussi important que la
mémoire pour les qualités de réception.
En un mot, les économistes privilégient la réflexion, et les entrepreneurs
privilégient l’intuition et l’action. D’ailleurs, de façon présomptueuse,
l’entrepreneur prétend parfois ne pas réfléchir, mais comme Dieu, intuiter. Peut-
être, mais lui entrepreneur, en se trompant souvent.
Après la méthode, le langage.
Le langage des économistes et celui des entrepreneurs sont sensiblement différents.
Pour les premiers, ce sont les flux, les marchés, les échanges, les balances, les
équilibres, les monnaies, les courbes, le libéralisme, le capitalisme.
Pour les seconds, simplificateurs extrêmes, ce sont deux mots magiques de base :
le client et la commande, et le reste en découlera.

4
• Le client est le partenaire privilégié de l’entreprise, celui qui la fait vivre et peut-
être la fera mourir. François Michelin distribuait volontiers un petit cochonnet en
bois soutenant l’entreprise avec ses trois pieds classés définitivement dans cet
ordre d’importance : Cochonnet Michelin
1. Le pied client
2. Le pied personnel
3. Le pied actionnaires (toujours après les deux autres).
On pourrait y ajouter le pied environnements au pluriel.
• Le mot commande, lui, est à la fois mystérieux et magique. Il est en amont de tout
et il est à lui tout seul le Big Bang.
En effet, il « commande » (et voilà !) la mise en route, la production, la livraison,
la facturation, l’encaissement … et la trésorerie.
• Mais ces deux pivots de l’entreprise, vus par l’entrepreneur : le client et la
commande sont soutenus par une fonction peu citée par les économistes et
troisième secret du succès de l’entreprise : la vente.
Si la commande est la réalisation de base de toute entreprise, même naissante, il
faut que l’entrepreneur accepte de se consacrer lui-même à l’acte qui la
déclenchera : la vente.
Or le mot vente a été peu à peu dévalorisé, surtout chez les étudiants du supérieur.
On ne sait pourquoi le titre de « vendeur » fait plus penser à chaussettes qu’à
ensembles électroniques complexes.
Lorsqu’un employeur propose à un jeune cadre frais émoulu d’une école, toujours
supérieure bien sûr, mais qui ne porte plus le titre de « commerciale »
honorablement remplacé par le superbe mot ésotérique de « management » qu’on
oublie de prononcer à la française, il s’instaure un dialogue ambigu.
Pendant des décennies, les directions générales d’IBM et de l’OREAL exigeaient
que leurs grands manageurs aient rempli auparavant des fonctions de vente.
Le plus éclatant triomphe de la vente, c’est celui de l’eau, ce produit le plus banal
sur la terre, mais vendu en bouteilles et transporté malgré son poids jusqu’à la table
des consommateurs du XXIème siècle. Un miracle de la vente !
Dans nos définitions prioritaires, nous pourrions ajouter le « produit »
généralement manufacturé, qui se distingue du service, dont le développement
récent peut occulter l’importance résiduelle de la production industrielle. Certains
ont cru que les services prendraient tout l’espace de l’économie et que l’industrie,

5
devenue mineure, disparaîtrait ou serait réservée à des pays émergents à bas coût
de main d’œuvre. C’étaient, il y a quelques années, les tenants de l’état post-
industriel, pourfendeurs de l’industrie dont l’importance reste pourtant majeure,
car c’est elle qui engendre finalement les progrès. Si on supprime artificiellement
le produit qui constitue le noyau, en ne conservant que cette « mousse » qui
l’entoure, celle-ci pourrait être balayée par les premiers vents boursiers. Attention
à la mousse sans noyau !
Si l’économiste est un stratège, l’entrepreneur doit être à la fois stratège et tacticien,
comme le rappelait avec humour Conrad Hilton : « l’essentiel pour créer une
chaîne d’hôtels est de savoir que le rideau de douche doit toujours être à
l’intérieur de la baignoire », puisque le diable se cache, paraît-il, dans les détails.
Autre obligation de l’entrepreneur de terrain : lorsqu’il a une idée novatrice qu’il
croit géniale, il doit la soumettre à l’épreuve des faits (production et surtout vente)
et avoir la modestie de faire demi-tour lorsqu’il se heurte au mur granitique des
réalités, plutôt que de s’obstiner de façon présomptueuse. C’était, rappelez-vous, le
langage constant de notre confrère Maurice Allais à propos de ses découvertes en
physique sur le pendule paraconique et sur l’anisotropie de l’espace devant
« l’irréductibilité des faits qui s’imposent à toutes les théories ».
Enfin, une caractéristique majeure de l’entrepreneur, c’est son optimisme inquiet :
- optimisme indispensable à cette aventure à laquelle il faut croire,
- inquiétude, car le véritable optimisme efficace n’a pas le droit d’être béat en
espérant que la bonne solution tombera du ciel alors qu’il faut s’acharner pour la
faire réussir.
CHAPITRE II
LES ENTREPRENEURS TENTENT DE COMPRENDRE LES ECONOMISTES
Permettra-t-on à un entrepreneur une petite incursion dans le domaine réservé à
l’Economie ?
Nos amis économistes ici présents me pardonneront, je pense, de ne pas citer tous
les grands économistes connus. Mais j’ai retenu ceux qui ont le plus impressionné
les entrepreneurs, par ordre purement chronologique car vous connaissez mon
attachement physique à la chronologie simple qui m’empêche de lire les romans
destructurés et même les curriculum vitae inversés à la méthode dite américaine,
m’obligeant à lire la tête en bas, ce qui est peu compatible avec la raideur de la
nuque des personnes de mon âge. En fait, le géotropisme de mon sablier est
définitif.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%