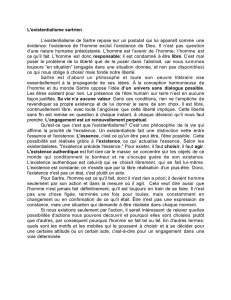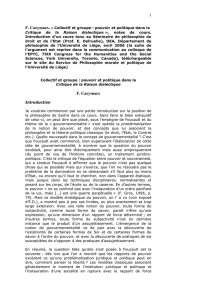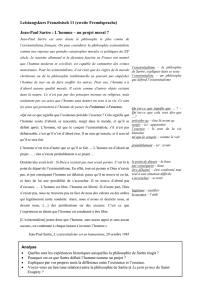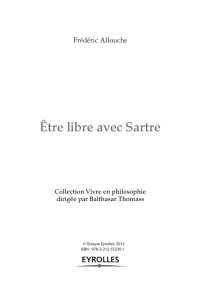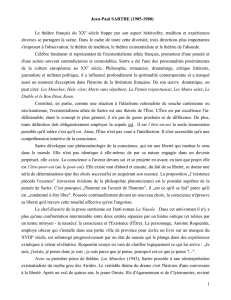GCormann CR Giovannangeli Le retard de la conscience

Version légèrement revue du compte rendu paru dans Revue Internationale de Philosophie, n° 219 , 2002/1, p. 144-149.
1
Daniel GIOVANNANGELI, Le retard de la conscience, Husserl, Sartre, Derrida, Bruxelles,
Ousia, 2001.
Avec son dernier ouvrage, Le retard de la conscience, Daniel Giovannangeli poursuit
des recherches entamées il y a plus de vingt ans. Dès Ecriture et répétition, en effet, il
interrogeait, à la suite de Mikel Dufrenne, les relations de l’en-soi et du pour-soi sartriens et
accordait du crédit à l’idée d’une « antériorité de l’être » sur la conscience (D. Giovannangeli,
Ecriture et répétition, Approche de Derrida, U.G.E, 1979, p.98). La reprise actuelle de ce
thème prend la trace de la lecture derridienne des Leçons pour une phénoménologie de la
conscience intime du temps. Jacques Derrida y affronte une aporie husserlienne qui se résume
en une question: « Y a-t-il une impression originaire ? » Ou bien le présent est-il toujours déjà
pris dans le jeu des rétentions-protentions ? On sait que Derrida, passant outre le refus
husserlien de l’inconscient, invoque une temporalité non vulgaire, et non phénoménologique,
semblable à celle qui est à l’œuvre dans les textes de Freud.
L’interrogation de l’A., à la limite de la phénoménologie, remonte, dans un premier
mouvement, à la philosophie de Kant pour lequel l’intuition sensible (intuitus derivatus) est
par définition en retard sur son objet. D. Giovannangeli invoque ici la lecture heideggérienne
de la Critique de la raison pure. Dans Kant et le problème de la métaphysique, Heidegger
insiste, en effet, sur l’intuition sensible et temporalise de part en part l’ego transcendantal
kantien. Derrida s’était déjà souvenu de cette lecture lorsqu’il s’était agi pour lui de dégager,
contre une lecture distraite, une temporalité freudienne « fondée » sur l’après-coup de la
Nachträglichkeit. On sait que les Leçons sur le temps de Husserl accomplissent également une
conscience essentiellement temporelle. Dans sa relecture des Leçons, l’A. se porte d’emblée
au cœur du problème légué – il nous le fait voir – par Husserl à ses héritiers : alors que le §31
des Leçons annonce que « l’impression originaire est le non-modifié absolu », le paragraphe
suivant affirme, à l’inverse, l’impossibilité phénoménologique d’« un maintenant que rien
n’aurait précédé ».
D. Giovannangeli s’autorise de cet écart la question d’un retard originaire de la
conscience (p. 36). A l’écart du refus husserlien, il considère, avec attention, l’apport possible
d’une phénoménologie ouverte à la psychanalyse, et davantage encore l’apport d’une
psychanalyse ouverte à la phénoménologie. Il suit en cela la leçon de Michel Henry qui, à la
question de Freud : « Y a-t-il un affect inconscient ? », répond que l’inconscient n’est pas
inconscient et n’est rien d’autre que la subjectivité comme affectivité, la subjectivité comme
auto-affection (p. 40). Interrogeant l’autre versant de la phénoménologie, qui insiste sur
l’intentionnalité de la conscience, l’A. envisage de même les perspectives offertes par le jeune
Derrida et par Sartre. Il invoque notamment Le problème de la genèse dans la philosophie de
Husserl, où Derrida marque l’enchevêtrement de passivité et d’activité qui caractérise la
rétention. Dans ce texte de jeunesse, Derrida affirme déjà les limites de la réduction
phénoménologique, incapable de neutraliser complètement l’objet transcendant et qui doit
accepter la contamination du constituant par le constitué. Conclusion de l’A. : « la rétention
du passé resterait inséparable de la facticité du monde : leur antériorité les imposerait
également à la conscience » (p. 43).
Cette phrase « scande » véritablement Le retard de la conscience, puisqu’on la
retrouve aux pages 101 et 128. Elle scelle également une lecture de Husserl commune à
Derrida et à Sartre. Lequel affirme, nous rappelle l’A. (p. 102), que « facticité et passé sont
deux mots pour désigner une seule et même chose ». Sartre donne d’ailleurs un sous-titre
évocateur à son ouvrage majeur, L’être et le néant : essai d’ontologie phénoménologique.
Sartre y radicalise la formule de l’intentionnalité husserlienne : toute conscience est
conscience de quelque chose d’autre. Ou, plus exactement, pour le dire comme Sartre (cité

Version légèrement revue du compte rendu paru dans Revue Internationale de Philosophie, n° 219 , 2002/1, p. 144-149.
2
p. 102) : « la conscience implique dans son être un être non conscient et transphénoménal ».
Cette relecture de Sartre, qui le fait côtoyer Husserl, Derrida et Freud, permet d’envisager la
question d’une sorte – j’essaie de rendre la prudence de l’A.- d’hantologie sartrienne, au sens
de ce terme que Derrida a « forgé » (p. 107). Il faut saluer ce rapprochement, tant demandait à
être éclairée – ne fût-ce que partiellement – l’omniprésence, dans L’être et le néant, du
vocabulaire de la hantise. Ce vocabulaire témoigne davantage, chez Sartre, d’une difficulté
que de l’amorce d’une résolution.
Rappelons, un peu plus longuement que D. Giovannangeli ne le fait, le réseau qui
hante le texte sartrien (je cite L’être et le néant, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1943) : « le
néant hante l’être » (46 et 51) ; « notre nature nous hante comme l’objet permanent de notre
compréhension rétrospective » (70) ; « l’être-en-soi de la tristesse hante perpétuellement ma
conscience (d’)être triste (96) ; « la contingence de l’en-soi hante le pour-soi » (119) ; « le
cogito est hanté par l’être » (125) ; « l’en-soi-pour-soi hante le pour-soi » (126) ; « la valeur
hante le pour-soi » (131) ; « le passé peut bien hanter le présent (148) ; « le pour-soi […] est
hanté par son futur » (177) ; « le moi vient hanter la conscience irréfléchie » (299) ; « la
conscience d’autrui hante ma conscience » (312) ; « mon choix […] est hanté par le spectre
de l’instant » (512) ; la mort […] me hante » (592) ; « dire qu’une maison est hantée, c’est
dire qui ni l’argent ni la peine n’effaceront le fait métaphysique et absolu de sa possession par
un premier occupant » (633) ; « [l’antivaleur] me hante » (657).
On le voit : suivre la hantise à la trace permettrait de reconstruire l’ensemble de
l’édifice de la grande œuvre de Sartre. D. Giovannangeli essaie d’unifier ces occurrences
largement disséminées dans le texte. Pour lui, « la hantise désigne volontiers dans L’être et le
néant l’insistance d’un contenu intentionnel passé ou à venir » (p. 106-107) Pourtant, que
signifient ces formules où Sartre affirme, de façon énigmatique, que le passé et autrui, dont je
viens de rappeler qu’ils hantent le pour-soi, sont « posés contre » celui-ci (cf. L’être et le
néant, p. 176 et 431.) ? Ne s’agit-il pas là de tout autre chose que de contenus intentionnels ?
Sartre n’aborde-t-il pas, en réalité, la « structure » de la conscience non-thétique, justement
difficilement thématisable, dans un mouvement de complication du cogito cartésien ?
L’incursion de D. Giovannangeli sur ce terrain, peu défriché, permet en tout cas d’enfin poser
la question.
On pourrait conclure. Et pourtant, ce développement bien maîtrisé du texte de D.
Giovannangeli ne couvre que ses chapitres I, III et V, ainsi qu’une partie du chapitre VI. Le
second pan du livre, dans une savante alternance réglée avec le premier, reconduit d’une autre
façon la phénoménologie à ses limites. D. Giovannangeli y aborde, en trois temps, les
rapports de la philosophie (et singulièrement de la phénoménologie sartrienne) à l’esthétique :
philosophie et peinture, philosophie et cinéma, philosophie et littérature. Notons que la
philosophie se trouve ainsi ultimement confrontée à un art du temps, après avoir été affrontée
à un art de l’espace et à un art de l’espace (et du) temps, un art du mouvement, qui vient
troubler la dichotomie traditionnelle.
Dans son deuxième chapitre, « La philosophie et la peinture », l’A. montre combien la
peinture, et en particulier Picasso, a pu prendre la relève de la philosophie. Sa lecture rend un
double hommage à Max Loreau : d’une part, d’avoir su penser l’impensé de la
phénoménologie hégélienne : le corps qui soutient le déploiement de la certitude sensible ;
d’autre part, d’avoir su montrer que Picasso, à l’inverse, « dégage » et « élabore » ce que la
peinture « enveloppe », à savoir « la sculpture imaginaire » (p. 47) qui y est à l’œuvre, « la
dimension strictement imaginaire du volume ». Loin de reproduire le volume, nous dit M.
Loreau, la peinture conquiert son autonomie en le produisant. Rompant avec le

Version légèrement revue du compte rendu paru dans Revue Internationale de Philosophie, n° 219 , 2002/1, p. 144-149.
3
« perspectivisme perceptuel », Picasso se porte ainsi, de façon « magique » (p. 48), vers la
chose même.
A partir de ce triple diagnostic : « autonomie de la peinture, irréalité de l’objet peint,
possession magique de la première par le second », l’A. engage un « dialogue virtuel » (p. 49)
entre Max Loreau (parlant de Picasso) et Sartre (parlant de Giacometti) dont la
phénoménologie de l’imagination corrobore le constat porté par Loreau. Selon Sartre, cité par
l’A. (p. 51), le mérite de Giacometti est de distinguer l’espace de la sculpture, pensée sur le
modèle de la peinture, et l’espace de la perception : « A ses personnages de plâtre il confère
une distance absolue comme le peintre aux habitants de sa toile. Il crée sa figure ″à dix pas″,
″à vingt pas″, et quoi que vous fassiez, elle y reste. Du coup, la voilà qui saute dans l’irréel,
puisque son rapport à vous ne dépend plus de votre rapport au bloc de plâtre : l’art est
libéré ». Pourtant, à l’inverse de Max Loreau, Sartre continue à subordonner la peinture au
primat de la vision, puisqu’il félicite Giacometti d’avoir su sculpter, non la chose en soi, mais
ce qu’il voit.
D. Giovannangeli boucle son chapitre, comme en une mise en abîme du rythme de son
livre, par un retour à la déconstruction du primat visuel, représentatif, de la métaphysique. Il
convoque de nouveau la lecture de Loreau qui cerne le même impensé chez Platon que celui
qu’il mettait en lumière chez Hegel : le mythe de la caverne suppose aussi la conversion au
sens propre, le « retournement corporel » (p. 53) des prisonniers. Max Loreau nous reconduit
du coup à l’origine de la métaphysique, une origine, insiste D. Giovannangeli, qui « ne se voit
[il faudrait s’arrêter sur ce mot] qu’après-coup ».
Le chapitre IV, intitulé « Le philosophe et le cinéma », noue un débat fructueux entre
Gilles Deleuze et la phénoménologie. L’Apologie du cinéma, un écrit de jeunesse de Sartre,
qui définit le cinéma comme un « art bergsonien », permet d’engager la convers(at)ion, la
conversion de Sartre à une véritable prise en compte du cinéma, absent de ses travaux sur
l’imagination. Permettons-nous cependant d’indiquer que le cinéma traverse, malgré tout, le
reste de son œuvre. On peut signaler, par exemple, que Sartre ressent, par contraste avec le
cinéma, la contingence de la vie (cf. Les mots, le film Sartre par lui-même ou La cérémonie
des adieux). Le cinéma reçoit aussi une attention patiente de Sartre dans ses textes sur le
théâtre. S’agissant de la question (certes peu importante) d’une influence sartrienne sur
Deleuze, il faudrait convoquer une autre pièce du dossier : L’art cinématographique qui est un
texte de distribution des prix prononcé par le tout jeune professeur Sartre. Ce texte de 1931
reprend, pour l’essentiel, le propos de L’apologie du cinéma, notamment sa tonalité
bergsonienne, et sa reproduction, en 1950, dans la Gazette du cinéma (cf. Les écrits de Sartre)
le rendait davantage accessible à Deleuze.
Quoi qu’il en soit, D. Giovannangeli a raison de marquer l’écart entre la conception
sartrienne du cinéma et la position de Merleau-Ponty à son égard. Si celui-ci renvoie le
cinéma au primat de la perception, Sartre se porte, en revanche, vers la différence entre la
perception, qui est présente, et le cinéma qu’il pense sur le mode rétrospectif. (Il faudrait
encore compliquer le débat, puisque Merleau-Ponty, note avec acuité D. Giovannangeli (p.
81), pense également le cinéma sur le mode du souvenir.) Pour grossir le trait, et amorcer un
retour à Deleuze, pour Merleau-Ponty, le cinéma perçoit, mais ne pense pas, alors que, pour
Sartre, proche en cela de Deleuze, le cinéma ne perçoit pas, mais pense. En effet, en 1921 (et
en 1931), Sartre qualifie le cinéma d’art bergsonien et suggère l’assimilation d’un film à une
conscience, anticipant en cela sur les analyses de Deleuze, publiées, rappelons-le, en 1983.
Pourtant, dans un mouvement désormais attendu, l’A., remarquant que cet accord n’est
que provisoire, déploie tout ce qui sépare la philosophie de Deleuze de la phénoménologie
que ce dernier renvoie volontiers à la doxa (p. 82). La critique sartrienne de la mélodie
bergsonienne, comme « image dégradée de la conscience » (p. 84), se place aux antipodes de
la prise en compte par Deleuze, à partir de Bergson, d’un passé pur : « un passé qui ne fut

Version légèrement revue du compte rendu paru dans Revue Internationale de Philosophie, n° 219 , 2002/1, p. 144-149.
4
jamais présent » (p. 85. On reconnaît cette formule qui terminait les développements autour
de M. Loreau). Un peu comme Derrida dégage l’aporie husserlienne de la temporalité,
Deleuze met au jour le(s) paradoxe(s) du temps, tel qu’il est décrit par Bergson dans Matière
et mémoire. La temporalité bergsonienne n’est plus succession, comme l’est encore la
temporalité phénoménologique, mais « insistance » (p. 85), « résistance » du passé,
« coexistence du passé avec le présent » (p. 95).
Le dernier chapitre aborde le troisième volet du triptyque « Philosophie et
esthétique », que j’aurais aussi pu intituler, après d’autres, « Sartre et les arts » : entre
philosophie et littérature. Il s’agit d’y interpréter les lectures respectives de Ponge par Sartre
et par Derrida. L’A. note d’abord (p. 124) que le reproche que Sartre adresse à Ponge est le
même que celui qu’il fait à Bergson. Tous deux manquent le caractère intentionnel de la
conscience et, dès lors, font de celle-ci une chose : « La conscience est quelque chose » (p.
92), et non pas conscience de quelque chose. Il me plaît de constater que D. Giovannangeli
insiste, ensuite, sur la lecture de Hegel par Sartre, et expressément sur la lecture de la
dialectique du maître et de l’esclave (telle qu’elle fut introduite en France par Kojève). On
sait que L’être et le néant et les Cahiers pour une morale (sans parler de la Critique de la
raison dialectique) dialoguent continuellement, en un approfondissement critique, avec la
description hégélienne du rapport : maîtrise – servitude. D. Giovannangeli convoque, pour sa
part, Situations I et II et le Mallarmé (p. 124). Dans ces textes, Sartre reproche à Mallarmé et
à Ponge de n’avoir franchi le pas accompli par le surréalisme, à savoir le passage, pour le dire
avec Hegel, du stoïcisme comme négation abstraite au scepticisme comme travail négatif.
Malgré tout, rappelle D. Giovannangeli (p. 126), il est arrivé à Jacques Derrida de parler,
s’agissant de La nausée, du moment pongien de Sartre. Face au marronnier, Roquentin subit la
résistance de la chose : la racine déborde ce qu’il peut en dire. L’A. conclut à une coïncidence
seulement partielle entre Ponge et la phénoménologie : « la chose pongienne est en excès sur
la chose du phénoménologue » (p. 126).
Une nouvelle fois, l’A. ne peut acter la défaite de Sartre – c’est pourtant ce que
beaucoup d’ouvrages font trop rapidement – sans faire allusion à la théorie sartrienne de la
contingence qui recoupe, et explique peut-être, ce que Derrida entend par supplémentarité de
l’être : « cette supplémentarité de l’être que Derrida associe à l’étonnement, voire à
l’effarement devant ″le fait que la chose même est là″ » (pp. 131-132). Le texte de Daniel
Giovannangeli s’achève donc sur le retour, savamment retardé, de « la chose même », qui
donne son titre au dernier chapitre et qu’il faut confronter au mot d’ordre husserlien d’aller
« aux choses mêmes », la chose même telle que Derrida, rappelant Kafka, tente de la penser à
partir de la loi : « Ce qui est à jamais différé, jusqu’à la mort, c’est l’entrée dans la loi elle-
même, qui n’est rien d’autre que cela même qui dicte le retard » (cf. p. 138). Ce mouvement
ultime du texte nous rend, comme le dit Foucault, cité par l’A. (p. 138), à « l’être vif du
langage » qui « suspend l’ontologie » (p. 139)
Tout au long de son livre, D. Giovannangeli instruit le procès (au sens de processus
comme au sens juridique) de la phénoménologie qu’il n’hésite pas à interroger radicalement.
Mais ce parcours, toujours éclairant, en extrait également les percées les plus remarquables.
On assiste tout particulièrement à une réélaboration vraiment vivifiante de la philosophie de
Jean-Paul Sartre, dans son déploiement, au contact de Derrida, de Husserl ou de Freud. Outre
les quelques remarques émises ci-dessus, on notera encore les nombreuses allusions à
Merleau-Ponty sur lequel on aimerait entendre davantage l’A., tout comme sur « la question
de la littérature » qui le hante depuis longtemps. Grégory CORMANN
Aspirant du Fonds National de la Recherche Scientifique
1
/
4
100%