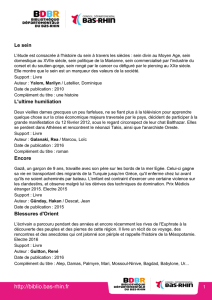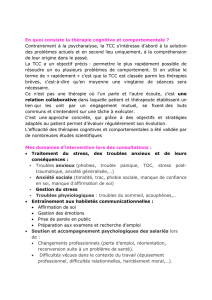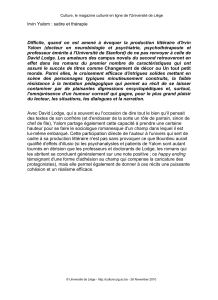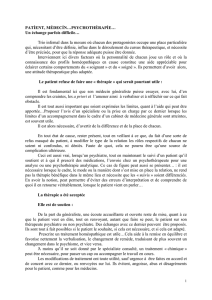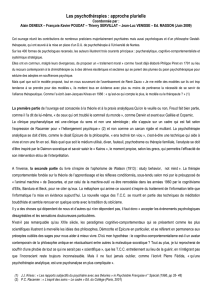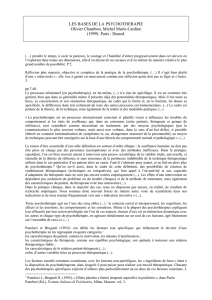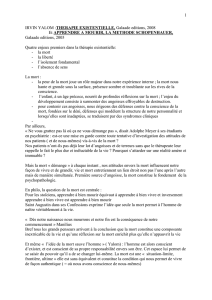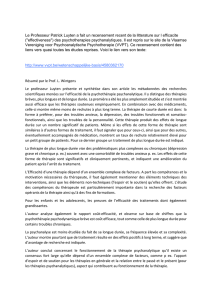Rencontre avec Irvin Yalom

Rencontre avec Irvin Yalom
C’est une sommité aux États-Unis. À 80 ans, Irvin Yalom, psychiatre, psychothérapeute,
essayiste et romancier, continue de consulter et d’écrire du fond de son fief californien, à Palo
Alto. Rencontre avec un des papes de la psychothérapie contemporaine qui ne souhaite pas
être un thérapeute distant.
Ce matin-là, Irvin Yalom est sorti de sa maison californienne pour m’attendre sur une petite
route de campagne ensoleillée. Les mains dans les poches, la tête légèrement inclinée vers le
sol, il lève de temps en temps les yeux pour vérifier discrètement que je ne prends pas un
mauvais virage. Professeur émérite de l’école de médecine de l’université Stanford, auteur de
best-sellers célébré par la critique, thérapeute assailli de demandes, le psychiatre respire la
santé, à l’approche de ses 80 ans : grand, l’œil aiguisé, il enveloppe son esprit vif, voire
cinglant, d’une voix douce mais ferme. Pendant l’entretien, il ne se lèvera qu’une fois de son
fauteuil, pour montrer sur l’écran de son ordinateur un e-mail. Un courrier envoyé d’un
cybercafé par un sans-abri qui a lu La Méthode Schopenhauer après l’avoir trouvée dans une
poubelle. « Ce roman a bouleversé mon existence », a-t-il écrit. Irvin Yalom masque à peine
son plaisir. C’est un peu comme si la boucle était bouclée. Comme si le petit garçon, fils
d’immigrés, venu à la psychologie par la littérature, tenait aujourd’hui la preuve qu’il a réussi
à concilier ses deux passions, l’écriture et la thérapie, dans une seule et même quête : offrir à
quelques-uns de ses congénères un chemin vers plus de liberté et de sérénité.
Psychologies : Pourriez-vous nous parler de votre enfance ?
Irvin Yalom : Je suis né dans la ville de Washington, aux États-Unis. Je n’ai pas vraiment eu
d’enfance. Nous avons grandi, avec ma sœur de sept ans plus âgée que moi, dans
l’appartement situé au-dessus de l’épicerie que possédaient mes parents. Nous étions pauvres,
les seuls juifs blancs dans un quartier noir. Je n’étais pas heureux. Je ne pouvais pas sortir :
c’était trop dangereux, et à l’intérieur de la maison, ce n’était pas facile non plus. Mes parents
étaient d’un autre monde, un monde ancien, tourné vers le passé. Ils n’étaient pas « modernes
», ne comprenaient pas grand chose à la culture américaine et n’avaient pas vraiment le temps
de s’occuper de nous. Ils travaillaient énormément : douze heures quotidiennes, six jours par
semaine.
Vous sentiez-vous « étranger », pas à votre place, au sein du milieu dans lequel vous
évoluiez ?
Tous mes copains étaient noirs. Et très vite s’est posée la question d’être juif. Mes parents
avaient fui les pogroms dans les années 1920. Ils venaient de Russie, disaient-ils. Enfin,
parfois ils disaient Russie, parfois Pologne. Un petit village à la frontière détruit par les nazis
et qui n’existe plus aujourd’hui, ai-je compris. Personne n’en parlait jamais chez moi, même
si mes parents étaient très immergés dans la culture juive. Ils lisaient des journaux en yiddish
et tous leurs amis étaient juifs. Cela dit, ils étaient indifférents à la religion et nous ne suivions
aucune fête à part Hanoukka. Je n’ai jamais cherché à en savoir plus sur mes origines. Il y a
quelques années, j’ai fait une conférence en Russie et j’ai compris par hasard d’où je venais
en dînant dans un restaurant ukrainien : leur bortsch avait exactement le même goût que celui
de ma mère. Je me souviens que mon identité me posait problème à l’école. Il y régnait une
atmosphère antisémite puissante, et je me sentais vraiment mal. Très vite, j’ai cherché du
réconfort dans la littérature. Je me suis plongé dans les livres que j’empruntais voracement à
la bibliothèque.

Vers 10 ans, j’ai commencé à me passionner pour les romans. Depuis, ils ne m’ont jamais
quitté. Ils ont fait mon éducation. Tolstoï et Dostoïevski m’ont formé psychologiquement,
philosophiquement et sociologiquement. Grâce à eux, j’ai découvert les tréfonds et les
angoisses de l’âme humaine.
Vous avez assisté à l’infarctus de votre père quand vous aviez 10 ans et décidé de
devenir médecin en voyant le docteur de la famille le sauver. Est-ce vraiment l’origine de
votre vocation ?
Il y a eu cet événement, oui. Mais indépendamment de cela, le choix de la médecine s’est
imposé parce qu’à l’époque c’était la carrière « classique » suivie par les meilleurs élèves
issus de l’immigration juive. En fait, soit vous repreniez le « business familial », soit vous
faisiez médecine. Si j’avais su que je pouvais devenir romancier, les choses auraient peut-être
été différentes… Mais je ne connaissais aucun écrivain. Je ne savais pas que c’était possible.
Ce qui est sûr, c’est que la décision de me spécialiser en psychiatrie vient de la lecture des
grands auteurs russes. Je suis un littéraire. D’ailleurs, toute la partie scientifique de ma
formation ne m’a jamais intéressé et m’a demandé beaucoup d’efforts. Au début de mes
études supérieures, je me sentais intellectuellement « sous-développé » par rapport aux autres
étudiants. Je travaillais tellement que je ne réfléchissais pas. J’emmagasinais. J’étais anxieux,
obsédé par l’idée de réussir. Les études de médecine étaient difficiles à l’époque, le quota de
juifs avait été fixé à 5 %. En plus, il fallait que je finisse mes études en trois ans plutôt que
quatre. J’étais amoureux de ma femme, Marilyn. Je voulais l’épouser très vite. J’avais peur de
la perdre.
L’un de vos textes les plus connus en France, un essai qui s’intitule "Thérapie
existentielle", développe cette notion que vous avez créée et que vous utilisez dans votre
pratique de thérapeute. Pourriez-vous expliquer de quoi il s’agit ?
La thérapie existentielle n’existe pas en tant que telle. Pour la pratiquer, il faut maîtriser
plusieurs techniques et être sensible aux questions existentielles, à savoir : que signifie vivre ?
Comment affronter la mort ? Comment trouver un sens à sa vie ? Comment accepter l’idée
que, même si vous avez réussi à faire couple avec quelqu’un, vous mourrez seul, de la même
manière que vous êtes venu seul au monde ? Si vous commencez à vraiment réfléchir à votre
propre existence, vous en arrivez forcément à ces questions de la mort, de l’isolement et du
sens de la vie. La thérapie existentielle, c’est cela : se pencher sur ces questions
métaphysiques dans le cadre d’une thérapie. J’ai toujours été passionné par la philosophie, pas
celle qui se préoccupe de logique mathématique, mais celle qui se penche sur la question du
sens de la vie. Et je ne vois pas pourquoi philosophie et psychothérapie devraient être
opposées. Toutes deux se préoccupent des mêmes enjeux essentiels.
Est-ce que la prise en compte de ces questions métaphysiques a modifié votre pratique et
les rapports avec vos patients ?
Absolument. Si vous avez en tête l’idée que nous, humains, sommes tous embarqués dans le
même bateau, que nous sommes tous confrontés à la perspective de notre disparition, alors
vous empruntez une route différente en tant que thérapeute. Je ne suis pas détaché, neutre. Je
m’engage avec le patient. J’essaie de comprendre exactement ce qu’il veut dire, de le
conseiller sans pour autant jouer le rôle de guide spirituel.

Mon objectif n’est pas de laisser les gens céder à la tentation de la soumission à un être «
supérieur », à une idéologie ou à une religion. Il ne s’agit pas d’enchaîner, mais de libérer en
dialoguant.
Donnez-vous beaucoup de conseils et de directives au cours de vos thérapies ?
Je ne veux pas apparaître comme un être omniscient. Ce n’est pas le rôle d’un bon thérapeute,
à mon avis. Je parle de ce que je connais, mais aussi de ce que je ne connais pas. Je donne
mes réponses aux questions quand je le peux. Il m’arrive même de me dévoiler. Avec Ginny,
la patiente de Dans le secret des miroirs, la cure s’est déroulée il y a plus de quarante ans. Et
mon idée, révolutionnaire à l’époque, était la suivante : que se passerait-il si Ginny savait ce
que je pense, ce que je ressens pendant nos séances ? Lui donner à lire ce que j’avais rédigé
sur nos séances était une expérience inédite. Je suis sûr que tous les patients se demandent ce
que leur thérapeute pense d’eux. Et je suis ouvert à cette question. Je considère qu’ils ont le
droit de me la poser. Je leur dis toujours qu’ils peuvent me demander ce que je pense. Chaque
fois que je l’ai fait, les résultats ont été excellents : cela anime la thérapie, alimente les
séances. Les patients se rendent compte que vous êtes sincère, qu’ils ne sont pas jugés et
peuvent s’exprimer librement.
Mais que faites-vous de la neutralité bienveillante préconisée par Freud ?
D’abord, je pense que ce principe de neutralité est archaïque. Théoriquement intéressant,
« thérapeutiquement » vain. La psychothérapie est avant tout une relation, et c’est le lien qui
soigne. Je suis d’ailleurs sûr que Freud était très présent avec ses patients, qu’il intervenait
dans leur vie, qu’il leur parlait énormément. Je travaille essentiellement sur les rapports que
mes patients entretiennent avec les autres. C’est d’ailleurs souvent pour cela qu’ils viennent
consulter : pour changer leurs relations avec leurs parents, leurs amants, leurs amis… En
examinant le lien qu’ils entretiennent avec moi, en leur révélant des choses si j’estime que
cela peut leur être utile, je peux pointer ce qui ne va pas et nous pouvons travailler, analyser
les nœuds et les difficultés.
Si vous parlez de vous, ne prenez-vous pas le risque de « bloquer » le transfert du
patient, de l’empêcher de faire de vous ce père tant aimé, cette mère absente, etc. ?
Pas besoin d’être opaque et silencieux pour susciter le transfert, il se produira de toute façon,
car c’est une force puissante. Et puis, nous déformons toujours les choses à cause des
sentiments du passé qui resurgissent au cours de la cure. Vous savez, j’ai passé trois ans en
analyse avec quelqu’un de très traditionnel et « lointain ». J’ai l’impression d’avoir perdu mon
temps. Je ne veux pas être distant. Je veux être humain, interagir.
Comment se déroulent vos séances ?
Elles durent généralement de cinquante minutes à une heure et se déroulent une à deux fois
par semaine. Je démarre souvent avec un rêve. C’est un excellent moyen d’accéder à
l’inconscient. Si les patients ne s’en souviennent pas, je leur demande de s’endormir avec du
papier et un crayon à côté d’eux, d’essayer de s’en rappeler au réveil, juste avant d’ouvrir les
yeux. Parfois, un mot suffit pour que le fil surgisse. Au début, c’est passionnant car les rêves
sont pleins d’énergie.

Utilisez-vous ce divan derrière nous ?
Très peu. Je préfère travailler en face à face. Je propose le divan aux personnes très timides
qui ont peur de me regarder dans les yeux, ou à celles qui sont fatiguées. Et puis, le divan est
tellement associé à la psychanalyse traditionnelle! Je pratique la psychothérapie. Aux États-
Unis, 99 % des patients suivent une thérapie. Mais jusqu’à présent, un courant très fort a
poussé massivement vers les thérapies comportementales et cognitives, ou TCC, pour des
raisons économiques, les assurances ne remboursant que les cures dont les effets bénéficient
de la mention EVT [empirically validated treatment, ou « thérapie empiriquement validée »,
ndlr]! Or, cette mention n’est délivrée qu’aux TCC. Je suis convaincu que ce n’est pas un bon
système. La psychothérapie ne doit pas être réduite au cognitivisme et au béhaviorisme. Cela
dit, il semble que les choses soient en train de changer. De plus en plus de voix scientifiques
s’élèvent pour protester contre l’omniprésence des TCC aux États-Unis.
Avez-vous expérimenté de nouvelles thérapies qui vous paraissent intéressantes ?
Non. Je travaille avec ce que je sais. Je reçois beaucoup moins de patients qu’avant. Je suis un
vieux monsieur, maintenant. Je n’accepte plus de personnes dont le traitement pourrait
dépasser un an. En fait, une grande partie de mon temps et de mon énergie est consacrée à
l’écriture. Je suis en train de terminer un roman sur Spinoza. J’aime écrire des histoires. J’ai
toujours pensé, quelque part au fond de moi, que publier de bons romans est la meilleure
chose qu’un homme puisse faire dans sa vie.
Hélène Fresnel
A lire :
Dans le secret des miroirs
C’est le dernier roman d’Irvin Yalom à être publié en France, mais l’un de ses premiers
textes. Un récit passionnant parce qu’il met en scène une psychothérapie racontée par ses
protagonistes : le docteur Yalom et sa patiente, Ginny, jeune fille pauvre, fragile, écrivaine en
puissance souffrant d’un blocage créatif. Pour entamer le processus de guérison et trouver un
moyen de se faire rémunérer, Irvin Yalom lui propose de payer sa thérapie avec des écrits.
Elle lui remettra chaque semaine un compte-rendu de leurs séances, de ce qu’elle a ressenti.
Lui s’engage à faire la même chose de son côté et à le lui donner… Le livre est la
transcription palpitante de ce journal à deux voix.
Dans le secret des miroirs d’Irvin Yalom et Ginny Elkin (Galaade).
!
1
/
4
100%