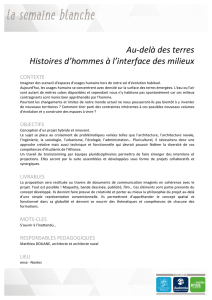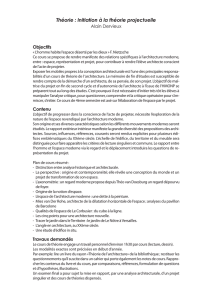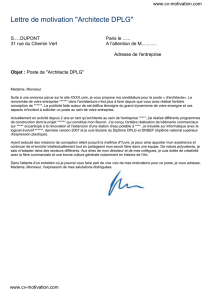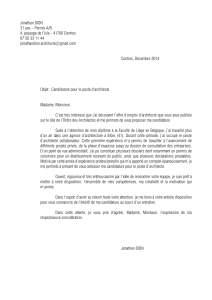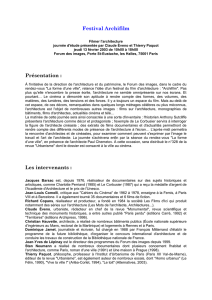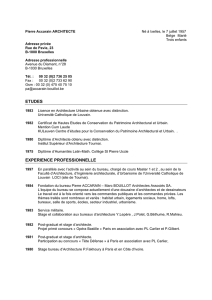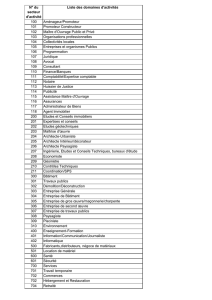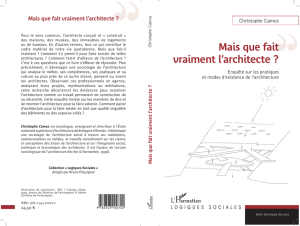Architectures

Architectures
Le musée Guggenheim Bilbao © FMGB

ART ET CULTURE
Architectures
Une collection documentaire de trente films de 26 mn.
> du samedi 26 février au samedi 14 mai 2005 à 20.15
26 février
La maison de verre INÉDIT
5 mars
L’abbatiale Sainte Foy de Conques INÉDIT
12 mars
Les thermes de pierre
19 mars
Le musée Guggenheim de Bilbao INÉDIT
26 mars
La Galleria Umberto 1er
2 avril
La saline d’Arc et Senans INÉDIT
9 avril
L’école de Siza
16 avril
Le bâtiment Johnson
23 avril
L’Opéra Garnier
30 avril
La maison de Jean Prouvé INÉDIT
7 mai
Le couvent de la Tourette
14 mai
La médiathèque de Sendaï INÉDIT
1
Contact presse : Céline Chevalier /
Nadia Refsi / Rima Matta
01 55 00 70 41 / 23 /40

Architectures
Du 26 février au 14 mai 2005,
ARTE diffuse 12 numéros dont 6 inédits
de la collection Architectures.
Cette série de films de 26 minutes est consacrée aux réalisations les plus marquantes de l’architecture, de ses
prémices jusqu’aux dernières créations des grands architectes d’aujourd’hui. Une enquête sur le terrain à la
recherche du désir de l’architecte...
Architectures est coproduite par ARTE France,Les Films d’Ici,la Direction de l’archi-
tecture et du patrimoine, le musée du Louvre, le Centre Pompidou et le musée d’Orsay
Chaque film traite d’un seul bâtiment choisi pour son aspect exemplaire, pour le rôle de jalon qu’il a joué ou
qu’il joue dans l’évolution de l’architecture. Le bâtiment est exploré de fond en comble, décortiqué depuis les
fondations jusqu’aux couvertures. Un travail sur le terrain fait apparaître des questions pratiques et simples, et
la façon dont l’architecte y a répondu.
Chaque film repose sur un tournage réel minutieux dans le bâtiment, avec l’aide de moyens sophistiqués. Une
maquette du bâtiment, réalisée spécialement pour chaque film, permet de montrer de façon claire et ludique ce
qui autrement est invisible : les étapes de la conception du bâtiment, son principe constructif, l’agencement des
espaces etc...
Bien plus lisibles que les plans ou les croquis, ces maquettes démontables rappellent que la véritable force de
la grande architecture est d’être simple comme un jeu d’enfant.
Enfin, dans les films consacrés aux réalisations d’aujourd’hui, l’architecte intervient lui-même brièvement,
apportant un éclairage plus subjectif en contrepoint de l’enquête du film.
2

Architectures en DVD
Architectures vol 4 .
Sortie DVD le 22 mars 2005
Une co-édition
ARTE Vidéo / La Réunion des musées nationaux
Avec le soutien du Ministère de la culture et de la
communication, Direction de l’architecture et du
patrimoine.
Prix DVD : 24 €
version trilingue : français, anglais, allemand
Au programme
La saline d’Arc et Senans
La maison de verre
Le musée Guggenheim de Bilbao
La maison de Jean Prouvé
La médiathèque de Sendaï
L’abbatiale Sainte Foy de Conques
Déjà parus
DVD Volume 1 : Le Bauhaus de Dessau ; L’Ecole de Siza ; Le Familistère de Guise, une cité radieuse au 19ème ;
Nemausus 1, une HLM des années 80 ; Le centre Georges Pompidou ; La Caisse d’Epargne de Vienne
DVD Volume 2 : Le bâtiment Jonhson ; La Galleria Umberto 1er ; Satolas-TGV, un monument à la campagne ;
Les thermes de pierre ; L’Ecole des Beaux-Arts de Paris
DVD Volume 3 : Le musée Juif de Berlin ; L’Opéra Garnier ; Le Couvent de la Tourette ; La Casa Milà ; L’auditorium
Building de Chicago ; Le Centre Municipal de Säynätsalo
CONTACTS PRESSE ARTE VIDEO
Henriette Souk 01 55 00 70 83/ [email protected]
Maud Lanaud 01 55 00 70 86/ [email protected]
3

Retrouvez
Architectures
sur www.arte-tv.com
Le site Internet d’ARTE accompagnera et prolongera ces 12 numéros d’Architectures
en leur consacrant un grand dossier spécial, qui s’enrichira au fur et à mesure des
diffusions sur ARTE.
Parmi les thèmes proposés :
•Une biographie complète des architectes
•Des photos, des plans et des croquis de chaque bâtiment présenté
•Une liste de liens et une bibliographie exhaustive
•Des interviews exclusives des auteurs et des architectes
•Une partie thématique concernant l’utilisation des nouvelles technologies
dans le domaine de l’architecture avec de nombreux exemples
www.arte-tv.com/architectures
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%