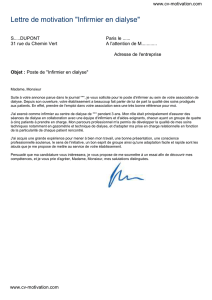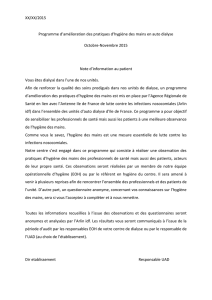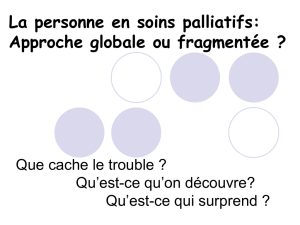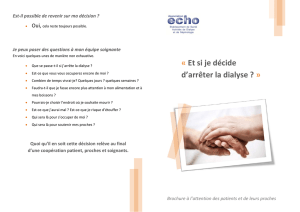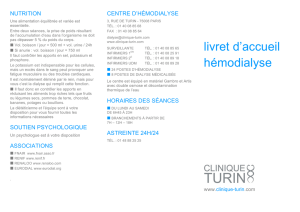LA GROSSESSE CHEZ LA FEMME DIALYSEE

Session 3
59
40 ans se sont écoulés depuis que Confortini
(1) a rapporté pour la première fois une gros-
sesse survenue chez une femme dialysée.
Depuis, les publications se sont multipliées, y
compris dans des pays où le développement
de la dialyse est récent (2,3). On constate une
nette augmentation de la fréquence de cet
événement, mais surtout une amélioration
très importante de son pronostic : le pourcen-
tage de grossesses aboutissant à la naissance
d'un enfant vivant est passé de 40 % en 1993 à
80 % dans les publications les plus récentes (4-
14). De plus, la naissance à terme d'un enfant
de poids normal est maintenant loin d'être
exceptionnelle, alors que il y a 20 ans, tous les
enfants étaient prématurés et hypotrophes.
L'augmentation de fréquence des grossesses
est probablement liée en partie à l'améliora-
tion de son pronostic, qui la rend plus accep-
table, et conduit à un recours moins fréquent
à l'interruption thérapeutique. Mais c'est sur-
tout l'amélioration des conditions de dialyse
qui en est responsable, en permettant la réap-
parition de cycles ovulatoires, ce qui rend pos-
sible la survenue d'une grossesse. Il est donc
essentiel d'en parler avec les patientes en
dialyse, an de leur prescrire une contracep-
tion si elles ne souhaitent pas de grossesse. Si
une grossesse est envisagée, on modiera le
traitement en arrêtant si c'est possible tous
les médicaments contre-indiqués pendant la
grossesse (médicaments du système rénine-
angiotensine notamment, mais aussi antivita-
mines K ou statines). Il est en particulier essen-
tiel de stabiliser la pression artérielle avec des
médicaments qui pourront être poursuivis en
cas de grossesse (inhibiteurs calciques et cer-
tains bêta-bloquants notamment).
LA GROSSESSE
CHEZ LA FEMME DIALYSEE
Dr Catherine GAUDRY,
Centre Hospitalier Sud Francilien, 91014 EVRY
La fréquence des fausses-couches sponta-
nées, précoces ou tardives, est importante ;
elle est sans doute sous-estimée au premier
trimestre, car le diagnostic de grossesse reste
souvent tardif, même dans les publications
récentes. Chez ces femmes qui n'ont pas de
règles régulières et qui ne pensent pas pou-
voir être enceintes, chez lesquelles des nau-
sées sont banales, c'est parfois une prise de
poids inexpliquée ou une soudaine mauvaise
tolérance des dialyses qui permet le diagnos-
tic. Celui-ci sera fait sur le dosage des bêta
HCG, qu'il ne faut pas hésiter à demander au
moindre doute, et bien sûr l'échographie. Les
tests urinaires sont évidemment sans valeur.
Des grossesses ont été décrites quels que
soient le temps passé depuis la mise en route
de la dialyse, la méthode de dialyse (hémodia-
lyse, hémodialtration ou dialyse péritonéale),
la pathologie responsable de l'insusance
rénale, et qu'il existe ou non une diurèse rési-
duelle.
Complications maternelles
La plus fréquente est l'hypertension artérielle,
qui peut être sévère en particulier chez des
femmes hypertendues avant la grossesse.
Elle est souvent très volodépendante, et sera
très dicile à stabiliser en cas de participation
d'une surcharge hydrosodée.
Les possibilités thérapeutiques au cours de
la grossesse sont assez limitées, puisqu'on ne
peut utiliser que certains inhibiteurs calciques
(Nicardipine et Nifédipine notamment), cer-
tains bêtabloquants (Labétalol, Propranolol
et Oxprénolol notamment), certains antihy-
pertenseurs centraux (Méthyldopa en parti-
culier). Les médicaments du système rénine

60
angiotensine (inhibiteurs de l'enzyme de
conversion, antagonistes des récepteurs de
l'angiotensine II et probablement inhibiteur
de la rénine) sont formellement contre-indi-
qués pendant toute la grossesse, car respon-
sables d'oligoamnios voire d'anamnios, et
d'atteintes de l'appareil urinaire foetal, avec
anurie néonatale pas toujours réversible. Ils
ont également été accusés d'un eet térato-
gène.
L'anémie a tendance à se majorer et néces-
site pour sa correction une augmentation des
apports en fer et une augmentation des doses
d'érythropoïétine. L'apport de fer est généra-
lement intraveineux en hémodialyse ; il est
habituellement oral en dialyse péritonéale,
mais l'augmentation des besoins en fer pen-
dant la grossesse peut rendre nécessaire le
recours à un traitement intraveineux. L'appari-
tion des agents stimulant l'érythropoïèse a été
l'un des facteurs de l'amélioration du pronos-
tic des grossesses en dialyse, et la fréquence
des transfusions dans cette situation a été très
nettement diminuée par leur utilisation.
Des complications graves peuvent se voir,
même si elles sont peu fréquentes, surtout
H.T.A. sévère ou oedème pulmonaire, en par-
ticulier dans le post-partum immédiat ; la sur-
venue brutale d'une H.T.A. doit bien sûr faire
évoquer une prééclampsie surajoutée, dont le
risque de survenue est élevé sur ce terrain. Le
diagnostic en est dicile, et pourtant essen-
tiel, et toute H.T.A. importante d'apparition
brutale est suspecte, si on a vérié l'absence
de surcharge hydrosodée. Il faut alors mettre
en place une surveillance foetale et surtout
maternelle intensive, an de dépister un
éventuel Hellp syndrome qui peut conduire à
une décision d'extraction foetale.
Quelques thromboses de l'accès vasculaire
ont également été mentionnées, ainsi que
des problèmes infectieux, septicémie en hé-
modialyse et péritonite en dialyse péritonéale,
qui peuvent être à l'origine de menaces d'ac-
couchement prématuré.
Enn l'une des complications à long terme
est le risque d'immunisation au décours de la
grossesse, qui peut poser problème pour une
transplantation rénale ultérieure.
Complications obstétricales
Elles sont essentiellement au nombre de deux :
hydramnios et menace d’accouchement pré-
maturé (MAP).
La survenue d’un hydramnios est très fré-
quente chez la femme dialysée. Il est en
général précoce, survenant en moyenne à
24 SA et noté parfois dès 13 SA. Il s’explique
par la charge osmotique provoquée par l’in-
susance rénale, qui bien sûr est la même
dans le sang fœtal, et induit chez le fœtus
une augmentation de la diurèse par diurèse
osmotique, d'où une augmentation du vo-
lume de liquide amniotique. On peut donc
logiquement penser que l’augmentation de
la quantité de dialyse délivrée à la patiente
peut éviter la survenue de cet hydramnios, ou
en limiter l’importance. C'est d'ailleurs le cas
dans les publications où la dose de dialyse
est très importante, et qui mentionnent une
fréquence d'hydramnios faible, voire nulle
(10). Un mauvais contrôle de la volémie par-
ticipe sans doute également à la survenue de
cette complication, d'où l'importance d'une
réévaluation hebdomadaire du poids sec de
la patiente, la prise de poids hebdomadaire
étant évaluée, selon les auteurs, entre 200 et
500 g par semaine aux deuxième et troisième
trimestres.
La seconde complication est la menace d'ac-
couchement prématuré, responsable de la
prématurité non iatrogène fréquente sur ce
terrain. La mise en route prématurée du tra-
vail est bien sûr favorisée par l'existence d'un
hydramnios, et directement liée à son impor-
tance, avec un risque surajouté de rupture
Catherine GAUDRY

Session 3
61
prématurée des membranes. Les variations
ioniques importantes et brutales que peut
provoquer l'hémodialyse, notamment sur la
calcémie, jouent sans doute également un
rôle. Certains auteurs ont également incri-
miné une baisse du taux de progestérone par
épuration au cours de la séance d'hémodia-
lyse. La diminution de fréquence de l'hydram-
nios obtenue avec une dialyse très intensive
va de pair avec une réduction importante du
nombre d'accouchements prématurés spon-
tanés. La survenue fréquente d'une menace
d'accouchement prématuré est peut-être un
argument pour utiliser en priorité des inhibi-
teurs calciques pour traiter l'H.T.A., puisqu'ils
ont également un eet tocolytique, à l'inverse
des bêta-bloquants qui pourraient, au moins
en théorie, avoir l'eet contraire.
Quelques cas d'hématome rétro placentaire
ont été décrits, sans qu'on puisse préciser si
ils sont survenus dans un contexte de préé-
clampsie ou sans cause particulière.
Ils sont évidemment de très mauvais pronos-
tic foetal.
Les morts foetales in utero ne sont pas excep-
tionnelles, sans doute dues le plus souvent
à des hypotrophies foetales extrêmes avec
troubles de la perfusion placentaire. On ne
peut pas éliminer le rôle éventuel des baisses
de pression artérielle par variation brutale de
la volémie lors d'une déplétion trop rapide en
hémodialyse
Enn des hémorragies de la délivrance ont
été rapportées, surtout en hémodialyse. Leur
risque de survenue peut être diminué en limi-
tant l'utilisation des anticoagulants au cours
des séances lorsque la n de la grossesse
semble imminente, et en utilisant plutôt des
héparines de bas poids moléculaire.
Le taux de naissances par césarienne est ex-
trêmement élevé, entre 33 et 80 %.
Caractéristiques néonatales
Il y a 20 ans, tous les enfants nés de mère dia-
lysée étaient prématurés et hypotrophes, tant
dans la littérature que dans l'enquête natio-
nale que nous avions menée. Dans les der-
nières publications, la prématurité est encore
fréquente, ce qui n'est pas étonnant compte
tenu des complications, tant obstétricales
que maternelles, dont nous venons de parler.
Une hypotrophie foetale s'y associe dans un
nombre de cas important, sans doute favo-
risée par une volémie variable, mais parfois
basse, responsable d'une hypoperfusion pla-
centaire. L'augmentation des résistances vas-
culaires placentaires joue également un rôle
important. Enn il n'est pas impossible que
la dénutrition maternelle et un apport pro-
téique insusant puissent être en cause dans
certains cas, comme le suggère un auteur qui
propose d'avoir recours à une alimentation
parentérale en dialyse pendant la grossesse
(15).
Dans les dernières publications, on note un
nombre croissant d'enfants nés à terme et
de poids sensiblement normal. Néanmoins,
un grand nombre de grossesses aboutissent
encore à la naissance de grands prématurés,
avec un risque de décès chez les enfants nés
avant 30 semaines. La fréquence du retard de
croissance intra utérin varie, dans les articles
publiés au cours des 10 dernières années, de
15 à 80 %. Pour les enfants nés très prématu-
rément ou de très petit poids, l'amélioration
du pronostic immédiat est liée aux progrès de
la prise en charge néonatale, mais le risque de
séquelles, notamment neurologiques, est loin
d'être négligeable, et le pronostic à très long
terme est encore inconnu.
Il a été signalé chez ces enfants, en plus des
problèmes habituels liés à la prématurité et
à l’hypotrophie, la survenue à la naissance
d’une diurèse osmotique, qui peut exposer
à un risque de déshydratation si elle n’est pas
compensée.
La grossesse chez la femme dialysée

62
Stratégie de dialyse pendant la
grossesse
Tous les auteurs s'accordent pour conseiller
une augmentation aussi précoce que possible
de la dose de dialyse. Même si aucune étude
n'a été menée, on peut constater que les deux
séries qui rapportent les meilleurs résultats
sont celles où la dose de dialyse était la plus
importante : des séances de 7 à 8 heures, 5 à
7 nuits par semaine pour l'une (10), et plus de
24 h par semaine en hémodialyse pour l'autre
(16). Cet auteur compare les grossesses réus-
sies et celles qui ont échoué, et note comme
seules diérences signicatives un taux d'hé-
moglobine un peu plus élevé dans le pre-
mier groupe, et surtout un taux d'urée (et de
créatinine) plus bas dans le premier groupe.
Il rejoint d'autres auteurs pour recommander
de maintenir le taux d'urée en dessous de
8 mmol/l pendant la grossesse. Le but est de
diminuer l'importance de l'hydramnios, dû
probablement à une diurèse osmotique chez
le foetus, dont les reins reçoivent le sang ma-
ternel, chargé de toutes les substances non
épurées chez la mère.
En hémodialyse, l'idéal est la réalisation de
séances quotidiennes (6 jours sur 7 le plus
souvent), en maintenant une durée relati-
vement longue pour chaque séance (3 à 4
heures). En eet, les deux éléments impor-
tants sont la dose de dialyse, avec des valeurs
de Kt/V au moins voisines de 3, et une dialyse
susamment longue pour permettre une
déplétion satisfaisante sans entrainer d'hypo-
volémie, an que la perfusion de l'unité foe-
to-placentaire reste correcte. Par ailleurs, les
systèmes actuels de contrôle de la volémie en
cours de dialyse sont tout à fait intéressants
sur ce terrain, an d'éviter les chutes tension-
nelles délétères pour le foetus.
Dans le même but d'obtenir une meilleure
tolérance hémodynamique, on n'utilisera
que des bains bicarbonate, certains auteurs
recommandant même les bains sans acétate.
Il a également été conseillé d'utiliser un bain
pauvre en calcium, en y associant si nécessaire
une supplémentation calcique par voie orale.
Le but est d’éviter les hypercalcémies de n
de dialyse, qui joueraient un rôle dans la sur-
venue prématurée de contractions utérines.
De même certaines publications préconisent
un débit de dialysat plus faible, pour éviter
de créer un déséquilibre osmotique entre les
milieux intra et extra cellulaires.
Il est essentiel de réévaluer le poids sec de la
patiente très régulièrement: si il est sous-es-
timé, la survenue d’épisodes hypovolémiques
en n de dialyse peut être très préjudiciable
pour le fœtus; si il est surestimé, il peut appa-
raître une H.T.A. sévère, qui résiste aux antihy-
pertenseurs utilisables sur ce terrain.
Il a aussi été recommandé de diminuer l'hé-
parinisation du circuit, mais cela ne semble
pas indispensable, surtout avec l'utilisation
des héparines de bas poids moléculaires, qui
exposent à un risque hémorragique moins
important, et dont l'utilisation reste possible
pendant la grossesse.
Quelques observations ont été rapportées
avec un traitement par hémodialtration (17)
et, là encore, la dialyse a été intensiée avec
réalisation de 6 séances par semaine, et une
durée moyenne de dialyse de 28 h par se-
maine.
Enn, depuis de nombreuses années ont éga-
lement été rapportées des observations en
dialyse péritonéale (18). L'une des dicultés
est que l’augmentation de la dose de dialyse
ne peut se faire qu’en augmentant le nombre
de cycles ou d’échanges, le volume intra-péri-
tonéal toléré étant limité surtout vers la n de
la grossesse. Il est souvent proposé d'associer
une dialyse automatisée la nuit et des poches
dans la journée. La dialyse uctuante a égale-
ment été recommandée (19).
Des problèmes de dysfonction du cathéter
ont été signalés, qu'on peut éviter grâce à un
Catherine GAUDRY

Session 3
63
positionnement latéral de l'extrémité du ca-
théter. Ils ont conduit certains auteurs à avoir
recours à l’hémodialyse pendant les derniers
mois de la grossesse. Certains ont même pro-
posé d’associer les deux techniques, hémo-
dialyse et dialyse péritonéale, pour obtenir
une dose de dialyse satisfaisante.
L’avantage de la dialyse péritonéale est de
permettre une épuration continue, sans
risque d’hypovolémie brutale, et sans désé-
quilibre osmotique entre les diérents sec-
teurs hydriques. Par contre il peut être dicile
d’assurer une déplétion hydro-sodée su-
sante, avec survenue d’une H.T.A., parfois dif-
cile à contrôler.
Plusieurs cas de péritonite ont été rapportés,
parfois responsables d'une mise en route pré-
maturée du travail. Un cas a été publié d'hé-
mopéritoine avec déglobulisation lié à un sai-
gnement de l'utérus par ulcération de sa paroi
sur le cathéter (20).
Après une césarienne, la reprise de la dialyse
péritonéale peut habituellement être très ra-
pide, dans les 24 à 48 heures.
Alors que les diurétiques sont habituellement
contre-indiqués pendant la grossesse, en
raison de la diminution de la volémie qu'ils
entrainent, on peut poursuivre le traitement
par le furosémide, qui n'est pas tératogène, et
qui risque peu sur ce terrain d'entrainer une
hypovolémie. Au contraire, en diminuant la
surcharge hydrosodée, il limitera le risque de
survenue d'une H.T.A. ou sa sévérité.
On peut poursuivre les traitements par cal-
cium et vitamine D, et il est recommandé d'y
associer un apport en acide folique. De même,
comme on l'a déjà dit, la correction de l'ané-
mie nécessite en général une augmentation
des apports en fer et des doses d'érythropoïé-
tine plus importantes.
Tous les traitements que la patiente reçoit
habituellement seront réévalués, pour ne
conserver que ceux qui sont sans risque pour
le foetus et indispensables pour la mère.
La surveillance obstétricale de la patiente
sera faite par des examens cliniques, écho-
graphiques et dopplers répétés, pour véri-
er l'état du col utérin et la contractilité de
l'utérus, la croissance foetale, le volume de
liquide amniotique, les indices de résistance
au niveau des artères utérines et des vais-
seaux du cordon ombilical. On réalisera aussi
des enregistrements cardiotocographiques,
si possible pendant les séances d'hémodia-
lyse, pour dépister une sourance foetale ou
la survenue d'une contractilité utérine anor-
male. Enn il est recommandé d'hospitaliser
la patiente à partir du terme où l'enfant est
viable, donc vers 26 à 28 semaines d'aménor-
rhée, à la fois pour permettre à la patiente un
repos maximum et pour pouvoir intensier la
surveillance obstétricale.
En conclusion
Malgré les progrès qui ont été faits ces der-
nières années, notamment en matière de thé-
rapeutique maternelle et de prise en charge
néonatale, le pronostic de la grossesse chez
une patiente dialysée reste encore mauvais. Il
est donc essentiel que toute femme jeune en
dialyse sache qu’elle reste féconde, et qu’une
contraception lui soit proposée.
De même il est souhaitable d’aborder le pro-
blème de la maternité, pour que la patiente
connaisse les risques d’échec que comporte
une grossesse, les complications qu’elle peut
entraîner, et les contraintes thérapeutiques
nécessaires pour que les chances de succès
soient optimales. Même si son pronostic s'est
beaucoup amélioré au l des années, la gros-
sesse chez une femme en dialyse reste une
aventure à très haut risque, qui nécessite une
mobilisation aussi précoce que possible de
tous les intervenants médicaux et paramédi-
La grossesse chez la femme dialysée
 6
6
 7
7
1
/
7
100%