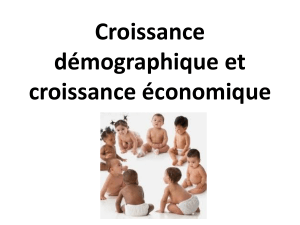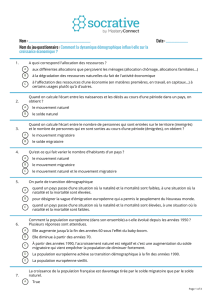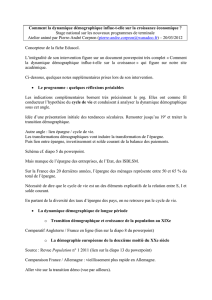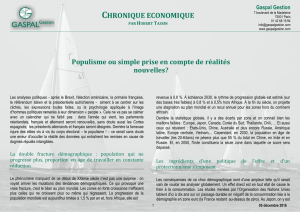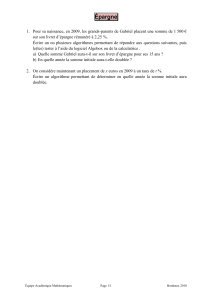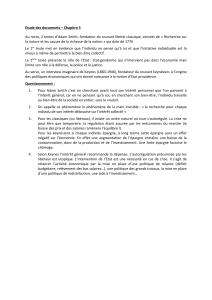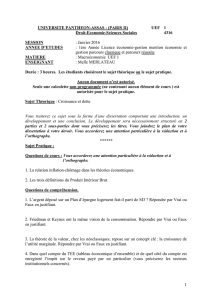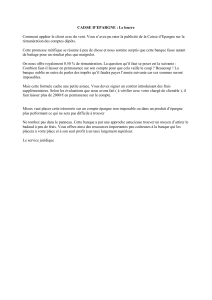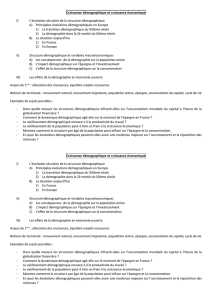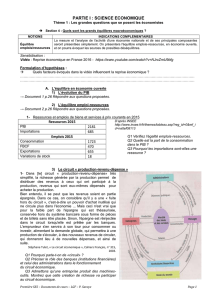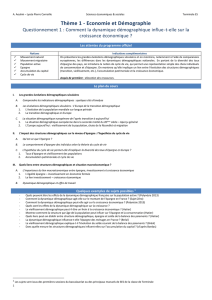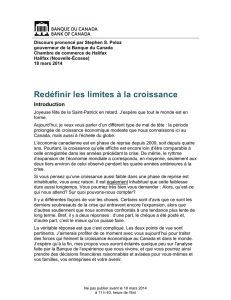TEA_-_2013-2014_-_1.1_et_1.2_

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille
Sciences économiques & sociales
2013 - 2014
1
Thème 1 - Economie et Démographie
Questionnement 1 : Comment la dynamique démographique influe-t-elle sur la croissance économique ?
Selon la définition proposée par l’ONU, la démographie serait « une science ayant pour objet l’étude des populations humaines, et traitant de leur dimension, de leur
structure, de leur évolution et de leurs caractères généraux, envisagés principalement du point de vue quantitatif ». La croissance économique est l’augmentation
sur une longue période d’un indicateur économique de dimension, en l’occurrence le PIB exprimé en termes réels. Les liens entre démographie et croissance
économique sont une des questions clés à laquelle tente de répondre la science économique, des économistes classiques (Malthus, Ricardo), jusqu’aux
développements plus récents qui ont cherché à valider empiriquement l’hypothèse du cycle de vie.
Les grandes évolutions démographiques séculaires
La dynamique démographique européenne et mondiale du début du 19ème siècle à nos jours peut-être synthétisée au travers de quatre périodes clés :
De 1850 à 1950, l’Europe connaît une période qualifiée de transition démographique. Ce modèle permet d’expliquer le passage d’un régime
démographique traditionnel (pré-transitionnel) caractérisé par des taux d’accroissement naturel faibles, avec mortalité et natalité élevées à un régime
démographique moderne (post transitionnel) caractérisé par des taux d’accroissement naturel faibles également, mais avec natalité et mortalité faibles.
Les caractéristiques de la transition démographique diffèrent selon les pays considérés (date de démarrage, étendue temporelle de la transition, …) mais il
en résulte une très forte croissance de la population, due à des taux d’accroissement naturels très élevés dans la période de transition (la mortalité
commençant à diminuer avant la natalité).
L’après seconde guerre mondiale est marquée par le baby-boom. Ce phénomène qui concerne principalement les pays d’Europe septentrionale et
occidentale se traduit par des hausses sensibles de la fécondité dans tous les pays dès 1945/46. Le baby-boom prend fin au début des années 70, la
natalité retrouvant partout en Europe des niveaux proches de ceux observés avant-guerre.
L’Europe connaît depuis les années 80/90 un phénomène de diminution régulière des taux d’accroissement naturel. Le taux d’accroissement total de la
population européenne passe de 9,7 pour mille entre 1950 et 1969 à 0,7 pour mille entre 1990 et 2000. Dans nombre de pays européens, la population
continue de croître en raison de soldes migratoires positifs. La faiblesse des taux d’accroissement résulte de la conjugaison d’une hausse de l’espérance de
vie (vieillissement par le haut) et d’une baisse de la fécondité (vieillissement par le bas), la France faisant figure à ces égards d’exception : la fécondité
demeure élevée (autour de 2 enfants par femme) et la croissance de la population reste expliquée par les mouvements naturels et non migratoires. Le
vieillissement de la population reste toutefois un phénomène généralisé : entre 1950 et 2010, la part des plus de 65 ans dans la population européenne a
progressé de 112%
L’impact des structures démographiques sur le niveau d’épargne : l’hypothèse du cycle de vie
La théorie du cycle de vie (Modigliani-Brumberg, 1954) vise à expliquer les différences d’épargne, en les reliant aux variables démographiques. Son point de départ
est microéconomique : les individus souhaitent maintenir le niveau de leur consommation tout au long de leur vie. Leur revenu évoluant en fonction de leur âge,
l’épargne, qui est le solde entre la consommation et le revenu disponible, évoluerait également avec l’âge :
Au début de la vie active, lorsque le revenu est faible, les individus s’endettent (leur épargne est négative) notamment pour financer leurs études
Par la suite, le revenu croît jusqu’à dépasser le niveau de consommation souhaité, ce qui se traduit par une épargne positive
Avec la retraite, le revenu décroît et les individus désépargnent à nouveau (en « consommant » leurs économies)
Si on retient une application stricte du modèle de cycle de vie, une vision courante des effets du vieillissement sur le long terme est de considérer qu’il doit faire
baisser l’épargne, puisqu’il accroît l’effectif des individus en âge de désépargne.
Empiriquement, cette hypothèse n’est pas validé si l’on observe les différences de taux d’épargne entre pays européens : pour ne prendre que cet exemple,
l’Allemagne, bien plus touchée par le vieillissement que la France, a un taux d’épargne bien plus élevé que la France depuis 2002.
La validité empirique de l’hypothèse du cycle de vie semble en revanche confirmée par les données relatives au patrimoine : en France, le patrimoine s’accroît tout
au long de la vie active et commence à diminuer en fin de vie, sans pour autant être complètement liquidé.
Plusieurs limites doivent amener à relativiser la portée de la théorie du cycle de vie, la principale résidant dans le fait que les comportements d’épargne sont résumés
à des motivations de consommation différée alors même que d’autres motivations existent (précaution, altruisme générationnel).
Les liens entre structures démographiques et situation macroéconomique
Le lien investissement / croissance économique
En partant de l’équilibre emploi-ressources en économie fermée, on montre que dans une économie fermée, le montant de l'investissement est strictement
équivalent au montant de l'épargne annuelle.
Or, empiriquement et théoriquement, il est également possible de montrer qu’il existe un lien entre investissement et croissance économique. Schématiquement,
dans le cadre d’une fonction de production simple, une hausse de l’investissement entraîne un accroissement du stock de capital, ce qui a pour effet d’accroître les
capacités de production et donc le PIB. L’investissement est également associé à une hausse de la productivité qui génère des revenus (baisse des prix ou hausse des
salaires) supplémentaires agissant positivement sur la demande et donc sur le niveau de production.
La croissance économique d'une nation est liée à son effort d'investissement et donc au niveau de l'épargne réalisée. Selon l’hypothèse du cycle de vie, les
transformations démographiques actuelles peuvent alors avoir des conséquences en termes de croissance économique. Une forte croissance démographique, qui
permet une augmentation du taux d’épargne, favorise des investissements élevés et une forte croissance économique. Inversement, le vieillissement
démographique risque de conduire à une réduction de l'effort d'épargne et d'investissement qui peut provoquer un ralentissement de la croissance.
L’impact de la démographie sur la population active
La démographie agit sur le nombre d’actifs sous l’effet de la variation de la population totale et par là de la population en âge de travailler. Une fécondité dynamique
et un solde migratoire positif sont favorables à un accroissement de la population active. En l’absence de politiques d’immigration plus ouvertes que celles
pratiquées aujourd’hui, les dynamiques démographiques actuelles se traduiraient, dans une cinquantaine d’années, par une baisse probable de la population de
l’Union et par un accroissement très sensible de la part des plus de 65 ans. Ce changement démographique conduira-t-il à une faible croissance ? La croissance
semble davantage due à l’amélioration de la productivité qu’à l’accroissement de la population active ou son vieillissement.

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille
Sciences économiques & sociales
2013 - 2014
2
Questionnement 2 : Quel est l’impact des variables économiques et démographiques sur le financement de
la protection sociale ?
La protection sociale, définie comme l’ensemble des mécanismes collectifs qui permettent aux individus de faire face aux conséquences (perte de revenu, hausses de
certaines dépenses) d’un certain nombre de risques sociaux (maladie, chômage, vieillesse sans ressources…), présente la particularité d’avoir un financement
sensible aux variables démographiques et économiques.
L’impact des variables économiques et démographiques sur le financement des retraites
Il existe deux grands types de régime de retraite :
- Le régime par répartition repose sur le principe d’un transfert des actifs vers les inactifs. Il s’agit d’un système fondé sur le principe de la solidarité entre
les générations : les actifs d’hier ont cotisé durant leur activité pour financer les pensions des retraités d’hier et les actifs d’aujourd’hui cotisent donc pour
recevoir demain des pensions financées par les travailleurs de demain.
- Dans un système par capitalisation, les retraites sont financées par la vente des actifs placés par les individus au cours de leur vie active auprès
d’investisseurs institutionnels. Chaque individu épargne pour financer sa propre retraite : la logique est donc individuelle.
On appelle taux de remplacement le rapport entre le montant de pension et le montant de revenu d’activité. Ce taux fournit des informations sur le niveau des
revenus de remplacement qu’un régime – ou, à un niveau agrégé, une nation entière – décide d’accorder à ses retraités par rapport aux revenus des cotisants.
Le régime français de retraite est structuré en trois niveaux :
- Les régimes de base obligatoires, qui représentent 72% des pensions versées en 2011, fonctionnent par répartition.
- Les régimes de retraite complémentaires obligatoires (26% des pensions versées en 2011) fonctionnent également par répartition et sont obligatoires.
- L’épargne retraite collective et individuelle, facultative. Ces formes d'épargne retraite, à rapprocher d’un régime de retraite par capitalisation connaissent
un développement récent mais ne représente que 2% des pensions versées en 2011.
Plusieurs contraintes pèsent sur le financement des retraites.
- Des contraintes démographiques pour commencer. Le rapport entre le nombre de personnes d’« âge inactif » (moins de 20 ans ou 60 ans et plus) et d’«
âge actif » (entre 20 et 59 ans), appelé aussi ratio de dépendance démographique, augmentera selon toutes les hypothèses. En 2007, il y avait 86
personnes d’« âge inactif » pour 100 d’« âge actif » ; il y en aurait 114 pour 100 en 2035 selon le scénario central de l’Insee, puis 118 en 2060. Le ratio de
dépendance économique (nombre d’actifs cotisants / nombre de retraités) passerait lui de 4 en 1950 à 1,2 en 2050.
- Des contraintes économiques également. On assiste à une réduction des cotisations sociales versées au système de retraite en raison d’une moindre
progression de la masse salariale, résultant à la fois d’une déformation du partage de la valeur ajoutée au détriment des salaires, de la réduction du
nombre d’ actifs occupés (donc cotisant), de la montée du chômage, de la faiblesse du taux d’activité des personnes à partir de 50 ans et de l’entrée
tardive des jeunes sur le marché du travail (avec de moins en moins de cotisants sur longue période).
Face à ces contraintes, les leviers d’actions sont les suivants :
- Augmenter les cotisations, ce qui peut avoir un impact négatif sur le niveau de demande des consommateurs et la compétitivité prix des entreprises.
- Augmenter la durée de cotisation, ce qui pose le problème de l’inégalité entre travailleurs en fonction de la pénibilité leur emploi et se heurte à la réalité
du taux d’activité des seniors en France
- Baisser le montant des pensions, ce qui peut entrainer une baisse du pouvoir d’achat des retraités et pose la question de l’égalité entre actifs et inactifs.
- Développer les systèmes par capitalisation, ce qui met en péril le caractère solidaire du système et pose problème en matière de justice sociale.
Le système de santé entre régulation marchande et administrée
Le système de santé français est largement organisé par la puissance publique et laisse la place à des mécanismes marchands. Cette articulation se traduit par :
- une offre de soins à la fois publique (hôpitaux public) et marchande (médecine libérale par exemple),
- un système d’assurance obligatoire géré par la puissance publique (Etat, Sécurité Sociale) par le biais de prélèvements obligatoires et de transferts
(monétaire ou en nature) que complète un système d’assurance facultative géré par des Mutuelles ou des compagnies d’assurance.
Ce système de santé est aujourd’hui soumis à une croissance des dépenses sous l’action de facteurs :
- démographiques : le vieillissement de la population fait augmenter les dépenses de santé qui ont tendance à être en hausse avec l’âge ;
- économiques : l’augmentation du niveau de vie engendre une augmentation de la consommation de biens supérieurs, les besoins de base ayant été
satisfaits ;
- politiques : choix de couvrir un plus grand nombre de personnes et renforcement des droits acquis ;
- technologiques : sophistication croissante des technologies médicales ⇒ hausse des prix relatifs des soins et produits de santé.
Face à cette croissance des dépenses de santé et au problème de financement qu’elle implique, les solutions sont complexes à mettre en œuvre en raison des
spécificités du marché de soin.
Les phénomènes de sélection adverse et d’aléa moral ne permettent pas d’envisager une régulation complètement marchande des systèmes de santé. Le marché de
la santé est en effet caractérisé par des asymétries d’information, entre assuré et assureur, mais également entre médecin et assuré voire financeur (Sécurité sociale
et Assureur).
- Il y a sélection adverse sur un marché lorsque l’asymétrie d’information conduit à éliminer les produits et/ou agents économiques de meilleure qualité.
Dans le cas de la santé, l’asymétrie d’information conduit à des problèmes de fixation du prix par l’assureur qui attire les clients en mauvaise santé et
repousse les clients en bonne santé.
- Il y a aléa moral lorsque, après la signature d’un contrat, l’une des deux parties est susceptible de léser l’autre en raison de l’asymétrie d’information qui
existe entre elles. Dans le cas du comportement de l’assuré, il peut modifier son comportement après signature du contrat d’assurance en n’effectuant
pas les actes de prévention requis ou en surconsommant les soins et biens de santé.
Face à ces asymétries, la mise en place d’incitations pécuniaires (ticket modérateur, franchises médicales…) peut permettre de juguler une partie du risque de
surconsommation de soins lié à l’assurance. La mise en place par les assureurs d’une tarification adaptée au profil de chaque assuré (questionnaire médical) peut
également apporter une réponse au phénomène de sélection adverse en amenant les assurés à dévoiler leur information privée.
Ces deux solutions posent toutefois un problème dans la mesure où elles peuvent entraîner une baisse de la qualité des soins ou l’aggravation des inégalités d’accès
aux soins.

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille
Sciences économiques & sociales
2013 - 2014
3
Définitions
Ci-dessous une liste des principales notions abordées dans ce premier chapitre. Au delà de la définition, il s’agit pour vous d’en maîtriser l’utilisation dans le
contexte de la problématique d’ensemble du chapitre. Les notions explicitement au programme sont encadrées.
Démographie : « La démographie est une science ayant pour objet l’étude des populations humaines, et traitant de leur dimension, de leur structure, de leur
évolution et de leurs caractères généraux, envisagés principalement du point de vue quantitatif » Dictionnaire démographique de l’ONU
Natalité : naissance comme composante des populations. Taux brut de natalité : pour une année donnée, nombre de naissances vivantes / population en milieu de
période
Fécondité : Naissances mises en relation avec l'effectif des femmes d'âge fécond. Taux de fécondité (généralement exprimé en nb d’enfants par femme) = Nb de
naissances vivantes / femmes en âge de procréer en milieu de période ; Indicateur conjoncturel de fécondité (également appelé somme des naissances réduites) :
somme, pour une année donnée, des taux de fécondité par âge.
Mortalité : décès comme composante des populations. Taux brut de mortalité : Nombre de décès / population moyenne au cours de l’année. Exprimé en ‰.
Mouvement (ou solde) naturel : Mouvement de population (à la hausse ou à la baisse) expliquée par les différences entre mortalité natalité Nombre de
naissances – Nombre de décès ; Taux d’accroissement naturel : solde naturel sur une période / population moyenne sur cette période
Mouvement (ou solde) migratoire : Mouvement de population (à la hausse ou à la baisse) expliquée par les différences entre immigration et émigration
Transition démographique : Modèle permettant d’expliquer le passage d’un régime démographique traditionnel – pré-transitionnel - (taux d’accroissement naturel
faible, mortalité et natalité élevée) à un régime démographique moderne – post transitionnel - (taux d’accroissement naturel faible, natalité et mortalité faible).
Epargne : partie non consommée du revenu disponible ; Taux d’épargne = Epargne Brut / Revenu Disponible brut
Hypothèses (ou Théorie) du cycle de vie : Selon le modèle de Modigliani, les individus souhaitent maintenir le niveau de leur consommation tout au long de leur âge
adulte. Leur revenu évoluant en fonction de leur âge, l’épargne, qui est le solde entre la consommation et le revenu, évoluerait également avec l’âge, avec une
décroissance du revenu et donc de l’épargne des individus à l’âge de la retraite.
Accumulation du capital : processus par lequel le dans une économie s’accroît le stock de capital. L’accroissement de ce stock de capital résulte des flux antérieurs
d’investissement.
Solde des transactions courantes (= solde courant de la balance des paiements) : (X – M) + Solde des revenus primaires et de transfert avec le reste du monde
Population active : ensemble des individus qui ont un emploi ou qui en cherchent un (chômeur)
Protection sociale : ensemble des mécanismes collectifs qui permettent aux individus de faire face aux conséquences (perte de revenu, hausses de certaines
dépenses) d’un certain nombre de risques sociaux (maladie, chômage, vieillesse sans ressources…)
Retraite : situation d’un individu qui présente les conditions d’âge et d’ancienneté́ lui permettant de cesser son activité́ professionnelle et de bénéficier d’un revenu
de remplacement que l’on appelle pension de retraite.
Régime de retraite par répartition : Le régime par répartition repose sur le principe d’un transfert des actifs vers les inactifs. Il s’agit d’un système fondé sur le
principe de la solidarité entre les générations : les actifs d’hier ont cotisé durant leur activité pour financer les pensions des retraités d’hier et les actifs d’aujourd’hui
cotisent donc pour recevoir demain des pensions financées par les travailleurs de demain.
Régime de retraite par capitalisation : Dans un système par capitalisation, chaque individu épargne pour financer sa propre retraite : la logique est donc individuelle.
Les générations d’actifs cotisant à un fonds de pension percevront un revenu, quand ils seront retraités, lié à la valorisation des actifs gérés par ce fonds.
Ratio de dépendance démographique : Nombre de personnes de moins de 20 ans ou de 60 ans et plus / Nombre de personnes entre 20 et 59 ans
Ratio de dépendance économique : Nombre d’actifs cotisants / nombre de retraités
Taux de remplacement : Un taux de remplacement rapporte un montant de pension à un montant de revenu d’activité, et fournit donc des informations sur le
niveau des revenus de remplacement qu’un régime – ou, à un niveau agrégé, une nation entière – décide d’accorder à ses retraités par rapport aux revenus des
cotisants.
Sélection adverse : Il y a sélection adverse sur un marché lorsque l’asymétrie d’information conduit à éliminer les produits et/ou agents économiques de meilleure
qualité. Dans le cas de la santé, l’asymétrie d’information conduit à des problèmes de fixation du prix par l’assureur qui attire les clients en mauvaise santé et
repousse les clients en bonne santé.
Aléa moral : Il y a aléa moral lorsque, après la signature d’un contrat, l’une des deux parties est susceptible de léser l’autre en raison de l’asymétrie d’information qui
existe entre elles. Dans le cas du comportement de l’assuré, il peut modifier son comportement après signature du contrat d’assurance en n’effectuant pas les actes
de prévention requis ou en surconsommant les soins et biens de santé.
Incitations pécuniaires : système d’avantages ou de désavantages monétaires utilisés par un acteur afin d’inciter un autre acteur à se comporter conformément à
son intérêt. Dans le cas de l’assurance santé, le ticket modérateur est un exemple d’incitations pécuniaires.
1
/
3
100%