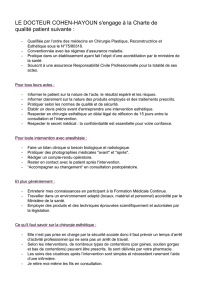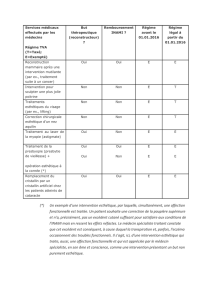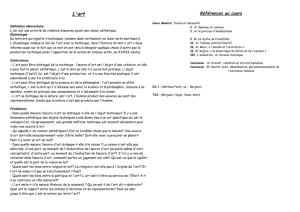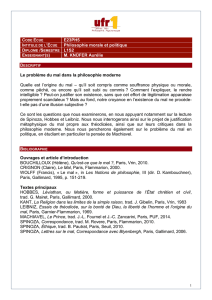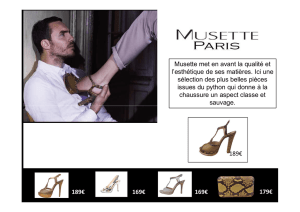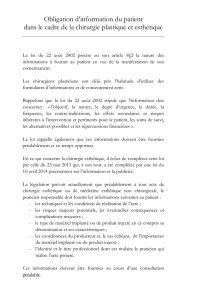Plan de cours - Département de philosophie

1
UQAM Plan de cours
PHI-4048
ESTHETIQUE
Session : Hiver 2010
Code du cours : PHI 4048
Horaire : Mercredi 18.00-21.00
Local : A-1750
Responsable : Mario Dufour
Téléphone : 987-4377 (boîte vocale : 9360)
Courriel : dufour.m@uqam.ca
DESCRIPTION (du cours selon l’annuaire)
Études des paradigmes selon lesquels la question du beau et celle de la réalité de
l’oeuvre d’art ont été pensées dans l’histoire de la philosophie. Les attaches du discours
esthétique à une anthropologie et à une métaphysique ; les approches de l’esthétique
philosophique contemporaine (herméneutique, pragmatique, analytique, sémiotique,
etc.).
INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE
Aussi loin que peut remonter le discours philosophique dans son souci de rendre compte de
ce qui est et de ce qui apparaît, bref du réel, que celui-ci soit naturel ou oeuvre instituée, se
manifestent un ensemble de préoccupations et un domaine de questions et de réponses, implicites et
explicites, qui touchent aux plaisirs, aux sentiments, aux jugements, aux valeurs et à la
compréhension de ce qu’est l’art et la beauté. La philosophie entretient depuis toujours un lien
étroit, sans doute constitutif, avec l’esthétique entendue comme discours réflexif sur le beau et
l’oeuvre d’art. Bien sûr, l’art, et l’appréhension du beau qui est devenue sa caractéristique principale

2
ou la plus commune, n’ont pas attendu la philosophie. Ils sont des activités et des expressions les
plus archaïques de l’humanité et de la culture. Aussi loin qu’on remonte dans le temps, on trouvera
des témoignages de ce sens esthétique universel de l’humanité : il s’agit de penser aux fresques des
grottes de Lascaux ... « le petit chien de M. Bergeret, dit Anatole France, ne regardait jamais le bleu
du ciel incomestible ». Malgré tout, la naissance de la philosophie marque un tournant et un coup de
force. Les premières ébauches de l’objectivité et de l’altérité des choses, lesquelles apparaissent
dans la philosophie grecque, coïncident avec la régression de la pensée magique et l’apparition
d’une idée « désintéressée », objective, conforme à la Raison, non seulement du Vrai, du Bien mais
aussi du Beau. Le concept se détache de l’image comme de son double, la raison absorbe le beau.
Au coté du Vrai et du Bien, le Beau deviendra l’un des visages, l’un des « transcendantaux » les
plus génériques de l’être ou du réel, l’une des valeurs les plus structurantes du discours. La question
du beau et de son rapport aux œuvres de l’homme (arts) et aux œuvres de la nature recèle non
seulement une portée universelle et ontologique mais aussi quotidienne, ancrée dans la perception et
les préoccupations les plus lointaines de l’humanité.
Selon le philosophe Heidegger, l’esthétique est « la science du comportement sensible et
affectif de l’homme et de ce qui le détermine », entendu que ce déterminant est le beau, lequel peut
apparaître aussi bien dans l’art que dans la nature. Mais le sens que nous attribuons aujourd’hui au
mot et au concept d’ « esthétique » est relativement récent. En effet, si l’adjectif est devenu
synonyme de beau et que le substantif est devenu synonyme de théorie de l’art, de science du beau
dans la nature ou dans l’art, l’ « esthétique » comme discipline spécifique ayant pour objet le
jugement d’appréciation du beau à travers le sentiment date seulement du XVIIIième siècle. En effet,
les divers discours théoriques dont l’ambition est de définir les éléments, les conditions, les
principes et les lois du beau seront regroupés sous le terme d’esthétique, forgé par le philosophe
allemand Baumgarten (Aesthetica, 1750-1758) à partir du grec aisthesis (faculté de sentir). Selon
son acception étymologique, le terme d’esthétique renvoie d’abord à l’idée d’une « théorie » du
sensible et à la faculté de l’esprit d’être affecté par les sens, qui reste, avant le XVIIIième siècle,
relativement indépendante d’une théorie de l’art et d’une théorie du beau. Le terme forgé par
Baumgarten renvoie à une connaissance sensible intermédiaire entre la pure sensation obscure et
confuse et la pure intellection rationnelle et claire, connaissance qui concerne la forme artistique
plutôt que son contenu. Cette indépendance de la forme sur le contenu et cette idée d’un
intermédiaire entre le rationnel et le sensible ont orienté les recherches ultérieures et l’émancipation
de l’art et de la beauté par rapport à la vérité. Cette valorisation de la sensibilité en liaison avec
l’appréciation du beau et de l’art indépendamment de la théorie de la connaissance et de la morale
ne semble pas avoir existée auparavant. Ainsi, selon Kant (dans Critique de la faculté de juger de
1791) l’oeuvre d’art possède une autonomie et une finalité internes qui sont indifférentes à son
contenu de vérité, et le jugement de goût traduit un accord entre l’imagination, l’entendement et la

3
raison où l’esprit jouit d’un pur plaisir qu’il prétend partageable sans pouvoir en démontrer le
fondement.
Le terme d’esthétique est récent, moderne, mais la chose même que le nom dénomme, c’est-
à-dire la réflexion sur l’art et le beau est aussi vieille que la pensée occidentale. Il faut penser
l’autonomisation de l’esthétique et la valorisation de la sensibilité sur le fond des doctrines
antérieures et des développements de la philosophie des Anciens (Platon, Aristote, Plotin) et ceux de
la philosophie médiévale (Bible, St-Augustin, St-Thomas d’Aquin). C’est que les premières
réflexions philosophiques sur le beau et l’art donnent déjà à l’esthétique ses présupposés et ses
concepts les plus structurants : nature et technè, matière et forme, sensibilité et intelligibilité,
réceptivité et productivité, modèle et copie, illusion et vérité, etc. C’est pourquoi on se penchera sur
les principaux moments de la réflexion philosophique qui concerne l’art et le beau depuis l’origine
platonicienne jusqu’à nos jours. Il s’agit de mettre en place un certain nombre de traits distinctifs et
de questions fondamentales qui structurent cette réflexion. Dans ce dessein, nous dégagerons, en
nous appuyant sur le travail et les recherches de Marc Sherringham dans son Introduction à la
philosophie esthétique, certains des « paradigmes » les plus saillants de l’histoire de la philosophie,
dont l’esthétique, « science du comportement sensible et affectif de l’homme », à bien y réfléchir,
n’est qu’un autre nom. Il s’agit de mettre en relief les grandes structures conceptuelles qui ont fixé
pour une période donnée les règles du discours de la philosophie esthétique ; l’identification de ces
grandes structures spécifiques peut se réaliser en isolant certaines des ses dimensions les plus
importantes : la localisation du beau, la définition du beau, le statut de l’art, l’appréhension du beau
et la production de l’art. Trois matrices paradigmatiques peuvent dès lors être isolées : le
classicisme, le criticisme et le romantisme.
I. Le classicisme (largement initié par Platon, l’antiquité et l’intuition de la Belle Totalité)
repose sur l’identification du beau avec la perfection de l’être saisie comme ordre, harmonie,
proportion, totalité achevée et cosmos dépassant l’être humain. Le Beau est objectif et intelligible, il
n’est ni relatif, ni sensible, il dépasse la perspective de l’individu. L’art est soumis à une réalité
idéale qui le précède. L’art est lié au beau s’il reproduit la structure de la réalité idéale ou naturelle,
mais cette beauté sera toujours inférieure à celle de l’être. Car l’art est imitation, copie de l’être ou
de la nature, donc par définition nécessairement inférieure et secondaire : l’art est fabrication et la
fabrication est inférieure à la contemplation théorique de l’ordre et de la beauté de l’univers (créée
par l’intelligence divine). Le classicisme s’établit sur cette séparation de la beauté et de l’art, et cet
écart entraîne ipso facto une dévalorisation de l’art par rapport à l’être. L’appréhension du beau
(perfection et plénitude) est source de désir (imperfection et manque). L’esthétique, parce qu’elle
réfère d’abord comme son étymologie l’indique à la sensibilité et que la philosophie se définit
comme dépassement du monde sensible, occupe une place seconde.

4
II. Il faudra attendre la modernité et la renaissance, l’intensification du subjectivisme
(insistance sur la sensibilité, la relativité du goût, la créativité, la nouveauté et l’innovation) pour
ébranlé le classicisme. Le second grand modèle ou paradigme de l’esthétique philosophique prend
se cristallise avec la pensée de Kant, i.e. le criticisme (XVIIIe siècle), lequel repose sur le lent mais
décisif renversement de la valorisation du sujet sur celle objective de l’être. Kant opère en
philosophie ce qu’il appelle une révolution « copernicienne », l’objet tourne autour du sujet et nul
part ailleurs que dans l’esthétique celle-ci n’est autant visible : il n’y pas de science du Beau, de
propriété objective à laquelle réfère l’idée de beauté, celle-ci est dépendante du sentiment
qu’éprouve la subjectivité dans le jugement esthétique de goût. D’autre part, l’œuvre artistique fait
intervenir les éléments mystérieux du génie et de la créativité, de la pensée inconsciente qui
demeurent sous-estimés bien que clairement aperçu dans le classicisme. En conséquence, l’art cesse
d’être inférieur, hétéronome, soumis à l’être, à la connaissance ou à tout autre domaine supérieur : il
devient autonome, indépendant, trouve sa fin en lui-même. Que le beau soit naturel ou artistique, il
n’est plus que l’occasion pour le sujet d’éprouver un sentiment de plaisir pur désintéressé (distinct
de l’agréable, de l’utile et du bon) que Kant prétend partageable, et produire de l’art revient à
présenter des formes libres (Idées esthétiques) en définitive inexplicables mais exemplaires et
instituantes pour le monde de l’art. L’idée tout à fait révolutionnaire d’un Art pour l’Art ne tardera
pas à apparaître.
III. Le troisième grand moment de l’esthétique est le romantisme (XIXe et XXe siècle) se
déployant à partir de cinq auteurs fondamentaux : Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche et
Heidegger. Le romantisme est l’inversion du classicisme : ce n’est pas l’art qui manque de vérité,
c’est la vérité qui a besoin d’art. Le statut de l’art n’est plus alors inférieur (classicisme), ni
autonome (criticisme), mais souverain (l’artiste est un « voyant » comme le dira Rimbaud,
l’imagination est la reine des facultés selon la formule de Baudelaire). L’art n’est plus imitation
servile, mais création qui dévoile ce qu’on ne voit pas dans l’expérience ordinaire, expression d’une
intériorité en résonance et/ou en conflit avec le monde. Le beau manifeste alors la réconciliation
et/ou la tension de la nécessité et de la liberté, de l’objectivité et de la subjectivité, du monde et de
l’homme, i.e. l’absolu, et il se définit comme révélation de la vérité elle-même. Le romantisme
affirme l’identité du beau et de l’art et aboutit à la définition de l’esthétique comme théorie de l’art.
L’art nous fait voir ce que le quotidien, le travail et la connaissance scientifique ne voit pas : il nous
renvoie à la connaissance ultime, à la révélation ou au dévoilement de l’unité profonde de l’homme
et du monde, de l’intériorité et de l’extériorité, de la pensée et de la non-pensée.
La mise en lumière de ces paradigmes ne doit pas nous faire oublier que l’esthétique pose
des difficultés considérables de définitions. Celles-ci sont sans doute irréductibles parce que liées à
l’écart du discours (toujours généralisant, cherchant l’essence du beau, l’essence de l’art) et son
objet (le beau et l’oeuvre d’art étant toujours sensible, toujours singulier, résistant au langage, à la

5
compréhension ordinaire, utilitaire et conceptuelle). Nul doute que l’esthétique, le discours sur
l’oeuvre d’art est grevé au départ d’une double hypothèque, disloquée par une tension entre le
jugement subjectif et la prétention à l’universalité, l’affect subjectif et la volonté d’intelligibilité.
Elle ne saurait sans renier son objet, par nature sensible et concret, donc singulier, se transformer en
une sorte de « métaphysique du beau » sur laquelle elle doit pourtant appuyer ses jugements de
valeurs et ses analyses en tant que « science » plus ou moins normative et générale. Mais elle ne
saurait sans tomber dans le particulier, l’arbitraire, voire le bavardage, se confondre avec une
critique des oeuvres qui ne s’appuierait ni sur des principes déterminés ni sur des concepts
philosophiques plus précis. Au-delà du partage moderne entre jugement objectif de fait et jugement
relatif de valeur, cette double appartenance laisse l’esthétique mal définie, inquiète, partagée entre
deux exigences opposées. Cette dualité reflète très bien la nature ambivalente de son objet : l’art. En
effet, l’oeuvre appartient au monde sensible, elle vient à nous par la voie des sens. Mais il va de soi
qu’elle ne s’adresse pas seulement aux sens... Ambiguïté du « sens » ... L’esthétique est difficile à
définir. Elle échappe à l’opposition de la pure connaissance (que veut dire cette œuvre ?) et de la
seule sensibilité immédiate (« moi » je trouve ça beau), de même qu’à l’idéal d’univocité et de
définition de la philosophie (même si à l’origine elle se confond avec l’éclat de cet idéal). Elle
communique avec une chaîne de concepts et de thèmes plus ou moins compatibles avec cet idéal et
avec le projet de dépassement du sensible : le corps, la matière, la subjectivité, la sensibilité, le désir,
le plaisir, l’affectivité, l’illusion, l’imagination, la fiction, l’erreur, le mensonge, l’apparence… De
plus, la facilité avec laquelle la beauté peut être attribuée, indépendamment des oeuvres d’art, à des
choses ou à des personnes spontanément qualifiées de belles (un beau paysage), sans même qu’elles
présentent forcément un intérêt premièrement esthétique (une belle farce, un beau geste, une belle
chaise) est évidente. C’est pourquoi la plupart des travaux contemporains d’esthétique ont le plus
souvent renoncé à repérer des normes du beau, à l’exemple de la logique par rapport au vrai ou de la
morale par rapport au bien. Elles font porter leurs recherches soit sur le l’étude des formes elles-
mêmes (selon une méthode structurale ou sémantique), soit sur rapport de ces formes dans leur
développement historique (Panofsky), soit sur les relations qui peuvent exister entre une oeuvre et
son créateur (approche sociologique ou psychologique). Dans tous les cas, une approche plus
descriptive ou plus explicative, plus phénoménologique, prend le dessus sur l’approche prescriptive.
Ce changement coïncide aussi avec l’émancipation de l’art, laquelle s’accompagne sans
doute paradoxalement de ce que Hegel appelait « mort de l’art ». En effet, la culture moderne de
l’égalité, de l’autonomie, et de la reproduction mécanisée (Benjamin) s’accompagne de la question
de la désublimation, de la sécularisation, de la désacralisation des oeuvres... pensons au surréalisme
et au dadaïsme (tout peut devenir oeuvre d’art). Si l’oeuvre d’art participe du processus de négation
sans limite qui ne s’épargne pas lui-même (Adorno, Lipovetsky), ne nous faut-il pas méditer
l’annonce prophétique de la mort de l’art par Hegel ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%