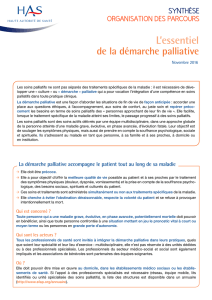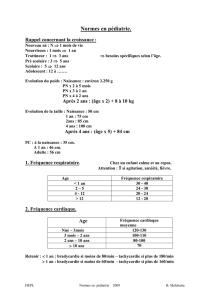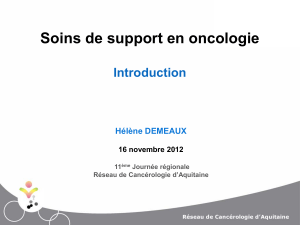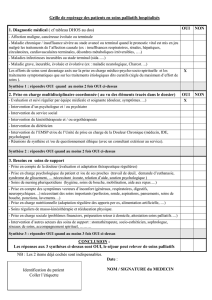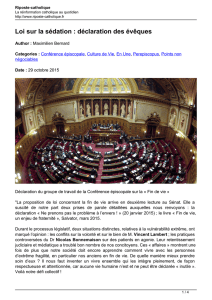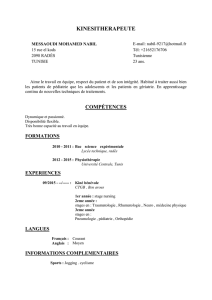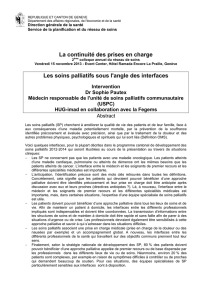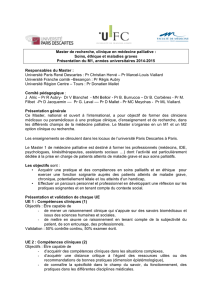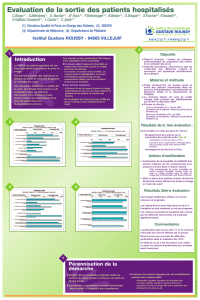Pédiatrie : démarche palliative, droit des malades en fin de vie

Journal Identification = MTP Article Identification = 0419 Date: February 13, 2012 Time: 11:4am
Dossier
mt pédiatrie 2012 ; 15 (1) : 38-42
Pédiatrie : démarche palliative,
droit des malades en fin de vie*
Paediatrics : Palliative procedure, patients’right at the End-of-Life
Marcel-Louis Viallard
EA 4659,
Département «Médecine, Vulnérabilité,
Ethique, Société »,
Université Paris Descartes,
PRES Sorbonne Paris Cité,
France
<Marcel-louis. [email protected]>
EMASP Pédiatrie & Adulte,
Necker Enfants Malades,
APHP,
149, rue de Sèvres
75015 Paris,
France
Résumé. La loi franc¸aise sur le droit des malades en fin de vie introduit la notion de traitement
déraisonnable, l’obligation de décision collégiale et de respect des directives anticipées. Elle
reste relativement silencieuse sur les situations pédiatriques complexes. La notion du respect
du sujet dans ses vulnérabilités est questionnée. La collégialité facilite un travail de raison
partagée et permet une approche éthique qui est détaillée. Les notions de «prendre soin »
et de «déraisonnable »au cours d’une démarche palliative sont présentées. Une réflexion
éthique sur la notion du temps en soins palliatifs est proposée Quelques spécificités de la
démarche palliative en pédiatrie sont discutées.
Mots clés : démarche palliative, pédiatrie, droit des patients, fin de vie
Abstract. French law about patients’right at the End-of-Life introduce some notions like unrea-
sonable obstinacy, obligation of collegially decision and respect of anticipated patient’s
instructions. Law says nothing about complex paediatric cases. The notion of human per-
son’s respect, with her vulnerability is questioned. Collegiality makes easier a shared work of
reason and an ethical approach of the complex situation which is detailed. Taking care and
unreasonable notions during a palliative procedure is introduced. An ethical reflexion about
the notion of time in palliative medicine is proposed. Some specificity of paediatric palliative
care are discussed.
Key words: palliative procedure, paediatrics, patients’right, end-of- life
La loi franc¸aise sur le droit des
malades en fin de vie repré-
sente une avancée dans la gestion
médicale, soignante et humaine des
situations de fin de vie complexes.
Elle permet en effet aux profes-
sionnels de privilégier à la fois la
volonté et les intérêts de la personne
malade. La loi introduit la notion de
traitement déraisonnable et facilite
ainsi l’évitement de tout acharne-
ment thérapeutique en introduisant
l’obligation de décision collégiale et
de respect des directives anticipées.
La loi ne résout pour autant pas tous
les problèmes éthiques rencontrés en
fin de vie. Elle reste relativement
silencieuse sur les situations pédia-
triques complexes.
Cependant, elle redonne au
patient (qu’il soit adulte ou enfant)
sa place première et essentielle de
sujet. La notion de dignitéaàvoir
avec le sujet lui-même. De même
elle replace le sujet dans une posi-
tion d’acteur et de non de spectateur
dans les décisions qui le concernent.
À défaut, le sujet peut être représenté
par une personne de confiance qu’il
a librement désignée. Dans le cas
particulier de l’enfant, ce seront ses
parents ou leur substitut qui occu-
peront cette place de personne de
confiance.
Pédiatrie : démarche
palliative, droit
des malades en fin de vie
Le sujet est au centre de
toutes les préoccupations dans ses
vulnérabilités, avec tous ses pos-
sibles comme tous ses impossibles.
∗Avertissement : Ce travail est le fruit de la synthèse proposée à la fin de la journée organisée
par l’équipe régionale ressource en soins palliatifs pédiatriques de l’Île de France (PALIPED) le
31 mai 2011 à Paris sur le thème «Loi Léonetti et pédiatrie »dont le programme est consultable
sur internet à l’adresse : http://www.rifhop.net/paliped/journee-du-31-mai-2011
doi:10.1684/mtp.2012.0419
mtp
Tirés à part : M.-L. Viallard
38
Pour citer cet article : Viallard ML. Pédiatrie : démarche palliative, droit des malades en fin de vie. mt pédiatrie 2012 ; 15(1) : 38-42 doi:10.1684/mtp.2012.0419
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Journal Identification = MTP Article Identification = 0419 Date: February 13, 2012 Time: 11:4 am
La vulnérabilité n’est pas que le fait du sujet malade, qu’il
soit nouveau-né, enfant, adolescent, adulte ou vieillard.
Les professionnels doivent aussi ne pas oublier qu’ils ont
au-delà de leurs compétences, de leurs possibles, eux
aussi leurs impossibles, leurs vulnérabilités. La collégia-
lité imposée pour l’instruction de toute décision médicale
est un impératif qui participe à l’émergence du respect du
sujet comme acteur de sa vie, de son temps, de ses intérêts.
Aussi vulnérable qu’il soit, malgré ses incapacités liées à
son âge, à sa pathologie ou à toute autre raison, le sujet
pourra bénéficier de regards, d’approches et compétences
croisées de fac¸on à questionner ses intérêts au plus près
de leur possible expression.
La collégialité induit comme impératif de ne pas déci-
der seul, de confronter sa rationalité comme ses ressentis
et ses projections ou interprétations avec celles des autres.
Elle facilite l’impérieuse nécessité de sortir d’une atti-
tude projective d’appropriation voire d’identification qui
peut être «désujettisante », plac¸ant le sujet en posi-
tion «d’objet »de désir, d’illusion, etc. Elle permet de
rendre au sujet toute sa place. Il en est de même pour
l’entourage (et donc pour les parents). Le sujet est ainsi
pris en considération en tant que tel et au-delà de ceux
qui le représentent. Les parents, les conjoints, les enfants,
les frères ou sœurs, les proches, quel que soit l’âge, sont
des tiers représentants indiscutablement, mais le sujet lui,
prime. Le simple fait d’être, lui donne le statut central.
Il paraît difficile objectivement de consentir pour autrui.
Tout au plus pouvons-nous prétendre que ce qu’à quoi
nous consentons nous paraît le plus raisonnable, le moins
mauvais à défaut du mieux. Cela un peu dans la notion
reprise par Kant [1] quand il conseille de ne pas faire à
autrui ce que l’on ne voudrait pas que l’on nous fît.
La collégialité facilite aussi l’émergence d’un possible
travail de raison partagée. Elle permet aussi de garantir une
approche éthique par étapes. La première approche étant
celle de l’éthique de conviction, moment d’expression
de la visée éthique qui va être confrontée à l’obligation
morale comme l’a décrit Paul Ricœur [2]. C’est le moment
où chaque acteur peut exprimer sa capacité à vouloir
(voire pouvoir) le bien ou le moins mauvais pour l’autre
que lui. Le moment où chacun exprime l’estime de soi qui
participe à l’expression de ce qu’il est, comme il est (son
background socioculturel). C’est aussi le moment pendant
lequel vont se mobiliser à la fois ces connaissances, ses
croyances, ces projections et interprétation. La seconde
étape est celle de l’éthique de discussion ou le «Je »(le
en-soi) rencontre le «tu »(l’autre que soi) comme le «Il »
(le tiers présent ou absent). La seconde approche, celle
de l’éthique de la discussion est l’instant des échanges,
de la rencontre, de la confrontation des convictions, des
ressentis, des interprétations voire projections des uns et
des autres. Viens ensuite l’étape de l’approche en res-
ponsabilité, qui amène chacun à identifier ses possibles,
ses impossibles, en d’autres termes les limites de soi, de
l’autre, des autres comme celle du tiers absent (en d’autres
termes de la société). La question des limites est probable-
ment cruciale en ce qu’elle ramène chacun à ce qu’il est,
un être-là au monde. Au monde, dans un monde qui n’est
pas centré sur lui. Ce n’est pas lui qui est le monde ni le
monde qui est lui. Il est simplement mais totalement être
dans le monde, monde non nécessairement pensé pour
lui, parfois hostile, parfois si étranger à lui qu’il n’en sait
que peu. Comme quoi Platon avait raison de faire dire, en
substance, à Socrate dans son apologie : «Je ne sais qu’une
chose c’est que je ne sais pas tout ou si peu, il me reste tant
à apprendre ». Derrière la question des limites, des pos-
sibles ou impossibles, il y a celle du doute. Doute non pas
comme paralysant mais bien comme moteur, comme désir
de rencontre, d’aller au plus loin dans le monde pour le
mieux connaître. Connaître n’est pas maîtriser. Ce pourrait
être le chemin pour développer une étape complémentaire
qui pourrait être une éthique de finitude. Finitude, non pas
comme renoncement, soumission, repli sur soi, obnubilé
que l’homme pourrait être de sa condition mortelle, mais
finitude au sens d’aller vers la fin en soi plus que vers la
fin de soi. La fin en soi étant d’être, totalement être, dans
ce monde malgré les étrangetés auxquels il me confronte,
préservant le sens d’être à chaque instant, en toute cir-
constance. La condition de mortel n’est qu’un fait, une
réalité, une limite qui ne doit en rien empêcher le vivre,
la vie, le sens et la mobilisation de soi. Chaque singularité
étant participative à l’émergence du sens partagé, d’une
part de sens commun permettant à chaque être humain
de dire, à sa fac¸on, dans ses limites, avec ses doutes de
l’humain, du sens. Cela malgré l’incertitude de l’être-au-
monde. La collégialité, plus particulièrement quand elle
est ouverte à tiers neutres et bienveillants est un outil utile
pour sortir celle ou celui sur qui pèse la responsabilité
de la décision de la solitude décisionnelle. Elle lui garan-
tit la prise en considération des différentes dimensions
du questionnement nécessaire qui mobilisent les grands
principes cardinaux de l’éthique : liberté, responsabilités,
autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, etc.
Prendre soin
comme objectif premier
Beaucoup de ce qui vient d’être décliné est dans la
rencontre, dans la présence à l’autre pour faire face à
cette incertitude d’être-au-monde. De moi, de l’être, de
l’homme, l’autre m’en dit, m’en témoigne tout autant que
je peux le faire. Autrement dit, c’est ensemble, au sein
de la rencontre, qu’ensemble nous disons de nous, de soi
comme de l’autre de soi. Ensemble nous pouvons parta-
ger cette incertitude, cette inquiétante étrangeté du monde
et ainsi dépasser notre simple singularité. C’est pour-
quoi nous pouvons considérer que soigner, prendre soin,
c’est d’abord et avant tout rencontrer [3, 4]. La rencontre
mt pédiatrie, vol. 15, n◦1, janvier-février-mars 2012 39
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Journal Identification = MTP Article Identification = 0419 Date: February 13, 2012 Time: 11:4 am
Pédiatrie : démarche palliative, droit des malades en fin de vie
permet de penser l’éthique au-delà des convictions, dans
la discussion, en responsabilité, malgré les limites dans la
finitude qui n’est autre que la possible projection de l’être
au sein du monde dans un «advenir »(au sens avenir dont
le sujet reste acteur).
Le déraisonnable est une notion qui ne peut
qu’interroger. Une décision, un acte, un dire peut être
déraisonnable mais pour qui ? Pour quoi ? En quoi ? Ilyalà
aussi appel au sens, travail de raison et questionnement de
nos projections, de nos interprétations, de nos émotions.
Là encore, il est nécessaire de dépasser les seules connais-
sances médicales ou techno-scientifiques et d’élargir les
champs de notre questionnement éthique et donc nos
actions soignantes et humaines.
Les notions de raisonnable ou de déraisonnable,
d’approprié ou non, invitent à décliner l’offre de prise en
charge comme un projet de vie et de soins partagé avec
le sujet lui-même. C’est le cœur même de la démarche
palliative.
Ce projet de soin se conc¸oit comme partagé avec
le sujet −enfant, adulte ou vieillard −considéré comme
acteur (efficient ou potentiel s’il ne le peut être) de sa
vie, de son désir, de son aspiration. Cette notion de projet
partagé implique également la prise en considération du
projet de vie, des désirs, de la qualité «d’acteurs »des
parents en pédiatrie tout particulièrement voire même des
professionnels soignants. S’inscrire dans une telle perspec-
tive nécessite du temps. Il est donc important de penser le
temps.
Penser le temps
Dans la réalité clinique et accompagnante, la question
du temps revient régulièrement. En médecine palliative,
on évoque souvent le fait que le temps du patient n’est
pas le même que celui des entourages ou que celui des
soignants. On parle des temps des uns et des autres et de
ces temps qui se croisent.
Cette conception mérite que l’on s’y arrête car elle
est probablement, en pédiatrie, bien plus prégnante et
plus indispensable à penser que ce soit en néonatalo-
gie, en oncohématologie pédiatrique, dans le champ des
pathologies génétiques, la mucoviscidose, ou en neuro-
pédiatrie.
On pourrait, à la suite des travaux de Franc¸ois
Jullien [5], tenter de penser le temps comme un moment.
Le temps, tel qu’il est habituellement pensé en Occident
est un concept extensif. Il a un début et une fin. Le moment,
lui, est intensif. Il n’a ni début ni fin, simplement il est !
De fait penser le temps comme un moment amène à «se
tourner vers »le sujet nous dit ce philosophe. C’est en cela
que penser le temps en moment participe à donner sens
et consistance à ce que l’on appelle «disponibilité »et
pourquoi pas à la notion d’accompagnement.
La disponibilité se pense alors selon le moment : un
projet de vie et de soin qui évolue au gré du moment
qui appartient au sujet et que l’on traverse avec lui, à ses
côtés, à notre place. Dès lors, la disponibilité ne peut plus
s’envisager comme simple intériorité, simple intentionna-
lité, simple visée éthique théorique. Elle oblige à se tourner
vers le sujet et non seulement vers le projet de soin ou
de vie qui n’est, de fait, que moyen, ou plutôt, tentative
d’expression d’un compromis entre le sujet lui-même en
tant que tel, les parents ou le tiers représentant, les soi-
gnants ou professionnels et la société elle-même. Le sujet
est placé en ad-venir même sans avenir, comme acteur
jusqu’à sa mort tout au long de sa vie, serait-elle brève
voire fugace.
Par ailleurs, la pensée de F. Jullien est un éclai-
rage innovant qui peut être fort utile dans les situations
complexes notamment en pédiatrie [6]. Si l’on pense la vie
sans l’horizon du temps, comme passage d’un début vers
une fin, comme extension de l’être en somme, la question
du sens de cette traversée de ce temps se pose : à quoi bon ?
À quoi bon aller d’ici à là ? De sa naissance à sa mort ? Si
l’on pense le vivre selon l’occurrence du moment, comme
transition continue, un moment appelant l’autre, chaque
moment se justifiant par leur variation, la question «à quoi
bon ? »se dissout.
La disponibilité à l’autre, le prendre soin, peut être pen-
sée comme l’être «d’emblée là »,«branché sur »l’appel
que l’autre lance comme sujet, en ce qu’il m’incite mais
aussi «branché sur »l’incitation qui nous vient du moment
du monde. Le projet de vie et de soin n’est pas nôtre, il est
celui du sujet, au sein d’un compromis qui le rend alors
«accessible »(donc assumable) par les autres que lui,
parents, soignants, société. Nous sommes ainsi renvoyés
à la nécessité de questionner la notion du «bien »,du
«bon ».
Question du «Bien »,
du «Bon »,du«Juste »
La question du «Bien »,du«Bon »ne peut que
laisser place au «Juste ». Juste en termes de bénéfices,
en termes de possibles. Ne faire, si faire est nécessaire,
que ce qui participe au moins «mal-être »du sujet, à son
«mieux-aller ». Non pas empêcher de mourir, ni faire
mourir, mais simplement laisser vivre, au mieux qu’il est
possible jusqu’au terme de sa vie. En d’autres termes,
laisser mourir au terme naturel de la vie en assurant un
confort optimal et une expression du sujet autant que se
peut dans ces limites comme dans les nôtres. Ce terme
naturel est la mort, non comme un temps appelant sens
car sens il n’y a pas, il ne peut y avoir dans la mort.
La mort considérée comme instant, moment occurrent,
naturel, comme extension ultime du possible du vivant,
de l’être. Cela nous renvoie, en substance, à l’idée de
40 mt pédiatrie, vol. 15, n◦1, janvier-février-mars 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Journal Identification = MTP Article Identification = 0419 Date: February 13, 2012 Time: 11:4 am
Schopenhauer : «Ce que je peux dire de la mort est à
propos de la mort de l’autre en ce qu’elle m’interpelle, me
bouscule, m’émeut, me mobilise... »Il en est de même
de la souffrance de l’autre qui est à propos de l’idée que
j’en ai, de ce que je ressens, interprète, appréhende, de la
souffrance de l’autre et à l’épreuve de la souffrance. Autre-
ment dit quand on parle de la mort ou plutôt du mourir de
l’autre comme de sa souffrance, c’est bien plus de notre
propre souffrance que nous pouvons parler. Cela parce
que nous sommes dans un moment partagé de rencontre
et que du fait de notre simple présence à l’autre, cet autre
que moi, si semblable à moi, m’est accessible dans ce
que l’un et l’autre disent de soi comme de l’autre que soi.
Existe-t-il une spécificité
de la démarche palliative en pédiatrie ?
Si l’on s’en tient à la réflexion éthique, à la prise de
décision, à la notion de projet de vie et de soin, il n’existe
aucune spécificité à l’approche palliative en pédiatrie par
rapport à la médecine d’adulte. L’enfant étant à considé-
rer comme sujet, acteur, de sa vie. Il est être-au monde,
pleinement et en absolu.
En revanche, les pathologies rencontrées, les enjeux,
le fait que l’enfant est inscrit dans un projet paren-
tal, la place de l’enfant dans nos sociétés et dans nos
conventions socioculturelles comme le retentissement
émotionnel induit par la maladie grave ou le mourir de
l’enfant font qu’on peut considérer qu’existent certaines
spécificités.
Les questionnements, les outils utilisés, les grandes
lignes de la démarche sont identiques en médecine adulte
et en pédiatrie. Ce qui peut être considéré comme spéci-
ficité est probablement la nécessité de conserver un cadre
pédiatrique de la prise en charge qui de fac¸on générale se
décline par une approche globale prenant en compte le
projet parental et le degré de développement de l’enfant
comme sa capacité, parfois relative à dire pleinement de
lui. De ce point de vue, la médecine palliative adulte
a à apprendre de la pédiatrie. Cela étant, en médecine
adulte, le poids des entourages, des parents, des enfants
du sujet sont tout aussi prégnants. On est, tout au long
de sa vie, la fille ou le fils, la mère ou le père, l’ami(e),
etc., de quelqu’un. On peut être dans l’impossibilité de
«dire de soi »tout au long de la vie et à tous âges.
Cependant, l’enfant, surtout en période néonatale ou en
cas de pathologie polyhandicapante ou lourdement han-
dicapante, n’a jamais eu l’occasion, ou si peu, de dire,
d’exprimer de lui en tant que tel, là réside une spécifi-
cité singulière à la pédiatrie. Tout ce qui est dit de lui,
l’est par un tiers, ses parents en particuliers. Ce tiers dit
de lui en ce qu’il en espérait et espère parfois encore,
en ce qu’il projette et interprète. Il est d’autant plus dif-
ficile d’avoir une idée relativement précise du désir, du
projet de vie autonome de l’enfant pour faire simple. Le
poids émotionnel ne peut être éludé. Même si une étude
des statistiques de mortalité nous rappelle que la mort de
l’enfant ou de l’adolescent est une réalité, nous avons bien
du mal, dans nos sociétés occidentales, à considérer qu’un
nouveau-né, qu’un enfant, qu’un adolescent puisse mou-
rir. Chaque mort est «scandale »et bouleversement, celle
d’un enfant encore plus. Ainsi sommes-nous «construits »
en tant qu’humains, nous pensons que la naissance est por-
teuse d’un avenir, que la mort ne peut intervenir qu’après
une vie longue et aboutie. Nous oublions très facilement
notre condition de mortel et imaginons que la mort ne
peut intervenir qu’à un grand âge. Les morts «précoces »
nous interpellent d’autant plus que nos sociétés, enfer-
mées dans une illusion de «maîtrise »quasi absolue,
nous amènent à quasiment nier la mort. La mort d’un
enfant est d’autant plus «scandaleuse »qu’elle nous bou-
leverse mais aussi qu’elle nous renvoie brutalement à nos
impossibles malgré nos capacités techno-scientifiques.
Simple rappel d’une réalité humaine qui nous est insup-
portable.
Une autre spécificité en pédiatrie, est l’incertitude
sur le devenir, l’évolution de telle ou telle pathologie,
l’incapacité de dire ce que sera l’évolution propre de
l’enfant en cas de handicap ou de pathologie rare évolu-
tive notamment. Par ailleurs, l’enfant n’est pas un «adulte
en miniature »[7]. L’enfant présente des symptômes
similaires à ceux des adultes mais qui nécessitent une
approche et une analyse spécifiques que les pédiatres
connaissent. La démarche palliative en pédiatrie ne se
conc¸oit qu’en lien avec le pédiatre et le médecin géné-
raliste référents de l’enfant (et des parents). Cela étant
dit, nous pensons qu’en médecine d’adulte, le lien avec
le médecin spécialiste d’organe et le médecin généra-
liste référents du patient est tout aussi indispensable. Cela
est bien explicite dans l’idée que les médecins et soi-
gnants exerc¸ant en soins palliatifs ne se substituent pas
à ces professionnels référents mais se présentent en pos-
ture de tiers, neutres, bienveillants, mettant à la disposition
des patients une compétence spécifique à la médecine
palliative comme complément possible tout comme ils
sont disponibles pour une aide à la décision en situa-
tion critique. Cette collaboration est indispensable nous
semble-t-il.
Autres spécificités :
–l’enfant est en cours de développement, en cours
d’autonomisation, il a des besoins spécifiques non seule-
ment physiologiques mais aussi en termes d’éducation par
exemple ;
–il n’existe pas d’unité d’hospitalisation de soins
palliatifs pédiatriques comme pour l’adulte ; il existe des
équipes mobiles référentes spécifiques, des équipes régio-
nales ressources en soins palliatifs pédiatriques ;
–l’enfant, l’adolescent ont un rapport à la mort dif-
férent de celui de l’adulte ;
mt pédiatrie, vol. 15, n◦1, janvier-février-mars 2012 41
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Journal Identification = MTP Article Identification = 0419 Date: February 13, 2012 Time: 11:4 am
Pédiatrie : démarche palliative, droit des malades en fin de vie
–la mort de l’enfant ou de l’adolescent peut être envi-
sagée au domicile, en institution médico-sociale comme
à l’hôpital et nécessite une organisation particulièrement
attentive prenant en compte l’anticipation de l’après-décès
pour les parents et l’entourage.
La fratrie, les grands parents, l’entourage familial
nécessitent une approche attentive dans le contexte des
soins palliatifs pédiatriques.
Les équipes référentes en soins palliatifs peuvent être
utiles et efficientes, aux côtés des pédiatres, pour dévelop-
per une démarche palliative et accompagnante optimale.
Si la loi ne résout pas tout, qu’elle est relativement
silencieuse sur les situations pédiatriques (néonatales
en particulier), c’est probablement du fait, d’une part,
d’une complexité toute singulière ne permettant pas une
«généralisation systématisée ou englobante »de cer-
taines situations pédiatriques mais, d’autre part, parce que
bien des questionnements comme leurs modalités sont
communs avec la médecine adulte. Le développement
des collaborations, des échanges entre équipes de soins
palliatifs adultes ou pédiatriques et équipes pédiatriques
facilitera la diffusion de la démarche palliative au bénéfice
des nouveau-nés, enfants et adolescents qui le nécessitent.
Conflits d’intérêts : aucun.
Références
1. Kant E. Critique de la raison pratique. (Traduction de F. Picavet).
Paris : PUF, Collection Quadrige, 2007 : 1-11.
2. Ricœur P. Avant la loi morale : l’éthique, Encyclopedia Universalis.
Edition DVD-ROM 2010.
3. Viallard ML. Prendre soin est solidarité humaine au-delà du seul
soigner. Au-delà des moyens : l’inculturation. Med Pal. 2008;7:1-3.
4. Viallard ML. Pour une approche transculturelle du soin : soigner
l’homme, nécessite de le comprendre. Med Pal. 2008;7:117-8.
5. Jullien F. Du «temps »: Éléments d’une philosophie du vivre. FJ.
Grasset. «Le collège de philosophie »2006 : 29-65.
6. Jullien F. Du «temps »: Éléments d’une philosophie du vivre. F.J.
Grasset. «Le collège de philosophie »2006 : 67-93.
7. Humbert N. La spécificité des soins palliatifs en pédiatrie. In :
Les soins palliatifs pédiatriques (Sous la direction de Nago Humbert).
Montréal : Éditions Hôpital Sainte Justine, Collection «Intervenir »,
2004 : 18-38.
42 mt pédiatrie, vol. 15, n◦1, janvier-février-mars 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.
1
/
5
100%