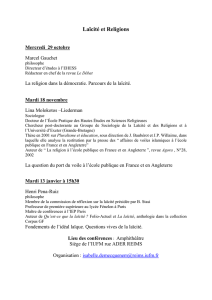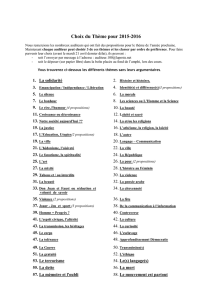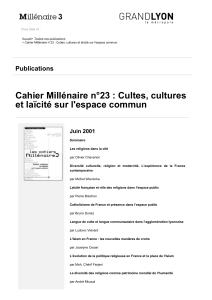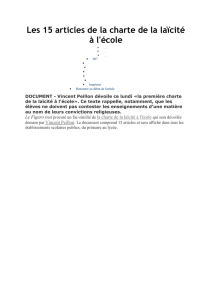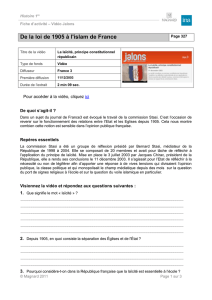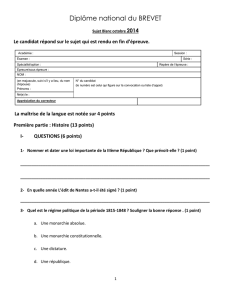Place des principes de laïcité de l`hôpital public dans les

1
Place des principes de laïcité de l’hôpital public dans
les études de médecine : le paradoxe français
Georgia Malamut, Paris Descartes Paris Sorbonne Université ; Service d’Hépato-
gastroentérologie-Hôpital Européen Georges Pompidou –APHP, Paris, France.
1: Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Centre; 2: Gastroenterology department, Hôpital
Européen Georges Pompidou APHP, Paris; France
Title: Laïcité in Medical school: the French paradox
Author reports no conflict of interest.
Correspondence to: Georgia Malamut, Hôpital Européen Georges Pompidou, 20 rue Leblanc
75015 Paris; phone: 33.1.56.09.35.52; Fax: (33).1.56.09.35.29, E-mail:

2
RESUME
Introduction : Depuis 10 ans, le sujet du respect de la laïcité à l’hôpital a fait l’objet de
nombreux débats publiques, commissions et décrets législatifs. Toutefois nous ignorons si les
médecins français connaissent les principes de la laïcité de l’hôpital public.
But : Evaluer ce que les étudiants en médecine et les médecins hospitaliers connaissent des
principes de la laïcité à l’hôpital.
Méthodes : 50 étudiants en médecine et 50 médecins hospitaliers ou hospitalo-universitaires
réalisant ou ayant effectué un cursus d’études médicales en France ont été interrogés par un
questionnaire comportant 9 questions de connaissance et 2 questions d’opinion.
Résultats : Le taux d’exhaustivité des réponses était d’environ de 99% chez les étudiants et
les médecins. Seuls 2% des étudiants et 4% des médecins déclaraient avoir reçu un
enseignement sur la laïcité à l’hôpital. Le score moyen de bonnes réponses était de 59.2%
chez les étudiants (médiane : 60%) et de 58.8% chez les médecins hospitaliers. Lorsque l’on
regardait les taux de réponses question par question, le meilleur taux de réponse concernait la
notion de neutralité religieuse des médecins et de non discrimination des médecins selon le
sexe par les patients. Les moins bonnes réponses concernaient les limites des pratiques
religieuses à l’hôpital par les patients. Les étudiants et les médecins répondaient de façon
assez similaire à l’exception de la question sur les différences d’application des principes de
la laïcité entre hôpitaux publics et privés : taux de bonnes réponses 60% chez les étudiants
versus 31% chez les médecins hospitaliers (p<0.05). Une majorité d’étudiants (70%) et de
médecins hospitaliers (64%) souhaitaient ou auraient souhaité recevoir un enseignement
spécifique sur la laïcité. Conclusion : Un paradoxe semble exister entre l’activisme croissant
du législateur sur la laïcité à l’hôpital et l’absence d’enseignement spécifique au cours des
études médicales. Le taux spontané des connaissances des futurs médecins est de 60% mais ne
s’améliore pas par la pratique clinique hospitalière. A l’avenir, l’insertion d’un enseignement
spécifique semble motivée par la place centrale croissante de la laïcité dans la relation
médecin-malade au sein d’une société française de plus en plus multiculturelle.

3
INTRODUCTION
Le terme de laïcité a été défini par Ferdinand Buisson prix Nobel de la paix en 1927 et proche
de Jules Ferry. La notion laïcité de l’hôpital public pourtant concernée par la loi de 1905 de
séparation de l’église et de l’état est restée assez marginale jusqu’au début des années 2000.
Le débat s’est ranimé avec les travaux de la commission Stasi de 2003 portant sur le port de
signes religieux à l’école et conduisant à la loi du 15 mars 2004. Les témoignages de
professionnels de santé suscités par la commission Stasi et les nombreux rapports ultérieurs
sur les entraves religieuses de plus en plus fréquentes aux principes de laïcité ont été
largement médiatisés: refus de mixité (refus de femmes d’être examinées par des hommes),
coutumes vestimentaires (accouchements en burqa) [dépêche AFP 21 octobre 2003 rapportant
les témoignages du directeur et d’une sage femme de l’hôpital intercommunal de Montreuil] ,
dysfonctionnements des soins (horaires de prières) [tribune de 5 professeurs de gynécologie
obstétrique, Libération 22 avril 2004] concernant tout particulièrement les services
gynécologie obstétrique, d’urgence, et de réanimation. Le Haut Conseil à l’Intégration
identifie alors trois catégories de problèmes : les « difficultés liées à l’accueil des patients
pouvant récuser le praticien qui les accueille », les difficultés d’ordre éthique, résultant de
choix thérapeutiques » et les « difficultés attachées à la vie quotidienne au cours d’un séjour à
l’hôpital ». L’activité accrue du législateur sur les principes de la laïcité depuis 10 ans semble
répondre en échos à l’émergence des ces nouvelles difficultés religieuses:
- loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé [1]
- circulaire du 2 février 2005 sur les établissements de santé [2]
- charte de la personne hospitalisée en 2006, actualisant celle de 1995 [3]
- charte de la laïcité dans les services publics du 13 avril 2007 [4]
- loi d’interdiction du port du voile intégral dans les espaces publics du 20 octobre 2010 [5]
Ainsi la circulaire de 2005 sur la laïcité dans les établissements de santé précise les limites du
libre choix du médecin, droit fondamental de la législation sanitaire [Article L.1110-8CSP]:
« Ce libre choix du malade ne permet pas que la personne prise en charge puisse s’opposer à
ce qu’un membre de l’équipe de soins procède à un acte de diagnostic ou de soins pour des
motifs tirés de la religion connue ou supposée de ce dernier ». La charte de la laïcité dans les
établissements de santé répond au problème vestimentaire et de dysfonctionnement des soins :
« le malade doit accepter la tenue vestimentaire imposée compte tenu des soins qui lui sont
donnés ». Face à l’activisme du monde médiatique et politique qu’en est-il de la mobilisation
des médecins hospitaliers ? Si les principes de la laïcité semblent si fortement intriqués aux
soins et à la relation médecin-malade, quels sont les repères qui guident le praticien au

4
quotidien face aux revendications religieuses ? Le médecin hospitalier est-il bien armé pour
résister aux pressions communautaires ? Pour tenter d’appréhender l’état des connaissances et
de formation des médecins hospitaliers sur la laïcité, nous avons entrepris un travail
d’évaluation par questionnaire d’une cohorte de 100 médecins hospitaliers ou étudiants en
médecine.
METHODES
L’interrogatoire a été proposé et rempli sur la base du volontariat par cinquante étudiants en
médecine suivant leurs études à l’Université Paris Descartes (Paris, France) et 50 médecins
hospitaliers ayant tous réalisé leurs études médicales en France. Les médecins hospitaliers
étaient majoritairement des participants du DIU de pédagogie médicale (promotion 2013) ou
des médecins de l’Hôpital européen Georges Pompidou. Les médecins travaillaient tous dans
des centres hospitalo-universitaires. L’interrogatoire a été réalisé sous la forme de
questionnaire anonymisé. Les réponses aux questions ont été élaborées grâce aux textes
législatifs existant (décrets, articles, circulaires, jurisprudences…) retrouvés grâce à une
recherche bibliographique avec le service juridique de l’Hôpital Européen Georges Pompidou.
Questionnaire
3 premières lettres du nom :
2 premières lettres du prénom :
Sexe (F/H) :
Statut (P2-D1-D2-D3-D4-CCA-PH-PHU etc) :
Entourer la bonne réponse ; question 6 : donner 3 termes
1. Avez-vous reçu une formation ou enseignement sur les principes de laïcité à
l’hôpital public?
Oui Non
2. Le port de signes religieux par les médecins est-il autorisé à l’hôpital public?
Oui Non
3. Un patient peut-il se plaindre, à l’hôpital public, du non respect de la laïcité ?
Oui Non
4. Les absences des médecins hospitaliers pour fêtes religieuses sont -elles autorisées
à l’hôpital public?
Oui Non
5. Les patients peuvent-ils pratiquer leur religion à l’hôpital public ?

5
Oui Non
6. Quelles sont les limites des pratiques religieuses des patients à l’hôpital public (3
réponses) ?
7. Faut-il obligatoirement satisfaire le souhait d’une patiente d’être soignée par un
médecin hospitalier public de sexe féminin ?
Oui Non
8. Existe-t-il des différences entre hôpital public et hôpital privé concernant le
respect des principes de la laïcité ?
Oui Non
9. Un praticien de l’hôpital public doit il respecter le refus de soins pour croyances
religieuses:
- cas des majeurs ?
Oui Non
- cas des mineurs ou majeurs sous tutelle?
Oui Non
10. Souhaitez vous ou auriez vous souhaité un enseignement sur les principes de
laïcité de l’hôpital public?
Oui Non
Statistiques
Les résultats sont exprimés sous formes de moyennes ou de médianes. La comparaison des
taux de bonnes et mauvaises réponses entre les deux groupes (comparaisons de fréquences) a
été réalisée par le test exact de Fisher. Un P inferieur à 0.05 était considéré comme
statistiquement significatif.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%