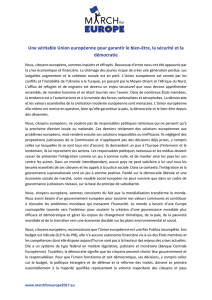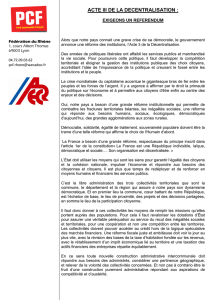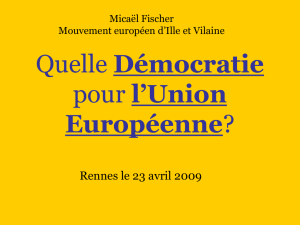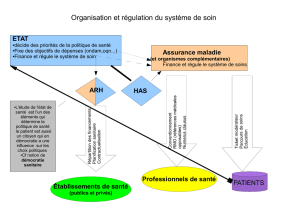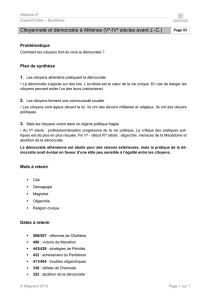La démocratie sociale, composante du projet démocratique de l`ESS

26/05/10
Gilles Rivet
p 1 sur 17
01 57 10 93 65– – g.rivet-co[email protected]
Xe Rencontres RIUESS – ESS et politique : quel projet
démocratique ?
La démocratie sociale, composante
du projet démocratique de l’ESS
Communication pour le colloque des 3 et 4 juin – Luxembourg
Mes activités professionnelles — consultant dans le champ des politiques sociales et enseignant auprès
d’un public en formation continue, majoritairement cadres d’organisations de l’économie sociale — m’ont
permis de constater un décalage important entre les valeurs énoncées par les organisations de l’économie
sociale, d’une part, et leurs pratiques de démocratie sociale, d’autre part. C’est le point de départ d’une
recherche doctorale
1
que je mène actuellement au sein du laboratoire CLERSÉ à l’USTL de Lille 1.
Dans un premier temps, je voudrais tenter de situer l’économie sociale naissante par rapport à la question
démocratique, au prix d’un détour par la question sociale : quelle est la contribution de l’économie sociale
à l’exigence démocratique de la période, à l’externe — dans un projet de changement de société —, à
l’interne — dans la perspective d’une abolition du salariat — ?
Je déclinerai la question, dans un deuxième temps, par le cas particulier de la démocratie sociale : point
de départ de ma recherche mais surtout analyseur particulièrement pertinent pour les entreprises de
l’économie sociale. Il s’agira de repérer quel développement a connu cette dimension interne de la
démocratie.
Enfin, c’est en revenant à l’économie sociale et solidaire contemporaine que je voudrais tester l’idée d’une
nécessaire centralité de la démocratie sociale pour renforcer la cohérence du projet démocratique de
l’économie sociale et solidaire.
1. Économie sociale et solidaire : le choix des mots
Créé en 2000, le RIUESS a choisi de militer pour ce qui n’est encore qu’un projet, l’économie sociale et
solidaire, soit la fusion de deux moments de l’histoire de l’économie sociale. Je ne parlerai, dans cette
communication, que d’économie sociale, pour deux raisons. La première est que je m’interroge sur la
qualité heuristique de cette appellation, alors même que l’économie sociale gagnerait à continuer à
s’interroger sur l’impérieuse nécessité qui a conduit à l’invention de cette descendance : l’économie
solidaire. Vue comme un projet, la fusion peut être dynamisante ; considérée comme un achèvement de la
pensée, elle est stérilisante. La deuxième raison est en lien avec l’objet de ma communication : je
m’intéresse tout d’abord à cette période d’invention de l’économie sociale, alors que cette dernière opère
déjà une fusion, peut-être simplificatrice, entre les mouvements associationnistes, coopératifs et
mutualistes et n’a pas besoin de l’appellation solidaire pour trouver place et sens ; j’observe ensuite les
héritiers directs de cette histoire, les organisations qui se disent de l’économie sociale, précisément du
point de vue d’une partie de l’héritage qu’est le projet démocratique.
1
« Pratiques de la démocratie sociale dans les organisations de l’économie sociale », sous la direction de Bernard Eme

p 2 / 17
– 25/05/10 Proposition de communication Xe rencontre RIUESS
2. Quelle exigence démocratique fondatrice ?
Afin de situer l’économie sociale naissante par rapport à la question démocratique, je choisirai de
m’intéresser aux points d’articulation entre économie sociale et question sociale : parce que la question
sociale est née d’un déficit démocratique, d’une part ; parce que l’économie sociale, dans sa genèse, peut
être considérée comme une réponse à la question sociale, d’autre part.
♦ La question sociale ou l’échec de la démocratie économique
On trouve une très forte convergence entre plusieurs auteurs
2
pour définir la question sociale comme une
non coïncidence entre la démocratie politique et la démocratie économique. Cet écart se traduit par une
fragilisation du pacte républicain susceptible de remettre en cause la cohésion d’une société, soit la
cohésion sociale. Ces auteurs tombent également d’accord pour situer l’émergence de la question sociale
entre février et juin 1848, dans ce concentré d’histoire qui voit des libertés politiques nouvelles
contredites, en quelques sortes, par une incapacité à régler la question centrale de l’époque, c’est-à-dire le
droit au travail. Cette contradiction provoquera l’insurrection de juin, brutalement réprimée, et la fin des
espoirs ouverts par cette jeune IIe République.
Regardons plus précisément les analyses proposées par deux de ces auteurs. Donzelot fait référence, d’une
part, au « contraste entre l’égale souveraineté politique de tous et la tragique infériorité de la condition
civile de certains » ; d’autre part, au rôle de l’État, condamné à tenir la promesse impossible d’« assurer
l’égalité de tous et la liberté de chacun »
3
. Jacques Commaille, quant à lui, choisit de résumer sa définition
de la question sociale en trois pôles que sont la citoyenneté (où l’on trouve, formellement, l’écart entre
citoyenneté politique et citoyenneté économique, déjà évoquée), le contrat social (où il est question de ce
qui lie et oblige les individus entre eux, mobilisant à la fois l’économique, le social et le politique) et l’État
social (dont le rôle, dans ses articulations avec la société, doit être redéfini). Assez clairement, on se
trouve devant une tentative d’articuler le politique et l’économique. À ce stade, il est nécessaire d’aller
encore un peu plus loin dans les pistes ouvertes par les tentatives de définition de la question sociale. Le
« quasi assujettissement économique » de « ceux-là mêmes qui viennent d’accéder à la capacité
politique »
4
se traduit, dans la société, par des inégalités productrices de fragilisation de la cohésion
sociale. La situation de subordination des salariés dans l’entreprise, décrite par ailleurs par Alain Supiot
5
,
est analysée comme une discordance, une anomalie dans la démocratie. À deux échelles différentes — la
société, d’une part ; l’entreprise, d’autre part —, il semble bien que ce soit le même sujet qui est traité : la
fragilité d’une cohésion sociale, d’un pacte républicain, du fait d’une anomalie, congénitale pourrait-on
dire, de la démocratie. S’il y a lien entre question sociale et question démocratique, c’est dans une
acception double de la démocratie : dans le champ du politique, d’une part ; de l’économique, d’autre
part. Autrement dit, il s’agit à la fois de démocratie politique et de démocratie économique, ou démocratie
sociale.
♦ L’économie sociale et la question sociale
L’économie sociale : un construit
Danièle Demoustier, dans son introduction à l’un des volumes des Œuvres de Charles Gide, définit quatre
étapes dans l’émergence de l’économie sociale, des années 1820-1830 aux années 1880-1890. Cette
Giovanna Procacci, Gouverner la misère. La question sociale en France 1789-1848, Seuil, 1993; Jacques Donzelot,
L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, Seuil, 1994 ;
Robert Castel, Les métamorphoses de la
question sociale. Une chronique du salariat, Librairie Arthème Fayard, 1995 ; Pierre Rosanvallon, La nouvelle question
sociale. Repenser l’État-providence, Seuil, 1995 ; Jacques Commaille, Les nouveaux enjeux de la question sociale,
Hachette Littératures, 1997
3
Jacques Donzelot, L’invention du social, op. cit. p. 66 et 67
4
Jacques Donzelot, L’invention du social, op. cit. p. 67
5
Alain Supiot, Critique du droit du travail,

p 3 / 17
– 25/05/10 Proposition de communication Xe rencontre RIUESS
analyse diachronique est également l’occasion de revenir sur l’effort conceptuel qu’ont dû produire les
théoriciens de l’économie sociale pour la distinguer de l’économie politique. C’est à partir des travaux
réalisés au cours de la troisième de ces quatre étapes (1850-1860, autour de Frédéric Le Play) que Charles
Gide développe ses propres contributions. Il attribue à Frédéric Le Play la paternité de la notion
d’économie sociale telle qu’il l’utilise lui-même, et le mérite de l’avoir rendue publique lors de l’Exposition
universelle de 1867
6
. Ayant lui-même beaucoup œuvré pour la formulation d’une définition rigoureuse et
complète de l’économie sociale, il est bien conscient du fait que cette définition a dû se distinguer d’autres
en présence. Plus précisément, il se retrouve dans la classification en « quatre écoles de l’économie
sociale » proposée par la Société chrétienne suisse d’économie sociale, respectivement « libérale »,
« chrétienne », « collectiviste », « nouvelle » (dite encore « de la solidarité »). Héraut de l’École nouvelle,
Gide tentera de préciser la manière dont celle-ci se situe par rapport aux trois autres, dans une dynamique
cette fois synchronique.
On peut en fait considérer que le processus tient à la fois de l’émergence d’une nouvelle notion et
d’arbitrage entre plusieurs définitions. Lorsqu’elle émerge, l’économie sociale est bien un construit, qui se
prolonge jusqu’à aujourd’hui ; autrement dit, l’économie sociale d’aujourd’hui est une étape de cette
construction non l’héritier passif d’un passé révolu.
Économie sociale et question sociale
Comme construit, l’économie sociale a donc dû, dans un premier temps, exister par rapport à l’économie
politique. « Pour distinguer les deux sciences », dit Charles Gide, « on pourrait, comme l’a déjà fait Léon
Walras, définir l’Économie politique, la science de l’utilité sociale et l’Économie sociale la science de la
justice sociale »
7
. Et pour préciser encore l’irréductible différence entre ces deux sciences, Gide rappelle
« que l’Économie politique, cette superbe science des richesses, ne dit rien au peuple de ses peines ni des
moyens de les guérir, tandis que l’Économie Sociale ne lui parle que de cela »
8
. Notons au passage la
volonté d’insister sur la complémentarité et non la conflictualité entre les deux sciences, manière de
plaider pour une économie sociale réconciliante et non combattante. Il me paraît donc juste de dire, avec
Danièle Demoustier que l’économie sociale a été pensée par ses premiers théoriciens et praticiens, comme
« la recherche de la solution à la question sociale, alors question ouvrière »
9
.
♦ L’économie sociale et la question démocratique
En proposant une articulation entre économie sociale et question sociale, je tentais d’éclairer ce que sont
à mon sens les fondements du rapport de l’économie sociale avec la question démocratique, avant d’en
venir à l’entrée que j’ai choisi de privilégier : les positions de l’économie sociale par rapport à la
démocratie sociale. Évoquer cela, c’est s’intéresser aux rapports de l’économie sociale avec le politique, ce
que je ferai en rappelant le projet de l’économie sociale de réconcilier l’économique et le politique, d’une
part, et en observant les rapports de l’économie sociale naissante avec les doctrines politiques, d’autre
part.
L’économie sociale comme tentative de réconciliation de l’économique et du politique
Concernant les rapports de l’économie sociale naissante ave le politique, nous nous trouvons devant une
certaine ambivalence de l’économie sociale. L’émergence de l’association et du mouvement coopératif,
dans la première partie du 19
e
siècle a été marquée par une violente hostilité à l’égard du politique,
6
Voir Charles Gide, Les institutions de progrès social, L’Harmattant/Comité pour les éditions des œuvres de Charles Gide,
2007, p.53
7
Charles Gide, Les institutions de progrès social, L’Harmattant/ Comité pour les éditions des œuvres de Charles Gide,
2007, p.57
8
ibid. p. 55
9
Charles Gide, Les institutions de progrès social, L’Harmattant/ Comité pour les éditions des œuvres de Charles Gide,
2007, introduction de Danièle Demoustier, p. 13

p 4 / 17
– 25/05/10 Proposition de communication Xe rencontre RIUESS
prolongée par une méfiance durable. Or, l’économie sociale comme construit opérant une fusion
théorique et institutionnelle entre les mouvements associationniste, coopératif et mutualiste, a affirmé
son refus de considérer l’économique comme une réalité sociale indépendante, cherchant au contraire à
lancer des passerelles avec d’autres sphères de la société, dont la sphère politique. Nous sommes renvoyés
ici à la genèse de la question sociale, dont l’une des dimensions est cette non coïncidence entre
citoyenneté politique et citoyenneté économique. L’on peut considérer qu’il a existé deux types de réaction
au constat de cette impasse : d’un côté, une volonté de séparation par disqualification du politique — ou
peut-être de la politique institutionnelle — ; d’un autre côté, une volonté de rapprochement, en reprenant
à nouveaux frais la question. C’est en observant comment ont pu se combiner ces deux réactions que l’on
comprendra peut-être la source et la nature de l’ambivalence que je viens d’évoquer. Il me semble qu’il
existe un objet commun à ces deux positions, c’est la démocratie.
Il me semble difficile de traiter des rapports entre l’économie sociale et le politique sans revenir, par
exemple, sur le processus de séparation entre mouvement mutualiste et mouvement syndicaliste. À ce
sujet, on peut partir de l’analyse d’Henri Hatzfeld, selon laquelle il existe « une sorte d’incompatibilité
entre les exigences révolutionnaires et les exigences gestionnaires »
10
. En l’occurrence, le mouvement
mutualiste, tenté d’évoluer vers des « sociétés de résistance », s’est trouvé déporté vers l’option « société
de prévoyance », pour des raisons à la fois économique — le manque de ressource des ouvriers interdisant
de constituer des caisses permettant de parler réellement de prévoyance — et politique — des notables, à
la fois par philanthropie et par peur sociale, s’investissent dans la création de mutuelles —. Ce divorce
marquera durablement les relations entre le mouvement syndicaliste et le mouvement mutualiste et, plus
largement, l’économie sociale. Est-il, de manière spécifique, emblématique d’une séparation entre
économique et politique ? La bataille dont a été l’objet le mouvement mutualiste se situe tout entière dans
le champ des luttes sociales et politiques : la « bonne » mutuelle étant celle qui valorisait le « bon »
ouvrier, fait de tempérance et de prévoyance. Et l’économique là-dedans ? Si l’on extirpe d’une mutuelle
son projet de transformation de la société, révolutionnaire ou pas, il lui reste une activité de production de
service qui appartient indubitablement au champ de l’économique et, en l’occurrence, de l’économie
sociale.
L’économie sociale et les doctrines politiques
Il faut distinguer, je crois, le rapport entre économie sociale et politique et les débats qu’ont engagé les
acteurs de l’économie sociale avec les doctrines politiques. Ces débats ont été intenses, et il est permis de
penser qu’ils ont aidé à l’économie sociale à se constituer un espace propre.
J’évoquerai en premier lieu les critiques de Karl Marx, économiste, à l’égard de l’économie sociale. C’est
comme économiste que Marx s’est intéressé à la coopération
11
, mais c’est comme révolutionnaire qu’il a
par ailleurs porté son regard critique sur le mouvement coopératif, d’un point de vue plus politique, donc.
Et c’est dans le prolongement de cette joute politique qu’ l’on peut situer, plus largement, les rapports
entre le mouvement coopératif et le mouvement socialiste. La première Internationale soupçonne la
coopérative d’être incapable de s’opposer au monopole et « insuffisante », c’est-à-dire non politique. La
deuxième Internationale affiche dans un premier temps son hostilité au mouvement coopératif avant,
dans un deuxième temps (aux alentours de 1910) de chercher à établir des passerelles, sous l’égide de
Jean Jaurès, Charles Gide, Albert Thomas, Marcel Mauss. La troisième Internationale s’exprime à ce sujet
sous la plume de Lénine
12
. On constate, à ce stade, l’expression de fortes méfiances, du côté des politiques,
nuancées de tentatives de rapprochement parfois opérées sur le plan théorique, parfois dans l’optique de
luttes politiques ou sociales.
10
Henri Hatzfeld, Du paupérisme à la sécurité sociale, Presses universitaire de Nancy, Nancy, 2004, p. 198 (1e édition,
Librairie Armand Colin, 1971)
11
Karl Marx, Le Capital, Livre I, Tome II, Chapitre XIII, « La coopération », Éditions sociales, 1973
12
Voir à ce sujet Henri Desroche, Le projet coopératif, Économie et humanisme-Éditions ouvrières/coll. Développement
et civilisation, Paris, 1976

p 5 / 17
– 25/05/10 Proposition de communication Xe rencontre RIUESS
Charles Gide, de son côté, a entretenu avec Jean Jaurès une relation intense, le plus souvent par articles et
discours interposés. Pour tirer un enseignement des échanges entre ces deux hommes, il faudra opérer la
distinction entre les débats doctrinaux — de nature essentiellement économique — et les échanges
politiques, même si, entre le savant et le politique, la répartition n’est pas semblable pour les deux
hommes.
C’est peut-être Marcel Mauss qui a le plus ouvertement assumé ces deux postures de savant et de
politique, analysant sans précaution oratoire excessive les rapports du mouvement communiste en
général, bolchévique en particulier, avec la pensée coopérative
13
.
3. La démocratie sociale, une déclinaison cohérente avec les ambitions de
l’économie sociale
Si j’ai choisi de traiter la question ouverte par les organisateurs de ce colloque sous l’angle de la
démocratie sociale, c’est, certes, parce qu’elle me paraît cette entrée me semble être un des enjeux
importants pour l’économie sociale d’aujourd’hui mais surtout parce qu’elle me semble être un analyseur
pertinent pour comprendre les caractéristiques fondamentales de l’économie sociale. Tentative de
rapprocher, voire de réconcilier, l’économique et le politique, l’économie sociale doit situer au cœur de
son projet cette notion qui prétend précisément appliquer au champ de l’économique la démocratie, née
du politique.
♦ Quelle approche de la démocratie sociale ?
Il me semble ici nécessaire de préciser la définition de cette notion que je privilégie, parmi les deux
grandes lectures qui en sont faites.
La loi 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de
travail » me paraît fournir le repère le plus éclairant d’une première lecture, celle que je choisis. Si l’on
s’intéresse plus particulièrement à la première partie de la loi, consacrée à la rénovation de la démocratie
sociale, on constate que l’exposé des motifs décèle trois grandes catégories d’articles, consacrés
respectivement à la modernisation du système de représentativité des organisations syndicales de
salariés, à l’organisation du futur mode de conclusion majoritaire des accords collectifs, à une meilleure
transparence et sécurité juridique du financement des organisations syndicales et des organisations
professionnelles. Définie de fait par ces articles, la démocratie sociale est bien l’ensemble des formes de
représentations des salariés dans le monde de l’entreprise et « la rénovation de la démocratie sociale est
indispensable pour moderniser notre système de relations professionnelles ». On est ici dans le champ de
l’économique.
La démocratie sociale est également utilisée dans une acception plus large et dans le même temps plus
politique. La démocratie sociale décrit alors un mode d’organisation de la société, comme représentant
d’un choix de « modèle social », dont seraient particulièrement représentatifs les pays scandinaves. Et
pour être plus précis et plus politique, la démocratie sociale ainsi définie serait quasi équivalente à des
social-démocraties favorisant le dialogue social à tous les échelons de la société. Cette approche prend sa
place dans les débats portant sur les rôles respectifs de l’État et de la société civile dans les sociétés
démocratiques. Préfaçant un livre sur la démocratie sociale
14
, Pierre Rosanvallon semble privilégier cette
lecture, saluant un ouvrage qui « vient à son heure, alors que se multiplient les interrogations sur
13
Voir notamment à ce sujet, Marcel Mauss, Écrits politiques, Librairie Arthème Fayard, 1997 ; Sylvain Dzimira, Marcel
Mauss, savant et politique, La Découverte, 2007
14
Alain Chatriot, La démocratie sociale à la française. L’expérience du Conseil national économique 1924-1940, La
Découverte, 2002
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%