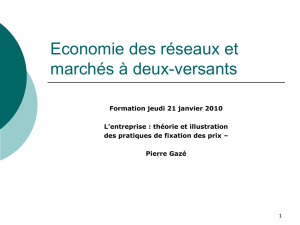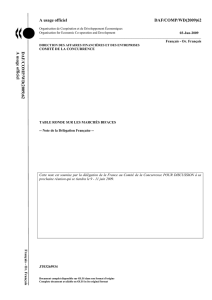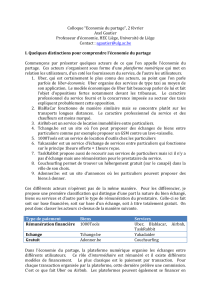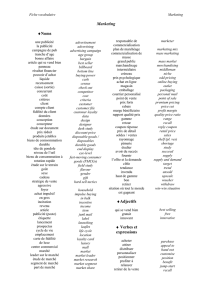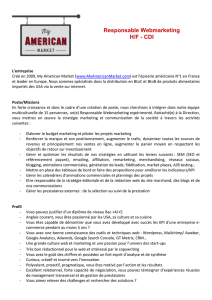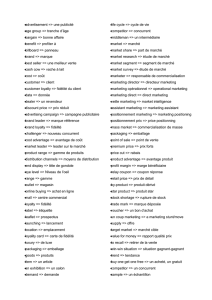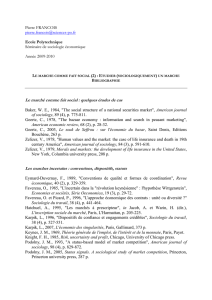Compte-rendu - Direction générale du Trésor

1
Compte-rendu du séminaire DGTPE-Concurrence du 15 décembre 2005
sur
« Les two-sided markets »
Présidente : Anne Perrot (AP), Vice-Présidente du Conseil de la Concurrence
Intervenants : Bernard Caillaud (BC), Professeur d’économie à l’Ecole nationale des Ponts
et Chaussées
Pascal Wilhelm (PW), Avocat
Les noms des personnes de la salle étant intervenues au cours du débat apparaissent en gras
dans le texte. Les propos rapportés n’engagent que leurs auteurs.
1. Introduction.
AP :
Les « two-sided makets », ou marchés bifaces, mettent en contact deux catégories d’agents
économiques qui interagissent : l’intérêt des participants d’un côté du marché dépend des
caractéristiques de la demande de l’autre côté. Ces marchés constituent des plates-formes
d’intermédiation.
Il existe plusieurs types de plate-forme : les plates-formes d’échange (le site de rencontres
récemment introduit en bourse, Meetic, en est un exemple), les plates-formes de transaction
(cartes de crédit), les plates-formes d’accès à des applications (console de jeux vidéo), les
plates-formes d’audience (médias) ;plus généralement, toutes les plates-formes
d’intermédiation comme les agences immobilières, les sites d’enchères constituent des
exemples d’acteurs intervenant sur des marchés bi-faces.
Les industries médiatiques constituent un exemple classique et particulièrement riche pour
l’analyse des problèmes de concurrence sur ces marchés. Dans le cas des chaînes de
télévision, par exemple, notamment lorsqu’elles sont « gratuites » pour les téléspectateurs et
financées principalement par la publicité :
- le profit des annonceurs publicitaires, qui souhaitent que leurs messages soient diffusés
auprès du plus grand nombre possible de téléspectateurs, dépend de la taille de l’audience,
c’est-à-dire de la demande sur le marché de l’audience (ou du lectorat) médiatique ;
- l’utilité des téléspectateurs dépend du volume de publicité, c’est-à-dire de la demande sur le
marché publicitaire, dans la mesure où elle permet de financer les programmes (mais le
volume de publicité peut aussi engendrer une externalité négative pour les consommateurs
lorsque ceux-ci s’estiment pollués par les messages publicitaires).
Les caractéristiques de ces marchés bifaces engendrent des situations particulières au regard
du droit de la concurrence, comme par exemple l’existence de prix inférieurs aux coûts de
production, sans qu’il y ait de prédation : c’est ainsi le cas des journaux « gratuits », dont le
coût est en réalité payé par l’autre côté du marché, celui des annonceurs ; la plupart des plate-
formes présentent aussi une forte tendance à la concentration, puisque c’est la taille d’un côté
du marché qui attire l’autre.

2
2. L’économie des marchés « bifaces ».
BC :
Présentation des marchés « bifaces ».
Les two-sided markets ou marchés « bifaces » font l’objet de recherches récentes en économie
industrielle. Ils peuvent être définis par trois caractéristiques.
- Ils réunissent deux groupes d’agents avec des gains potentiels à interagir (gains de
transaction).
- Une plateforme rend possible et facilite les interactions.
- Il existe des externalités indirectes (le bénéfice d’un agent dépend directement ou
indirectement du nombre d’agents de l’autre groupe).
Le marché « biface » fournit un service joint aux deux groupes. Le volume d’activité dépend
d’une part de la participation des deux groupes, d’autre part du nombre de transactions
réalisées.
Les instruments tarifaires mis en place peuvent être :
- une tarification différenciée pour chaque groupe (identifiable ex ante, homme/femme par
exemple, ou selon l’usage, vente/achat par exemple) ;
- une tarification sous forme de taxe à la participation (tarification à l’accès, à l’inscription, à
l’abonnement) ;
- une tarification sous forme de taxe sur les transactions (tarification à l’usage).
Monopole.
Une première étape dans l’étude de l’économie des marchés bifaces consiste à analyser le cas
du monopole. Lorsque celui-ci pratique des tarifs à l’accès positifs, il existe un risque de
cercle vicieux où aucun des agents ne participe, pouvant anticiper que les membres de l’autre
groupe ne participeront pas. Cela crée donc un problème de coordination. Pour le résoudre,
plusieurs solutions peuvent être adoptées :
- subventionner un groupe ;
- lier participation et vente d’un autre service (information, contenu…) ;
- intégrer la plateforme avec un côté du marché ;
- ne pas tarifer l’accès mais seulement l’usage.
A l’équilibre, le tarif et le coût de service ne sont pas corrélés. Un tarif peut ainsi être inférieur
au coût marginal, nul (gratuité) voire même négatif (subvention). Il sera d’autant plus faible
que le groupe auquel il est destiné cause une forte externalité positive sur l’autre groupe. Un
côté du marché peut être déficitaire (audience des médias, porteurs de cartes de crédit), et
l’autre profitable (annonceurs, marchands).
Il convient de noter que la structure des prix relatifs vérifiant l’optimum social peut être
similaire, dans ce cas très particulier, à celle introduite par un monopole.

3
Concurrence et accès.
Les modalités d’accès aux plateformes sont déterminantes pour les conditions de la
concurrence. L’accès peut être limité à une seule plateforme (singlehoming, par exemple du
fait d’une clause d’exclusivité) ou multiple (multihoming).
Dans le cas du singlehoming, les externalités intensifient la concurrence : les prix et les profits
sont faibles. Un basculement vers une situation de monopole est possible, car une unique
plateforme est efficace.
Dans le cas des accès multiples, on peut distinguer l’accès multiple bilatéral (les deux groupes
utilisent plusieurs plateformes) et l’accès multiple pour un seul des deux groupes. Dans le
premier cas, cela nécessite une complémentarité entre plateformes, et induit une
différenciation endogène des plateformes. Lorsque l’accès multiple n’est pas bilatéral (par
exemple, les centres commerciaux : les acheteurs fréquentent un seul centre, une chaîne de
magasins est présente sur plusieurs centres), la concurrence est intense du côté où l’accès est
unique (sur le côté des acheteurs dans le cas des centres commerciaux), ce qui dissipe les
profits perçus sur l’autre côté (via la gratuité des parkings, ou de faibles prix pratiqués sur
l’essence notamment) . La compatibilité, c’est-à-dire favoriser l’accès multiple quand cela est
possible, peut constituer une stratégie d’accommodation dans la mesure où elle atténue la
concurrence.
Conclusion.
La définition d’un marché pertinent dans le cas d’un marché « biface » doit prendre en
compte l’impact d’une variation du tarif d’un groupe sur les profits réalisés sur l’autre groupe.
L’analyse des prix pratiqués sur de tels marchés est confrontée à des spécificités : la structure
des prix ne reflète pas forcément celle des coûts, une marge élevée n’est pas forcément
synonyme de pouvoir de marché, un tarif inférieur au coût marginal n’est pas une preuve de
prédation. L’analyse de la structure de marché doit également tenir compte des
caractéristiques « bifaces » du marché, qui peuvent notamment :
- rendre le basculement vers le monopole parfois efficace ;
- faire que l’exclusivité conduise à une concurrence plus forte ou, au contraire, à des
barrières à l’entrée ;
- faire émerger la compatibilité comme stratégie d’accommodation.
Plusieurs questions peuvent être encore soulevées, comme celle de l’existence de barrières à
l’entrée (une clientèle établie d’un côté est un avantage nécessaire pour l’activité de l’autre),
l’existence d’ententes illicites ou l’intégration verticale d’un côté, qui permet de résoudre les
problèmes de coordination.
3. La notion de « two-sided markets » en droit de la concurrence.
PW :
Introduction.
Un « two-sided market » est une notion principalement économique, qui trouve une
application juridique en droit de la concurrence. Les caractéristiques communes possédées par
ces marchés sont les suivantes.

4
Deux opérateurs distincts, un vendeur de biens ou de services et un acheteur,
souhaitent interagir entre eux.
Un intermédiaire (« plateforme ») offre un bien ou service qui permet à ces deux
opérateurs d’interagir.
Les deux opérateurs sont demandeurs du bien ou service intermédiaire.
Chaque opérateur appréciera davantage le bien ou service intermédiaire si l’autre
opérateur achète le même bien ou service: leurs demandes sont interdépendantes.
Les interactions entre les deux opérateurs sont la source d’effets de réseau.
Tentative de définition juridique.
Il n’y a pas de littérature juridique doctrinale, notamment en France, sur les « two-sided
markets ». L’approche juridique doit donc être fondée sur la pratique décisionnelle des
autorités de concurrence.
L’appréciation des éventuelles atteintes à la concurrence nécessite toujours, au préalable, que
soit délimité le (ou les) marché pertinent. Ce dernier est défini comme le lieu sur lequel se
rencontrent l’offre et la demande pour un produit ou un service spécifique (rapport d’activité
2001 du Conseil de la concurrence). Dans le cas d’un « two-sided market », l’intermédiaire
offre un bien ou un service à deux demandeurs distincts. On pourrait donc considérer que cela
suppose l’existence de deux marchés pertinents distincts.
Les autorités de concurrence françaises ont cependant précisé qu’il ne peut y avoir de marché
pertinent que là où il existe une relation commerciale entre l’offreur et le demandeur, à savoir
l’échange d’un bien ou d’un service à titre onéreux (Lettre Ministre 29 mai 1998,
NRJ/Nostalgie). Or certains opérateurs jouant le rôle d’intermédiaire sur un secteur, et
répondant à la définition économique des « two-sided markets » n’ont pas de relation
commerciale avec l’un des deux opérateurs demandeurs, au sens de la jurisprudence précitée.
C’est le cas notamment des radios, journaux ou chaînes de télévision gratuits. Un « two-sided
market » n’est donc pas nécessairement caractérisé par l’existence de deux marchés pertinents
distincts.
Toutefois, parce que les demandes de chaque côté du « two-sided market » sont
interdépendantes, il est nécessaire de s’intéresser aux deux versants de ce marché pour
délimiter le ou les marchés pertinents, déterminer la position de l’opérateur intermédiaire sur
le ou les marchés concernés et mener correctement l’analyse des effets, sur le jeu de la
concurrence, d’une pratique mise en œuvre par cet opérateur ou d’une opération de
concentration.

5
Les principales applications juridiques : appréciation de l’incidence d’un « two-sided
market ».
La délimitation du marché pertinent.
Dans le cas « Visa International I »1, pour délimiter le marché de systèmes pertinent, la
Commission, après avoir relevé que l’utilisation de différents systèmes de paiement était
déterminée par les décisions interdépendantes des consommateurs et des commerçants, a
analysé aussi bien la demande des commerçants que celle des titulaires de cartes.
La détermination du pouvoir de marché de l’opérateur intermédiaire.
Les parts de marché des opérateurs intermédiaires sur un versant ont une incidence sur la part
de marché ou pouvoir de marché de ces mêmes opérateurs sur l’autre versant du « two-sided
market ».
Les effets de réseau qui caractérisent les « two-sided markets », sont la source de barrières à
l’entrée qui influent sur le pouvoir de marché de l’opérateur intermédiaire.
Une intégration verticale dans le cadre d’un « two-sided market » peut entraîner des effets de
levier.
L’appréciation de l’existence d’une entente illicite dans le cadre de « two-sided
markets ».
L’appréciation de l’existence d’une entente et de ses effets reste difficile, dans la mesure où il
faut prendre en compte les interactions positives d’un marché sur l’autre. Le 9 août 2001, la
Commission a rendu des attestations négatives à VISA International, société privée détenue
par des institutions financières, qui lui avait notifié différentes règles la concernant au titre de
l’article 81 du Traité CE (« règles VISA »). La Commission avait reconnu dans ce cas la
spécificité du « two-sided market » en cause :
« Un système de paiement ne peut se développer que si les émetteurs peuvent avoir la
certitude que leurs cartes seront acceptées par les commerçants liés par contrat à d’autres
acquéreurs » (pt. 67).
L’appréciation de l’existence d’un abus de position dominante.
Dans sa décision « Microsoft »2, la Commission européenne a condamné Microsoft au titre de
l’article 82 du Traité CE notamment pour sa pratique ayant consisté à lier la vente de son
lecteur Windows Media (WMP) avec son système d’exploitation pour PC clients (Windows).
La Commission a relevé que la pratique de vente liée de Microsoft avait notamment un effet
1 CE, déc. COMP/29.373, 9 août 2001.
2 CE, déc. COMP/37.792, 24 mars 2004
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%