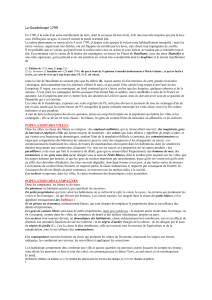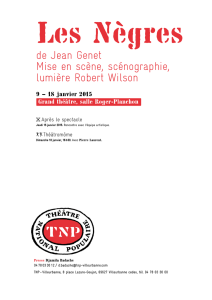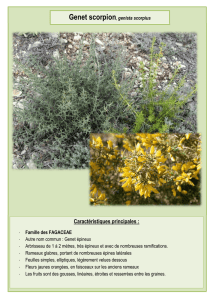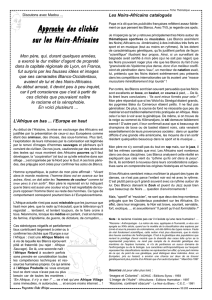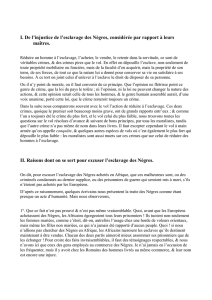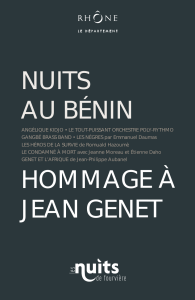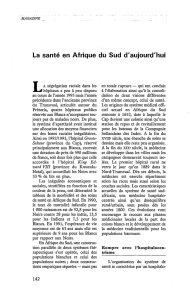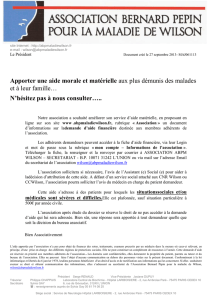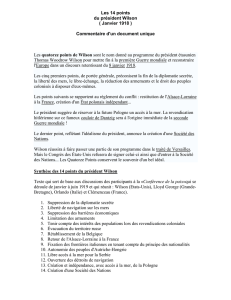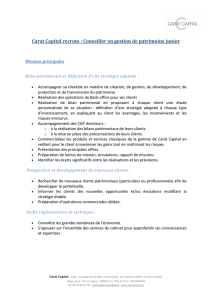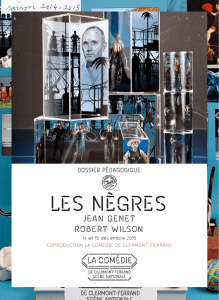Les nègres - La Comédie de Clermont

1
dimanche 14 décembre à 15:00 et lundi 15 à 20:30
maison de la culture salle Jean-Cocteau
durée 1 heure 40
CONTACT PRESSE : Émilie Fernandez – Tél. 0473.170.183 – [email protected]
LES NÈGRES
JEAN GENET
ROBERT WILSON
création le 3 octobre au Théâtre de l’Odéon
Clermont en début de tournée
COPRODUCTION LA COMÉDIE
DE CLERMONT-FERRAND

2
texte Jean Genet
mise en scène,
scénographie et lumière
Robert Wilson
avec
La Reine Armelle Abibou
Bobo Astrid Bayiha
Neige Daphné Biiga
Nwanak
Diouf Bass Dhem
Le Missionnaire Lamine
Diarra
Félicité Nicole Dogué
Le Gouverneur William
Edimo
Le Valet Jean-Christophe
Folly
Vertu Kayije Kagame
Village Gaël Kamilindi
Ville de Saint-Nazaire
Babacar M’Baye Fall
Le Juge Xavier Thiam
Archibald Charles Wattara
Saxophoniste Logan Corea
Richardson
Saxophoniste enregistré
Dickie Landry
dramaturgie
Ellen Hammer
collaboration artistique
Charles Chemin
collaboration à la
scénographie
Stéphanie Engeln
costumes Moidele Bickel
collaboration à la lumière
Xavier Baron
musique extraits d’albums
d’Ornette Colemann
(entrée public et scène 14)
son Thierry Jousse
maquillages Christelle
Paillard, Julie Poulain
coiffures Judith Scotto
assistante à la mise en
scène Cerise Guyon
assistante aux costumes
Tifenn Morvan
réalisation des costumes
Atelier Caraco Cazenou
réalisation du décor
les Ateliers de construction
de l’Odéon-Théâtre de
l’Europe et l’équipe tech-
nique de l’Odéon-Théâtre
de l’Europe
production Odéon-
Théâtre de l’Europe.
coproduction Festival
d’Automne à Paris,
Théâtre national
Populaire – Villeurbanne,
deSingel campus des arts
international – Anvers,
Festival Automne en
Normandie, la Comédie
de Clermont-Ferrand – SN.
avec le soutien du Cercle
de l’Odéon et de LVMH.
en tournée
• création du 3 octobre au
21 novembre, Théâtre de
l’Odéon, Paris.
• les 3 et 4 décembre,
Le Cadran, Automne en
Normandie, Évreux.
• les 14 et 15 décembre,
La Comédie de Clermont-
Ferrand – scène nationale
(coproduction).
• du 9 au 18 janvier 2015,
Théâtre National Populaire,
Villeurbanne.
• du 26 au 28 janvier,
deSingel – Campus
artistique international,
Anvers (Belgique).
crédits
illustration de couverture
Antoine+Manuel
photographies Lucie
Jansch (communiquées
uniquement à la demande
aux rédactions).

3
L’artiste qui nous présente sa vision des
Nègres de Jean Genet est un géant de la
scène. Pour en prendre la mesure, il faut
revenir à Nancy, un soir d’avril 1971, le
jeudi 22 exactement. Invité par le festival
de théâtre alors dirigé par Jack Lang, un
américain de trente ans que personne ne
connaît, Robert Wilson. Une nuit, une
seule petite nuit, suffira pour que ce nom
fleurisse d’une bouche à l’autre et devienne
pour toujours synonyme d’avant-garde.
Bob Wilson est né. Il vient de l’architec-
ture, de la peinture et… de New York, là
où s’invente depuis une dizaine d’années
le neuf, le vif, le meilleur d’un art, toutes
disciplines confondues, que l’on n’appelle
pas encore, contemporain. Bob Wilson est
venu à Nancy avec Le Regard du sourd, un
immense poème visuel totalement éman-
cipé de la contrainte du texte, livré, comme
un rêve, au seul pouvoir de l’image devenue
le lieu principal – sinon unique – du récit.
Un art nouveau apparaît, un théâtre
d’images reconnaissable à la succession de
tableaux d’une beauté foudroyante, à l’ab-
solue primauté du corps en mouvement,
au traitement incroyablement sophistiqué
de la lumière, du son, du costume et du
maquillage. Le Regard du sourd impose au
public une révolution du regard compa-
rable à celle que fut la création du Sacre de
Nijinski à Paris, en 1913. Bob Wilson dit
aux spectateurs regardez, ressentez, faites
votre propre expérience. C’est le même
Bob Wilson, devenu star des scènes nord-
américaines et européennes, un artiste dont
on ne compte plus les coups de génie, qui
s’attache, avec des comédiens français, à
éclairer l’une des pièces de Jean Genet les
plus musicales et poétiques. Théâtre dans
le théâtre, cérémonial burlesque, rituel ou
messe noire, jeu de masques et de miroirs,
on y voit treize personnages, dominés et
dominants, jouer une tragédie sur fond
de décolonisation. Blancs contre Noirs,
Cour blanche contre Nègres comédiens.
Non loin de là, une révolte se prépare. Bob
Wilson se rappelle avoir vu Les Nègres à
New York. Il était alors un étudiant.
Pour la Comédie de Clermont-Ferrand
© Daniel Conrod, printemps 2014
« Un musical corrosif et sculptural,
somptueux écrin à la poésie de Genet. »
DATE ÉVÉNEMENT– Pour la première fois, la Comédie de Clermont accueille
Bob Wilson créateur inimitable et inépuisable, à qui l’on doit, entre autres, le célèbre
opéra
Einstein On The Beach
. Danseur, chorégraphe, créateur et metteur en scène
de théâtre et d’opéra, il impressionne le monde depuis bientôt 45 ans avec une
œuvre aussi protéiforme que foisonnante. La Comédie est coproducteur de cette
nouvelle création. Écrit en 1948, en période de décolonisation, ce texte qui aborde
la question du racisme sur le ton de l’humour, porte en lui le parfum du scandale.
Construction gigogne, déguisement, masques, jeux de miroirs se multiplient,
et font de la pièce un véritable carnaval, une clownerie qui nous perd entre le jeu
et le réel, entre le rite et l’improvisation. Les intrigues se succèdent et les situations
se renversent dans ce texte vivant et joyeux, porté par une troupe d’acteurs
étourdissants de talent.

4
LA PIÈCE
Quand Jean Genet reçut la commande d’une
pièce destinée à être jouée par des interprètes
noirs devant un public de Blancs, sa première
réaction fut d’hésiter. Il ne souhaitait pas
parler de leurs révolutions, de leurs luttes
contre la discrimination, pour la liberté et la
reconnaissance de leurs droits. Il se posa donc
les questions suivantes : qu’est-ce que les Blancs
voient et éprouvent lorsqu’ils rencontrent des
Noirs ? Peuvent-ils se mettre à leur place ?
Ou ne sont-ils que les fantômes des préjugés
des Blancs ? Genet avait vu Les Maîtres fous,
un documentaire de Jean Rouch montrant un
rituel d’Afrique de l’Ouest au cours duquel
des Noirs en transe sont hantés par les esprits
des ex-puissances coloniales blanches. Ce
film déclencha l’écriture des Nègres : il décida
de mettre en scène une cérémonie sous les
yeux de spectateurs déguisés en Blancs, une
combinaison d’absurdités et de remarques
contradictoires visant à amuser leur « public ».
Genet qualifie son œuvre de « clownerie ».
Les Noirs de Genet parlent un langage
poétique qu’ils doivent à leurs exploiteurs
(en l’occurrence, ce langage est constitué des
métaphores poétiques de Genet). Les Blancs
sur scène sont décrits comme déprimés ; leur
vide émotionnel témoigne de leur déclin, qui
finira par s’achever en auto-dissolution. Les
Noirs ne se contentent pas de voler les mots des
« Blancs ». Ils jouent aussi avec leurs peurs et
leurs traumatismes : ils récupèrent à leur profit
les stéréotypes empruntés à leurs ennemis en
jouant à être cruels, sans culture, passionnels,
fourbes, débordants de haine et de désir de tuer
– pour ne rien dire de leur mauvaise odeur. Ils
se vantent d’avoir sauvagement tué plusieurs
femmes blanches après les avoir fécondées et
attendent désormais leur châtiment. Cependant,
la véritable lutte contre les exploiteurs a lieu
« au-dehors » : hors du théâtre et de la réalité
théâtrale. Sur scène, les «Blancs» démasqués
s’avèrent être des Blancs qui sont mis à mort au
cours d’une farce grotesque, à moins qu’ils ne
s’anéantissent eux-mêmes, et la pièce peut dès
lors recommencer depuis le début. Un prologue
silencieux, présenté devant un bâtiment africain
de terre crue, exprime les luttes et les dangers
auxquels les Noirs sont confrontés aujourd’hui.
Quand les acteurs en franchissent le seuil et
pénètrent l’espace sacré s’ouvrant vers les
profondeurs du plateau, cet espace devient le
refuge de leur « clownerie poétique ».
Ellen Hammer, dramaturge, septembre 2014,
traduction de Daniel Loayza.
Résumé
La pièce des Nègres, écrite sur commande est, selon
les termes mêmes de Jean Genet, une « clownerie
». Clownerie sartrienne destinée à montrer sur
le mode ludique du théâtre dans et sur le théâtre,
que le nègre n’est rien d’autre qu’un Noir vu dans
le prisme avilissant du Blanc. C’est par là que la
pièce atteint un niveau de réflexion politique que
les minorités (noires, mais pas exclusivement) ont
considéré comme un support efficace pour exalter
leurs revendications aussi bien culturelles et
sociales qu’anticolonialistes.
« En face de l’être que j’adore et aux regards de qui j’apparus comme
un ange, voici qu’on me terrasse, que je mords la poussière, que je me
retourne comme un gant et je montre exactement l’inverse de qui j’étais.
Pourquoi ne serais-je pas également cet « inverse » ? »
Jean Genet,
Journal du voleur

5
L’espace scénique est divisé en deux parties : assis
sur des gradins surplombants, des dignitaires
blancs (Reine, Gouverneur, Missionnaire, Juge)
dénommés la Cour, assistent à la mise en place
encore approximative, par des Nègres, d’un
spectacle tout entier axé sur le viol et le meurtre
d’une Blanche. On se rend compte rapidement
que les choses sont plus compliquées, car les
Blancs sont en fait des Noirs masqués ; loin
d’être de simples spectateurs, ils interviennent,
tout en se sentant menacés, pour exciter ou
réprimander les Nègres et ils sont au courant du
déroulement futur de l’action. Ce déroulement
est pris en charge par un meneur de jeu/metteur
en scène, Archibald, qui commence par présenter
son personnel dramatique et en brosser une
biographie, avouée comme imaginaire car c’est
un jeu de théâtre où tout est sujet à caution.
Il a bien du mal à faire entrer ses comédiens
dans le cadre du scénario prévu : les rivalités
des Noires : Vertu d’un côté, Bobo et Neige de
l’autre ; les hésitations de Village, destiné, à son
corps défendant, à être le futur meurtrier d’une
Blanche “déjà morte” ; les scrupules de Diouf
qui, tout Nègre qu’il est, prêche la réconciliation ;
l’interférence de la relation amoureuse de Village
et Vertu avec l’enjeu collectif en cours, tout cela
retarde l’enclenchement de l’action proprement
dite, pendant un bon tiers de la pièce. La
représentation du meurtre est jouée au second
degré, sous forme de théâtre dans le théâtre et
mobilise tous les Nègres du plateau pour une
reconstitution vécue comme un psychodrame
par Village et comme une bouffonnerie par tous
les autres, avant de s’achever en coulisse dans une
atmosphère de dérision et de complicité amusée
qui fait douter du sérieux de toute l’opération.
Sa raison d’être, pourtant, si suspecte soit-elle,
est de servir de paravent à une autre action, vraie
celle-ci, qui a lieu en dehors du lieu scénique,
dans quelque clairière de la brousse africaine : on
y procède clandestinement - nous informe Ville
de Saint-Nazaire, Nègre qui fait le va-et-vient
entre l’extérieur et l’intérieur - au jugement,
puis à l’éxécution d’un mauvais Noir. On a
donc besoin de la diversion que constitue le
spectacle pour détourner la puissance coloniale
de la Cour de toute intervention. Voire, car
bien des signes laissent entendre que tout, du
dedans et du dehors, est sujet à caution et miné
par une théâtralité qui exalte le faux : fausseté de
la situation (car il n’y a pas de cadavre dans le
catafalque présent sur scène et qui est pourtant
l’objet de tous les discours) ; fausseté de l’enjeu,
car si le faux meurtre de la Blanche provoque
la vengeance de la Cour, c’est finalement cette
dernière qui se fait piéger et massacrer à la fin
par les Nègres qui retournent à leur avantage un
procès qui devait les condamner à expier leurs
forfaits. S’insèrent dans ce dispositif à multiples
fonds les très lyriques interventions d’un
personnage emblématique, Félicité, la Mère
Afrique. Elle chante la prochaine victoire de la
négritude et en magnifie tous les traits de beauté
et de force. S’entremêle également l’histoire
d’amour de Village et de Vertu : leur désir est
d’échapper à la malédiction du regard blanc
et de construire à neuf leur identité ; il semble
qu’ils aient des chances de réussir. Insolente et
bigarrée, la pièce justifie particulièrement son
sous-titre de “clownerie” à son denouement où
les membres de la Cour viennent tour à tour
se faire métaphoriquement et grotesquement
exécuter avant que les uns et les autres, en se
démasquant, n’apparaissent sous leur vraie
identité de Noirs, révoltés et solidaires d’un
même projet : se libérer totalement, en esprit
comme en actes, de la tutelle aliénante des
Blancs.
Michel Corvin, Jean Genet, Les Nègres,
Gallimard, Folio Théâtre, 2005, pp 182-183
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%