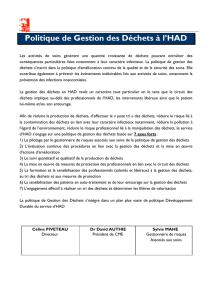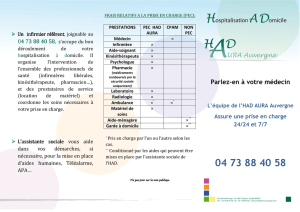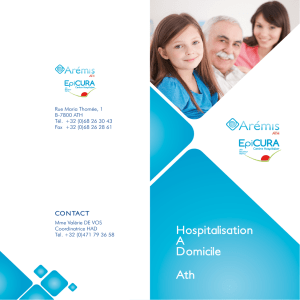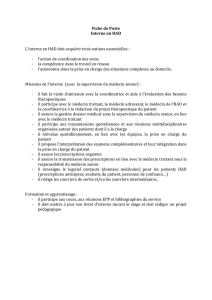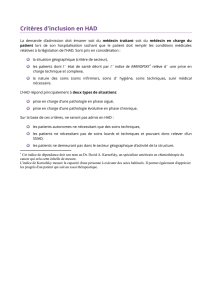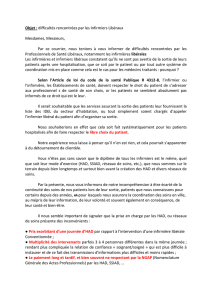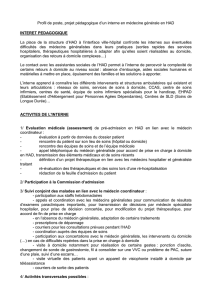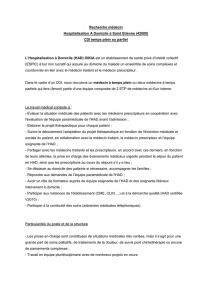Hospitalisation à domicile - L HAD Croix St

a structure d’HAD Croix St-
Simon a été créée en 1967 et
intégrée à la fondation Croix
St-Simon en 1997.
Fonctionnement
La demande d’hospitalisation à domi-
cile fait suite à une prescription médi-
cale, établie en général par un méde-
cin hospitalier, et accessoirement par
un médecin traitant. « Nous sommes
une alternative à l’hospitalisation :
soit on écourte un séjour hospitalier,
soit on évite une hospitalisation »,
explique M. Raphaël Viollet, directeur
de l’HAD Croix St-Simon. Le médecin
prescripteur et un cadre de santé
coordonnateur de l’HAD établissent le
projet thérapeutique du patient, qui
définit les objectifs de la prise en
charge en HAD. Il appartient ensuite
au médecin coordonnateur de délivrer
l’avis médical d’admission. Le méde-
cin traitant est le pivot de la prise en
charge en HAD. Il doit effectuer au
moins une visite hebdomadaire au
domicile du patient afin de déterminer
l’évolution de son état et de renouve-
ler les prescriptions. La mise en œuvre
du projet thérapeutique nécessite une
prise en charge médicale, sociale et
psychologique. Cette prise en charge
globale du patient requiert une
approche pluridisciplinaire. La durée
du séjour n’est pas définie a priori. Elle
est en moyenne de 35 jours pour les
patients adultes et de 15 jours pour
les enfants. L’HAD Croix St-Simon
assure une continuité des soins
24 h/24 et 365 j/an, selon son direc-
teur : « Nos équipes soignantes peuvent
se déplacer au domicile des patients
en permanence. Nous avons une per-
manence téléphonique continue, assu-
rée par un cadre de santé, ainsi qu’une
permanence médicale ». L’HAD Croix
St-Simon dispose d’une convention
avec les Urgences Médicales de Paris
(UMP), et compte pas moins d’une
soixantaine de partenariats hospitaliers.
M. Viollet revient sur la notion d’équipe
pluridisciplinaire, notion essentielle à
ses yeux : « Toute notre organisation
vise à faciliter la collaboration entre les
différents professionnels par le biais de
réunions pluridisciplinaires et de visites
conjointes ». Et de poursuivre : « Chaque
professionnel de santé a un regard
propre en fonction de sa compétence,
et c’est la confrontation de ces diffé-
rents regards qui permet d’avoir la
vision la plus globale du patient ».
Chaque équipe (notamment les
équipes de jour) est encadrée par des
cadres de santé référents, qui assurent
la mise en œuvre du projet thérapeu-
tique en liaison avec le médecin coor-
donnateur, le service social et les psy-
chologues. Tous les professionnels de
santé sont des salariés de la structure
d’HAD. « Nous faisons aussi appel à
des professionnels libéraux – kinésithé-
rapeutes, sages-femmes, infirmières
libérales – en fonction des besoins »,
précise M. Viollet.
Le médecin coordonnateur
Ancienne praticienne en gériatrie et
soins palliatifs à l’Assistance publique,
le Dr France Vautier est aujourd’hui
médecin coordonnateur-gériatre au
sein de l’unité François-Xavier Bagnoud.
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 53 • mars 2004
Elle a été d’emblée séduite par les ver-
tus de l’hospitalisation à domicile.
« J’ai découvert un outil de travail for-
midable pour maintenir et soigner les
patients à domicile en toute sécurité
dans le respect de la personne et de
sa dignité. J’ai retrouvé des valeurs
que j’avais perdues à l’hôpital». Le
médecin coordonnateur est respon-
sable de la coordination des soins, de
l’admission initiale au domicile ou à
l’hôpital jusqu’à la sortie de l’HAD. Il
doit s’assurer que les critères d’admis-
sion correspondent bien à une prise
en charge en HAD. Il délivre ensuite
l’avis favorable d’admission en HAD.
Dans la pratique, ce sont les cadres de
santé coordonnateurs qui examinent
les critères d’admission et délivrent
par délégation l’avis favorable d’admis-
sion. Le médecin coordonnateur n’est
pas prescripteur, il est à “la disposition”
du médecin traitant et peut proposer,
le cas échéant, des visites en binôme,
surtout en soins palliatifs. « Il nous est
difficile de soumettre certains conseils
aux médecins traitants qui nous
reprochent, à tort, d’être éloignés du
terrain et accaparés par les tâches
administratives », rapporte le Dr Vautier.
Pourtant, le conseil auprès du méde-
cin traitant est évident : par sa compé-
tence de clinicien d’une part, et par sa
position qui le place en médiateur,
d’autre part., il est ce lien indispen-
sable entre les soignants et le patient
et son entourage. « Le profil de méde-
cin coordonnateur est encore relative-
ment nouveau », souligne-t-elle. Le
médecin coordonnateur assure certes
des obligations administratives. Mais il
a aussi un rôle de formation auprès
des équipes soignantes qu’il soutient
de ses avis. Il effectue des déplace-
ments de la clinique au domicile et
représente l’HAD lors des rencontres
régulières avec les chefs de service
des hôpitaux partenaires. « Nous nous
déplaçons au domicile du patient à la
Soins Libéraux
34
Hospitalisation à domicile
L’HAD Croix St-Simon “joue en équipes”
Les forces vives d’une structure de HAD, ce sont les professionnels
de santé qui la composent. Celles de la Croix St-Simon ne dérogent
pas à la règle. Participant à des réunions pluridisciplinaires hebdo-
madaires, directeur, médecin, infirmière, aide-soignant ont accep-
té de se pencher sur le fonctionnement concret de la structure.
L
Infos ...
La structure HAD
Croix St-Simon
Elle dispose
de 200 lits ou places
et elle est dotée
d’un effectif de
137 professionnels
de santé et autres
(dont 60 infirmiers(es)
diplômés).
Ces professionnels
de santé sont
répartis entre
les quatre équipes
de jour, l’équipe
de nuit, l’unité de
soins pal
liatifs
“unité François-Xavier
Bagnoud”,
et l’unité
pédiatrie. La zone
d’intervention de
l’HAD couvre Paris
intra-muros,
les communes
limitrophes de Paris
et l’Est francilien
jusqu’à Pontault-
Combault.
Soins libéraux 26/03/04 16:13 Page 34

demande des équipes soignantes, de
la famille ou du médecin traitant »,
rappelle le Dr Vautier. À titre d’exem-
ple, le médecin coordonnateur peut
intervenir au domicile du patient pour
réévaluer une prise en charge, notam-
ment par rapport à la famille (épuise-
ment de la famille). Le Dr Vautier se
félicite de la qualité de la collaboration
et des échanges – sur le terrain et lors
des réunions pluridisciplinaires – avec
les autres professionnels de santé,
notamment les infirmières. « En plus
d’une compétence technique de haut
niveau, largement équivalente à celle
de l’hôpital, les infirmières ont une
grande capacité à gérer seules les
situations difficiles au
domicile » s’en-
thousiasme le Dr Vautier.
La relation est
plus intime puisqu’elle se déroule
chez le patient dont la vie sociale et
familiale doit être prise en compte ; ce
qui exige une certaine souplesse
d’adaptation car cela ne va pas sans
introduire une certaine complexité
dans l’organisation des soins.
Dossiers de soins
Les infirmières de l’HAD sont habilitées
à faire les entrées, c’est-à-dire à expli-
quer le fonctionnement de l’HAD au
patient. « Nous avons une grande auto-
nomie dans notre pratique et une res-
ponsabilité accrue à domicile et une
hiérarchie moins importante qu’à l’hô-
pital. De plus, étant donné l’éventail
des soins, le travail n’est jamais
routinier », résume Christine Dalahaye,
infirmière de jour. Il y a aussi l’attrait de
rencontrer le patient à son domicile car
son comportement n’est pas le même
qu’à l’hôpital. Bien entendu, les infir-
mières effectuent les mêmes soins qu’à
l’hôpital, à savoir les soins techniques
(perfusions, seringues électriques, PCA,
pansements complexes), les soins de
confort (toilette, prévention d’escarres),
mais aussi des soins relationnels (bilan
régulier avec le patient sur son état, sa
douleur, sa situation psychologique).
« Les relations soignant/ soigné sont
les mêmes qu’à l’hôpital. Si ce n’est
qu’en HAD, il faut gagner la confiance
du patient et le rassurer car les soins
sont complexes, explique Mme Dela-
haye. C’est pourquoi on demande une
bonne expérience professionnelle aux
infirmières et une capacité certaine
d’autonomie ». Notre infirmière rap-
porte, par ailleurs, qu’au démarrage de
l’HAD, le patient et la famille éprouvent
une inquiétude importante quant à la
mise en œuvre des soins : inquiétude
qui tend à s’estomper par la suite.
« Nous devons gagner leur confiance »,
insiste l’infirmière. Dans sa pratique
quotidienne à domicile, l’infirmière
consigne par écrit dans un dossier de
soins tout le contenu des soins prati-
qués, toutes les ordonnances, ainsi que
les transmissions aux autres soignants.
La réunion pluridisciplinaire hebdoma-
daire sert aussi à partager et à trans-
mettre les informations entre les
équipes afin d’optimiser les soins. Sur le
terrain, l’infirmière est équipée d’un
téléphone portable pour pouvoir joindre
les autres soignants, le cadre de secteur,
le médecin coordonnateur et le méde-
cin traitant. Selon Christine Delahaye,
l’une des difficultés récurrente dans la
pratique à domicile est de pouvoir assu-
rer à la demande du patient des
horaires de passage fixes, ce qui est
clairement
impossible en raison de
certains soins aux horaires priori-
taires. « Cette contrainte est souvent
mal perçue par le patient et sa
famille, qui doivent attendre le soi-
gnant », regrette Mme Delahaye.
Cette
dernière évoque également le cas
des patients dépendants pour lesquels
la présence d’un entourage familial se
révèle indispensable afin qu’ils accè-
dent à une prise en charge en HAD. Il
arrive souvent qu’infirmière et aide-soi-
gnante exercent en binôme pour la
mobilisation des patients douloureux
(corpulents) et se retrouvent ensemble
au domicile du patient.
Soins délégués
L’aide-soignant dispense les soins
délégués par l’infirmière, essentiel-
lement les soins d’hygiène et les
pansements simples. « Le moment
de la toilette est important pour
signaler tout changement de l’état
général du patient à l’infirmière ou
au médecin », avance Mme Chris-
tine Rochet, aide-soignante de
l’équipe de jour. Selon elle, la rela-
tion avec le patient est plus riche à
domicile. Les échanges sont plus
approfondis qu’à l’hôpital, ce qui
permet de déceler certains pro-
blèmes sociaux ou des angoisses
liées à la maladie. Dans leur rela-
tion quotidienne avec certains
patients, les aides-soignants peu-
vent se trouver confrontés à la bar-
rière de la langue. « On arrive tout
de même à communiquer »,
assure Mme Rochet. Les aides-soi-
gnants veillent alors à ce que les
prescriptions médicales (traitement
et mobilité du malade) soient bien
comprises et suivies par le patient
et son entourage.
Ordonnance du 4 septembre
À tout seigneur, tout honneur,
Raphaël Viollet, en gestionnaire avisé,
fait le point sur cette année 2003.
Ainsi, le budget 2003 de l’HAD Croix
St-Simon était de 11 millions d’euros
pour un objectif annuel de
69 000 journées de prises en charge.
La structure est financée par dotation
globale. Le directeur de la structure se
montre volontiers circonspect quant à
l’impact des réformes introduites par
l’ordonnance du 4 septembre. «La
suppression du taux de change n’a
pas d’impact sur notre structure, car
on n’a pas de projet de développe-
ment à court terme. L’ordonnance
devrait certes faciliter les créations de
places mais le problème majeur
reste le
financement de ces places
autori
sées »,
explique le directeur. Ce
dernier se félicite cependant de l’avè-
nement des groupements de coopé-
ration sanitaire qui devrait permettre
à sa structure d’établir des coopéra-
tions étroites avec d’autres établisse-
ments, notamment dans les domaines
pharmaceutiques et logistiques.
Le développement de l’HAD est une
voie d’avenir, notamment grâce à la
mise en place de certains dispositifs
d’aide financière. Car les limites du
maintien à domicile ont souvent un
caractère social.
François Cohen
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 53 • mars 2004
Soins Libéraux 35
Soins libéraux 26/03/04 16:13 Page 35
1
/
2
100%