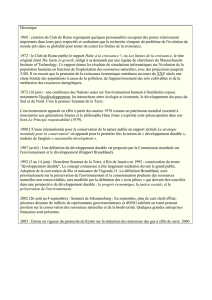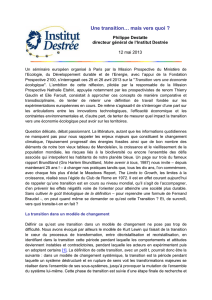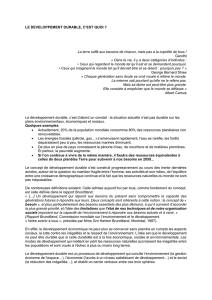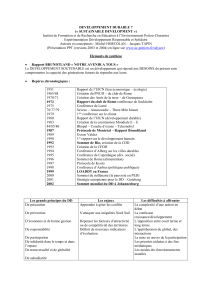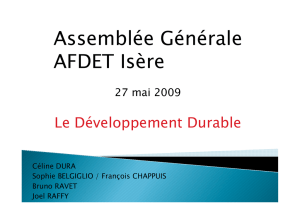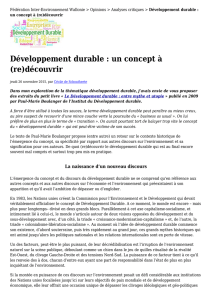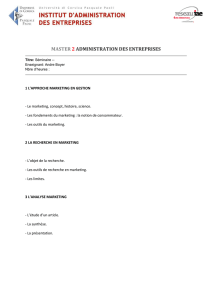l`apport de l`économie politique

La revue électronique en sciences de l’environnement VertigO, Vol7no2, septembre 2006
VertigO, Vol7 No2
1
SUD, DEVELOPPEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE :
l’apport de l’économie politique
Catherine Figuière, Laboratoire d'Economie de la Production et de l'Intégration Internationale,
Université Pierre Mendès France de Grenoble (UPMF), BP47 38040 GRENOBLE Cedex 9, France,
Courriel : catherine.figuiere@upmf-grenoble.fr
Résumé : Cet article a pour objet de traiter la problématique du développement durable sous l’angle des enjeux pour les pays du Sud. Il
tente de proposer une lecture en économie politique de l’avènement du développement durable version Brundtland. L’objectif est de
montrer en quoi cette version, parce qu’elle ne nécessite pas de changement paradigmatique, ne permet pas un renouvellement de la
problématique du développement. Alors que des propositions comme l’écodéveloppement, formulées au cours des années 70 auraient pu
permettre une internalisation de la contrainte environnementale dans des projets motivés centralement par la satisfaction des besoins, la
définition retenue sur la base du Rapport Brundtland et validé par le cadre onusien, choisit de ne pas hiérarchiser les trois pôles et donc
implicitement de ne pas remettre en cause la centralité des objectifs économiques. Ainsi, le « Paradigme de Rio » constituant un
prolongement thématique du « Consensus de Washington », le développement durable ne vient que complexifier la problématique du
développement des pays du Sud en le rendant plus coûteux.
Mots clés : développement durable, Sud, développement, écodéveloppement, économie politique.
Abstract : This paper addresses the issue of sustainable development for South countries. It offers a political economy approach of the
coming of the Brundtland version of sustainable development. The aim is to show that this consensus seeking version does not offer a
renewal of development approach because it does not require a change of paradigm. The guiding principles of the Brundtland report,
widely accepted by the United Nations’ system, do not offer a hierarchy among the three poles, and thus do not question the prevailing
central position of economic goals - whereas the ecodevelopment project in the 1970’s was to integrate the environmental constraint in a
human needs satisfaction perspective. In this context we present the ‘Rio paradigm’ as a mere thematical extension of the Washington
Consensus, thus bringing both more complexity and higher costs for development process in the South.
Key Words : Sustainable Development, South, Development, « ecodevelopment », political economy.
Introduction
Alors qu’il s’annonçait comme le projet des « bons sentiments »1,
le développement durable menace aujourd’hui de devenir une
« chimère malfaisante » (Godard, 2004). S’il a pu être perçu
pendant une courte décennie, comme un moyen du
développement, les actions menées en son nom sont en effet
parfois taxées aujourd’hui « d’ingérence écologique » (Rossi,
2000). En un quart de siècle, le développement durable s’est
certes imposé mais les critiques à son encontre se sont
développées.
Cette distance entre les intentions et les réalisations peut assez
naturellement s’expliquer par l’ampleur des ambitions fixées par
le rapport Brundtland : « Le développement soutenable
(sustainable) est un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion :
1) le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins
essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus
1 La références aux bons sentiments en matière de développement
durable est devenue récurrente, Brunel (2004) p21, Theys (2000).
grande priorité, et 2) l’idée de limitation que l’état de nos
techniques et de notre organisation sociale imposent à la
capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à
venir » (CMED, p51).
Cette distance peut également trouver des explications dans la
dilution progressive des priorités qui rend aujourd’hui
l’opérationnalité du projet incertaine. Dans la formulation
« officielle »2 par exemple, les objectifs inhérents à la sphère
sociale (besoins) précèdent clairement les contraintes
environnementales. En d’autres termes, les enjeux de
développement sont premiers. Pourtant, force est de constater que
les acceptions ultérieures du développement durable vont
s’avérer peu fidèles à l’intention affichée et « dans les faits, le
développement durable se résume de plus en plus au respect de
l’environnement » (Brunel, 2005b, p17).
2 Gauchon et Tellene (2005, p1). Ces derniers précisent par
ailleurs que cette définition amène « à trop étendre le concept »
et préfèrent définir le développement durable comme « la
capacité de notre génération à améliorer sa situation matérielle
tout en préservant le milieu pour que nos successeurs puissent en
faire autant ».

La revue électronique en sciences de l’environnement VertigO, Vol7no2, septembre 2006
VertigO, Vol7 No2
2
Si cette distance rappelle l’effectivité relative des actions en
faveur du développement durable, elle ne réduit pourtant pas
l’actualité de la visée « politique » du rapport Brundtland. Car
comme le note I. Sachs, «le rapport Brundtland n’a rien apporté
sur le plan conceptuel, mais il a énormément compté sur le plan
politique. » (2002, p7). Le prologue du Rapport Brundtland,
signé par Gagnon et Mead, situe d’ailleurs explicitement cette
ambition politique dans une double logique d’identification des
problèmes et de proposition de solutions globales. La
Commission « a clairement identifié les problèmes
environnementaux les plus importants » (p XIII) et elle « propose
des mesures permettant de solutionner les problèmes à l’échelle
mondiale » (p XIV). Le décalage entre les intentions et les
réalisations masque donc un écart beaucoup plus significatif pour
l’économiste : l’écart entre quelques succès -Kyoto- et des échecs
massifs -la situation économique et sociale des pays du Sud.
Le constat de ce décalage constitue la motivation première des
interrogations développées dans ce texte. L’objectif est donc de
progresser dans la compréhension des enjeux de l’avènement du
développement durable pour les pays du Sud. En d’autres termes,
cet avènement peut-il constituer une opportunité nouvelle pour
les nations qui ne sont pas parvenues à se développer ? L’analyse
vise à montrer que, dans la mesure où le projet initié par le
rapport Brundtland ne s’accompagne pas d’un changement de
paradigme, le développement durable n’entraîne pas les
modifications indispensables à l‘impulsion d’un développement
et , a fortiori, d’un développement durable.
Après avoir précisé, dans un premier temps, la démarche retenue
dans ce papier, qualifiée d’économie politique du développement
durable, un second point éclairera les relations sémantiques,
conceptuelles et historiques entre trois notions : le
développement, l’écodéveloppement et le développement
durable. Dans un troisième et dernier point, ce texte montrera
enfin en quoi le développement durable dans sa version la plus
consensuelle ne constitue pour le Nord qu’une nouvelle façon de
« tirer l’échelle » au pays du Sud, en leur fermant la voie qu’ils
ont eux-mêmes empruntée pour se développer.
Quelle démarche pour quel développement durable ?
La prolifération des publications proposant des typologies des
travaux consacrés au développement durable est révélatrice de la
grande diversité des postures méthodologiques de ces derniers De
manière générale, ces typologies mettent en avant la nécessité
pour le chercheur de préciser cette posture, en amont de toute
amorce de réflexion3.
L’objectif poursuivi ici amène à proposer une démarche en
économie politique, que l’on peut définir par la préférence
donnée à deux angles d’attaque :
3 Sur ces tentatives en français se reporter notamment à Hatem
(1990), Godard (1994) et Vivien (2004).
• l’analyse des stratégies d’acteurs, et en particulier les
stratégies des Etats-Nations, des institutions
internationales ou des ONG –y compris des « ONG, ou
coalition, d’entreprises4». Ces acteurs interviennent en
effet à la fois dans les choix entre projets concurrents,
mais également dans celui des modalités pratiques au
moment du passage à la mise en œuvre.
• l’analyse des interactions entre les sphères politiques et
économiques, essentielles à la compréhension des
compromis adoptés. La définition de l’Economie
Politique Internationale (EPI) formulée par G.
Kébabdjian (1999, p8) permet de progresser dans la
détermination d’une démarche en économie politique.
En effet, l’EPI « cherche à analyser la sphère des
relations économiques internationales, centrées sur les
phénomènes de richesse (production et circulation de la
« richesse des nations ») en prenant en compte les
articulations avec la sphère du politique, centrée sur les
phénomènes de pouvoir. » Cette façon de raisonner sera
ici transposée à des domaines qui ne sont pas
nécessairement « internationaux ».
Cette orientation d’« économie politique du développement
durable » n’est pas sans implications analytiques fortes.
Premièrement, elle entraîne un certain rapport à l’économie. Le
détour par les stratégies d’acteurs tant sur le plan de la production
de richesse que sur celui du pouvoir, invite en effet à une
approche économique qui, par essence, se préoccupe des activités
des hommes en vue de satisfaire leurs besoins, avant de lire les
impacts de ces activités sur l’environnement5. Cette posture n’est
pas incompatible avec une vision « forte » de la soutenabilité
dans la mesure où elle reconnaît une forte spécificité au
« capital » naturel, auquel le capital n’est que très partiellement
substituable6. La démarche en économie politique proposée ici
4 Se référer notamment à C. Giorgetti, NYU environnemental law
journal (1999)
http://www.law.nyu.edu/JOURNALS/ENVTLLAW/issues/vol7/
2/v7na2.pdf.
5 L’anthropologie réside dans l’étude de la dimension sociale de
l’homme. L’anthropocentrisme est une conception, une attitude,
qui rapporte toute chose à l’univers de l’homme (définitions
Larousse). D’où l’impossibilité de distinguer une approche
« anthropocentrée » (dans laquelle l’économie englobe les
sphères environnementale et sociale) d’une démarche « socio-
centrée » dans laquelle c’est la sphère sociale qui englobe les
deux autres, comme le font Sébastien et Brodhag (2004).
6 A ceux qui prétendent « qu’il faut « être deep » ou ne pas être,
car si on ne prend pas une position deep, finalement, la logique
économique va finir de détruire entièrement l’écosystème »
[Smouts, 2005, p58], il peut être répondu qu’ils réduisent une
fois encore le développement durable à deux de ses pôles. Or
l’optique qui est ici défendue vise au contraire un recentrage sur
le pôle social comme priorité dans la hiérarchie des objectifs du

La revue électronique en sciences de l’environnement VertigO, Vol7no2, septembre 2006
VertigO, Vol7 No2
3
s’inscrit, en fait, dans une approche plus anthropocentrée, dans
laquelle « le souci de préserver les ressources naturelles est
justifié par l’utilité qu’elles présentent pour l’homme (…). Le
développement durable se définira donc en référence au maintien
ou à l’augmentation du bien-être humain. » (Hatem, 1990, p103)
à la différence d’une démarche strictement écocentrée dans
laquelle « la vie est supposée avoir une valeur en elle-même ; le
fondement du droit à l’existence d’une vie des non-humains n’est
plus utilitariste mais éthique ».
La deuxième implication analytique de cette démarche en
économie politique concerne les trois piliers du développement
durable –social, environnemental et économique- et leur
positionnement respectif. Dans les typologies mentionnées ci-
dessus, si les auteurs ne sont pas forcément d’accord sur les
positionnements de tels ou tels travaux, ils ont néanmoins en
commun de définir trois catégories en fonction de la priorité
affichée pour l’un ou l’autre des piliers du développement
durable (Godard [1994], Vivien [2004]). L’« entrée » dans le
développement durable retenue ici se fait par le social, mais se
préoccupe bien des possibilités de l’articulation entre les trois
piliers, sans laquelle il ne saurait être question de développement
« durable ». En cela, la démarche rejoint la proposition faite par
J.-P. Revéret (2004) : « le développement social et humain est un
objectif, l’intégrité écologique, une condition, et le
développement économique, un moyen ».
Une troisième et dernière implication concerne l’analyse
territoriale. Dans la mesure où les enjeux de l’application des
principes du développement durable aux pays en voie de
développement constituent l’objet de l’analyse, il convient en
effet de s’interroger à la fois sur le niveau territorial pertinent
pour édicter les objectifs du développement durable, mais
également sur celui où sont mis en place les moyens de les
atteindre. Les travaux portant sur l’ancrage territorial du
développement durable peuvent là encore faire l’objet d’une
typologie en trois catégories. Les premiers postulent sur « la
prééminence du global », les deuxièmes se fondent sur
« l’antériorité du régional » (Vivien et Zuindeau, 2001), les
troisièmes enfin, travaillant sur la nécessaire articulation des
niveaux territoriaux, reconnaissent la nécessité d’un niveau
intermédiaire susceptible d’assurer « la rencontre des logiques
ascendante et descendante » (Godard, 2005, p7). L’analyse
menée ici s’inscrit directement dans ce cadre, relativement
compatible avec une démarche en économie politique soucieuse
de la construction des compromis entre acteurs appartenant à des
niveaux territoriaux différents.
développement durable ; l’environnement étant considéré comme
nécessaire à la survie de l’espèce humaine. En d’autres termes,
l’hypothèse d’une Terre parfaitement préservée –wilderness-,
dans laquelle le bien-être des hommes ne rentre pas en ligne de
compte, n’est pas notre objet.
Les critères caractéristiques d’une démarche d’économie
politique ayant été précisés, il convient désormais d’analyser la
signification de la succession des notions concernant le
développement des pays du Sud, en prenant soin de distinguer
ceux qui ont au moins fait l’objet d’une tentative d’application de
ceux qui sont restés à l’état de projets.
Développement, développement durable, écodéveloppement :
des notions concurrentes pour des projets différents
La prise de conscience de la finitude du monde remonte au tout
début des années 1970 avec la publication notamment du premier
Rapport Meadows. Le terme de développement durable apparaît
quant à lui dès 1980 dans un rapport de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature. Il n’est cependant médiatisé
qu’à partir de la publication du Rapport Brundtland en 1987.
Les projets proposés durant les années 1970 pointent davantage
les contradictions entre les sphères économiques et
environnementales. Ils soulignent parfois même l’irréductibilité
entre le maintien de la croissance économique et la préservation
des conditions de survie de l’espère humaine sur la terre. Dans ce
contexte, et face à la réaction d’un certain nombre de dirigeants
politiques (Kissinger suite au Sommet de Coyococ en 1974 en
particulier), l’ONU va explicitement demander à Gro Harlem
Brundtland de travailler sur des propositions en faveur d’un
« consensus » autour du double thème du développement et de
l’environnement. Il faut dépasser le conflit entre les deux sphères
et les réconcilier. Pour l’initiative onusienne, le développement
« durable » doit désormais se présenter comme « englobant » le
développement. Le développement durable est censé relever du
développement avec une dimension supplémentaire : la prise en
compte de l’environnement qui entraîne nécessairement la
réflexion sur les générations futures.
L’analyse des enjeux de l’avènement du développement durable
pour les pays du Sud, nécessite de revenir sur le moment précis
du « basculement des propositions » en matière de
développement durable : le passage « direct » du développement
au développement « durable », qui s’est opéré au cours de la
décennie 80. Ce passage se fait au détriment du projet
d’écodéveloppement, initié au début des années 70 dans le but
explicite de trouver une solution à la situation du Tiers Monde.
Développement et environnement : les projets des années 70.
Les années 70, décennie de la médiatisation de la finitude du
monde, ont vu émerger plusieurs projets de développement pour
les pays du Sud, tous motivés par la prise en considération de la
question environnementale.
Le projet d’écodéveloppement proposé pour la première fois à
Stockholm en 1972 s’articule autour de la nécessité de prendre en
considération conjointement cinq dimensions du développement
(Sachs, 1994, p54).

La revue électronique en sciences de l’environnement VertigO, Vol7no2, septembre 2006
VertigO, Vol7 No2
4
1. La première est la plus importante : elle combine la
pertinence sociale et l’équité des solutions proposées puisque
la finalité du développement est toujours éthique et sociale.
2. La seconde concerne la prudence écologique : (…) la survie
de l’espèce humaine est en jeu et par conséquent il n’est plus
possible d’externaliser les effets environnementaux de nos
actions sans s’en préoccuper aucunement.
3. La troisième dimension vise l’efficacité économique qui
n’est qu’instrumentale. (…) Il s’agit de mieux situer
l’économie et de mesurer son efficacité à l’aune des critères
macrosociaux et non simplement de rentabilité micro-
économique.
4. Une quatrième dimension est d’ordre culturel. Les solutions
proposées doivent être culturellement acceptables, ce qui
renvoie à l’un des problèmes les plus difficiles pour le
« développeur » : celui de proposer le changement dans la
continuité culturelle en évitant d’imposer des modèles
exogènes mais, en même temps, en refusant de s’enfermer
dans le traditionalisme immobile.
5. Finalement, il y a la dimension de territorialité, la nécessité
de rechercher de nouveaux équilibres spatiaux, les mêmes
activités humaines ayant des impacts écologiques et sociaux
différents selon leur localisation. La planification socio-
économique et l’aménagement du territoire doivent être
pensés conjointement.
Si dans sa version initiale, cette « approche opérationnelle »,
comme la qualifie Sachs lui-même, est motivée par la question
du sous-développement, dès 1974 à Coyococ une nouvelle
version propose un modèle de développement valable pour tous
(Vivien et Zuindeau, 2001, p23).
Ce projet d’écodéveloppement porté par des personnalités très
médiatiques comme Maurice Strong et Ignacy Sachs a eu
tendance à faire oublier d’autres projets de même nature conçus
au cours de la même décennie. Par exemple, « L’autre
développement », proposé dans un rapport sur le développement
et la coopération internationale commandé à la Fondation Dag
Hammarskjöld pour la 7ème session extraordinaire de l’Assemblée
Générale des Nations Unies en 1975, mérite d’être mentionné.
D’une part, les « cinq éléments de son cadre conceptuel » sont
très proches des cinq principes de l’écodéveloppement, et d’autre
part, comme le Rapport Brundtland, il voit le jour dans le cadre
onusien.
« Un autre développement
1. « est axé tout entier vers la satisfaction des besoins, à
commencer par l’élimination de la misère ;
2. est endogène et « self-reliant », c'est-à-dire en prenant
appui sur les forces mêmes des sociétés qui s’y
engagent ;
3. s’harmonise avec l’environnement ;
4. exige des transformations de structure ;
5. nécessite une action immédiate possible et nécessaire »
(p28-40).
Cette proposition induit la nécessité d’un « nouvel ordre
international » remettant en cause notamment la validité d’un
modèle unique de développement valable pour tous à tout
moment de l’histoire. Centré sur la satisfaction des besoins en
harmonie avec l’environnement, il n’a pas retenu l’attention alors
qu’il avait pourtant pour caisse de résonnance l’Assemblée
Générale des Nations Unies.
Il est à souligner que cette tradition ne s’est pas pour autant
éteinte malgré la focalisation sur le « développement durable »
qui caractérise les décennies suivantes. Les travaux initiés par
Juan Martinez-Allier à partir des années 80 constituent en
particulier une critique à la fois du développement durable qui
permet de « recommander les programmes d’ajustement
écologiques » à travers une « sorte de FMI écologique » (1992,
p1), mais également du paradigme à la base de l’ordre
international en vigueur à travers le concept d’échange
écologiquement inégal (2001).
Les projets « d’écodéveloppement » et « d’un autre
développement » se situent dans la lignée des approches critiques
en matière de développement7. Ils convergent sur la
reconnaissance de la spécificité de la situation des pays en
développement. C’est au contraire un projet porteur d’un modèle
universel pour le Nord et le Sud qui va être retenu au cours de la
décennie 80 avec l’avènement du « développement durable ».
Le développement durable version Brundtland : un projet pour
tous
« L’avènement du développement durable » résulte donc de
l’éviction des projets de développement durable pour le Sud. Il
n’y a cependant pas consensus sur les raisons de cet
« avènement » au cours des années 80-90. Les deux propositions
suivantes situent l’éventail des hypothèses avancées. La première
explication, qualifiée d’endogène, est constitutive de la définition
même du développement durable. La seconde, qui cherche ses
arguments dans des évènements non constitutifs de cette
définition, est quant à elle qualifiée d’exogène.
La lecture endogène du processus mobilise, pour expliquer « les
origines historiques et institutionnelles du développement
durable », des arguments issus du thème des prises de conscience
dans le domaine de l’environnement. Cette vision est proposée
notamment par l’IRD (Institut de Recherche sur le
Développement) (Martin, 2002). Dans ce cadre, « la montée en
puissance du développement durable à partir des années 1980 »
est caractérisée par une énumération de phénomènes allant de la
« reconnaissance institutionnelle de pollutions qualifiées de
7 La distinction entre pensée dominante et pensée critique faite
dans le champ du développement durable (Boisvert et Vivien,
2006) mais également dans d’autres comme celui de l’économie
politique internationale (Kébabdjian 2006) sera retenue ici. Ce
dernier retient le terme de système dualiste constitué d’un pôle
« mainstream » et d’un pôle « hétérodoxe ».

La revue électronique en sciences de l’environnement VertigO, Vol7no2, septembre 2006
VertigO, Vol7 No2
5
globales », aux diverses catastrophes majeures du type
Tchernobyl, en passant par les risques d’épuisement des
ressources naturelles non renouvelables (pp56-57). Les
motivations de l’ajout du thème environnemental au
questionnement sur le développement se situent exclusivement
dans la sphère environnementale. Cette lecture intronise « la »
nécessité d’une « durabilité » sans pour autant se positionner ni
par rapport au développement ni par rapport à la concurrence
entre les différents projets de développement durable.
D’autres auteurs, comme Sylvie Brunel – géographe du
développement -, proposent une lecture totalement exogène de
l’émergence du développement durable comme successeur du
développement. Ils mobilisent des facteurs explicatifs situés dans
la sphère politique.
« Le développement est un produit de la guerre froide. (…) Il
s’agit d’empêcher les pays pauvres de basculer dans le camp
du communisme (…) par le biais de l’aide économique aux
nations (qualifiées alors) de « sous-développées ». (…) (Ce
développement) sous-tend aussi que les pays pauvres doivent
forcément connaître un cheminement identique à celui des
pays riches, qui les conduise de la pauvreté à l’entrée dans
une société de consommation ». (…) (Brunel, 2004, p26-27)
« Si le concept de développement durable est apparu
précocement au sein des institutions internationales, il n’a
pas réussi à s’imposer immédiatement, parce que le contexte
économique et géopolitique n’était pas propice. L’évolution
de la donne internationale au tournant des années 1990 va,
au contraire, lui permettre de s’installer. » (Brunel, 2004, p
35) (…) « l’aide publique au développement s’effondre avec
la disparition du mur de Berlin en 1989 (…). Jusque là
allouée pour des motifs stratégiques et géopolitiques par les
grandes puissances (…) elle perd dès lors son utilité ».
(Brunel, 2004 p19)
Cette lecture exogène met en avant la volonté politique qui
émanent des pays du Nord : le thème du développement durable
est interprété comme une tentative d’évincer les approches
« développementistes » fondées sur une reconnaissance des
spécificités des pays du Sud. Radicale, cette approche a
néanmoins l’avantage de souligner la nécessité de resituer
l’apparition d’une notion, ou concept, dans le contexte de la
dynamique des relations de pouvoir existant entre les Etats-
nations, et des capacités d’influence de ces derniers au sein des
institutions internationales. Le choix de ces institutions en faveur
de la définition du développement durable issue du Rapport
Brundtland, au détriment de l’écodéveloppement d’I. Sachs, est
révélateur d’une motivation spécifique : le contenu du « nouvel
outil » doit être consensuel, « politiquement correct », c’est à dire
compatible avec le paradigme8 en vigueur au sein d’autres
8 La définition du paradigme retenue ici fédère des apports de
Kuhn et d’Heidegger. Chez le premier sera retenu l’idée d’un
ensemble de règles admises et intériorisées comme normes par la
communauté scientifique à un moment donné de son histoire
grandes institutions internationales comme le FMI et la Banque
Mondiale9.
En définitive, l’explication de l’évincement des projets comme
l’écodéveloppement au profit du développement durable version
Brundtland relève donc d’une opposition polaire entre une
analyse en termes de « dommages environnementaux majeurs »
[sans politique] et une analyse en termes de « stratégies
politiques » [sans environnement].
Pour Olivier Godard, l’explication est plus médiane : elle se
trouve plutôt dans les caractéristiques mêmes du Rapport
Brundtland. Le projet d’écodéveloppement des années 1970
apparaît comme susceptible de conjuguer les impératifs du
développement avec une prise en compte des « nouveaux »
impératifs liés aux contraintes environnementales. Pourtant « ce
projet (l’écodéveloppement) ne s’est pas réalisé. Politiquement,
il a été écarté à la fin des années soixante-dix par l’appareil
onusien car son contenu politique dérangeait les gouvernements
occidentaux et en particulier la première puissance mondiale.
C’est alors que vint le développement-durable. Moins précis et
moins radical, dans son contenu explicite, plus œcuménique, le
développement-durable a été adopté à la fin des années quatre-
vingt (..). » (Godard, 2005, p18).
Plus précisément, Godard (1998, p227) souligne que
« l’approche néo-classique est davantage congruente (que
l’écodéveloppement) à un monde dans lequel le marché
représente, aux yeux de tous les acteurs, la figure centrale de la
coordination économique et où, concrètement, les grands
groupes industriels et les milieux financiers privés sont les
acteurs leaders du développement international ». Selon lui, la
version Brundtland du développement durable permet
d’internaliser la contrainte environnementale sans pour autant
remettre en cause le paradigme10 économique en vigueur.
pour délimiter et problématiser les faits qu’elle juge digne
d’étude. Chez le second sera reprise l’idée du paradigme comme
champ délimité reposant sur un système d’hypothèses dont on
n’est pas a priori conscient, soit un cadre référent de pensée
adapté à un certain état de développement.
9 Cette lecture de l’avènement du développement durable permet
de rajouter un élément à la liste proposée par Huybens et
Villeneuve (2004). Afin de qualifier le développement durable,
ils distinguent les fonctions idéologique, stratégique et
heuristique, auxquelles s’ajoute ici la fonction politique.
10 L’absence de consensus sur la relation entre changement
paradigmatique et développement durable est en grande partie
imputable à la mobilisation de définitions différentes du concept
de paradigme. Ainsi pour Huybens et Villeneuve, par exemple,
(2004, p4), « le développement durable (…) est un paradigme : il
fait éclater les systèmes de pensées centrés sur l’économie ou sur
l’écologie seulement, en y intégrant une dimension humaine et en
rendant logique l’idée qu’il faut se préoccuper des trois en même
temps ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%