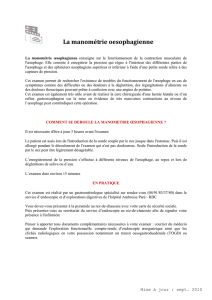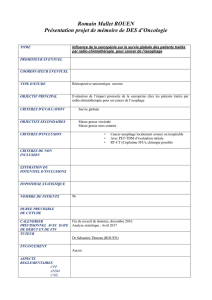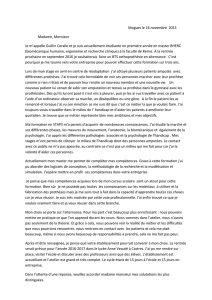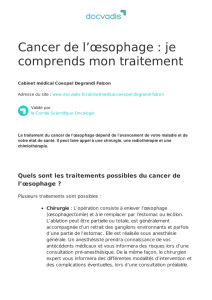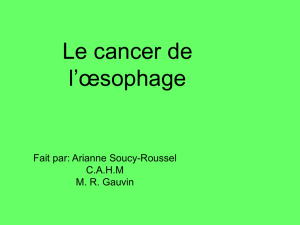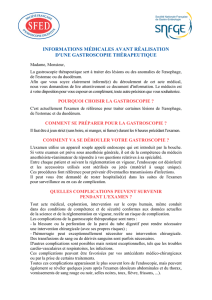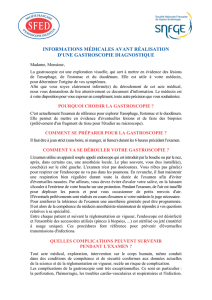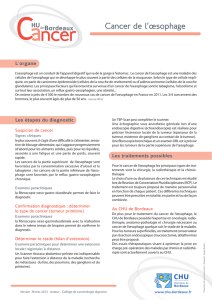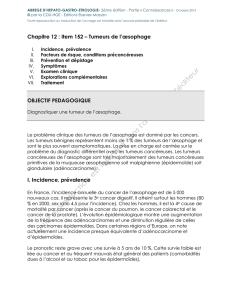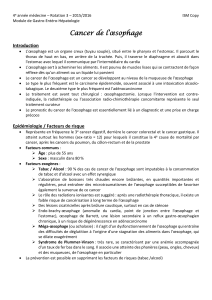Cancer de l`œsophage cervical

IMAGES
Image 2. PET scan : hypermétabolisme intense de la tumeur sans autre hyperméta-
bolisme à distance.
Image 1.
Tomodensitométrie cervicale,
reconstructions sagittales :
tumeur œsophagienne
au contact de la face
postérieure de la trachée,
s’étendant sur 5 cm de hauteur,
bombant sur le bord supérieur
de la trachéostomie.
116 | La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XIII - n° 3 - mai-juin 2010
IMAGE COMMENTÉE EN... ... Cancérologie
Cancer de l’œsophage cervical
Isabelle Trouilloud*, Tarek Boussaha*, Olivier Dubreuil*, Julien Taïeb*, Bruno Landi*
* Service d’hépato-gastroentérologie, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris.
Observation
Un homme, âgé de 63 ans, est admis en décembre 2009
aux urgences pour aphagie. Ses antécédents sont
marqués par un carcinome épidermoïde du larynx attei-
gnant les 3 étages, traité par laryngectomie totale et
chimiothérapie adjuvante par 5-FU et cisplatine en 1997.
Il persiste une insuffi sance rénale modérée depuis la
chimiothérapie.
La gastroscopie réalisée initialement met en évidence
une sténose tumorale infranchissable du tiers supérieur
de l’œsophage, à 17 cm des arcades dentaires et à 1,5 cm
de la bouche de Killian. L’examen anatomopathologique
des biopsies conclut à un carcinome épidermoïde infi l-
trant différencié et mature.
Sur le scanner est décrite une formation tissulaire latéro-
œsophagienne gauche mesurant 4 cm, au contact de la
face postérieure de la trachée, s’étendant sur 5 cm de
hauteur, bombant sur le bord supérieur de la trachéos-
tomie (image 1). Le bilan d’extension est complété par
un PET scan qui retrouve un hypermétabolisme intense
de la tumeur et un autre plus modéré d’une adénopa-
thie du groupe IIB droit, sans autre hypermétabolisme
à distance (image 2). La fibroscopie bronchique ne
retrouve pas de lésion suspecte.
Il est décidé en réunion de concertation pluridiscipli-
naire un traitement par radio-chimiothérapie conco-
mitante qui délivrera 50 Gy avec une chimiothérapie
par carboplatine et 5-FU aux semaines 1 et 5. Avant de
commencer le traitement, le patient bénéfi cie d’une
pose de prothèse œsophagienne métallique, entière-
ment couverte, extirpable, à largage proximal, avec une
collerette proximale de 0,5 cm de longueur (image 3).
Le bord proximal de la prothèse est positionné juste
en dessous de la bouche de Killian, permettant à cette
dernière de continuer à se fermer normalement. Les
suites endoscopiques sont simples, avec une reprise
progressive de l’alimentation liquide. La radio-chimio-
thérapie débute la première semaine de février.
Quelques jours après le début du traitement, le patient
présente un syndrome fébrile associé à l’apparition
d’une collection à gauche de la trachéotomie de 5 cm
de diamètre environ, avec un écoulement purulent
associé, ainsi qu’une dysphagie. L’irradiation est alors
interrompue et une antibiothérapie est instaurée. On
conclut à une probable surinfection de nécrose tumorale
avec fi stulisation cutanée (image 4).
Après l’amélioration du syndrome septique, la radio-
chimiothérapie est reprise. Au terme du traitement, le
patient présente de nouveau une aphagie, mais la lésion
cutanée a entièrement régressé. Une nouvelle gastros-
copie est réalisée, mettant en évidence une sténose

IMAGES
Image 3. Mise en place d’une pro-
thèse œsophagienne sous contrôle
radio scopique.
Image 4. Tomodensitométrie cervicale : nécrose
tumorale étendue.
Image 6. Tomodensitométrie cervicale :
obstruction prothétique tissulaire.
Image 5. Sténose œsophagienne non fran-
chissable en endoscopie, au-dessus de la
prothèse.
La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XIII - n° 3 - mai-juin 2010 | 117
IMAGE COMMENTÉE
infranchissable de la bouche de Killian, le pôle supérieur
de la prothèse ne pouvant être visualisé (image 5). Sur
le scanner, il existe une légère diminution du volume
tumoral et une obstruction de l’extrémité supérieure de
la prothèse par un bourgeon tissulaire qui pourrait être
infl ammatoire et non tumoral (image 6). On conclut
donc à une réponse partielle à la radio-chimiothérapie
et on prévoit une nouvelle évaluation endoscopique et
scannographique plus à distance du traitement.
Discussion
L’incidence du cancer de l’œsophage en France était
de 4 040 cas chez l’homme et 928 cas chez la femme
en 2000 (1). Six pour cent des patients ayant un
cancer de l’œsophage ont un antécédent de cancer
des voies aéro-digestives supérieures. Un dépistage
systématique par gastroscopie pourrait être proposé
à ces patients, mais il n’existe pas de recomman-
dation, car plusieurs études ont suggéré qu’une
telle attitude n’avait pas d’impact sur le pronostic.
L’intérêt d’un dépistage systématique reste donc
très débattu (2).
Les prothèses œsophagiennes sont actuellement le
traitement le plus utilisé pour la palliation des sténoses
néoplasiques de l’œsophage. Le développement récent
de prothèses extirpables a permis d’élargir les indi-
cations des prothèses œsophagiennes aux patients
présentant un cancer de l’œsophage potentiellement
“curable” (3). Il est habituellement recommandé de ne
proposer ce traitement qu’aux patients dont le pôle
supérieur de la tumeur se situe à plus de 2 cm de la
bouche de Killian (4). Cependant, plusieurs études ont
montré que les prothèses œsophagiennes pouvaient
être tolérées par les patients avec un cancer de l’œso-
phage cervical (5). La tolérance est de plus améliorée
par le développement de prothèses à collerette supé-
rieure plus courte et aussi meilleure chez les patients
ayant eu une laryngectomie totale.
Chez les patients atteints d’une tumeur localement
évoluée opérable, la radio-chimiothérapie exclusive
a les mêmes résultats que la chirurgie en termes de
survie globale. Il s’agit donc du traitement recom-
mandé en première intention pour les cancers de
l’œsophage cervical, qui nécessitent une chirurgie
lourde et mutilante (4). Le cancer épidermoïde de
l’œsophage a un pronostic très sombre, malgré les
progrès de la chirurgie et l’apport de la radio-chimio-
thérapie. Le traitement est palliatif d’emblée dans
environ 40 % des cas, et après traitement curatif les
récidives sont fréquentes et précoces. La dysphagie
est souvent le symptôme le plus invalidant et le déve-
loppement des prothèses œsophagiennes permet
d’améliorer la qualité de vie de ces patients. ■
Références bibliographiques
1. Faivre J. Variation in survival of patients with diges-
tive tract cancers in Europe, 1978-1989. Eur J Cancer
Prev 2001;10:173.
2. Petit T, Georges C, Jung GM et al. Systematic eso-
phageal endoscopy screening in patients previously
treated for head and neck squamous-cell carcinoma.
Ann Oncol 2001;12:643-6.
3. Sreedharan A, Harris K, Crellin A, Forman D,
Everett SM. Interventions for dysphagia in oe-
sophageal cancer. Cochrane Database Syst Rev
2009;7:CD005048.
4. Thésaurus national de cancérologie digestive
(www.tncd.org).
5. Profi li S, Meloni GB, Feo CF et al. Self-expandable
metal stents in the management of cervical oesopha-
geal and/or hypopharyngeal strictures. Clin Radiol
2002;57:1028-33.
1
/
2
100%