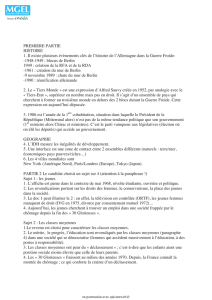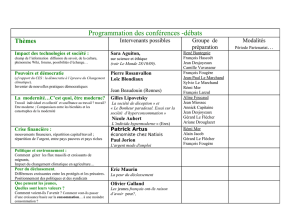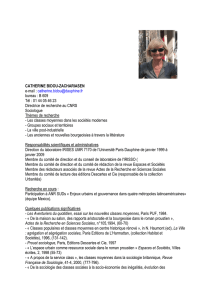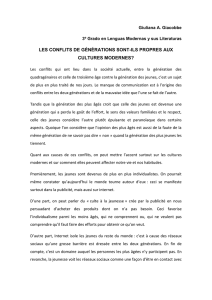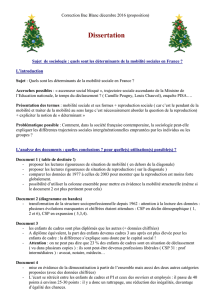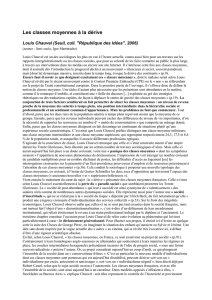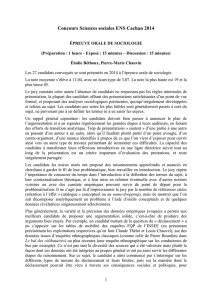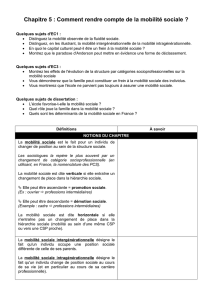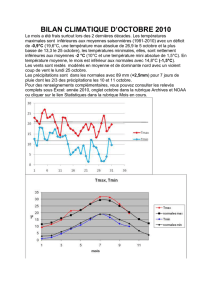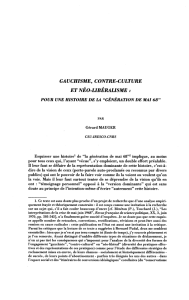Déclassement : affronter la réalitéRencontre avec Louis Chauvel

Mensuel N° 287 - décembre 2016
La manipulation - Pourquoi sommes-nous tous influençables ?
Déclassement : affronter la réalité
Rencontre avec Louis Chauvel
Les Français sont hantés par la peur du déclassement. Et s’ils avaient raison ? C’est la thèse
du sociologue Louis Chauvel, qui tire la sonnette d’alarme : les inégalités socioéconomiques
seraient en train de se radicaliser en France, au détriment des jeunes et de la classe moyenne.
Dans votre dernier livre, vous prenez le contre-pied de ceux qui disent que les transformations
économiques actuelles conduisent à un accroissement des richesses dans notre société.
Pourquoi ?
Il s’agit en effet d’une réponse à Angus Deaton, le prix Nobel d’économie 2015, qui soutient que les
sociétés, notamment occidentales, ne se sont jamais mieux portées qu’aujourd’hui. Le diagnostic est
vrai si l’on mesure la croissance du revenu et du patrimoine en moyenne. Mais ici plus qu’ailleurs, les
moyennes sont trompeuses car elles dissimulent des évolutions bien plus complexes, comme
l’enrichissement sélectif des milliardaires et la stagnation des autres, qui peuvent avoir l’impression
d’un recul. Ces chiffres peuvent être tirés vers le haut pour désigner l’amélioration considérable du sort
des seniors et dissimuler la régression sociale vécue par leurs enfants, certes plus riches en
téléphones portables, mais bien plus pauvres en termes de pouvoir d’achat immobilier. Mon livre
consiste ainsi à étudier ce contraste entre une France qui va bien – celle des jeunes seniors des
classes moyennes salariées, protégées, propriétaires – et une autre France, celle des jeunes actifs et
des classes moyennes salariées.
Qui sont les classes moyennes aujourd’hui ?
Définir ces classes moyennes n’est pas aisé, puisqu’elles correspondent à une diversité de positions
d’emploi, de niveaux de revenus et de sentiment d’appartenance. Henri Mendras, dans les
années 1980, a dépeint l’apogée de ce groupe en ascension. Il le définissait comme un archipel,
comme une constellation de catégories professionnelles centrales, pas nécessairement homogènes
mais néanmoins connexes et proches par leurs niveaux de revenus moyens, comme une forme
sociale construite autour des acquis de l’État providence (stabilité, visibilité de l’avenir, accès à la
santé, aux services sociaux et à l’éducation pour les enfants), et plus encore comme une culture et
une identité collective en opposition à la culture populaire et à celle de la bourgeoisie. Selon le
caractère plus ou moins large du spectre retenu, une bonne moitié, voire deux tiers de la population
peuvent s’assimiler aux classes moyennes inférieures, intermédiaires ou supérieures. En 2006, dans
mon livre Les Classes moyennes à la dérive, je montrais comment le mouvement d’ascension
perpétuelle décrit par H. Mendras s’est interrompu. À l’époque, il était encore possible de croire que

les classes moyennes étaient protégées contre la crise, qu’elles vivaient à l’écart du chômage et de la
précarité. C’est de moins en moins vrai aujourd’hui. Beaucoup de ses ressortissants ont l’impression
d’un recul. Mon travail consiste à aller au-delà de l’hypothèse de « peur du déclassement » pour
comprendre la réalité du déclin vécu par beaucoup.
Vos précédents ouvrages évoquaient déjà la menace du déclassement social. D’où vous vient
cet intérêt pour ce sujet ?
En 1995, dans les semaines qui ont suivi la grande vague de chaleur de Chicago, j’ai visité les
immenses friches industrielles à l’orée de la ville. C’était une impression de fin du monde. La classe
ouvrière n’était pas la seule à s’effondrer : le « white trash » issu des classes moyennes – les parents
avaient connu l’emploi salarié stable et la société de consommation – était touché à son tour par la
crise, dans le déni des réalités. De cette visite derrière le décor, j’ai conservé un intérêt pour les «
sociétés Potemkine », qui dissimulent derrière le carton-pâte repeint en bleu layette et rose bonbon
leurs sombres réalités.
Vous contrastez en France le sort extrêmement favorable des jeunes seniors et celui de leurs
enfants. Comment expliquer ce décalage de morale entre ce que pensent les retraités et ce que
pensent les actuels salariés ?
On ne peut comprendre le recul social en cours dans les classes moyennes françaises si on ne
s’interroge pas sur la place très particulière des retraités : avec ces derniers, les moyennes (de niveau
de vie, de départs en vacances, de taux de propriété, etc.) sont toujours en croissance vive ; sans eux,
elles stagnent ou se renversent. Ces analyses révèlent le passage d’une dynamique sociale propre
aux Trente Glorieuses, celle qu’ont connue les jeunes retraités au temps de leur jeunesse, et le monde
nouveau des quarantenaires. C’est particulièrement vrai pour le logement. En 1984, dans Paris, une
année de salaire de professeur de lycée permettait d’acheter 9 m², et aujourd’hui, trente-deux ans
après, de l’ordre de 3 m². Ce n’est pas propre à Paris, les salaires des jeunes générations ne
permettent plus de se loger correctement sans sacrifier autre chose : les vacances, les loisirs, une
partie du niveau de vie, etc. L’analyse montre comme l’existence d’une pente dévalante, une « spirale
», c’est-à-dire une glissade régulière vers le bas des nouvelles générations dès lors qu’on étudie leur
patrimoine. Le mot-clé ici est celui de « repatrimonialisation » : jusque dans les années 1980, la
société salariale permettait de se passer d’acquisition patrimoniale. Loyers bon marché, retraite et
santé garantis, loin des tickets modérateurs et des déremboursements d’aujourd’hui, tout cela signifiait
la dépatrimonialisation privée, dans une dynamique de constitution de ce que Robert Castel appelait le
« patrimoine social ». Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il était possible d’envisager
ses vieux jours sans épargne, sans être issu d’une famille possédante. Par un paradoxe étonnant, la
génération de classes moyennes qui aurait pu vivre sans patrimoine est justement celle qui a pu
épargner pour se constituer un bas de laine significatif aujourd’hui. La génération de leurs enfants, au
contraire, aurait intérêt à épargner (si l’on suit les réformes récentes des retraites qui frappent ceux qui
partiront en retraite dans les prochaines décennies) ; or le faible niveau des salaires et l’explosion des
prix de l’immobilier, notamment, rendent la chose impossible, sauf si vos parents sont riches et
généreux.

Faut-il déduire qu’il existe aujourd’hui une rupture générationnelle en termes d’égalité des
chances ?
Le meilleur indicateur de progrès social consiste à suivre ce que la nouvelle génération peut obtenir
par son effort, son propre mérite, en dehors de l’apport de ses parents. De ce point de vue, les
nouvelles générations sont assez mal loties ! Un aspect important de ce déclassement relève du
diplôme : il faut aux jeunes générations trois années d’études de plus que leurs propres parents pour
parvenir au même emploi. C’est ce qu’avec Emmanuelle Nauze-Fichet et Magda Tomasini, j’appelle le
« déclassement scolaire » et que la sociologue Marie Duru-Bellat appelle « inflation des diplômes » :
les diplômes sont de plus en plus répandus et en viennent à perdre de leur valeur. Une façon
d’échapper à cette fatalité du déclassement, c’est de s’expatrier. Certains pays comme le Québec
offrent de meilleurs débouchés pour les diplômés français. Pour ceux qui restent en France, les
ressources parentales deviennent vitales, surtout pour celles et ceux qui s’engagent dans des emplois
vocationnels, c’est-à-dire dont le prestige élevé a pour contrepartie des niveaux de rémunération plus
faibles et aléatoires (artiste, journaliste, etc.) : Cyprien Tasset, Thomas Amossé et Mathieu Grégoire
dans leur étude sur les travailleurs intellectuels précaires montrent que ces jeunes sans enfants
survivent grâce au soutien de leurs propres parents. S’il fléchit, ou si les enfants naissent, il faudra
donner une autre orientation à sa vie, pour trouver un vrai gagne-pain. C’est alors l’entrée dans la
vraie vie où il n’est plus possible d’euphémiser le déclassement.
Cette situation est-elle spécifique à la France ?
Mes collègues qui travaillent sur la question des retraites, comme Bernhard Ebbinghaus à Oxford,
classent maintenant la France dans le même groupe que l’Italie et l’Espagne, et non plus comme
l’Allemagne. Ces pays dits familialistes préfèrent le maintien des droits maximaux pour les seniors –
qui peuvent ainsi soutenir leurs enfants dans le besoin –, à la défaveur des salariés actuels qui paient
les retraites. Le souci de ces pays se pose en termes de soutenabilité. En Italie et en Espagne, les
adultes ont moitié moins d’enfants que dans les années 1970, avec en outre une émigration massive
des diplômés : c’est le familialisme sans famille. La prospective sociale à l’horizon de 2050 est
effrayante. En France, l’enjeu se pose davantage en termes d’appauvrissement, avec l’inversion de la
courbe de l’ascension sociale après les générations nées en 1950.
Selon vous, il s’agit d’un déclassement systémique de l’ensemble de la société. Mais ne peut-
on pas y voir plutôt l’effet d’une mobilité accrue des individus par rapport à leurs parents ?
Je pense plutôt que nous rebattons des ambitions de notre modèle socio-économique. Nous nous
orientions naguère vers l’Europe du Nord et nous nous alignons de plus en plus sur les modèles du
Sud de l’Europe : une société de classes postmoyennes déstabilisées, précarisées, où les salaires ne
permettent plus de se constituer un patrimoine. Dans le privé comme dans le public, les catégories les
plus solides (techniciens et même ouvriers qualifiés de l’automobile, de l’industrie de pointe, des
grandes entreprises), toute cette société de classes moyennes qui s’est imposée en France dans les
années 1980 s’est fissurée, fracturée. C’est encore plus évident quand on regarde les moins de 40 ans
aujourd’hui. Cette société s’est déstabilisée. Les catégories connaissant un confort protégé sont en
nombre déclinant. Cette situation engendre une frustration de masse.

Vous dénoncez dans votre ouvrage une « société des illusions ». Qu’entendez-vous
exactement par là ?
Depuis les années 1990, les sciences sociales se sont mises à préférer l’analyse des représentations
à celle des réalités, particulièrement lorsqu’elles sont gênantes. La notion même de « faits sociaux »
est renvoyée au cabinet des antiques. Cette attitude a fait perdre un temps précieux dans la
compréhension de ce qui nous arrive.
J’en appelle donc à une démarche néoréaliste ou néomatérialiste ultralucide. Elle consiste en un
retour aux faits sociaux comme des choses, comme le recommandait Durkheim. Notre utilité sociale
en tant que sociologues, c’est de mettre au jour des réalités nouvelles, problématiques, souvent
dissimulées. La psychosociologue viennoise Marie Jahoda soulignait comment les pires dominations
sociales sont possibles dès lors qu’elles se dissimulent sous les idéologies, les hallucinations et les
fascinations collectives, et les illusions. En France, il existe un profond refus de voir les choses et de
les appeler par leur nom. Ce processus alimente une partie du cercle vicieux des problèmes que l’on
ne peut résoudre faute de les avoir caractérisés à temps. Certains ont clamé que le déclassement
n’était qu’une peur, et non pas une réalité. Ce diagnostic inexact a fait beaucoup de mal en nous
détournant d’une confrontation aux réalités.
Votre bilan, celui d’un déclassement global des jeunes générations, n’est-il pas exagérément
pessimiste ?
Les statistiques soutiennent mes conclusions. Par exemple, alors que le bac de 1970 représentait pour
les trentenaires le ticket d’entrée dans les professions intermédiaires dans 60 % des cas, seuls 30 %
des bacheliers y ont accès aujourd’hui, les autres étant employés, ouvriers ou chômeurs. Le bac
aujourd’hui vaut ce que le certificat d’études représentait dans les années 1950. Il faudrait en réalité 20
% de cadres et professions intermédiaires pour absorber le surcroît de diplômés : la croissance a été
nettement insuffisante. Le salaire à temps plein des professions intermédiaires n’a pas simplement
fléchi relativement à celui des ouvriers (l’écart s’est réduit de 20 points depuis 1980), il a aussi baissé
en termes réels, en perdant 2 000 euros de 1980 à 2010. Il est intéressant de regarder l’écart entre les
faits que vivent les gens et la réalité seconde, mouvante et friable, qu’ils en expriment. Ce sont là deux
mondes différents, qui restent sans rapport tant que le réel ne fait son retour avec son cortège
d’illusions perdues. Par exemple, les jeunes de 25 ans ne sont pas forcément les plus critiques envers
leurs conditions de vie : c’est avec les factures qui s’accumulent, les traites, le coût de l’école et toutes
les réalités triviales que la vie amène, que les jeunes commencent à compter.
La génération est-elle homogène ? Tous les jeunes se trouvent-ils dans la même situation, au-
delà des clivages générés par les patrimoines familiaux inégaux ?
Le premier sociologue à s’être intéressé à ces questions est Karl Mannheim. Le Problème des
générations (écrit à Francfort en 1928) est un classique que l’on doit mettre à la même hauteur que Le
Suicide de Durkheim ou L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme de Max Weber. Mannheim
s’intéresse au Zeitgeist, à l’esprit du temps, en particulier celui des nouvelles générations. Il savait bien
que celles-là sont diverses : l’extrême gauche s’opposait alors dans la rue avec l’extrême droite ; la
jeunesse était fragmentée en classes sociales et en fractions idéologiques conflictuelles. Malgré cette
fragmentation, la jeunesse était une unité par l’« entéléchie », le point d’orgue d’une scène historique

commune, produite par l’esprit du temps, dans un destin d’effondrement et de suicide collectif de
l’Allemagne. Il faut voir ici aussi l’erreur qu’il y aurait à ne considérer que les diversités des jeunesses
sans voir l’unité d’une jeune génération, au singulier, orpheline d’un destin social.
Ce qui est commun à la jeunesse d’aujourd’hui, c’est l’amplification des difficultés sociales. Le but de
mon travail, à l’horizon de mon espérance de vie, est de mieux comprendre comment les effets de
classe et de génération se combinent pour produire des inégalités aujourd’hui en cours de
radicalisation.
Louis Chauvel
Né en 1967, sociologue, professeur à l’université du Luxembourg. Ses analyses portent sur le
changement social, les inégalités entre générations, en particulier dans les classes moyennes. Il a
notamment publié Le Destin des générations (2e éd, Puf, 2010), Les Classes moyennes à la dérive
(Seuil, 2006) et La Spirale du déclassement. Essai sur la société des illusions (Seuil, 2016).
1
/
5
100%