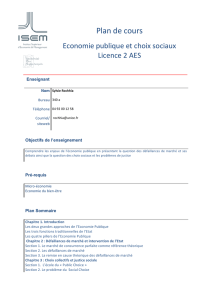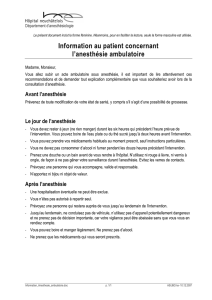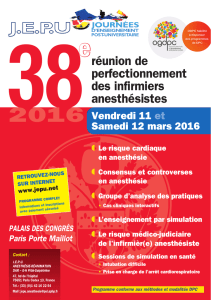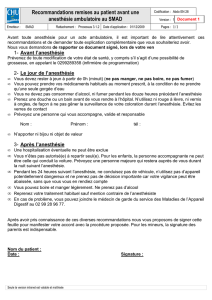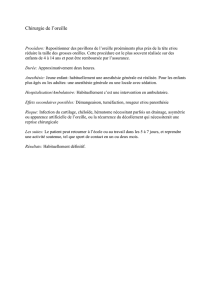Approche systémique du risque

MAPAR 2003
282
APPROCHE SYSTÉMIQUE DU RISQUE
M. Sfez.
Clinique Saint Jean de Dieu-19, Rue Oudinot-75007 Paris.
Société Française de Gestionnaires de Risques en Etablissements de Santé, 77 avenue
Paul Doumer 75116 Paris
INTRODUCTION
Comme certaines activités industrielles, l’anesthésie constitue une activité à haut
risque mettant en jeu une organisation à haute abilité [1]. Il est donc possible de
lui appliquer des modalités d’analyse et de maîtrise du risque issues de l’industrie.
L’hypothèse formulée est que, comme les catastrophes majeures, les accidents d’anesthé-
sie résultent de l’enchaînement aléatoire d’événements impliquant aussi bien les individus
que les organisations au sein desquelles ils agissent. Ainsi, l’ensemble des personnes, des
moyens techniques et de l’organisation concourant au bon déroulement de l’anesthésie
constitue un système orienté vers la sécurité des patients.
Appréhender ce système comme un tout permet de mieux comprendre la genèse des
accidents liés à l’anesthésie et de proposer des mesures pour les maîtriser. Cette approche
systémique pluridisciplinaire s’applique à l’analyse et à la maîtrise des risques.
1. LE SYSTÈME DE L’ANESTHÉSIE
Ces notions appellent des dénitions
1.1. LA NOTION DE SYSTÈME EST ISSUE DE L’INDUSTRIE
Elle décrit l’ensemble des moyens techniques, organisationnels et humains sur lesquels
l’établissement a la capacité d’agir pour atteindre l’objectif xé : production d’un bien
ou d’un service, réalisation d’une anesthésie.
1.2. SÉCURITÉ DES SYSTÈMES [2]
Chaque système peut présenter des défaillances, dénies comme des actions non
intentionnelles conduisant à un résultat non attendu. Certaines conduisent à la réalisa-
tion d’un risque, c’est-à-dire à un événement indésirable générateur de dommages. La
sécurité est l’aptitude du système à ne pas créer de conditions préjudiciables à l’intégrité
physique ou à l’environnement.

MAPAR 2003
284
Le risque en anesthésie 285
La sécurité permet de réduire les risques à un niveau acceptable par le système
socio-technique. La réduction des risques repose d’une part sur la réduction de leur
fréquence par des mesures de prévention, d’autre part sur des mesures de réduction des
conséquences :
• Protection pour diminuer la gravité,
• Ségrégation ou connement pour préserver des fonctions essentielles de l’établis-
sement,
• Duplication pour répartir le risque.
Les événements précurseurs des accidents sont accessibles à la prévention. Quand le
risque se réalise, sa détection précoce permet d’appliquer les mesures de protection pour
limiter les dommages. A un stade ultérieur, ou en l’absence d’efcacité des mesures de
protection, les mesures de réparation visent à corriger les conséquences du risque, en
phase de récupération.
1.3. SÉCURITÉ DE L’ANESTHÉSIE [3]
L’application de ces notions à l’anesthésie a conduit à des prescriptions profession-
nelles et réglementaires modiant profondément le système dans chaque établissement
[4-6]. Ces prescriptions ont abouti à des organisations spéciques à chaque établissement
pour réduire le risque de l’anesthésie par la prévention, la détection et le traitement
précoce des incidents et des accidents. Dans le domaine humain, les efforts portent sur
la compétence des acteurs, la formalisation des actions de routine et l’amélioration du
comportement de chaque acteur et de l’équipe d’anesthésie. Dans le domaine techni-
que, l’accent est mis sur le monitorage, l’amélioration de la sécurité des matériels et la
redondance des moyens de suppléance. Dans le domaine de l’organisation sont prises
en compte la prise en charge médicale, la circulation de l’information, la réservation de
ressources, la programmation de l’activité. Il est vraisemblable que l’ensemble de ces
mesures réduit notablement la mortalité péri-anesthésique [7].
2. APPROCHE SYSTÉMIQUE ET ANALYSE DU RISQUE
L’approche systémique dans chaque établissement a permis de développer des mé-
thodes d’analyse efcaces dans le monde industriel et pertinentes en anesthésie. Ce type
d’analyse permet de ne pas s’arrêter aux causes apparentes, mais de rechercher les causes
racine des accidents. De cette façon, la mise en cause des individus est limitée.
2.1. ANALYSE INDUSTRIELLE
Depuis vingt ans, l’analyse des catastrophes technologiques a mis en cause la per-
tinence de la responsabilité isolée des individus. Le poids des organisations est apparu
clairement à travers des catastrophes comme celles de Three Miles Island, Bophal, Tcher-
nobyl ou Challenger [8-10]. De la sorte, l’analyse systémique postule que la survenue
d’accidents résulte de l’association parfois aléatoire de défaillances mineures non prises
en compte. Ces défaillances relèvent soit :
• De défaillances humaines, patentes car elles entraînent directement un événement
indésirable,
• De défaillances système, dites latentes car elles résident dans le système et ne se
révèlent qu’à l’occasion d’une action humaine.
Les défaillances humaines sont présentes dans 70 à 80 % des causes d’accident,
volontiers associées à des défaillances système. Le poids des défaillances système dans
la survenue d’accidents est d’autant plus important que le système est complexe et que
les éléments du système présentent un couplage étroit. La défaillance d’un élément du
système engendre alors une réaction en chaîne difcilement maîtrisable. En l’absence

MAPAR 2003
284
Le risque en anesthésie 285
de marge de manœuvre pour les opérateurs, cet enchaînement conduit à la catastrophe,
comme à Tchernobyl [8]. Pour limiter les conséquences des défaillances, le système
comporte des défenses, conçues comme des barrières matérielles (par exemple contrôle
d’accès) ou non (par exemple procédures) disposées en série dans le déroulement du
processus. L’accident ne peut survenir que si plusieurs défenses sont successivement
mises en défaut, du fait de défaillances dans l’organisation ou le travail humain liées à
une mauvaise observance des règles ou des procédures. Ces mises en défaut font souvent
suite à des glissements progressifs des pratiques aboutissant à la « déviance normale »
qui a conduit à l’explosion de la navette Challenger [10]. Ces migrations de pratiques
surviennent rapidement, de façon rapidement irréversible.
L’analyse de ces défaillances conduit à des mesures correctives dont la description,
l’application et l’efcacité font l’objet d’un retour d’expérience. Celui-ci est conçu
comme un élément central de l’amélioration de la sécurité en permettant la valorisation
de l’expérience par la mutualisation des expériences de chacun. Il formalise la mémoire
de l’organisation et contribue à la culture de sécurité indispensable au traitement des
risques résiduels.
2.2. ANALYSE EN ANESTHÉSIE [3]
Le processus de l’anesthésie est bien codié, ce qui permet de lui appliquer assez
aisément une analyse systémique. Dans ce cadre, la dénition des défaillances système
a été précisée [11, 12, 13] pour faire la part de ce qui revient à des défaillances évitables
et ce qui relève de l’aléa thérapeutique. La confusion de ces deux catégories expose à
surévaluer les défaillances système jusqu’à 92 % des causes racine [13].
Moyennant ces ajustements, le modèle [11] identie 93 % des causes racines comme
relevant d’éléments organisationnels, techniques ou humains. Les 7 % restants relèvent de
l’état du patient. Ces chiffres soulignent la méconnaissance de nombreux facteurs favori-
sant la survenue d’accidents d’anesthésie par les analyses épidémiologiques classiques.
L’approche systémique permet de décrire le poids des facteurs en cause :
• 27 % des accidents comportent des facteurs techniques,
• 27 % des accidents comportent des facteurs organisationnels,
• 40 % des accidents comportent des facteurs humains.
Les défaillances humaines sont sous-estimées ici par rapport aux 70 % généralement
admis car, dans ce modèle, les défaillances liées à l’équipe sont intégrées aux défaillances
de l’organisation, constituant donc des défaillances système.
L’organisation nécessaire à la maîtrise du risque anesthésique repose sur :
• Une stratégie et des objectifs faisant de la sécurité une priorité managériale,
• Une structure qui associe :
- l’adéquation entre les compétences et les fonctions,
- la distribution des responsabilités,
- le transfert aux nouveaux arrivants d’informations spéciques au site,
- la qualité et la disponibilité des procédures de travail,
- la supervision des tâches à risque.
• Une culture de sécurité qui associe :
- des normes et des règles pour faire face aux risques,
- des comportements collectifs de sécurité,
- une réexivité collective sur les pratiques de sécurité.
La réexivité sur les pratiques est renforcée par la mise en place d’un retour d’ex-
périence.

MAPAR 2003
286
Le risque en anesthésie 287
Les défaillances culturelles rendent compte d’environ 9 % des causes racines des
incidents d’anesthésie analysés suivant cette méthode.
La culture et les éléments de structure contribuent à l’organisation du travail. Elles
conditionnent le fonctionnement des équipes à travers les comportements individuels et
l’organisation nécessaire à la coordination des acteurs.
Le processus d’analyse systémique des accidents a donc évolué dans le sens d’une clas-
sication des facteurs favorisant la survenue d’accidents plutôt que d’une identication
de causes. Ce processus, actuellement utilisé pour l’analyse rétrospective des accidents
ou presque accidents [14], démembre les facteurs favorisants et distingue le contexte
institutionnel, les facteurs d’organisation et de gestion, ceux liés à l’environnement de
travail, à l’équipe, aux tâches à effectuer et les facteurs liés aux patients. L’analyse d’un
accident repose sur la conduite méthodique d’une enquête de dossier et de terrain, menée
de façon pluridisciplinaire sur un événement précis. Le caractère rétrospectif de l’analyse
peut inuencer les conclusions des enquêteurs. Cette méthode est cependant puissante
pour mettre en évidence les défaillances système impliquant l’anesthésie.
L’analyse a priori des risques recourt à des méthodes industrielles lourdes à mettre en
œuvre. Elle repose sur l’analyse des causes ou des conséquences des risques identiés
à partir des données de la littérature, de l’exploration des base de données internes ou
externes à l’établissement (vigilances notamment) ou à dire d’experts. Cette analyse
aboutit à la description de scénarios d’accident pour lesquels la dimension quantitative
demande à être validée dans chaque établissement [15]. Si ces scénarios quantiés aident
au choix des mesures correctives prioritaires, la lourdeur de la démarche expose à l’obso-
lescence rapide des conclusions du fait de la migration des pratiques déjà évoquée. Cette
étape d’analyse doit donc nécessairement s’accompagner d’actions visant notamment au
respect des règles de bonne pratique.
3. MAÎTRISE DU RISQUE EN ANESTHÉSIE
Les apports de l’approche systémique incluent les éléments de maîtrise du risque.
L’analyse contribue à la culture de sécurité, le signalement traduit cette culture en actes,
les mesures correctives impactent l’organisation de l’établissement.
3.1. L’ANALYSE A POSTERIORI DES RISQUES
L’analyse pluridisciplinaire des accidents sensibilise un large nombre d’acteurs aux
défaillances système. Elle permet l’appropriation de la méthode, dans le cadre d’une
démarche collective, comme au cours des réunions de mortalité - morbidité dans les
services [16]. Cette démarche conduit à des mesures correctives souvent simples impli-
quant aussi bien les équipes médicales que les responsables de l’organisation du bloc
opératoire.
3.2. LE SIGNALEMENT DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
Cette action implantée depuis plusieurs années en anesthésie a bénécié de l’automa-
tisation de la saisie. Le rajout d’items relevant de l’organisation du processus opératoire,
dépasse le seul cadre de l’anesthésie, mais contribue à identier les défaillances du sys-
tème. Sur cette base, il est possible d’identier les événements précurseurs d’accidents
et leurs causes organisationnelles [17].
3.3. LES SIMULATEURS RÉALISTES D’ANESTHÉSIE
L’utilisation de ces appareils coûteux repose sur une organisation lourde à mettre en
œuvre. Elle apparaît toutefois intéressante pour tester et analyser les réactions d’équipes
mises en situation critique [1]. Les principales défaillances système identiées relèvent

MAPAR 2003
286
Le risque en anesthésie 287
de la communication et de la cohésion de l’équipe. Les données manquent cependant
pour en évaluer l’efcacité.
3.4. LA PROPOSITION DE SOLUTIONS INTÉGRÉES
Une meilleure organisation de la prise en charge des patients pour limiter les con-
séquences des erreurs humaines peut être favorisée à l’occasion de la mise en œuvre
d’améliorations techniques.
Le développement et la mise en place d’un système combinant l’identication
informatisée des médicaments ont permis la rationalisation de l’organisation de l’espace
de travail et le recueil automatisé des données [18], divisant par deux la fréquence des
erreurs d’administration médicamenteuse. Cette modication de pratique améliore la
prévention des événements indésirables et en limite les conséquences en favorisant le
dépistage précoce des défaillances.
4. LA DYNAMIQUE DE LA DÉMARCHE
L’approche systémique nécessite une mobilisation importante et soutenue de l’équipe
d’anesthésie et, au delà, de tous les acteurs contribuant au fonctionnement du bloc opé-
ratoire. D’un point de vue pragmatique, si l’analyse justie une implication simultanée
de tous les acteurs, la mise en œuvre des mesures de maîtrise du risque se fait souvent
de façon plus sectorielle. Par contre, le retour d’expérience, constitué du signalement des
événements indésirables, de la description du contexte de survenue et des mesures de
récupération mises en œuvre, permet de restituer à l’ensemble de l’établissement de l’in-
formation pertinente sur la maîtrise du risque et la abilité et la sécurité du système.
Les hommes contribuent à la sécurité du système, non seulement par leur capacité à
réduire leurs défaillances mais surtout à détecter et corriger précocement leurs défaillances
et celles du système [19]. Cette aptitude des acteurs permet de limiter les conséquences
d’une conception trop rigide de la sécurité du système. La limitation des couplages étroits
dépend de cette souplesse et confère à l’organisation une réactivité particulièrement
adaptée à l’anesthésie.
CONCLUSION
L’approche systémique de la sécurité en anesthésie a permis la mise en œuvre de
modications substantielles de pratique et d’organisation. Leur efcacité est vraisemblable
malgré une controverse récente sur leur impact réel [19].
Ces modications ont toujours eu pour origine des décisions extérieures aux établis-
sements de santé et aux équipes d’anesthésie. La prochaine étape d’amélioration de la
sécurité passe par une mobilisation de chaque équipe d’anesthésie pour s’approprier les
concepts et les méthodes nécessaires à une approche systémique tenant compte du contexte
propre à chaque établissement. Cette mobilisation nécessite un effort particulier de la
part des responsables de ces équipes pour convaincre non seulement les acteurs du bloc
opératoire mais également les directions d’établissement, forcément impliquées [20].
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
[1] Gaba DM. Anaesthesiology as a model for patient safety in health care. Br Med J 2000;320:785-88
[2] Leroy A, Signoret JP. In Le risque technologique. Que sais-je. PUF. Paris 1992;pp13-43
[3] Sfez M. Analyse et maîtrise du risque en anesthésie. In : Conférences d’actualisation de la SFAR. Paris,
Elsevier, 2002;371-386
 6
6
1
/
6
100%