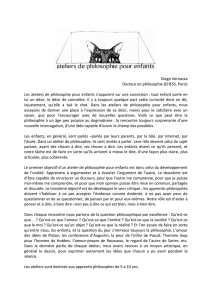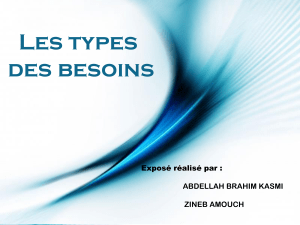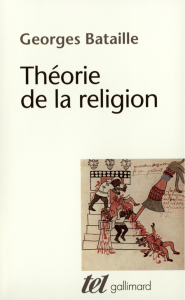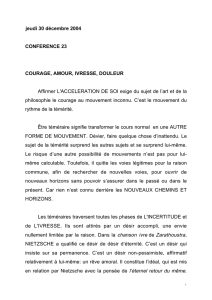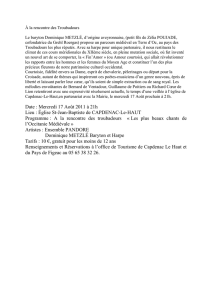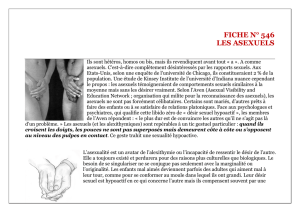Amour de la philosophie Philosophie de l`amour ACTES des

Amour de la philosophie
Amour de la philosophie
Philosophie de l’amour
Philosophie de l’amour
ACTES
des Rencontres Philo 2002
Centre d’Action Laïque - Régionale du Brabant wallon
rue Lambert Fortune 33 à 1300 Wavre
tél. : 010/ 22 31 91 - fax : 010/ 22 72 11 - courriel : [email protected]

Amour de la philosophie
Amour de la philosophie
Philosophie de l’amour
Philosophie de l’amour
Ferme de La Ramée à Jodoigne
Vendredi 15.11.02
Table ronde
L’amour est-il une invention chrétienne?
Robert JOLY, Professeur honoraire aux Universités de Mons et de Bruxelles
Les troubadours: entre philosophie et langage
de l’amour
Didier STAMPART, Licencié en Philologie romane
Amour et désir dans la “fin’ amor” ou Eros à
l’école de la mélancolie
Luc RICHIR, Psychanalyste
Ateliers
1. L’enfant philosophe
Martine NOLIS, Animatrice et Formatrice d’animateurs et de formateurs à
la pratique de la philosophie avec les enfants
Hélène SCHIDLOWSKY, Formatrice d’animateurs et de formateurs à
la pratique de la philosophie avec les enfants et Professeur de Philosophie à la Haute
Ecole Francisco Ferrer
2. Amour du prochain
Robert JOLY, Professeur honoraire aux Universités de Mons et de Bruxelles
Baudouin DECHARNEUX, Professeur à l’ULB
3. Amour, ami ou ennemi?
Luc RICHIR, Psychanalyste
en collaboration avec :
Entre-vues, les Extensions de l’ULB, les Amis de la Morale
Laïque de La Hulpe, Morale Laïque - Humanisme de Rixensart

1
Robert Joly
Professeur honoraire aux Universités de Mons et de Bruxelles
La charité est-elle une invention chrétienne ?
Que l’amour du prochain, la charité soit une invention chrétienne, les
chrétiens en ont toujours été convaincus et le sont encore, au point que cette
prétention passe pour une évidence, pour une vérité au-dessus de tout soupçon,
qu’il serait malséant de contester.
Bien plus : beaucoup d’incroyants entérinent purement et simplement la foi
chrétienne en la matière, ceux qui pensent par eux-mêmes comme les autres : de
Renan à Comte-Sponville, cela ferait un long cortège. On le leur a tellement
répété qu’ils marchent avec les croyants, sans même se douter qu’il y aurait là
tout un espace où exercer opportunément l’esprit critique.
Je pense pourtant que la revendication chrétienne en la matière est
totalement injustifiée. J’en suis même sûr, pour une raison très simple : la
démonstration que la charité n’est pas une innovation chrétienne est très facile à
administrer.
Je vais la faire ici même, accessible à tout lecteur attentif, qui n’aura besoin
d’aucun savoir préalable : la saine raison y suffira amplement.
En effet : pour prouver ma thèse, il faut et il suffit de faire état de
textes non chrétiens et antérieurs au christianisme qui recommandent l’amour du
prochain. Or, ces textes existent, ils sont même nombreux. On peut aller les
cueillir en Chine, au 5ème siècle avant J.-C., ou dans la Bible Juive, dans le
bouddhisme un peu partout en Asie et naturellement aussi dans le paganisme
gréco-romain.
C’est ce dernier secteur que nous allons retenir, parce que c’est le milieu
où s’est développé le christianisme . Je ne vais pas verser ici tout un dossier1,
mais évoquer quelques textes illustrant les plus fines pointes de la charité : ce
sera plus que suffisant.
Pour être parfaite, la charité doit être désintéressée ; elle doit englober
les ennemis et être universelle, c’est-à-dire considérer comme prochain tout
être humain quel qu’il soit.
Commençons par le rejet de toute motivation intéressée.
Dom. J. Dupont, un ecclésiastique érudit, oppose le désintéressement de la
charité chrétienne au paganisme « qui était resté enfermé dans l’égoïsme »2.
1 On le trouvera dans Glane de philosophie antique, éd. Ousia, 1994, pp. 212-252.
2 Studia Hellenistica, 5, 1948, p. 153.

2
C’est tout simplement faux. Une maxime de Démocrite (5ème siècle avant J.-C.)
stipule : « L’homme bienfaisant n’est pas celui qui envisage une récompense, c’est
celui qui a choisi librement de bien faire »3. Il existe beaucoup de
développements ultérieurs. Un seul, de Cicéron, mort en 43 avant J.-C., suffira :
« Ajoutons que si la vertu est recherchée, non pour sa valeur
propre, mais pour ce qu’elle rapporte, cette vertu méritera
qu’on l’appelle malice. Plus, en effet, un homme rapporte
toutes ses actions à l’intérêt, moins il est homme de bien et
par suite, mesurer la vertu au prix qu’elle peut valoir, c’est
croire qu’il n’y a de vertu que la malice. Où est la
bienfaisance si l’on ne fait pas le bien pour l’amour
d’autrui ? »4.
La plus fine pointe de la charité chrétienne serait d’englober les ennemis.
L’affirmation est très répandue, jusqu’à aujourd’hui. On y a vu une véritable
révolution. Gabriel Ringlet suit le cortège, bien sûr, et notamment le poète
Grosjean qui y voit « le fond de la révolution évangélique »5. Un professeur de
l’Université de Louvain a fait placer une de ses pensées en exergue de sa
nécrologie : « Je suis fier d’appartenir à la seule religion qui enseigne qu’il faut
aimer son prochain, ennemi ou ami, condition essentielle d’un véritable progrès
de la civilisation »6.
Pourtant, le précepte d’aimer ses ennemis se trouve dans le judaïsme
d’après l’exil : Exode 23, 4-5 ; Proverbes 25, 21 et dans la Lettre d’Aristée, 227.
Mais il se trouve aussi dans le paganisme. Sénèque, un strict contemporain de
Paul, fait dire aux fondateurs du stoïcisme :
« Jusqu’au terme suprême de la vie, nous agirons, nous ne
cesserons de travailler au bien de la société, de soulager
chacun en particulier, de venir en aide même à nos
ennemis… »7.
Et Marc-Aurèle (2ème siècle après J.-C.) écrit : « Le propre de l’homme, c’est
d’aimer même ceux qui l’offensent »8.
En ce qui concerne l’universalité, un seul témoignage suffira, parmi
beaucoup d’autres. Cicéron écrit :
3 Fragment B 96.
4 Lois, I, XVIII, trad. Appuhn. Cicéron n’invente pas, il s’inspire de textes grecs bien antérieurs
qui, pour nous, sont perdus.
5 Cité par G. Ringlet, L’évangile d’un libre penseur, Albin Michel, 1998, p. 120.
6 Nécrologie de Robert De Smet, Le Soir du 15-04-78. Elle n’a pas été reprise par G. Ringlet dans
Ces chers disparus, 1992.
7 De otio, I, 4.
8 Pensées VII, 22, parmi d’autres.

3
Or, parmi les formes de cette moralité, il n’y en a point qui
ait plus d’éclat et plus de portée que l’union des hommes avec
les hommes, cette sorte d’association et de mise en commun
des intérêts et cette tendresse elle-même qui lie tout le
genre humain »9.
Le terme « tendresse » est la traduction de Martha (Budé) que j’ai
reprise, mais le terme latin est caritas, terme païen donc, avant de devenir
chrétien. Et ici, l’expression « genre humain », generis humani, nous garantit
l’universalité.
C’est loin d’être le cas de multiples textes chrétiens qui parlent du
« prochain » : il ne va pas de soi que « prochain », traduit en latin par proximus,
désigne tout le genre humain. Spontanément, pour le chrétien le prochain, c’est
le coreligionnaire. Il s’agit alors de charité « fraternelle » , largement célébrée
par Paul, qui ne l’élargit que deux fois, marginalement et très brièvement10. Jean
n’a même pas cette retouche : chez lui, la charité n’est que fraternelle. C’est la
seule aussi qui joue un rôle dans leur théologie.
Tout le monde a au moins entendu parler du « bon Samaritain », qui fait
inévitablement partie du scénario Jésus de la pastorale chrétienne. Je n’ai rien
contre le bon Samaritain ; c’est un bien brave homme. Mais voici un autre texte
de Sénèque : « L’homme cerné par des brigands trouve en moi un défenseur,
alors qu’il n’est permis de passer mon chemin sans m’exposer »11. Le Samaritain a
soigné un blessé au bord de la route. Chez Sénèque, les bandits sont toujours
là ; il faut secourir en pleine attaque, il faut exposer sa vie. Nul ne peut
contester que Sénèque aille plus loin que Luc, plus haut, si l’on veut. Et pourtant,
personne, que je sache, n’a relevé cette phrase de Sénèque pour la comparer à la
parabole évangélique. Le texte est accessible à tout lecteur cultivé en plusieurs
recueils traduits. Des milliers de gens – ne serait-ce que les professeurs de grec
et de latin depuis des générations – sont censés l’avoir lu, comme tous les textes
païens, et beaucoup d’autres, cités plus haut. Pourtant, personne n’a
pratiquement jamais écrit là-dessus. Etrange silence, qu’il serait intéressant
d’examiner en lui-même.
Le sommet indiscutable de la charité païenne est une phrase d’Epictète (1er
et 2ème siècles après J.-C.) :
« C’est en effet un sort bien plaisant qui est tressé pour le
Cynique : il doit être battu comme âne et, ainsi battu, il doit
9 Definibus V, 23, 65.
10 I Thessaloniciens 5, 16 et Galates 6, 10.
11 De benef. IV, XII, 2.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%