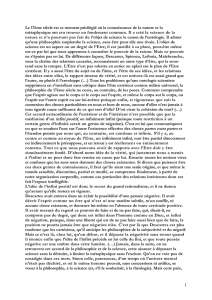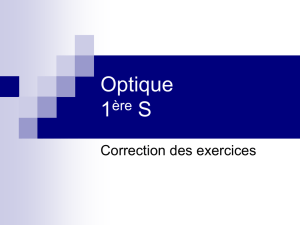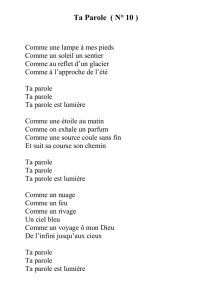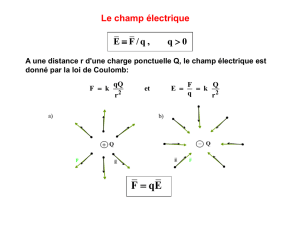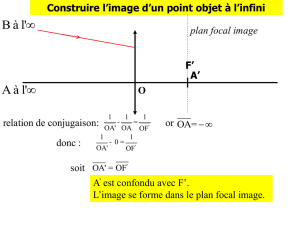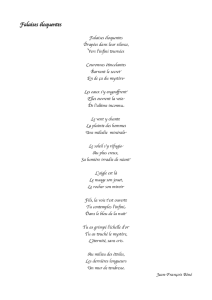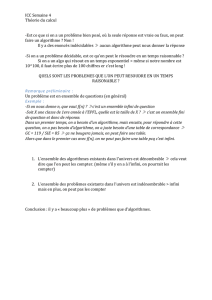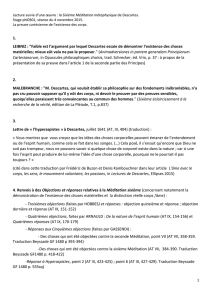L`INCOMPRÉHENSIBILITE DE L`INFINI ET LA

An. Inst. de Ist. „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, tom. XI, 2013, p. 251–270
L’INCOMPRÉHENSIBILITE DE L’INFINI
ET LA CONSTITUTION DE LA SCIENTIA CHEZ DESCARTES
Călin Cristian Pop
1
New Europe College, Bucharest
Abstract. We intended here to study the correlation between scientia, known as
the possibility of any science, and the concept of infinity. This link is being mediated by
the metaphysical foundation of scientia, which can be done only by acknowledging the
existence of God. From this perspective, the discourse regarding the infinity becomes
necessary. However, explaining the infinity implies to question its incomprehensibility.
Analyzing the incomprehensibility of the infinity thus opens the possibility of
understanding a profound connection between metaphysics as a possibility of scientia
and the incomprehensibility. Our conclusion reveals that the metaphysics could only be
built on a preliminary acknowledgement of the infinity’s incomprehensibility.
Moreover, this acknowledgement has the nature of a process, and is necessary for
elaborating the metaphysics itself. The incomprehensibility of the infinity must be
understood as a constitutive element of the metaphysics, and implicitly of the scientia.
Keywords: Descartes, Infinity, incomprehensibility, scientia.
1. LA SCIENTIA, DIEU, L’INFINI
Notre recherche vise à établir une corrélation entre la scientia, comme
possibilité de toute science, et l’incompréhensibilité de l’infini dans l’articulation
de cette possibilité même, étant donné que l’infini
2
ouvre le champ d’élaboration
des arguments pour l’existence de Dieu
3
. Dans la mesure la possibilité de toute
science y est engagée, il est clair qu’elle doit atteindre l’horizon de la
1
Researcher in the project MODELS OF PRODUCING AND DISSEMINATING
KNOWLEDGE IN EARLY MODERN EUROPE: THE CARTESIAN FRAMEWORK (code PN-II-
ID-PCE-2011-3-0998), supported by the Romanian National Research Council (CNCS), implemented
at the New Europe College, under the supervision of Prof. Vlad Alexandrescu.
2
Alexandre Koyré proclame fortement la signification majeure de l’infini : « L’idée de l’infini
joue dans la philosophie de Descartes un rôle important, si important que le cartésianisme peut être
considéré comme ayant cette idée pour base seule et unique » (Du monde clos à l’univers infini
[1957], traduit de l’anglais par Raissa Tarr, Paris, Gallimard, 1973, p. 134).
3
Plus précisément, les arguments par les effets dans la troisième Méditation.

2
L’incompréhensibilité de l’infini et la constitution de la scientia chez Descartes
252
métaphysique
4
que Descartes développe. En ce sens, notre hypothèse regarde le
rapport essentiel qui doit être pensé entre l’incompréhensibilité de l’infini et la
métaphysique comme possibilité de la scientia : la métaphysique est un processus
qui se déploie seulement par l’acceptation préalable et difficile de
l’incompréhensibilité de l’infini.
Il faut que nous acceptions dès le début la connexion très forte qui existe
entre la possibilité de la scientia et la connaissance de l’existence de Dieu
5
, que
Descartes assume explicitement plusieurs fois dans les Meditationes :
[…] si Deum ignorarem, facile ab opinione dejicerent, atque ita de nulla
unquam re veram et certam scientiam, sed vagas tantum et mutabiles
opiniones, haberem
6
.
Postquam vero percepi Deum esse, quia simul etiam intellexi caetera omnia ab
eo pendere, illumque non esse fallacem; atque inde collegi illa omnia, quae
clare et distincte percipio, necessario esse vera; etiamsi non attendam amplius
ad rationes propter quas istud verum esse judicavi, modo tantum recorder me
clare et distincte perspexisse, nulla ratio contraria afferri potest, quae me ad
dubitandum impellat, sed veram et certam de hoc habeo scientiam
7
.
Atque ita plane video omnis scientiae certitudinem et veritatem ab una veri
Dei cognitione pendere, adeo ut, priusquam illum nossem, nihil de ulla alia re
perfecte scire potuerim
8
.
4
Jean-Luc Marion affirme ce statut : « La métaphysique se définit et se constitue par l’acte
même de transgresser toute autre science » (Sur le prisme métaphysique de Descartes. Constitution et
limites de l’onto-théologie dans la pensée cartésienne, Paris, Presses Universitaires de France, coll. «
Épiméthée. Essais philosophiques », coll. fondée par Jean Hyppolite et dirigée par Jean-Luc Marion,
1986, p. 25).
5
Roger Texier énonce explicitement cette corrélation : « Au principe de la science, il y a
Dieu » (Descartes, la nature et l'infini, Paris, L'Harmattan, coll. « Ouverture philosophique », 2012,
p. 135).
6
Meditatio V, AT VII 69 (« […] si j’ignorais qu’il y eût un Dieu. Et ainsi je n’aurais jamais
une vraie et certaine science d’aucune chose que ce soit, mais seulement de vagues et inconstantes
opinions », AT IX-1 55). Les textes de Descartes sont cités d’après l’édition, Œuvres de Descartes,
publiées par Charles Adam et Paul Tannery, Paris, Vrin, 1996, en indiquant, à chaque fois, après
l’abréviation AT, le numéro du volume et les pages.
7
Meditatio V, AT VII 70 (« Mais après que j’ai reconnu qu’il y a un Dieu, parce qu’en même
temps j’ai reconnu aussi que toutes choses dépendent de lui, et qu’il n’est point trompeur, et qu’en
suite de cela j’ai jugé que tout ce que je conçois clairement et distinctement ne peut manquer d’être
vrai : encore que je ne pense plus aux raisons pour lesquelles j’ai jugé cela être véritable, pourvu que
je me ressouvienne de l’avoir clairement et distinctement compris, on ne me peut apporter aucune
raison contraire, qui me le fasse jamais révoquer en doute ; et ainsi j’en ai une vraie et certaine
science », AT IX-1 55–56).
8
Meditatio V, AT VII 71 (« Et ainsi je reconnais très clairement que la certitude et la vérité de
toute science dépend de la seule connaissance du vrai Dieu : en sorte qu’avant que je le connusse, je
ne pouvais savoir parfaitement aucune autre chose », AT IX-1 56).

3
L’incompréhensibilité de l’infini et la constitution de la scientia chez Descartes
253
La scientia peut se développer seulement dans la mesure où la connaissance
de Dieu est devenue la vérité qui lui donne raison, donc qui la fonde. L’existence
de Dieu est la garantie de la « veram et certam scientiam » et de la « omnis
scientiae ». La démarche cartésienne vise la fondation de toute science, donc de la
science en général entendue comme scientia. En ce sens, la connaissance de Dieu
ne joue pas un rôle exclusivement propédeutique, mais elle doit être comprise
comme ayant le statut d’un vrai et unique fondement : « omnis scientiae
certitudinem et veritatem ab una veri Dei cognitione pendere ». Seule la
connaissance du « vrai Dieu » peut assurer des autres connaissances, dans la
mesure où cette connaissance (cognitione) donne la certitude et la vérité, qui sont
les déterminations essentielles pour la constitution de la scientia. Donc la seule
possibilité de dépasser les opinions (« vagas tantum et mutabiles ») vers quelque
chose de stable et de certain réside dans la connaissance de Dieu (« vero percepi
Deum esse », « veri Dei cognitione »
9
).
Etant donné que la connaissance de Dieu est le principe de toute
connaissance possible il faut accepter le statut transcendantal
10
de l’idée innée de
Dieu : c’est ce qui rend possible les autres connaissances. Mais en plus, on doit
penser le caractère fondamental de ce principe sur lequel s’appuie la possibilité
véritable de connaître : « […] chercher un Etre, l’existence duquel nous soit plus
connue que celle d’aucun autre, en sorte qu’elle nous puisse servir de principe pour
les connaître »
11
. Le rapport théorique avec ce principe devient problématique dans
la mesure où on n’entend pas une différence subtile, mais radicale, entre les
diverses modalités de connaissance qui sont mises en jeu, principalement en ce qui
concerne l’infinité divine : comprendre (comprehendere, capere) d’un côté,
concevoir et entendre (concipere, intelligere, percipere) de l’autre côté. La scientia
s’actualise seulement à l’intérieur d’un horizon ouvert et rendu possible par un
principe qui le dépasse par l’acte même de l’ouverture. Le principe est fondement
et limite pour la scientia, de sorte qu’à partir de la scientia il n’est pas possible de
transgresser la limite que ce fondement lui impose. Les outils gnoséologiques
propres à la scientia deviennent inutiles par rapport au fondement de la scientia. En
fait, il faut accepter que la limite de la connaissance ne peut être atteinte par la
connaissance elle-même. En ce sens seul, on pourrait déchiffrer l’importance de la
distinction des modalités de connaître que Descartes assume.
Dans une lettre à Regius, Descartes affirme la relation essentielle entre la
scientia et l’existence de Dieu : « [...] scientia vero sit persuasio a ratione tam forti,
9
Il y a une différence entre les deux situations épistémologiques : dans la première, il s’agit de
la connaissance de l’existence de Dieu, pendant que dans la seconde il s’agit de la connaissance du
véritable Dieu. Mais il faut que nous saisissions leur identité conceptuelle, étant donné que pour
Descartes le vrai Dieu existe.
10
Descartes lui-même utilise ce terme dans une lettre. Mais nous l’utilisons dans un sens plus
proche de celui de Kant. En outre, l’innéisme cartésien ne s’identifie pas avec l’innéisme
psychologique, mais avec celui transcendantal.
11
Lettre de Descartes à Clerselier, [Egmond, juin ou juillet 1646], AT IV 444.

4
L’incompréhensibilité de l’infini et la constitution de la scientia chez Descartes
254
ut nulla unquam fortiore concuti possit; qualem nullam habent qui Deum
ignorant »
12
. En outre, dans la même lettre, Descartes rejette la possibilité de
former l’idée de Dieu par le truchement de l’augmentation « à l’infini » des
perfections du fini : « […] quod contendam me non posse esse talis naturæ ut illas
perfectiones, quæ minutæ in me sunt, possim cogitando in infinitum extendere, nisi
originem nostram haberemus ab Ente, in quo actu reperiantur infinitæ […] »
13
.
Descartes reprendra cet argument dans la Troisième Méditation :
Nam primo, ut verum sit cognitionem meam gradatim augeri, et multa in me
esse potentia quae actu nondum sunt, nihil tamen horum ad ideam Dei
pertinet, in qua nempe nihil omnino est potentiale; namque hoc ipsum,
gradatim augeri, certissimum est imperfectionis argumentum. Praeterea,
etiamsi cognitio mea semper magis et magis augeatur, nihilominus intelligo
nunquam illam idcirco fore actu infinitam, quia nunquam eo devenietur, ut
majoris adhuc incrementi non sit capax ; Deum autem ita judico esse actu
infinitum, ut nihil ejus perfectioni addi possit. Ac denique percipio esse
objectivum ideae non a solo esse potentiali, quod proprie loquendo nihil est,
sed tantummodo ab actuali sive formali posse produci
14
.
La connaissance de Dieu s’appuie sur une idée de Dieu, mais elle ne peut pas
se configurer par l’élaboration d’une idée adéquate de Dieu à partir des
déterminations du fini. Descartes insiste fortement sur le caractère reçu (inné) de
l’idée de Dieu, et implicitement de l’infini actuel, étant donné que « l’existence de
Dieu est la première et la plus éternelle de toutes les vérités qui peuvent être, et la
12
Descartes à Regius, [Leyde, 24 mai 1640], AT III 65 (« […] la seconde [scientia], lorsque la
raison de croire est si forte qu’il ne se présente jamais de plus puissante, et qui est telle enfin, que
ceux qui ignorent qu’il y a un Dieu ne sauraient en avoir de pareille […] », Descartes, Œuvres
philosophiques, tome II, (1638–1642), textes établis, présentes et annotés par Ferdinand Alquié, Paris,
Classiques Garnier, 1992, p. 245).
13
AT III 64 (« […] j’affirme que ma nature ne pourrait être telle que je pusse augmenter à
l’infini par un effort de ma pensée ces perfections qui sont très petites en moi, si nous ne tirions
origine de cet être en qui ces perfections se trouvent actuellement infinies », Descartes, Œuvres
philosophiques, tome II, éd. cit., p. 244).
14
AT VII 47 (« […] car, premièrement, encore qu’il fût vrai que ma connaissance acquît tous
les jours de nouveaux degrés de perfection, et qu’il y eût en ma nature beaucoup de choses en
puissance, qui n’y sont pas encore actuellement, toutefois tous ces avantages n’appartiennent et
n’approchent en aucune sorte de l’idée que j’ai de la Divinité, dans laquelle rien ne se rencontre
seulement en puissance, mais tout y est actuellement et en effet. Et même n’est-ce pas un argument
infaillible et très certain d’imperfection en ma connaissance, de ce qu’elle s’accroît peu à peu, et
qu’elle s’augmente par degrés ? Davantage, encore que ma connaissance s’augmentât de plus en plus,
néanmoins je ne laisse pas de concevoir qu’elle ne saurait être actuellement infinie, puisqu’elle
n’arrivera jamais à un si haut point de perfection, qu’elle ne soit encore capable d’acquérir quelque
plus grand accroissement. Mais je conçois Dieu actuellement infini en un si haut degré, qu’il ne se
peut rien ajouter à la souveraine perfection qu’il possède. Et enfin je comprends fort bien que l’être
objectif d’une idée ne peut être produit par un être qui existe seulement en puissance, lequel à
proprement parler n’est rien, mais seulement par un être formel ou actuel », AT IX-1 37–38).

5
L’incompréhensibilité de l’infini et la constitution de la scientia chez Descartes
255
seule d’où procèdent toutes les autres »
15
. La primauté de l’idée de Dieu est un
principe qui génère les autres vérités, en les assurant même par cette « production »
qui fonde. En outre, pour Descartes il n’est pas possible de construire l’idée de
l’Etre le plus parfait parce que cette perfection n’est pas un résultat de
l’intellection, ou une projection à l’infini de certaines qualités de l’être fini. Le
concept qui révèle l’impossibilité d’atteindre la perfection absolue par
amplification des perfections relatives est celui de l’infini actuel. Descartes met
implicitement en jeu la distinction aristotélicienne entre l’infini potentiel et l’infini
actuel
16
. En plus, Descartes affirme que l’infini actuel ne s’obtient point à partir de
l’infini potentiel, à cause de l’impossibilité du cogito d’acquérir
17
l’infini actuel,
accompli et absolument parfait, par augmentation ou par addition. L’infini actuel
dénote ce qui est achevé par lui-même à partir de lui-même, donc qui n’a pas
besoin d’altérité parce qu’il ne manque de rien. La potentialité fonctionne
seulement à l’intérieur du champ du cogito, champ ouvert par les deux idées innées
(l’idée de Dieu et celle du cogito).
L’identité entre Dieu et infini est explicitement affirmée dans une lettre :
« […] ut enim variis in locis inculcavi, de iis quæ ad Deum vel infinitum spectant,
non quid comprehendere possimus, cum sciamus illa non debere a nobis posse
comprehendi, sed tantum quid certa aliqua ratione attingamus, est
considerandum »
18
. L’infini exprime l’essence même de la Divinité, par
l’affirmation d’une identité significative. Dans ce contexte, la liaison entre l’infini
et incompréhensibilité s’exprime par une certitude qui appartient à « sciamus » et
par une interdiction directe qui vise l’acceptation de cette limite de l’intellection,
constitutive du cogito. La compréhension est interdite au cogito, mais
paradoxalement celui-ci doit assumer cette impossibilité d’une manière positive.
Ce manque n’est pas un défaut de la raison, mais au contraire, il appartient à la
structure originaire de l’esprit fini : le fini ne peut comprendre l’infini par sa « dé-
15
Lettre de Descartes à Mersenne, Amsterdam, [Amsterdam, 6 mai 1630], AT I 150.
16
Mais, contrairement à Aristote, il ne rejette pas l’infini actuel.
17
Nous rejetons la thèse de Françoise Monnoyeur qui affirme : « La notion d’infini existe de
façon très particulière chez Descartes dans la mesure où elle est formée à partir du cogito […] »
(« L’infini et l’indéfini dans la théorie cartésienne de la connaissance », dans Infini des
mathématiciens, infini des philosophes, ouvrage collectif sous la direction de Françoise Monnoyeur,
préface de Jean Dieudonné, postface de Hourya Sinaceur, Paris, Belin, coll. « Regards sur la
science », 1992, p. 86). Tout au contraire, nous avons explicité le caractère « reçu » de l’idée de
l’infini. Même s’il s’agit d’une « idée » du cogito, il faut saisir le statut spécial de celle-ci.
L’incompréhensibilité est la marque du fait que le cogito joue un rôle passif, étant donné qu’il ne
« produit » pas l’idée de l’infini, mais seulement « constate » sa présence, qui s’impose à lui.
18
Lettre de Descartes à X*** (Hyperaspistes), [Endegeest, août 1641], AT III 430 (« […] car,
comme je dis souvent, quand il est question des choses qui regardent Dieu, ou l’infini, il ne faut pas
considérer ce que nous en pouvons comprendre (puisque nous savons qu’elles ne doivent pas être
comprises par nous), mais seulement ce que nous en pouvons concevoir, ou atteindre par quelque
raison certaine », traduction par Claude Clerselier (éd.), Lettres de Monsieur Descartes, tome II,
Paris, Charles Angot, 1659, p. 134).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%