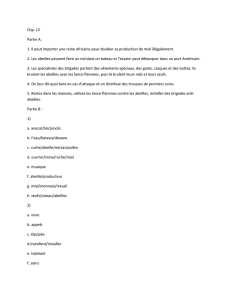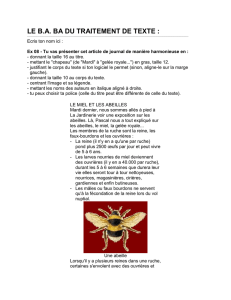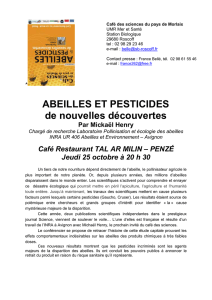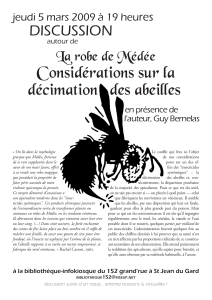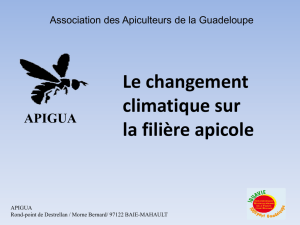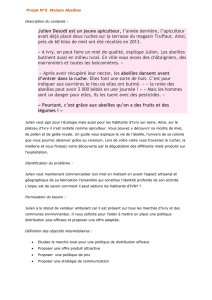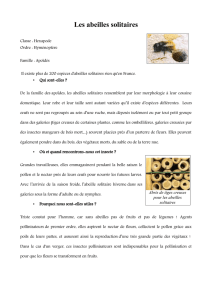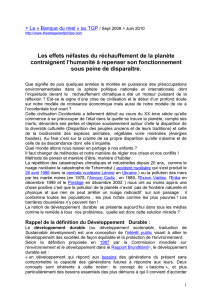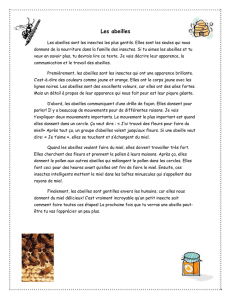Les plantes mellifères selon les saisons

Les plantes du printemps
Le noisetier fleurit de décembre à mars. Sa floraison précoce en fait une importante source de pollen
pour les abeilles en début de saison. Le pollen est indispensable à l'abeille : mélangé à du miel, il
devient " pain d'abeille" qui sert au nourrissement des larves. Arbre commun, on appelle
communément sa fleur «chaton». Un seul chaton mâle de noisetier peut produire 3 millions de
grains de pollen par jour.
Le saule marsault est source de vie pour les abeilles en début d’année : l’inflorescence typique est le
chaton dressé, sessile, odorant et nectarifère (nectaires à sa base.) Les sujets mâles perdent l'écaille
unique protégeant le bourgeon floral et produisent des chatons ovoïdes à oblongs d'abord
recouverts de poils soyeux blanc argentés puis laissant apparaître de toutes petites fleurs jaunes très
décoratives. Ces chatons de 3 à 7 cm de long apparaissent au printemps avant les feuilles (foliaison).
Les fleurs femelles sont de couleur verdâtre. Avant l'éclosion, les fleurs sans pétales sont enfermées
dans un bourgeon floral qui s'ouvre par écartement d'une seule grande écaille brune. Allez à leur
recherche et les beaux jours vous verrez quelques abeilles faire leurs emplettes de pollen dont elles
font des pelotes autour de leurs pattes arrière. Si vous voyez des abeilles, c’est qu’il existe des ruches
dans un rayon de 3 kilomètres.
L’amandier se trouve essentiellement dans le Sud de la France. Il est le premier arbre fruitier en
fleur. Sa floraison abondante en fait une ressource de choix pour l’abeille à la fois en nectar et en
pollen. Mais l’amandier profite aussi pleinement de la pollinisation.
Chez les rosacées, les principaux agents de pollinisation sont les insectes et notamment les abeilles
domestiques qui représentent environ 60 à 90 % de la faune pollinisatrice. Les abeilles sont inactives
à une température inférieure à 14 °C. La vitesse de butinage est 6 à 15 fleurs par minute et l’aire de
butinage est de quelques dizaines de mètres carrés. Pour optimiser la pollinisation, il est nécessaire
de placer des ruches dans le verger à raison de 2 à 5 ruches/ha et disposés perpendiculaires aux
lignes de plantation. Les ruches sont à placer dès le début de floraison.

Le colza, plante issue d’un croisement entre un chou et une navette, semble avoir été cultivé depuis
2 000 à 1 500 ans av. J.-C.
En Europe, c'est l'huile végétale alimentaire la plus consommée, devant l'huile de tournesol et celle
de soja. Cette huile peut être utilisée aussi bien en assaisonnement qu'en cuisson, mais elle n'est pas
recommandée pour la friture.
L'extraction de l'huile fournit un coproduit, le tourteau de colza, qui est une source de protéines
intéressante en alimentation animale.
En France, à cause de l'essor des biocarburants, et en particulier du biodiesel, la plus grande partie de
la production d'huile de colza y est destinée (entre 65% et 85% selon les sources). Au niveau de
l'Union européenne, 63% de l'huile va à l'industrie des biocarburants.
Si le colza est cultivé principalement pour sa graine, il sert aussi de plante de couverture en hiver.
Dans le système de culture classique avec labour ou travail du sol, ce type de culture est destiné à
couvrir le sol et à contribuer ainsi à limiter le lessivage de l'azote. Il est ensuite enfoui, constituant
alors un engrais vert.
Les fleurs de colza produisent un nectar abondant à partir duquel les abeilles font un miel clair, très
riche en glucose, qui doit être extrait assez rapidement des rayons car il a tendance à cristalliser. Ce
miel est habituellement mélangé avec d'autres miels plus doux pour la consommation directe ou
bien vendu pour la pâtisserie. Il est souvent commercialisé sous l'appellation « miel de printemps ».
La sauge tire son nom du latin salvare, «sauver ». Certaines espèces de sauge principalement la
sauge officinale, possèdent en effet de nombreuses vertus médicinales. Elles étaient considérées au
Moyen Âge comme une panacée.
Reconnue par les Chinois, ces derniers n'hésitaient pas à échanger leurs feuilles de thé les plus
précieuses contre des feuilles de sauge. Louis XIV en avait même fait sa tisane d'élection et en servait
à tout propos. Les Grecs, les Romains et les Arabes l'employaient communément comme tonique et
en compresse contre les morsures de serpent. Au XVIe siècle, le botaniste Jacob Tabernae-Montanus
raconte que les femmes égyptiennes avaient l'habitude de boire du jus de sauge pour accroître leur
fertilité.
Au XVIIIe siècle, on roule les feuilles de sauge comme des cigarettes. Tous les asthmatiques se
mettaient à fumer de la sauge dès l'apparition du premier pollen printanier. La plante était associée à
l'immortalité et à la longévité.
Certains groupes d'Amérindiens mélangeaient la sauge avec de la graisse d'ours pour guérir les

problèmes de peau. On a aussi utilisé la plante pour traiter les verrues. "Qui a de la sauge dans son
jardin, n'a pas besoin d'un médecin" (dicton provençal).
Elle est aussi bien connue de la cuisinière : Consommez-la de préférence séchée car ce sont des
feuilles sèches que se dégagent les arômes les plus marqués. Celles-ci parfument à merveille les
farces de volailles. Excellent stimulant de la digestion, n'hésitez pas à l'employer dans tous les plats
riches. Ainsi, elle relève parfaitement l'agneau, le porc, la saucisse, les marinades et les omelettes.
Les pâtés et les fromages profitent aussi de son agréable parfum frais et à peine camphré. En Italie,
elle est mise en vedette dans de nombreuses préparations à base de veau, notamment la piccata et
la saltimbocca. On la déguste aussi frite ou en beignet. Il est également possible de déchirer de
jeunes feuilles de sauge fraîche sur une salade ou un plat de légumes.
La mélisse est connue dans nos jardins pour ses senteurs de citronnelle. Elle est avec le mélilot, la
seconde plante dont le nom fait référence à ses vertus mellifères. Mélisse est emprunté au bas latin
melissa… emprunt au grec melissophullon, composé de melissa (abeille) et de phullon (feuille). La
plante est dite proprement « feuille à abeilles » parce qu’elle les attire (une de ses désignations en
français est «piment des abeilles »).
La mélisse, est réputée depuis l’antiquité mais surtout chez les médecins arabes du moyen âge pour
ses propriétés thérapeutiques. Elle était très appréciée au XIXe siècle pour ses propriétés digestives
et infusée elle offre une tisane apaisante. De plus elle renferme une essence qui est un tonique
nerveux. Il était fabriqué avec les feuilles de mélisse fraîches un alcoolat appelé eau de mélisse ou
Eau des Carmes.

Les Plantes de l’été
La lavande est le symbole de la Provence. Ces champs inspirent les peintres et les abeilles ! Elle a un
petit cousin : le lavandin.
Toutes deux de la famille des labiées, la lavande et le lavandin, que l'on confond très souvent, sont
néanmoins d'espèces différentes. La lavande vraie est une espèce originelle, alors que le lavandin est
un hybride qui résulte du croisement de la lavande vraie et de l'Aspic. La lavande vraie se reproduit
par graines et par bouture, mais le lavandin est stérile et ne se reproduit que par bouture. La lavande
vraie peut donc être cultivée ou sauvage, alors que le lavandin ne se rencontre pas à l'état sauvage.
Chaque graine de lavande donne un plant différent, d'où l'aspect hétérogène des lavanderaies, alors
que les plants du lavandin, beaucoup plus gros et en "boule", sont rigoureusement identiques du fait
de l'hybridation. L'altitude joue aussi un grand rôle dans la différenciation entre les deux espèces :
tandis que le lavandin croît à toutes altitudes (du niveau de la mer à plus de 900 m), la vraie lavande
ne pousse qu'à partir de 350-400 m environ, jamais en dessous.
À noter également la différence de fleurs et de feuilles : on reconnaît la lavande vraie à sa petite tige
(30 à 40 cm environ) et à son épi de fleurs plus petit, couleur "lavande", tandis que la tige du lavandin
est plus longue (60 à 80 cm) et que son épi est plus gros, plus pointu et de couleur franchement
violette; de plus, il se caractérise par la présence de deux "épillets" latéraux, placés en bas.
Enfin et surtout, l'huile essentielle de lavande vraie, utilisée en aromathérapie est plus fine de
parfum, plus douce, presque ronde. Elle a gardé toutes ses propriétés thérapeutiques, alors que
l'essence de lavandin, d'odeur plus âcre, beaucoup plus "camphrée", n'est pratiquement plus utilisée
en pharmacopée.
La lavande (ou le lavandin) a pour l’apiculteur, outre la qualité du miel qu’elle fournit, une deuxième
vertu : une fois séchées, ses tiges constituent un excellent combustible pour les enfumoirs.
Le tilleul procure un miel délicat. Sa floraison prend le relais de celle de l’acacia. C’est un arbre plus
majestueux que ce dernier. Il rivalise avec le chêne en la matière, ce qui n’avait pas échappé aux
anciens. Ovide dans ses Métamorphoses , nous raconte l’histoire de Philémon et Baucis, couple âgé
uni par leur amour depuis l’adolescence. Jupiter et Mercure, ayant pris l’apparence humaine, sont
reçus chaleureusement par eux, après avoir été rejeté par tous les voisins. En suprême récompense à
la fin de leur longue vie, ils sont transformés en arbre unis à jamais par leurs branches. Philémon en
chêne et Baucis en tilleul, « l’arbre qui guérit » et qui unit, comme l’écrit La Fontaine : Pour peu que
des époux séjournent sous leur ombre, ils s’aiment jusqu’au bout malgré l’effet des ans. Le tilleul est
abondamment consommé en tisane pour ses vertus sédatives. Au mois de juillet, les abeilles ne se
contentent pas de visiter le fond des corolles, elles récoltent également le miellat, produit par les
pucerons se développant sur le feuillage dont ils ponctionnent la sève. Cette sève digérée, ils
régurgitent le miellat brillant et collant sur les feuilles, véritable friandise pour les abeilles. En effet,
après l'avoir longuement léché, ce miellat est une fois de plus digéré, ventilé et stocké à l'instar du
nectar. Le miel de Tilleul peut entrer dans la composition poly-florale du miel de forêt ou faire l'objet
d'un miel mono-floral. Dans ce cas, il est ambré-clair et prend, à l'état solide (cristallisation courte à
longue), une teinte jaune plus ou moins sombre dont la granulation est moyenne. À l'état liquide, la
présence de miellat fonce sa couleur. Au nez, son odeur mentholée caractéristique est forte et assez
persistante. En bouche, l'arôme très puissant d'infusion de tilleul et de menthol est souvent associé à
une saveur balsamique et persistante. Il laisse régulièrement une légère amertume en fin de bouche.

Sa conservation est bonne malgré sa teneur en eau parfois élevée. Le miel de tilleul est conseillé aux
personnes nerveuses et insomniaques.
La bourrache est originaire de Syrie et, en arabe, son nom (abu rach) signifie « le père de la sueur »,
une allusion évidente à ses propriétés sudorifiques. On trouve des traces de son usage dès le premier
siècle de notre ère. En raison de ses propriétés et de son action diurétique, on a souvent utilisé la
bourrache comme dépuratif. On l'a également employée pour donner « du bonheur et du courage »
et pour stimuler la lactation.
En climat tempéré, la floraison intervient de juin à août. Dans le midi de la France elle fleurit fin mars
début avril. Elle est assez commune dans les terrains vagues. Elle est souvent cultivée surtout dans
les jardins. Les jardiniers apprécient son effet répulsif sur les limaces.
La bourrache est une excellente plante mellifère. Son miel clair et limpide, discrètement parfumé,
mais rarissime à l'état pur. Il est en effet rare de voir produit des miels mono-floraux de bourrache et
il entre plutôt dans la constitution de miels polyfloraux.
La toxicité d’un miel monofloral de bourrache est évoquée par certains auteurs. « Ces publications
font référence à la présence d’alcaloïdes pyrrolizidiniques que l’on trouve dans certaines plantes
appartenant à la famille des borraginacées (bourrache, vipérine, consoude, myosotis…) et de
certaines astéracées (séneçons, eupatoire, tussilage…), ces substances étant hépatotoxiques et
carcinogénétiques. Ces alcaloïdes sont présents dans les nectars issus de ces plantes donc dans leurs
miels. Il convient cependant de relativiser les choses. D’une part, comme toujours dans ces
domaines, il faut ramener cela à la dose journalière moyenne de miel absorbé par individu et
l’associer aux autres aliments susceptibles de contenir de telles substances. En général, on ne mange
pas le miel par kilogramme par jour ! D’autre part, seuls les miels monofloraux ou provenant
majoritairement d’un mélange de ces plantes pourraient présenter un danger potentiel. Ces cas de
figure sont extrêmement rares. Pour produire un miel monofloral, les abeilles doivent butiner des
millions de fleurs. Les plantes en questions doivent donc toujours être massivement présentes sur un
même lieu.
L’extraction du pollen des anthères (partie terminale de l'étamine, organe mâle de la fleur, qui
produit et renferme le pollen) de la bourrache nécessite une méthode particulière de la part de
l’insecte pollinisateur. Il fait entrer les anthères en vibration par des contractions rapides de ses
muscles. A une certaine fréquence les étamines entrent en résonnance et projettent les grains de
pollen. Seuls les bourdons sont capables de produire les vibrations et fréquences adéquates. Les
abeilles quant à elles se contenteront de récolter le nectar abondant.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%