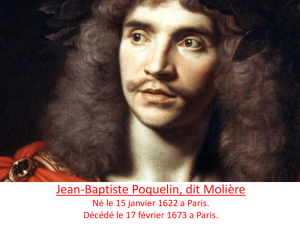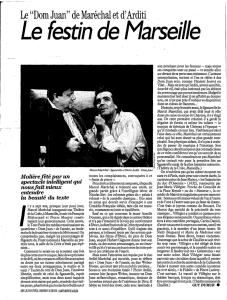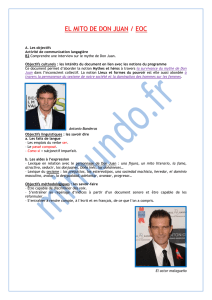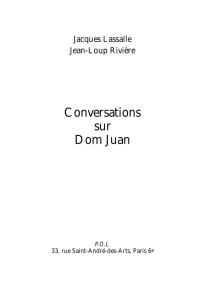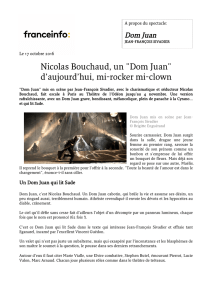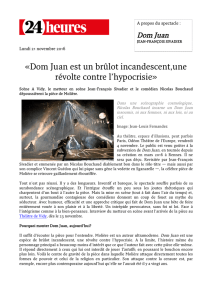Programme - Théâtre National de Strasbourg

LE FESTIN
DE PIERRE
d’après Dom Juan de Molière

Mise en scène et scénographie Giorgio Barberio Corsetti
Costumes et scénographie Christian Taraborrelli
Composition musicale Gianfranco Tedeschi
Création et réalisation vidéo Fabio Massimo Iaquone
Lumières Kélig Le Bars
Création des marionnettes Antonin Bouvret
Collaboration artistique Anne-Françoise Benhamou
Assistant à la mise en scène Georges Gagneré
Conception et réalisation du vol à l’élastique Claude Lergenmuller/Les Élastonautes
Avec
Elvire, Le Spectre Claire Aveline
Dom Juan Luc-Antoine Diquéro
Gusman, Le Pauvre, Monsieur Dimanche Jean-Marc Eder
Dom Louis, La Statue du Commandeur Philippe Girard
Mathurine Maud Le Grévellec
Charlotte Marie-Christine Orry
Pierrot, La Ramée, La Violette Clément Victor
Sganarelle Daniel Znyk
Et les musiciens Gianfranco Tedeschi (contrebasse)
Caroline Stenger (violoniste)
Manipulation des marionnettes Maud Le Grévellec, Clément Victor,
Jean-Marc Eder, Antonin Bouvret
Production Théâtre National de Strasbourg
Équipe technique du TNS
Régie générale Bruno Bléger
Régie lumière Bernard Cathiard
Électricien Olivier Merlin
Régie son Sébastien Lefèvre
Régie vidéo Bernard Klarer
Régie plateau Denis Schlotter
Machinistes Charles Ganzer, Pascal Lose
Daniel Masson, Abdel-Karim Rochdi
Franck Vincent
Accessoiriste Olivier Tinsel
Habilleuses Bénédicte Loux, Géraldine Lorelle
Christine Clavier-Walter
Maquilleuse Brigitte Ferrante
Stagiaire plateau (Institut du théâtre de Catalogne) Carles Fernandez
> Les décors et les costumes on été réalisés par les Ateliers du TNS
> Remerciements :
• Cosmétiques « art du maquillage professionnel pour tous »
7, rue des Orfèvres, Strasbourg
• Boulangerie/Pâtisserie Maurice Helterlin
Dates Du lundi 28 avril au mercredi 7 mai 2oo3
Du lundi au samedi à 20h
Relâche le jeudi 1er mai et le dimanche 4 mai
Salle Bernard-Marie Koltès
Durée du spectacle 2 heures
> Reprise d’un spectacle créé le 30 mai 2oo2 au TNS avec les acteurs de la troupe
>
Tournée : Le Festin de pierre est présenté au CDN Gennevilliers du 15 mai au 6 juin 2oo3
> Représentations spéciales
• Représentation en audio-description pour le public aveugle et malvoyant
le mercredi 30 avril à 20h
• Représentation surtitrée en allemand : le samedi 3 mai à 20h
• Représentation surtitrée en français pour le public sourd et malentendant
le lundi 5 mai à 20h

Ce dont Dom Juan est fiévreusement en quête, c’est de tout autre chose que de l’amour.
JEAN MASSIN
Marie-Christine Orry (Charlotte), Luc-Antoine Diquéro (Dom Juan), Claire Aveline (Elvire)

6
7
Commence alors la chute de Dom Juan*, son voyage
vers la n. Sa course en avant trouve toujours de nou-
veaux empêchements - tous viennent lui demander des
comptes, des dettes non payées -, et sa façon de se tirer
d’affaire dans un monde couvert des signes de la défaite,
de l’impossibilité, l’amène toujours plus près de la n.
Lui qui est dangereux et aime le danger, est suivi d’un
Sganarelle effrayé et continuellement surpris.
Des objets inutilisables remplissent les étagères de la
chambre de Dom Juan, symboles de son incapacité à
prendre, à saisir les choses. Les choses peuvent seule-
ment être dévorées, car c’est le seul moyen de les faire
disparaître. Les femmes notamment sont dévorées et
chaque conquête amoureuse est une femme de moins
dans la grande réserve de vivres du monde qui doit
être consommée jusqu’au bout par le grand Dom Juan
angélique, boulimique et sombre.
Les personnages changent autour de lui tandis qu’avec
Sganarelle à ses côtés, il voyage vers la mort en prenant
tout et en ne donnant rien, toujours dèle à son nihilisme
absolu. C’est un monde à dévaster qu’il a devant lui, et
sa dévastation génère la transformation des autres.
La pièce repose sur les épaules d’un ange noir, dont le
dos correspond au plateau.
Sganarelle assiste et écoute, c’est ce qu’il doit faire ;
son regard et son oreille sont ceux du public, un public
privé - cet Autre synthétisé justement en Sganarelle,
gure merveilleuse de la simplicité, de la surprise, du
bon sens chargé de banalité poétique et de superstition.
Sur l’écran du fond se projettent les pensées, les paroles ;
la parole domine comme un souverain absolu, mais
la parole, sujette à la censure et l’autocensure, laisse
toujours échapper le merveilleux des profondeurs - la
Le ciel
de pierre
censure pratiquée par les ennemis de la parole libre
laisse toujours échapper des mots qui trahissent la
vraie nature des censeurs.
Paroles projetées, paroles déchirées.
Le monde devient parfois une roue fermée sur elle-
même (faisant pédaler les petits animaux en cage), ou
encore une bande de pelouse avec deux chaises.
La statue du Commandeur est le défi suprême,
l’extrême doute : qu’y a-t-il après la mort ? La statue
du Commandeur est comme le masque mortuaire en
or posé sur le visage de Joseph Beuys qui tient dans ses
bras un lièvre. C’est la mort qui annonce toujours son
arrivée et qui, même si elle ne l’annonce pas, arrive
quand même. C’est là le grand dé de Dom Juan, son
grand appel à la vie : déer jusqu’au bout la mort. Lui
qui nalement « ne trouve rien de trop chaud ni de trop
froid » est brûlé par un feu invisible et assiste à la n de
son propre corps.
Le festin de pierre est le moment de la perte ; l’atta-
chement à la vie porte à l’extrême dérision l’apostasie,
l’hypocrisie, dernier acte de mépris à l’égard du monde
et de ses faiblesses, et seule stratégie possible pour ne
pas payer ses dettes quand on est au pied du mur.
Une èvre s’empare de Dom Juan après la visite au
cimetière ; le fond du puits dans lequel se déroule la
pièce est obscurci par le visage du Commandeur qui se
découpe là-haut sur le cercle de ciel qu’on arrive à voir.
Un visage d’or comme un masque mortuaire. Un ciel de
pierre comme le puits qui se referme et se transforme
en tombeau.
GIORGIO BARBERIO CORSETTI
Trad. Angela De Lorenzis
J’ai dit « cruauté » comme j’aurais dit « vie »
ou comme j’aurais dit « nécessité »
ANTONIN ARTAUD
* Dom Juan de Molière, s’écrit avec « m », les autres Don Juan s’écrivent avec un « n ».

8
9
Joseph Beuys,Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort, 1965
Le diable
et le tabac
Le tabac est un aliment qu’on ingère sans
l’absorber. L’ingestion, qui s’accompagne de
sensations gustatives-olfactives génératrices de
plaisir, est donc immédiatement suivie d’une
expulsion ou rejet, par expectoration si l’on
fume, par crachat si l’on chique, ou par éternue-
ment si l’on prise. La loi du tabac est qu’une fois
le plaisir pris, on l’élimine intégralement, sans
en garder que le goût d’une éphémère jouis-
sance. Don Juan consomme le cigare comme
il consomme une femme, sans autre n que d’y
prendre du plaisir et de le rejeter aussitôt, inu-
tile désormais, inabsorbable, une fois épuisée,
par épuisement immédiat, la jouissance qu’on
s’est promis d’en tirer. On ne saurait fumer
deux fois le même cigare, ni la même femme.
MAURICE MOLHO
Mythologiques, Don Juan,
José Corti, 1995, p. 32.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%