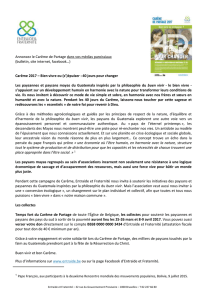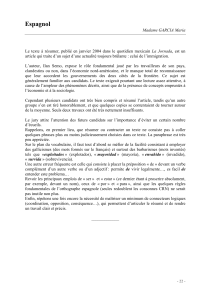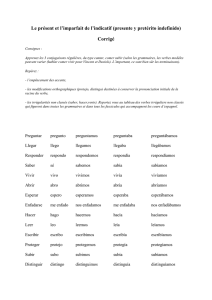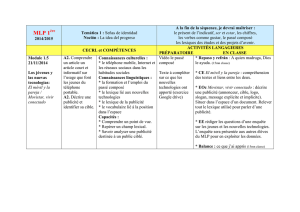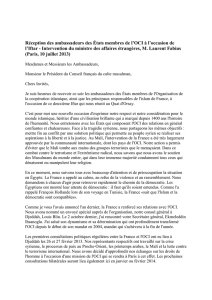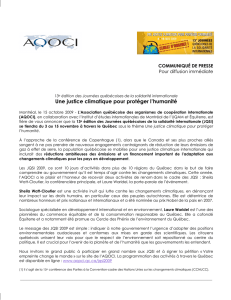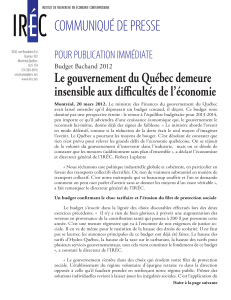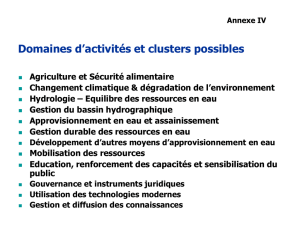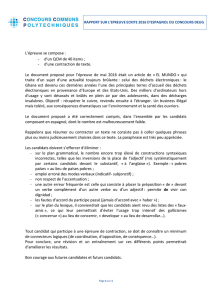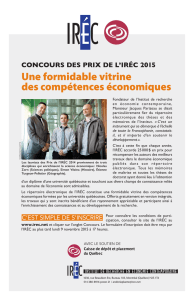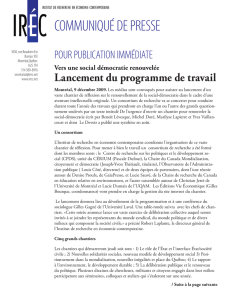Le « Buen vivir » une autre vision du développement économique

À l'heure de la globalisation, les alternatives au développe-
ment néolibéral se font de plus en plus nécessaires. Les inéga-
lités entre les riches et les pauvres s'accroissent de jour en jour
et laissent des centaines de millions de personnes vivre en
situation d'extrême pauvreté. Les dommages causés à l'envi-
ronnement se font aussi de plus en plus sentir à un moment où
les limites des écosystèmes terrestres sont pratiquement toutes
atteintes. À ce sujet, le cinquième bilan quinquennal de l’état
de la planète du Programme des Nations unies pour l’environ-
nement révélait que les efforts convenus par la communauté
internationale dans la lutte contre le réchauffement climatique
n'avaient connu un progrès significatif que pour 4 des 90 objec-
tifs majeurs identifiés depuis 1950.
L'Équateur, petit pays andin d'Amérique latine, a entrepris de
développer son propre programme depuis 2007. Critiquant les
fondements du développement capitaliste occidental à l'origi-
ne de cette double crise civilisationnelle, il a introduit, au sein
de sa nouvelle constitution en 2008, la notion autochtone du
« Buen vivir »**. Son plan de développement pose ainsi les
bases en trois temps d'une transition écosocialiste dont l'objec-
tif est de transformer la matrice productrice, mais aussi de
décoloniser notre manière de vivre ensemble.
Développement humain
Le « Buen vivir» propose une solution de rechange à la concep-
tion néolibérale du développement dont la priorité va aux indi-
vidus plutôt qu’à l'accumulation sans fin du capital. La straté-
gie vise à améliorer les capacités de tout un chacun afin que
tous puissent être en mesure d'agir et de se prendre en main.
Le développement en ce sens ne dépend pas de l’État, même
s'il peut en être un acteur important, mais dépend des indivi-
dus que les institutions publiques cherchent à encadrer. Les
pauvres et les marginalisés ne sont pas vus comme des obs-
tacles à la prospérité collective, mais représentent plutôt des
vecteurs d'un développement solidaire auquel ils sont destinés
à participer. En d'autres termes, l’objectif est de donner les
aptitudes nécessaires à qui en a besoin, pour qu'il participe à
son propre développement et au développement de la collecti-
vité.
Le « Buen vivir » une autre vision du
développement économique
Par Simon Morin, étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l’UQAM *
NUMÉRO 17 · AUTOMNE 2012
(Le « Buen vivir » : suite à la page 2)
Photo : Christian Bélanger

BULLETIN DE LIAISON DE
JEUNES ET SOCIÉTÉ
FERME BERTHE-ROUSSEAU
MER ET MONDE
L’Unisson paraît trois fois l’an; il est envoyé par
courriel aux personnes qui constituent notre
réseau. De plus, il est disponible sur notre site à :
www.jeunesetsociete.org/lunisson.htm. Sauvons
des arbres, faites nous parvenir votre adresse de
courriel.
COMITÉ DE L’UNISSON
Claudia Beaudoin, pour Mer et Monde
Hélène Boulais, rédactrice en chef
Michel Corbeil, pour Jeunes et Société
Martin Couture, pour
la Ferme Berthe-Rousseau
Jamie Lambert, conception et mise en page
André Fortin, correcteur
340, rue Saint-Augustin
Montréal QC H4C 2N8
Tél.: (514) 495-8583
L’UNISSON · AUTOMNE 2012
2
JEUNES ET SOCIÉTÉ regroupe des hommes et
des femmes qui acceptent de mettre leurs talents
d'organisateurs et leurs ressources d'imagination
et de créativité au service des personnes visées
par les activités du Centre Berthe-Rousseau et de
Mer et Monde. ARC: 86751 4028 RR 00001
La FERME BERTHE-ROUSSEAU est un petit
organisme qui gère une ferme communautaire,
son but est d'accueillir des gens blessés par la vie.
C'est un lieu tout simple où l'on a le droit d'être
fragile.
MER ET MONDE a pour but de contribuer au
développement durable, en proposant des stages
d'initiation à la coopération internationale, stages
par l'intermédiaire desquels les participants ont
l'occasion d'approfondir leur analyse sociale
globale et de mieux saisir les défis auxquels notre
monde est confronté. S'étant interrogés sur les
valeurs humaines et sociales qu'ils veulent faire
prévaloir dans l'histoire de l'humanité des
prochaines décennies, les participants pourront
être des acteurs responsables et avisés pour
inspirer et animer les grands débats en faveur de
la justice et du respect des personnes et de la
nature.
Par exemple, l’Équateur a investi d'im-
portantes ressources dans le système de
santé et d'éducation au cours des der-
nières années. L'objectif n'était pas seule-
ment de fournir la capacité de lire et
d'écrire, de façon à ce que tous obtiennent
un emploi, mais également de renforcer
les capacités d'expression, d'entreprise,
d'innovation et une pensée critique,
nécessaires au développement d'une éco-
nomie solidaire.
Développement démocratique
Le développement du « Buen vivir »
concerne aussi les communautés. Le plu-
rinationalisme et l'intercul-
turalisme sont deux des
composantes fondatrices de
l’État et de la société équa-
torienne. Toutes deux sont
reconnues explicitement à
l'article 1 de la Constitution
de 2008.
De pair avec cette idée de
redonner les capacités aux
individus, le « Buen vivir » privilégie la
décentralisation et la déconcentration du
pouvoir de manière à ce que l'État perde
son monopole de l’action sociale au profit
de l'autodétermination collective. En
effet, le « Buen vivir » privilégie l’engage-
ment citoyen sous diverses formes démo-
cratiques, délibérative, participatives, et
représentatives tant à l’échelle locale,
régionale que nationale. L’État ne doit
plus agir de façon paternaliste, mais
redistribuer le pouvoir aux communau-
tés, afin qu'elles puissent se réapproprier
l’État qui les gouverne et l'économie qui
les coordonne.
Le Plan national pour le « Buen vivir » 2009-
2013 propose ainsi un équilibre entre la
société civile, le pouvoir économique et
l’État démocratique. Deux innovations
politiques intéressantes ont aussi été
adoptées durant le processus
constitutionnel, soient la promotion des
Assemblées communautaires ainsi que
le droit de consultation accordé aux
communautés autochtones, « afrodesce-
dantes » et « montuvios »***.
Développement durable
En plus de promouvoir l'épanouissement
individuel et collectif, le « Buen vivir »
propose également d'établir une relation
harmonieuse entre l'humanité et son
milieu de vie, en rejetant la vision anthro-
pocentrique du développement – où l'hu-
main est au centre de tout. Comme l'ex-
plique Karl Marx, le développement du
capitalisme fait des êtres humains, les
maîtres de la nature afin de répondre à
leurs besoins matériels croissants et sans
doute sans limites. Selon Alberto Acosta,
ex-président de l'Assemblée constituante
de 2007, le réchauffement climatique est
la conséquence de cette façon de
vivre ensemble coupée de l’envi-
ronnement. À son avis, la crois-
sance matérielle sans limites à
laquelle nous nous adonnons et
avec laquelle la logique néolibé-
rale s'accorde à merveille par la
création d'un endettement
impossible, nous mène tout droit
à un suicide collectif.
Le « Buen vivir» nous rappelle l'impor-
tance de redéfinir notre relation avec la
nature afin de maintenir un équilibre. Par
exemple, les articles 72 et 73 de la nou-
velle constitution reconnaissent la nature
comme un objet et un sujet du droit équa-
torien. La nature a le droit à l’existence
dans le maintien et la régénération de ses
cycles de vie. Tout citoyen peut ainsi se
porter à sa propre défense face à tout pro-
jet menaçant ses droits constitutionnels.
Les projets de reforestation et de protec-
tion du territoire, ainsi que l’Initiative
Yasuní-ITT, visant à laisser sous terre
plus de 840 millions de barils de pétrole
dans une des aires les plus riches en bio-
diversité de la planète, concrétisent un
peu plus la volonté de l'Équateur de lut-
ter contre les changements climatiques en
accordant de la valeur à autre chose qu'à
l'argent. De plus, permettre aux individus
et à leur communauté de s’épanouir dans
un environnement propre fait partie du
nombre des libertés reconnues par la
constitution et assure la prise en charge
par les individus du développement
d'une économie solidaire.
(Le « Buen vivir » : suite de la page 1)
* L’auteur est aussi assistant de recherche à la Chaire Nycole-Turmel sur les espaces publics et les innovations
politiques à l’UQAM et vient de faire un stage de deux mois en Équateur, dans le cadre d’une recherche sur le
« Buen vivir ».
** Le « Buen vivir » se traduit en français par « Bien vivre ». Dans les deux cas, ils sont des traductions
latines de « Suma quamaña » en langue aymara et de « Sumak Kawsay » en langue quechua.
*** « montubios » : Les peuples montubios comptent plus de 1400 communautés situées pour la majorité sur la
côte pacifique équatorienne. Ils se réclament être un peuple métissé avec leur propre culture. La Constitution
de la République de 2008 lui reconnait d’ailleurs des droits collectifs ainsi que son droit à l’autodétermination.

L’UNISSON · AUTOMNE 2012 3
Tous connaissent le mouvement de la simplicité volontaire
dont Serge Mongeau s’est fait le plus ardent porte-parole, et
cela, bien avant que les médias de masse y portent une quel-
conque attention. Ce mouvement social vise à nous mettre en
garde contre la surconsommation dont certains psychiatres
disent qu’elle peut être la source de maladies mentales graves.
Or, de volontaire et individuelle la simplicité est devenue
nécessaire et collective.
Soyons clairs : lorsque j’emploie les termes « simplicité néces-
saire », je ne veux évidemment pas parler de cette simplicité
obligée à laquelle les pauvres sont condamnés depuis toujours.
Je parle de celle que la réalité nous imposera de gré ou de force,
tôt ou tard. Si je qualifie cette simplicité de nécessaire c’est tout
simplement parce que la survie de la planète l’exige. Je
corrige : la planète survivra quoi que nous fassions, mais la vie
humaine sur terre n’a aucune garantie automatique de survie.
Si la tendance actuelle se maintient en matière de développe-
ment économique, nous allons droit sur un mur.
Suivant les sacro-saintes lois du marché, tout ce qui fait gonfler
le PIB est bon. Peu importe ce qu’on produit ou comment on le
produit, c’est le chiffre au bout qui compte. On comprendra
pourquoi des criminels socio- économiques s’en prennent aux
mouvements citoyens qui mettent leurs choix en question en
les accusant d’œuvrer contre l’économie et donc contre la crois-
sance. Voila le mot- clé : croissance. Le mot devant lequel nous
devons nous prosterner sous peine d’être traités d’utopistes.
Mais posons la question : qui sont les véritables utopistes ?
Ceux qui affirment que la croissance infinie sur une planète aux
limites finies est chose possible, ou ceux qui prétendent que
l’économie doit se plier à la réalité de ce monde? Dire que la
croissance peut augmenter sans cesse relève de la croyance et
non de la science. Les économistes néolibéraux sont des
croyants.
Il y a une différence entre croissance et développement. Qui dit
croissance ne veut pas nécessairement dire développement. Il
peut même y avoir un développement harmonieux et béné-
fique dans le cadre d’une décroissance. Voila le mot qu’aucun
homme ou femme politique n’osera prononcer : décroissance.
Et pourtant nous y sommes condamnés, par la force des choses.
Que nous le voulions ou non il nous faudra l’envisager. Alors,
aussi bien la préparer pour la gérer dans le sens du développe-
ment plutôt que la subir dans le désordre et les crises.
C’est maintenant qu’il nous faut adopter la simplicité comme
règle de vie. Ce ne sera pas facile car nous sommes tous plus ou
moins des drogués de la consommation. Il faudra apprendre à
redécouvrir le véritable sens des mots et des choses et ainsi pou-
voir faire la différence entre le nécessaire et le superflu, entre
l’utile et l’inutile. En évitant d’être contaminés par la propagan-
de commerciale que certains persistent à nommer publicité.
Les crises qui viendront seront nombreuses et multidimension-
nelles. Elles seront à la fois économiques, écologiques et
sociales. Les dirigeants politiques et les élites économiques sont
dans le déni le plus total devant ces crises qu’ils ont rendues
inévitables. C’est à nous de prendre le volant de ce système
devenu fou, non pas pour le conduire mais pour l’arrêter, le
reconstruire et lui donner une autre vocation, fondée non pas
sur l’accumulation sans fin de la fortune de quelques- uns mais
sur la satisfaction des besoins de la majorité.
La simplicité volontaire devient nécessaire
Par Robert Jasmin, juriste et sociologue, président de ATTAC-Québec de 2000 à 2011
Au Sénégal, 70% de la population vit de l’agriculture et 80%
des femmes en milieu rural assurent les charges de la famille.
Ces femmes, comme celles du village de Terokh, en partenariat
avec l’Association Nord Pas de Calais développent l’agri-
culture, qui est le moteur de l’économie.
Ce projet de coopération permet aux femmes de cultiver des
légumes à l’année longue à l’intérieur de leur périmètre maraî-
cher. Elles sont assurées d’un salaire journalier de 2000 CFA
par jour ce qui leur permet également de lutter contre le chô-
mage et la pauvreté.
Le projet a pour objectif d’investir la moitié des bénéfices
annuels dans le domaine de la santé, de l’éducation et de la pro-
motion féminine. Les femmes ont ressenti les retombées de
cette coopération au niveau de la Caisse d’épargne et de crédit : on
a constaté en effet une augmentation de leur participation. Au
sein des ménages on constate l’acquisition de nouveaux équi-
pements domestiques comme des armoires, des chaises, des
ustensiles de cuisine, etc. Mais, au delà
de l’aspect financier, le projet a permis
aux femmes de mettre fin au calvaire
qu’elles vivaient en se faisant
« louer » pour la lessive à Tivouane
moyennant un coût de 1500 CFA par
jour.
On ne peut développer le Sénégal sans
passer par l’agriculture, car c’est le sec-
teur le plus productif. Les femmes en sont tellement
conscientes qu’elles se sont battues pour obtenir la parité, et
c’est cette parité qui leur a permis d’avoir accès à la terre.
Les femmes présentent le plus grand bassin de main d’œuvre,
car après les cultures, elles s’investissent dans la commerciali-
sation et la transformation des produits.
Au Sénégal, l’économie passe par l’agriculture et les femmes
Par Prosper Faye, responsable de la Caisse de crédit et d’épargne de Terokh

L’UNISSON · AUTOMNE 2012
4
À partir du 19e siècle, la première
phase de l’économie du Québec est
placée sous le signe de la
« National Policy » du gouverne-
ment Macdonald. Cette politique
confine la bourgeoisie canadienne-
française à la marginalité. Cette der-
nière va occuper ces interstices en
se positionnant dans l’immobilier,
la construction, dans le vêtement,
dans la fourniture de biens durables
légers, etc. « Elle prend pied dans
les secteurs industriels et s’y affir-
me. Même si elle n’est pas cantonnée à la sous-traitance, elle
demeure néanmoins à la remorque du grand capital. Elle est en
quelque sorte une force subsidiaire qui occupe un espace satel-
lite. Même si elle y joue un rôle plus affirmé, ce n’est pas elle
qui donne à l’économie du Québec ses impulsions. Elle en pro-
fite, mais elle ne les oriente pas », explique le directeur général
de l’IRÉC.
La crise de 1929 achève le travail de marginalisation de cette
bourgeoisie, en effaçant les gains qu’elle avait réalisés depuis le
dernier quart du 19e siècle, dans la foulée de l’entrée massive
du grand capital anglo-américain dans le secteur des res-
sources. Une période de reconquête économique s’ouvre alors,
basée sur la création de PME, et vise la constitution d’un réseau
d’entreprises prenant appui sur l’économie locale. « Ce sont les
économistes des HEC et leurs alliés dans les mouvements
nationalistes qui vont progressivement élaborer les stratégies
de cette reconquête par une approche de progression linéaire,
poursuit l’économiste. À partir de la seule activité économique
où ils sont en position relative de gagner du contrôle c'est-à-
dire l’agriculture, les Canadiens-français pourront progressive-
ment gagner des positions : de l’agriculture à l’artisanat, de
l’artisanat à la petite entreprise et ainsi de suite. Ces penseurs
et avec eux la large fraction de la classe d’affaires qui s’en ins-
pire sont convaincus qu’il faut prendre appui sur l’économie
locale, l’économie des villages et des petites villes pour déve-
lopper une première base d’accumulation ».
L’échec du modèle de croissance « linéaire »
Au milieu des années 50, on constate que ce modèle de crois-
sance « linéaire » n’est pas réalisable et qu’il manque de capi-
taux pour inscrire le Québec dans l’économie continentale. Il
faut un État, mais Duplessis qui est anti-étatiste, va résister
farouchement à ce constat et penser qu’il faut plutôt redonner
au grand capital une deuxième impulsion pour compenser,
pour ne pas avoir à prendre appui sur l’État. Il devra faire d’im-
portants compromis pour obtenir les investissements améri-
cains. Entre autres, on se rappellera les grandes concessions qui
ont accompagné le développement minier de la Côte-Nord et la
canalisation du Saint-Laurent, qui eut pour effet de marginali-
ser Montréal. Le développement se retrouve à nouveau dans
une impasse et c’est ce qui a mené à la Révolution tranquille
des années 60.
Le constat est évident : il faut s’appuyer sur l’État, mais on ne
peut compter sur l’État fédéral. Pour donner au gouvernement
du Québec des moyens s’approchant de ceux d’un véritable
État, il faudra donc miser sur ce qui fait déjà la force et l’intérêt
du grand capital qui les a accaparés : les ressources naturelles.
« Pas étonnant que la nationalisation de l’hydro-électricité revê-
te un caractère inaugural, indique Robert Laplante. Hydro
Québec va devenir le « navire amiral » du développement du
Québec avec ses travaux, ses politiques d’achats, de fournis-
seurs et d’ordonnance de ses projets qui vont « internaliser »
des objectifs de développement régional. Les grands projets de
la Révolution tranquille, les barrages, Expo 67 et le métro de
Montréal vont permettre de faire ce que la stratégie de
Duplessis n’avait pas réussi à faire ».
Deux approches
Cependant à la fin des années 70, la pensée économique se divi-
se en deux approches : l’une privilégiant la construction d’une
structure économique complète sur tout le Québec, et une autre
qui mise sur les possibilités de prendre sa place dans le marché
canadien. « Le Québec Inc. naissant est en quelque sorte préci-
pité précocement dans une crise d’adolescence qui est une vraie
crise de croissance, constate Robert Laplante. Ce sera le début
d’un débat autour du rapport Gobeil, prônant la réduction de
la taille et du rôle de l’État, subordonnant les ambitions natio-
nales aux contraintes du marché ».
Dans les années 80, l’adhésion au néo-libéralisme prend le des-
sus. L’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
représente une solution de compromis, qui peut offrir les avan-
tages du grand marché tout en évitant les difficultés d’avoir à
se construire un espace économique national complet. Par ce
biais, les nationalistes pensent devenir moins dépendants de
l’économie canadienne, mais le gouvernement fédéral est
l’unique détenteur des juridictions clés (commerce internatio-
nal, affaires extérieures). Pour tirer avantage de cet accord, la
bourgeoisie d’affaires au Québec doit refaire ses compromis
sur la question du maintien des secteurs et des industries stra-
tégiques.
Pendant que cette bourgeoisie tergiverse, le Canada devient un
État pétrolier au début des années 2000. L’économie du
Québec, qui avait profité de l’accroissement des exportations
sur l’axe nord-sud, doit désormais composer avec un dollar
élevé qui déstructure sa base industrielle. « Incapable de se
doter d’une stratégie de développement, explique Robert
Laplante, Québec propose le Plan Nord, la formulation électo-
L’économie du Québec : y voir clair pour
maîtriser le développement
Tiré d’une entrevue que donnait monsieur Robert Laplante, économiste, chercheur et directeur général de l’Institut de
recherche en économie contemporaine (IRÉC) dans le numéro 44 de la « Revue intervention économique » *
Photo : Normand Rajotte
(L’économie : suite à la page 5)

raliste du choix de la grande entreprise pour une croissance
sans le développement. De plus, les grands leviers de l’État de
la Révolution tranquille sont mis à mal par la dynamique de la
financiarisation, qui les écarte pour le moment de la construc-
tion d’un modèle original pour le Québec ».
Une classe d’affaires en panne
Force est de constater qu’il n’y a pas dans la classe d’affaires
actuelle une vision minimale de ce qu’est l’intérêt national.
Devant cet état de fait, l’économiste de l’IRÉC soutient que la
clé consiste en des politiques industrielles visant une coordina-
tion et une concertation plus grandes. Il propose des approches
qui favoriseront la mise en réseau, qui tisseront les liens d’al-
liance et de concurrence entre des acteurs des divers secteurs.
« Et cela ne peut pas se faire, dit-il, en s’en remettant à la seule
logique des créneaux de marché et de la mondialisation, c’est
d’abord une affaire de territoire et de logiques de proximité ».
Trois grands principes forment autant d’axes devant charpen-
ter les futures politiques industrielles : 1) viser à faire fonction-
ner de concert et en complémentarité l’économie publique,
l’économie sociale et l’économie de marché; 2) construire sur le
principe de la souveraineté alimentaire; 3) affirmer l’originali-
té nationale.
Pour qu’une politique d’innovation procure une prospérité
durable, elle doit maximiser les caractéristiques propres à la
culture. La force d’une économie innovante tient à la capacité
d’apprentissage collectif, qui se définit dans les réseaux
sociaux et dans le sentiment d’une appartenance commune.
Sur le plan programmatique, trois orientations sont à privilé-
gier : 1) L’indépendance énergétique; 2) Le transport et les
infrastructures de transport collectif; 3) La valorisation de la
recherche et de l’innovation en redonnant à la fonction
publique ses compétences, en recentrant l’université sur sa
fonction critique et en introduisant un ensemble de mesures
visant à rehausser le niveau de compétence civique.
La question centrale des réservoirs d’épargne
Sur la question de l’indépendance énergétique, on aurait inté-
rêt à s’Inspirer de modèles, comme celui de la Norvège. Ce
pays a développé un modèle de perception des redevances qui
lui assure 80 % de la valeur produite par l’exploitation d’une
ressource naturelle. « Cependant, avertit l’économiste de
l’IRÉC, l’indépendance énergétique ne se construit pas seule-
ment par une substitution d’importation en remplaçant un
intrant par un autre. Il faut une stratégie d’industrialisation
pour permettre de développer un ensemble de filières ».
Enfin, la question fondamentale pour y parvenir est encore
celle du contrôle des réservoirs d’épargne. « Il faut reconnecter
les grands instruments de la Révolution tranquille comme la
Caisse de dépôt sur leur mission de soutien au développement
de l’économie du Québec et renoncer à la spéculation pour
mieux soutenir l’économie réelle », conclut le directeur général
de l’IRÉC.
* http://interventionseconomiques.revues.org/1496
L’UNISSON · AUTOMNES 2012 5
Sommation à tous les
cons consommateurs
Par Mélanie Roy*
J’aimerais comprendre pourquoi
Vous continuez de tant consommer, gang de
cons consommateurs
Conditionnés à posséder
Convaincus que vous êtes constamment contraints
De tout avoir, acheter, accumuler
La grosse baraque, la télé plate
Le gazebo, les vacances sur le gros paquebot
Pis l’abri tempo pour les deux gros chars pis la moto sport
Pis ça s’arrête pas là
Y’a le MP3, le IPhone, le IPod, le IPad, le portable
Les souliers dernier cri, la sacoche Gucci
En avoir toujours plus pour toujours moins
Sans rééchir aux conséquences de ces soit disant besoins
C’est tu ça la vie?
Pis pendant que vous vous relaxez
Dans votre solarium
Avec votre expresso, capuccino, mokaccino, apuccino
Avec votre laé fait de café au goût corsé ou velouté
Est-ce qui vous arrive de penser
Que ces grains ont un goût amer pour celui qui les a cultivés?
Celui qui a travaillé comme un bœuf
Pour une maigre pitance, sa subsistance, son existence
Celui qui doit en faire toujours plus pour toujours moins
Sans savoir si y’aura quequ’chose à manger le lendemain
C’est tu ça la vie? Non, ça c’est la survie
Réveillez-vous! Gang de cons consommateurs
Constatez les contrastes
Consternez-vous devant les injustices
Prenez conscience des conséquences de vos choix
Et considérez des comportements plus responsables
Consommez moins, pour un monde plus vert
Consommez mieux, pour un monde plus juste
De la garde-robe au garde-manger En passant par les jouets de
bébé
Y’a des alternatives à envisager
Parce que dans l’fond, vous pensez pas que la vie
C’est d’orir, pas d’acheter
C’est de partager, pas d’accumuler
Que la vie c’est être, pas avoir
* Dans le cadre d’une initiative de l’AQOCI pour souligner la Semaine du
développement international, un concours de Slam a été organisé.
Mélanie Roy a gagné le prix du public et une mention spéciale du jury.
Pour visionner ce slam : http://www.goodnesstv.org/fr/aqoci-
sdi/?v=48627
(L’économie : suite de la page 4)
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%