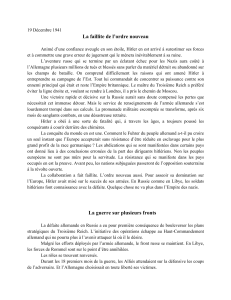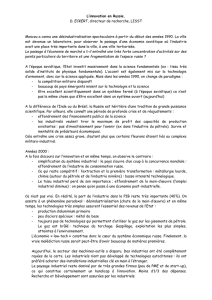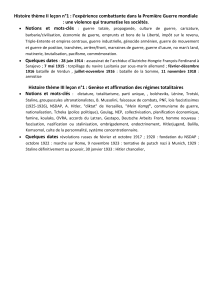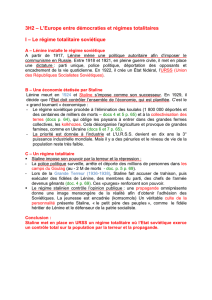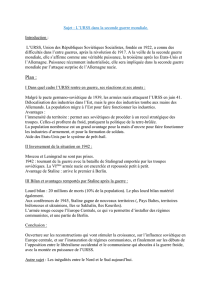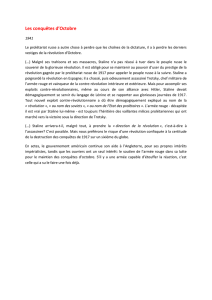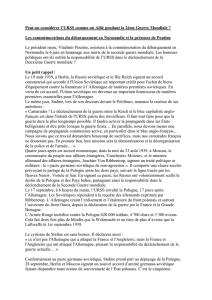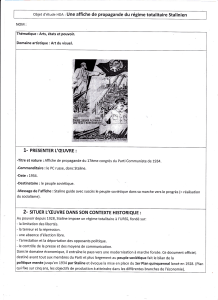1941-1945 - NowLedge Tech


NICOLAS BERNARD
LA GUERRE GERMANO-SOVIÉTIQUE
1941-1945
TALLANDIER

Sommaire
Couverture
Titre
Copyright
Table des cartes
Préface, par François Kersaudy
Introduction
I. - « Un rébus enveloppé dans un mystère »
II. - « Minuit dans le siècle »
III. - « Le Russe est inférieur »
IV. - « Le Russe est un colosse, il est tenace »
V. - « Les bolcheviques ont de la chance : Dieu est de leur côté ! »
VI. - « Nous sommes les seigneurs de ce pays »
VII. - « Le Russe est fini ! »
VIII. - « Stalingrad, fosse commune »
IX. - « Le tiers-monde plus le T-34 »
X. - « La patrie socialiste est en danger ! »
XI. - « L’étrange alliance »
XII. - « La lutte véritable ne fait que commencer »
XIII. - « La Russie vengeresse avance »

XIV. - « Un sort effroyable »
XV. - « La victoire se trouve dans la direction opposée »
XVI. - « Le monde ne tremblera pas de peur »
XVII. - « Un rideau de fer tombera »
XVIII. - « L’Allemagne est une sorcière ! »
XIX. - « Berlin écrasé, mis en miettes, haché, mutilé »
XX. - « Que feras-tu après la guerre ? »
Épilogue - Guerres de mémoires autour du conflit germano-soviétique
Conclusion
Notes
Bibliographie
Index
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%