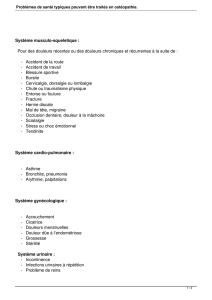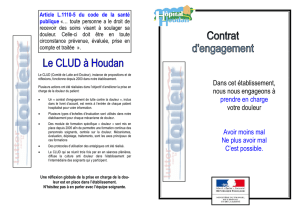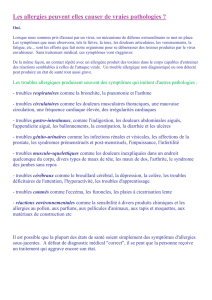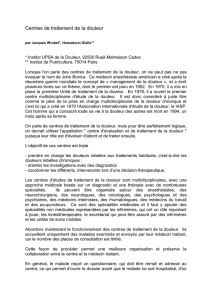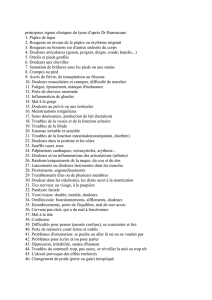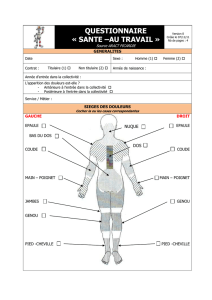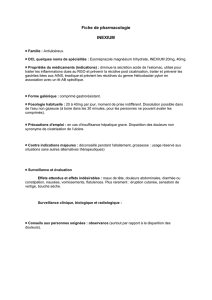Les douleurs ORL - autismes et potentiels

www.institut-upsa-douleur.org
JANVIER 2013
14
n° la douleur
DES RECOMMANDATIONS À LA PRATIQUE
DOSSIER P. 1-6
Les douleurs ORL
• Les infections
naso-sinusiennes
• Les douleurs pharyngées
• Les otalgies
FOCUS P. 7
• Douleurs et sclérose
en plaques
BRÈVES P. 8
DANS CE
NUMÉRO
La douleur d’une sinusite est bien connue, que la
sinusite soit aiguë ou chronique, limitée à un sinus
ou diffusant dans toute la face, liée à une affection
virale ou bactérienne. Une exploration clinique,
endoscopique, bactériologique et l’imagerie (scan-
ner le plus souvent) vont conduire au diagnostic et
guider l’attitude thérapeutique.
Les douleurs vont varier en fonction du sinus atteint.
Elles sont le plus souvent pulsatiles, accentuées par
la position tête penchée en avant, et la pression au
niveau de la paroi antérieure du sinus.
L’algie de la sinusite frontale est de topographie supra-
orbitaire unilatérale ou de l’angle interne de l’œil
2.
Elle est parfois accompagnée de larmoiement, de
photophobie. L’imagerie recherche une complication
méningo-encéphalique ou orbitaire. Dans la sinusite
« bloquée » hyperalgique, la rhinite est inaugurale,
sans écoulement nasal. Le traitement est local décon-
gestionnant, la nécessité d’une trépano-ponction est
exceptionnelle. La récidive lors d’un barotraumatisme
doit faire rechercher une malformation anatomique,
une pathologie d’environnement (tabac, poussière,
professionnelle…) ou de terrain (allergie, diabète, défi -
cit immunitaire…)
2,3. L’algie de la sinusite maxillaire
intéresse la région infra-orbitaire, unilatérale, irradiant
dans les dents sous-jacentes et l’orbite ; elle est cal-
mée par le mouchage, accentuée la nuit
3. Elle peut
être confondue avec les lésions dentaires qui peuvent
être causales. La sinusite chronique est en règle géné-
rale indolore, sauf lors des poussées.
Les douleurs ORL
Les douleurs ORL
Les douleurs ORL
M. Navez, A. David, A. Timochenko, C. Berger, J-M. Prades
Centre de la douleur, CHU Saint-Étienne
Service ORL, CHU Saint-Étienne
Service Pédiatrie, CHU Saint-Étienne
La pathologie ORL est fréquente en soins primaires et s’accompagne souvent de douleur.
Elle affecte aussi bien l’enfant que l’adulte. Elle est en lien avec des infections virales,
voire bactériennes, et va poser le problème de la prescription ou non d’antibiotiques.
Cependant, ces douleurs ORL peuvent être d’autres origines, en particulier liées à des
atteintes et projections des organes voisins (pharyngo-larynx ou articulation temporo-
mandibulaire sur l’oreille), des lésions carcinologiques (cancer pharyngo-laryngé) ou
d’origine névralgique (nerf glossopharyngien). Nous nous limiterons aux pathologies
les plus fréquentes rencontrées en soins primaires, à savoir les affections rhino-
sinusiennes, pharyngo-laryngées, et l’otite moyenne de l’enfant.
Les infections naso-sinusiennes
La sinusite est souvent le premier diagnostic évoqué par les patients et leurs médecins devant
une douleur faciale
1. Ces douleurs de « sinusite » peuvent être d’étiologie différente, directe-
ment en lien avec une infection naso-sinusienne, ou sans cause infectieuse avérée et plutôt
liée à « un déséquilibre trigéminé-sympathique » impliquant les structures avoisinantes.
UPSA-Douleur Reco Pratique-n14 BAT.indd 1 25/01/13 11:50

La douLeur, des recommandations à La pratique • n°14 • JanVier 2013
DOSSIER
2
L’algie de la sinusite sphénoïdale se caracté-
rise par des douleurs profondes, postérieures
de topographie rétro-orbitaire (2/3 des cas)
nucale ou frontale (1/3 des cas). Souvent
violente et paroxystique, elle peut s’accom-
pagner de troubles vasomoteurs (rhinorrhée,
congestion nasale, larmoiements, rougeur de
l’hémiface). Les troubles ophtalmologiques
comme la baisse de l’acuité visuelle, l’ampu-
tation d’un champ visuel, l’œdème au fond
d’œil font redouter une complication intra-
crânienne 4.
L’algie de la sinusite ethmoïdale est très fré-
quente chez l’enfant, fronto-orbitaire, vive et
paroxystique, accentuée par la pression de
l’angle interne de l’œil (signe de Grunwald),
associée à un œdème palpébral, des signes
généraux (fi èvre à 40°, prostration…) et
d’une rhinorrhée purulente. La douleur accrue
par la pression du globe ou lors de mouve-
ment oculaire doit faire évoquer d’emblée une
complication orbitaire sous-jacente et appelle
un traitement en urgence.
■ Les traitements
Le traitement de ces algies naso-sinusiennes
aiguës (le plus souvent virales, voire bacté-
riennes) comporte les traitements étiologiques
de la sinusite (antibiotiques, décongestion-
nants des muqueuses nasales et sinusiennes,
corticoïdes par voie locale ou générale, muco-
lytiques, lavages de nez voire des gestes
chirurgicaux à type de ponction) et les traite-
ments symptomatiques, dont les antalgiques
et les anti-infl ammatoires.
Lors des sinusites virales accompagnant les
rhinites liées au froid (coryza), l’antibiothérapie
est inutile
5 et comporte un risque d’induire
des effets indésirables (allergie, diarrhée,
résistance), elle n’est pas recommandée de
manière systématique en soins primaires chez
les patients dont l’immunité est considérée
comme normale.
Les médicaments à visée anti-inflammatoire
diminuent le syndrome d’obstruction nasale
et réduisent ainsi la douleur comme la cor-
ticothérapie per os, associée aux antibio-
tiques, avec des effets indésirables modérés.
Elle n’a jamais été évaluée en administration
isolée sans antibiotiques 6. Les résultats rap-
portés par voie nasale sont modestes sur les
symptômes sinusiens, mais cette voie peut
toutefois être proposée. La mometasone
furoate (Nasonex) 400 mg versus 200 µg est
plus efficace
7. L’usage des décongestion-
nants et des antihistaminiques chez l’enfant
ne semblent pas apporter de bénéfice
8. Les
lavages de nez avec des solutions salines,
réalisés plusieurs fois par jour, améliorent
les symptômes naso-sinusiens, quel que soit
le produit choisi
9. La vitamine C (0,2 g ou
plus) peut avoir un effet très modéré sur la
durée des symptômes, mais insuffisant pour
recommander son utilisation prophylactique
en routine lors des coryzas
10. Les médica-
ments à base de zinc n’ont pas démontré
leur efficacité contre placebo 11.
Dans la sinusite chronique, bien que l’infection
fongique soit incriminée, l’impact d’un traite-
ment fongique systématique ou préventif n’est
pas démontré 12. Les corticoïdes locaux par voie
nasale réduisent les symptômes naso-sinu-
siens des sinusites chroniques sans polypes 13.
■ Le cas des algies faciales
sans sinusite
Les algies faciales sans sinusite sont des
douleurs évoquant un déséquilibre trigéminé-
vasculaire. Elles se distinguent des céphalées
neurologiques comme la migraine ou l’algie
vasculaire de la face associant douleur périor-
bitaire intense, larmes, rhinorrhée et syn-
drome de Claude Bernard Horner survenant
de manière périodique, le plus souvent chez
l’homme. Les céphalées récurrentes, altérant
la vie quotidienne et celles spontanément
résolutives associées à des symptômes rhi-
nologiques sont probablement des migraines.
Si les symptômes rhinologiques sont pré-
pondérants et associés à des maux de tête,
leur expertise sur le plan rhinologique élimine
une pathologie ORL sous-jacente (endoscopie
nasale, importance du TDM). Les céphalées
avec fi èvre et écoulement nasal purulent sont
probablement d’origine rhinologique 14.
En dehors d’un contexte infectieux, les dou-
leurs décrites après chirurgie naso-sinusienne
(quelques fois violentes après ethmoïdectomie
et faisant parfois craindre une brèche dur-
mérienne) sont liées à des lésions nerveuses
périphériques du sinus maxillaire opéré. Elles
sont de type « neuro-vasculaire », secondaires
Critères de diagnostic
Critères de diagnostic d’une affection
naso-sinusienne selon l’American
Academy of Otolaryngology
Head and Neck Surgery
Critères rhinosinusite
International Headache Society
Critères majeurs Critères mineurs
Pus dans les fosses
nasales Céphalées posturales
A : Céphalée frontale et une ou plus
localisation faciale, oreilles, dents + critères
C ou D
Douleur faciale à la
pression, plénitude,
congestion nasale
Halitoses, cacosmie
B : Examen clinique, endoscopique,
imagerie ou biologique en faveur d’une
infection aiguë ou chronique rhinosinusienne
Obstruction nasale,
Rhinorrhée purulente Fatigue, asthénie
C : Céphalée et douleur faciale apparues
en même temps que le début de la sinusite
aiguë
Fièvre si sinusite
aiguë seulement
Douleur dentaire/
Otalgie
D : Céphalée et/ou douleur faciale améliorée
en moins de 7 jours après traitement
effi cace sur la sinusite aiguë ou chronique
Hyposmie, anosmie Toux
E : Signes cliniques évidents : pus dans la
cavité nasale, obstruction nasale, hyposmie,
anosmie et/ou fi èvre.
Au total, lors d’une sinusite
aiguë les traitements propo-
sés pour traiter les symptômes
naso-sinusiens et réduire
la douleur sont les soins
locaux (lavage de nez eau
salée, corticoïdes locaux), les
antalgiques (paracétamol, anti-
inflammatoires stéroïdiens).
L’antibiothérapie n’est proposée
que devant une surinfection.
3
UPSA-Douleur Reco Pratique-n14 BAT.indd 2 25/01/13 11:50

2 3
DOSSIER
à la lésion du nerf infra-orbitaire ou de ses
branches et associent des troubles vasomo-
teurs et sécrétoires : rhinorrhée, larmoiement,
rougeur et œdème cutané… Le traitement
associe antidépresseurs, anti-épileptiques,
voire des blocs anesthésiques locaux 3.
Les céphalées du
« vacum sinus »
de Sluder sont
liées à l’obstruction mécanique aseptique du
canal naso-frontal, responsable d’une dépression
douloureuse du sinus frontal avec un œdème
secondaire de la muqueuse. Ces douleurs orbito-
frontales sont exacerbées lors de l’accommoda-
tion visuelle rapprochée. L’imagerie doit éliminer
une sinusite chronique éthmoïdo-frontale 3.
Les céphalées « nasales » sont des douleurs rap-
portées à un contact muqueux entre les cornets
et le septum, une déviation septale ou un éperon
endonasal, une
concha bullosa
, sans sinusite
systématisée. Ces anomalies déclencheraient
la sécrétion locale de neuropeptides algogènes
– d’où les céphalées 14 – mais ont pu être rappor-
tées en dehors de tout contexte algique1. L’appli-
cation sous contrôle endoscopique d’un mélange
anesthésique local ou de capsaicine sur la zone de
confl it muqueux doit réduire les douleurs avant de
proposer une chirurgie correctrice 15. Ce concept
de céphalées nasales est controversé 16.
Le traitement proposé va comporter des anti-
biotiques dans 70 à 80 % des cas alors qu’ils
ne sont indiqués que dans les infections à
streptocoques. Une plus large utilisation du
test de diagnostic rapide antigénique devrait
permettre d’identifi er les patients susceptibles
d’en bénéfi cier 18.
Les plaintes au cours des infections pharyn-
gées sont la douleur, les troubles de déglutition,
et l’odynophagie. L’origine amygdalienne est
fréquente mais non exclusive 19.
■ Origine amygdalienne
La douleur est fréquente dans les atteintes de
l’amygdale, d’origine infectieuse ou tumorale.
Elle est aggravée par la déglutition et s’asso-
cie à une otalgie homolatérale d’irradiation. La
dysphagie accompagne très souvent la douleur.
Elle est à distinguer du
« globus pharyngeus »
ressenti comme une sensation de blocage pha-
ryngé vis-à-vis de la salive, moins souvent pour
les aliments et en rapport avec un spasme du
muscle crico-pharyngien secondaire à un refl ux
gastro-œsophagien, un diverticule, ou surtout
le stress 20.
L’odynophagie est une diffi culté de déglutition
en rapport avec la douleur, elle est fréquente
au cours de l’amygdalite, et particulièrement
intense en cas de carcinomes. D’autres signes
peuvent alors s’associer comme le trismus, une
déviation à la protraction linguale, une dyspnée
laryngée trachéale, une paralysie des nerfs crâ-
niens (X, XII, IX), des adénopathies cervicales
traduisant l’évolution carcinomateuse.
Les atteintes infectieuses aiguës de l’amyg-
dale, appelées aussi pharyngite aiguë ou
angine sont des infl ammations de l’amygdale
palatine (tonsille). Les angines non spécifi ques
sont d’origine virale dans les deux tiers des
cas (adénovirus, rhinovirus, virus infl uenza,
para-infl uenza, virus respiratoire syncytial,
herpès…). Les étiologies bactériennes ne
représentent qu’un tiers des cas et sont dues
le plus souvent aux streptocoques du groupe
A (20 à 30 % des angines en milieu scolaire),
mais aussi
haemophilus infl uenzae
ou
myco-
plasma pneumoniae
. Certains tableaux sont
plus sévères mais plus rares comme l’angine
de Vincent (agents anaérobies) ou au décours
d’une scarlatine, tularémie ou diphtérie 3 ou lors
de pathologie maligne (lymphome non hodgki-
nien) ou par infection VIH.
Les angines peuvent se compliquer d’abcès
péri-tonsillaires ou parapharyngés, suppuration
unilatérale développée autour de la capsule
amygdalienne œdématiée et refoulée avec un
voile bombé et de nombreuses adénopathies.
Elle est accompagnée de fi èvre, de douleur
intense, de trismus, de déglutition diffi cile. Le
streptocoque bêta hémolytique du groupe A
est souvent en cause. Chez l’enfant, l’abcès
rétro-pharyngé est secondaire à une infection
du tractus respiratoire supérieur. Le drainage
chirurgical des collections péri-pharyngées
confi rme le diagnostic, permet les prélève-
ments bactériologiques et par sa fonction éva-
cuatrice soulage rapidement les symptômes.
Elle est associée à l’antibiothérapie et aux
antalgiques, les anti-infl ammatoires pouvant
favoriser la survenue d’abcès péripharingés.
Les pharyngites chroniques ou amygdalites
chroniques sont d’étiologies diverses et pas
toujours caractérisées. Elles peuvent être
associées à des altérations de la muqueuse
pharyngée comme l’hyperplasie amygda-
lienne (rétention cryptique de débris épithéliaux
surinfectés : caséum…), à des mycoses, une
pharyngite sèche du syndrome de Gougerot ou
secondaire aux traitements psychotropes, voire
un carcinome muqueux. Les algies pharyngées
isolées sans altération muqueuse peuvent être
en rapport avec un
« globus pharyngeus »
,
c’est un diagnostic d’élimination de toutes les
autres pathologies, en particulier carcinologique.
Les traitements proposés au cours des pharyn-
gites aiguës ont fait l’objet de plusieurs études
et analyses dans la littérature.
■ Les traitements
Une méta-analyse récente à propos de la dou-
leur pharyngée montre que l’ibuprofène et le
paracétamol sont plus effi caces que le pla-
cebo. Sur trois essais randomisés chez l’adulte
(N = 346) et deux en pédiatrie (N = 347)
400 mg ibuprofène 3 fois/jour (10 mg/kg chez
l’enfant) sont plus effi caces que le paracétamol
(dose 1 g 3 fois/jour ou 15 mg/kg chez l’enfant) 21.
Les antibiotiques sont effi caces sur la douleur
de pharyngite à 3 jours/placebo mais avec des
résultats plus modestes à 7 jours et surtout
dans le groupe pharyngite à streptocoques
22.
En population pédiatrique, le scoring clinique
avec test antigénique est plus bénéfi que (rap-
port coût/effi cacité) que le traitement antibio-
tique d’emblée 23.
Les douleurs pharyngées
À partir de différentes méta-
analyses pour le traitement de
la pharyngite aiguë en soins
primaires, il est recommandé :
l’ibuprofène et/ou le paracé-
tamol en première intention,
les médicaments à usage local
(gargarismes avec eau salée,
pastilles à sucer contenant des
anesthésiques locaux), l’alimen-
tation et les boissons douces,
tièdes voire froides ou même
glacées. Les antibiotiques pour
les pharyngites streptococ-
ciques sont prescrits si l’infec-
tion est confi rmée par un test
antigène streptococcique 28.
Les douleurs pharyngées aiguës sont un motif de consultation fréquent en
soins primaires. Elles sont le plus souvent d’origine virale mais les infections
bactériennes liées aux streptocoques B-hémolytiques représentent 15 à 30 %
des cas chez l’enfant et 5 à 15 % des cas chez l’adulte 17.
UPSA-Douleur Reco Pratique-n14 BAT.indd 3 25/01/13 11:50

La douLeur, des recommandations à La pratique • n°14 • JanVier 2013
DOSSIER
4
L’effi cacité de la corticothérapie est plus miti-
gée dans les populations adulte et enfant où
ils ont toujours été administrés conjointement
avec les antibiotiques
24. Ils diminuent préco-
cement la douleur avec un résultat modeste à
24 heures (diminution de seulement 0,9 point
sur l’EVA) et une meilleure réponse dans le
groupe pharyngite à streptocoques, et avec des
effets indésirables identiques 25. Leur utilisation
systématique en soins primaires est discutée
et pourrait être réservée aux angines graves
(trismus, phlegmon) 26.
Les pastilles à sucer ayant des propriétés anal-
gésiques (amylmetacresol, dichlorobenzyl alco-
hol) sont effi caces sur la douleur pharyngée, et
les diffi cultés de déglutition 27 de même que les
pastilles avec lidocaine 28. En revanche, l’usage
des plantes médicinales chinoises et la supplé-
mentation en zinc n’apportent aucun bénéfi ce
sur la douleur pharyngée 29.
Le traitement de choix de l’amygdalite chronique
reste l’amygdalectomie chirurgicale en réduisant
les risques de pharyngite chronique diffuse.
Les otalgies
■ Priorité à la prise en charge
de la douleur
Le traitement de la douleur doit être une priorité
dans la prise en charge de l’otite de l’enfant. Les
dernières recommandations de l’Association
Américaine de Pédiatrie
30 sont claires : après
avoir fait le diagnostic d’otite moyenne aiguë
(OMA), et avant de discuter une antibiothérapie
éventuelle, il faut en premier lieu soulager l’en-
fant :
« Recommandation 2 : la prise en charge
de l’OMA doit comprendre une évaluation de la
douleur. Si la douleur est présente, le praticien
doit prescrire un traitement antalgique »
. C’est
la seule recommandation, de ce consensus,
classée comme
« strong »
(avec un niveau de
preuve important).
Le diagnostic d’otite moyenne aiguë repose
indispensablement sur un examen otosco-
pique. Les signes otoscopiques sont l’infl am-
mation (congestion ou hypervascularisation
tympanique) associée à un épanchement rétro-
tympanique, extériorisé (otorrhée) ou non exté-
riorisé (opacité, effacement des reliefs normaux
ou bombement) 31.
La prise en charge de la douleur et son évalua-
tion sont indispensables. La douleur est mieux
prise en charge quand elle est évaluée initiale-
ment et quand le traitement est régulièrement
réévalué 32. Les outils d’évaluation sont adap-
tés à l’âge de l’enfant. Simples d’utilisation,
ils peuvent être remis aux parents afi n de leur
permettre de réévaluer eux-mêmes la douleur
et d’adapter le traitement antalgique.
■ Les traitements
Le traitement de la douleur de l’otite moyenne
aiguë est essentiel, surtout dans les premières
24 heures, avant de discuter le traitement
antibiotique 30.
En première intention, on propose un antalgique
de palier 1 de type paracétamol à dose effi cace et
sous une forme adaptée à l’enfant : paracétamol :
15 mg/kg toutes les 6 heures . La forme orale est à
privilégier si elle est possible. Les différentes formes
disponibles sont : paracétamol sirop (1 dose par
kilogramme toutes les 6 heures), les suppositoires
ou comprimés (pour l’enfant plus grand).
En deuxième intention, si la douleur persiste
malgré le paracétamol, il est possible d’associer
un antalgique de palier 2 à base de codéine très
effi cace sur les otalgies de type Codenfan
®.
La posologie du Codenfan est de 0,5 mg/kg
toutes les six heures. Il est alors plutôt conseillé
d’alterner les prises de paracétamol et de
codéine, ce qui permet une meilleure couver-
ture de la douleur sur la journée avec la pos-
sibilité d’administrer ainsi un antalgique toutes
les trois heures.
Les recommandations de l’ANAES32 préconisent :
- pour une EVA < 5/10 : la prescription d’un
antalgique de palier 1 pendant 48 heures et,
si échec, la codéine ;
- pour une EVA > 5/10 : les antalgiques de
palier 1 associés d’emblée à la codéine.
L’utilisation d’anti-infl ammatoires non stéroïdiens
est à éviter autant que possible et n’est pas ano-
dine. Elle n’est pas recommandée par l’AFSSAPS :
«
Dans cette pathologie, l’utilité des anti infl am-
matoires non stéroïdiens à doses anti-infl amma-
toires et des corticoïdes n’est pas démontrée
» 31.
«
Dans le traitement symptomatique des OMA,
une des rares études évaluant l’effi cacité de
l’ibuprofène versus le paracétamol concluait à
une équivalence entre les deux traitements
34
. Les
effets indésirables de l’ibuprofène chez l’enfant
sont plus fréquents que ceux du paracétamol
» 35.
Les indications d’antibiothérapie varient avec
l’âge. Chez l’enfant de moins de deux ans,
l’antibiothérapie est recommandée d’emblée.
Après deux ans, l’antibiothérapie n’est pas
systématiquement recommandée, sauf en cas
de symptomatologie bruyante (fi èvre élevée,
otalgie intense). Le choix de l’abstention doit
s’accompagner d’une réévaluation de l’enfant
à 48-72 heures sous traitement symptoma-
tique 31. Le traitement antipyrétique est assuré
par le paracétamol.
Le recours à la paracentèse peut
être recommandé dans certains
cas après, bien entendu, l’avis
d’un spécialiste ORL. L’effi ca-
cité des anesthésiques locaux
n’est pas démontrée dans
l’OMA et ils n’ont qu’un effet
de courte durée. Aucune étude
n’a démontré l’effi cacité des
traitements homéopathiques.
Il a été montré que la plupart
des enfants souffrant d’une otite
ont une douleur intense, le plus
souvent sous-estimée et insuf-
fi samment traitée ; l’utilisation
d’échelles d’évaluation est pos-
sible à domicile pour adapter le
traitement par les parents.33
Il faut également prendre en
compte la suppression des
foyers infectieux dentaires et
sinusiens, le traitement d’un
refl ux gastro-œsophagien docu-
menté, d’un dysmétabolisme,
d’un terrain anxio-dépressif
et cancérophobe. La crénothé-
rapie (cures thermales) face à
une pharyngite chronique atro-
phique ou congestive rebelle
peut également être proposée.
5
Les otalgies sont d’origines diverses en lien direct avec une pathologie d’oreille
(externe, moyenne ou interne) ou projetées à l’oreille. Les otalgies sont réper-
toriées sur le schéma (page 5). Celles en lien avec l’otite moyenne aiguë sont
particulièrement fréquentes chez l’enfant et seront seules détaillées. Les otal-
gies en lien avec le cancer ont fait l’objet de plusieurs publications.
UPSA-Douleur Reco Pratique-n14 BAT.indd 4 25/01/13 11:50

45
DOSSIER
OREILLE MOYENNE
• Otalgies +++
• Otite moyenne aiguë
TYMPAN
• Myringite bulleuse/Perforation
• Otite barométrique :
Otalgie ++ Surdité
• Tumeur oreille
OREILLE EXTERNE
• Otite externe
• Furoncle
• Nécrosante
• Mycose
PAVILLON DE
L’OREILLE
• Othématome
• Zona du ganglion
géniculé
• Carcinome
spinocellulaire
OTALGIE PROJETÉE À PARTIR DU PHARYNGO-LARYNX
• Infection (angine, pharyngite, phlegmon)
• Tumeur pharyngo-larynx
• Otalgie projetée à partir d’un désordre temporo-mandibulaire
OTALGIE D’ORIGINE NÉVRALGIQUE
• Nerf glossopharyngien (névralgie essentielle, cancer ORL +++)
• Nerf intermédiaire de Wrisberg (zona du ganglion géniculé)
OREILLE
EXTERNE
PAVILLON
OREILLE
MOYENNE
TYMPAN
OREILLE
INTERNE
Otalgies
En conclusion
Les douleurs ORL sont fréquentes, diverses, et peuvent répondre aux antalgiques de niveau 1 et 2, voire à des stratégies antibiotiques
et anti-infl ammatoires bien codifi ées. Elles sont à distinguer des douleurs faciales neurologiques comme la migraine, également très
fréquente, qui répond à des traitements spécifi ques. Elles nécessitent un examen adapté pour éliminer toutes les complications possibles
(méningées) et, surtout, l’étiologie carcinologique. L’essentiel est de bien comprendre que le traitement de la douleur ne doit s’envisager
que dans le cadre d’un diagnostic étiologique.
UPSA-Douleur Reco Pratique-n14 BAT.indd 5 25/01/13 11:50
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%