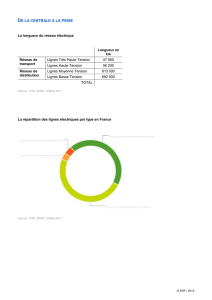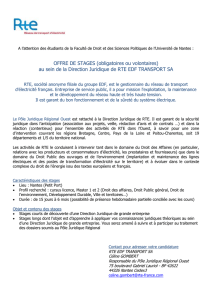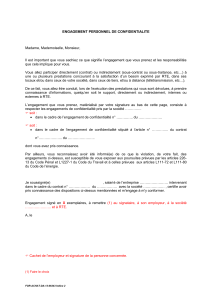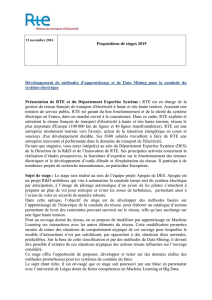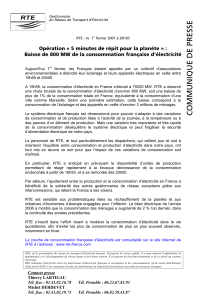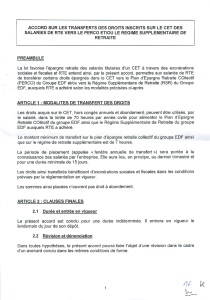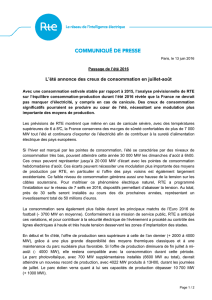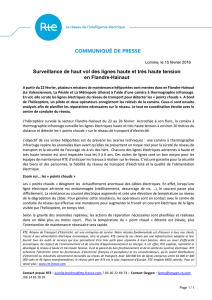le réseau de transport d`électricité au cœur de la transition énergétique

Anticiper - Innover pour développer le réseau électrique de demain, en France et en Europe - P. 2 | Gérer - Les enjeux de RTE pour le réseau
d’aujourd’hui et de demain - P. 3 | Innover - Plus d‘intelligence pour plus de flexibilité - P. 4 |
MARDI 20 JANVIER 2015
SUPPLÉMENT PARTENAIRE
En tant qu’opérateur du réseau de transport d’électri-
cité à haute et très haute tension, RTE joue, depuis
sa création en 2000, un rôle très actif au sein de
l’Europe de l’électricité. Grâce à son expertise et son savoir-
faire, tant au niveau des infrastructures qu’au niveau des
flux électriques et de l’organisation du marché de l’électri-
cité, RTE contribue tous les jours à l’accomplissement de
la politique européenne de l’énergie et à la mise en œuvre
de la transition énergétique.
RTE adapte son offre en continu pour répondre aux
exigences de ses clients – qu’ils soient producteurs,
distributeurs, industriels ou négociants – et leur fournir
en permanence un accès économique, sûr et propre à
l’électricité. Ainsi, en assurant la qualité et la continuité de
l’alimentation électrique et en offrant des services adaptés
aux besoins de ses clients, RTE participe activement au
maintien de la compétitivité des industries françaises et
européennes.
Répondre aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui
et de demain
Maillon essentiel des politiques énergétiques, les réseaux
électriques européens sont à l’intersection de trois enjeux
majeurs : la sécurité d’approvisionnement, la compétitivité
de l’économie européenne et la lutte contre le changement
climatique. En faisant de 34 pays la zone électrique la plus
large du monde, les interconnexions électriques jouent
également un rôle clé dans le développement des énergies
renouvelables en optimisant l’utilisation des différents
parcs de production installés à travers le continent. Loin
d’être figé dans le temps ou dans l’espace, le déséquilibre
entre zones productrices et zones consommatrices d’élec-
tricité peut s’inverser au cours d’une journée, au fil des
saisons ou bien dans l’année.
La mutualisation des moyens de production et la com-
plémentarité des sources d’énergie permettent alors de
gérer intelligemment l’équilibre avec les besoins de con-
sommation à travers l’Europe et d’assurer, à tout moment,
la livraison d’une énergie sûre et fiable. En permettant aux
entreprises d’accéder à chaque instant aux sources de
production énergétique les plus performantes et les moins
chères, le réseau européen d’électricité favorise activement
le développement du tissu industriel.
Réussir la transition énergétique et maintenir la
compétitivité des entreprises
Les différents articles de ce dossier visent à mieux faire
connaître les divers enjeux liés à la construction du
réseau européen d’électricité, à expliquer l’ajustement de
l’équilibre entre l’offre et la demande à travers le continent
et à mettre en lumière les différentes activités de RTE
pour faire vivre et évoluer le réseau électrique français
et européen. Acteur majeur dans la structuration d’une
filière d’excellence française spécialisée dans les réseaux
électriques intelligents, RTE contribue à la réussite de la
transition énergétique et à la compétitivité des entreprises.
Un engagement au service de l’économie et de l’énergie
européenne de demain.
LA PERFORMANCE DES RÉSEAUX ET L’INTELLIGENCE
ÉLECTRIQUE AU SERVICE DE L’ÉNERGIE DE DEMAIN
LE RÉSEAU DE
TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ
AU CŒUR DE
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
COMMUNIQUÉ
SUPPLÉMENT RÉALISÉ PAR RTE / LE RÉSEAU DE L’INTELLIGENCE ÉLECTRIQUE ET LES ECHOS MEDIAS
En haut : éoliennes dans l’Ouest de la France.
Au centre : Centre National d’Exploitation du Système électrique à Saint-Denis.
En bas : application mobile éCO2mix sur la consommation et la production électrique en France.
RTE en chires
105000 km de lignes et 47 lignes
transfrontalières pour connecter le
réseau français à 33 pays européens
Opérateur du réseau de transport électrique français à haute et très haute tension, RTE ore à ses clients
– producteurs, distributeurs, industriels et négociants – un accès économique, sûr et propre à l’électricité.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.rte-france.com
490 clients dont 135 acteurs
de marché, 54 producteurs
d’électricité, 258 consommateurs
industriels, 32 distributeurs et
11 entreprises ferroviaires
8500
salariés
MARC DIDIERCYRIL E NTZMANN
GUILLAUME MURAT

2COMMUNIQUÉ
INNOVER POUR DÉVELOPPER
LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE DEMAIN,
EN FRANCE ET EN EUROPE
Parmi les missions de service public
de RTE figure notamment la respon-
sabilité de proposer des modalités de
fonctionnement de marché. Mis en
place par RTE dès 2008, le recours
aux « effacements » repose sur l’en-
gagement d’un client – une entreprise
le plus souvent – à reporter ou réduire
temporairement sa consommation,
afin de soulager les tensions sur la
demande aux heures de pointe sans
avoir à mobiliser de moyens de pro-
duction supplémentaires.
Propriété du chimiste Solvay, le site
de Tavaux dans le Jura, qui produit
des polymères, est l’un des premiers
sites industriels français à avoir sous-
crit à ce processus. « En cas de besoin,
RTE peut nous demander de réduire
notre consommation électrique jus-
qu’à un maximum de 20jours dans
l’année », explique Gildas Barreyre,
Asset Manager au sein du groupe
Solvay. Lorsque c’est le cas, le site
de Tavaux est prévenu la veille de
l’opération.
Bien entendu, cet « effacement »
de consommation a une incidence
directe sur la production. « En cas
d’effacement, la production est ré-
duite ponctuellement. Le site revient
en quelques heures à un mode de
fonctionnement nominal », dévelop-
pe Gildas Barreyre. En contrepartie,
Solvay reçoit une rémunération
financière sous forme d’une prime
forfaitaire annuelle, ainsi que d’une
part variable, directement liée au
volume d’électricité effectivement
effacé. « Ce mécanisme a contribué à
réduire globalement la facture éner-
gétique du site de Tavaux », conclut
Gildas Barreyre.
TÉMOIGNAGE
DES INDUSTRIELS CONTRIBUENT
À L’OPTIMISATION DU SYSTÈME
12
Des logiciels de prévision
intelligents
LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION CONSTITUENT UNE AIDE
PRÉCIEUSE NON SEULEMENT POUR PRÉVOIR
PRODUCTION ET CONSOMMATION MAIS AUSSI
POUR GÉRER LES ÉCARTS ÉVENTUELS ENTRE
CES PRÉVISIONS ET LE TEMPS RÉEL.
EN FRANCE : IPES
IPES (pour « Insertion de la Production
Éolienne et photovoltaïque dans le
Système ») est un logiciel de prévision
de la production des parcs éoliens et
photovoltaïques en France. Développé par
RTE, en partenariat avec Météo-France,
IPES permet ainsi d’optimiser l’utilisation
des énergies renouvelables.
EN EUROPE : i-TESLA
i-Tesla (pour « Innovative Tools for Electrical
System Security within Large Areas ») est
un projet soutenu par l’Union européenne
et coordonné par RTE, visant à définir des
règles de sûreté pour optimiser l’exploitation
du réseau électrique interconnecté. Les
fortes variabilités attendues tant du côté
de la production avec l’intermittence des
ENR que du côté de la consommation (par
exemple avec le déploiement des véhicules
électriques) amènent RTE à traiter un
nombre croissant de données. Là où hier
quelques simulations suisaient à porter
un diagnostic sur la stabilité et la sûreté du
réseau, ce sont aujourd’hui des millions qui
sont nécessaires.
3
De nouveaux mécanismes
de marché innovants
LES MÉCANISMES DE MARCHÉ AGISSENT
SUR TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR DE
L’ÉLECTRICITÉ. CES MÉCANISMES CONTRIBUENT
À LA SÉCURITÉ D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE,
À L’OPTIMISATION ÉCONOMIQUE DU SYSTÈME
ET DONC À DE MEILLEURS PRIX POUR LES
CONSOMMATEURS.
EN FRANCE : L’EFFACEMENT
Parmi les récents mécanismes de marché
développés par RTE figure un mécanisme
valorisant l’eacement. Des équipements
consommant de l’électricité chez certains
clients, peuvent être momentanément
arrêtés, moyennant rémunération. Du point
de vue de l’opérateur du réseau électrique,
la non consommation est une solution
équivalant à la production d’électricité et qui
permet d’éviter des investissements dans
des moyens de production pour couvrir des
pointes de consommation.
EN EUROPE : LE COUPLAGE
DES MARCHÉS
Le couplage des marchés de l’électricité
permet aux sources d’électricité les plus
performantes partout sur le territoire
européen de répondre aux besoins des
consommateurs. Il permet des économies
significatives pour la collectivité évaluées
à plusieurs centaines de millions d’euros
par an pour toute l’Europe, ainsi qu’une
compétitivité accrue pour tous les
industriels européens.
Pour une utilisation
optimisée de
la production
éolienne et
photovoltaïque
Des prévisions de
production de l’éolien
et du photovoltaïque
jusqu’à 3 jours à
l’avance
Ajustement
dynamique
des capacités
du réseau
Station météo
et prévisions
locales de vent
Rémunérer
les acteurs pour
consommer moins
Impératif d’équilibrer
ore et demande
d’électricité en
temps réel
WCIE
CHRISTIAN42
ANTICIPER
FLUX ÉLECTRIQUES : exploiter le réseau
pour assurer l’équilibre entre l’ore et la
demande d’électricité
MARCHÉS : organiser et structurer les
marchés européens pour une optimisation
économique du système électrique
INFRASTRUCTURES : entretenir et adapter
le réseau pour orir un accès économique
sûr et propre à l’électricité
Focus sur l’expertise de RTE
Quelques exemples français et européens pour illustrer l’expertise de RTE
Des infrastructures
plus performantes
LES DÉSÉQUILIBRES ENTRE ZONES
PRODUCTRICES ET CONSOMMATRICES
S’INVERSANT SANS CESSE, LA PERFORMANCE
DU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
SERA JUGÉE À SA FACULTÉ À S’ADAPTER À
LA VARIABILITÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA
CONSOMMATION À TRAVERS L’EUROPE.
EN FRANCE : LE POSTE
ÉLECTRIQUE INTELLIGENT
Le poste électrique intelligent est une
installation de gestion dynamique de
l’énergie avec une station météo intégrée
pour prévoir une production éolienne
sensible aux variations météorologiques et
l’adapter aux besoins locaux .
EN EUROPE : BEST PATHS
Best Paths est un projet regroupant
38partenaires européens, opérateurs de
réseaux, industriels et universités avec
pour objectif commun de développer et
de démontrer l’eicacité de solutions
industrielles et novatrices pour que le
réseau de transport d’électricité européen
permette le développement massif
de la production d’énergie électrique
éolienne. Dans ce cadre, RTE pilotera un
démonstrateur essentiel dans le domaine
très prometteur des réseaux à courant
continu.

COMMUNIQUÉ
LES ENJEUX DE RTE POUR LE RÉSEAU
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Sur un même territoire, la
production d’électricité ne
coïncide pas avec les besoins
locaux de consommation. Le réseau
assure la solidarité électrique entre
les territoires. Ce concept de solida-
rité s’entend à l’échelle du quartier, de
la ville, de la région, du pays, de l’Eu-
rope. Incombe alors à l’opérateur du
réseau haute et très haute tension un
rôle de gestionnaire de flux, capable
d’anticiper creux et pointes, et d’uti-
liser la complémentarité des sources
d’énergie. C’est particulièrement vrai
avec le développement des énergies
renouvelables. La production d’élec-
tricité coïncide d’autant moins avec
les besoins locaux de consommation
qu’elle peut être tributaire des condi-
tions météorologiques : le vent pour
les parcs éoliens, comme le soleil
pour les panneaux photovoltaïques.
Les territoires européens ne sont
pas tous logés à la même enseigne :
l’ensoleillement est meilleur au Sud,
le vent plus fort à l’Ouest. Les énergies
renouvelables comme la géothermie
ou la biomasse offrent moins de
variabilité, la géothermie étant tou-
tefois circonscrite à certains bassins.
Les énergies marines, comme l’éo-
lien offshore, affichent elles aussi
davantage de constance, mais sont
exploitées dans des zones éloignées
des centres de consommation.
Le concept de foisonnement
Le réseau européen d’électricité per-
met de lisser la variabilité des sources
de production et les relatives inégali-
tés dans la répartition des gisements
d’énergie renouvelable. À travers lui,
le concept dit « de foisonnement»
peut pleinement s’exprimer: la météo
étant rarement la même à 500 km
d’écart, il y aura toujours un parc de
production d’énergie renouvelable
capable de pallier la production
qu’un autre parc distant n’aura pas
été capable de livrer.
Des différences culturelles
De son côté, la consommation d’élec-
tricité dépend non seulement des
conditions climatiques, mais aussi
des modes de vie et des habitudes
culturelles, de la densité du tissu
industriel ou encore de la dynamique
démographique d’une région. En
France, la pointe de consommation
du soir survient à 19h, mais en Alle-
magne, elle apparaît plus tôt compte
tenu des habitudes domestiques.
Là aussi, le réseau permet de tirer
bénéfice de ces différences culturelles
en couvrant les besoins par exemple
grâce à la production française. De
même, l’éolien et le photovoltaïque
allemands font bénéficier le reste de
l’Europe d’une électricité bon marché
lorsqu’elle est disponible.
Une électricité sûre et fiable
La variabilité de la demande est une
donnée à prendre d’autant plus en
compte qu’avec l’essor annoncé des
véhicules électriques, elle promet
d’être de plus en plus forte. En effet,
si des millions de voitures électriques
se mettent à circuler sur les routes
d’Europe, elles auront besoin d’être
rechargées régulièrement, et cela à
des moments et dans des lieux diffi-
cilement identifiables à l’avance. Là
aussi, le réseau et la gestion des flux
devront s’adapter. Loin d’être figé
dans le temps ou dans l’espace, le
déséquilibre entre zones productrices
et zones consommatrices d’électricité
peut donc s’inverser au cours d’une
journée, au fil des saisons ou bien
dans l’année. Or, comme elle est
difficile à stocker, l’électricité doit
être produite au moment où elle est
consommée.
La mutualisation des moyens de
production et la complémentarité des
sources d’énergie permettent alors
de gérer intelligemment la courbe
de consommation et d’assurer, à tout
moment, la livraison d’une énergie
sûre et fiable.
Acteur tant du système électri-
que que du marché de l’élec-
tricité, RTE développe des
outils qui assurent la compatibilité
entre les échanges commerciaux et
la sécurité d’alimentation électrique.
Par l’intermédiaire des bourses
européennes d’échanges d’électrici-
té, le couplage des marchés permet
d’utiliser au maximum les capacités
d’interconnexions pour optimiser
les sources de production d’électri-
cité disponibles. C’est le concept de
couplage des marchés. Mis au point
avec la participation active de RTE, le
couplage des marchés du Portugal à
la Scandinavie permet ainsi d’utiliser
les moyens de production selon leur
avantage économique, tout en optimi-
sant l’utilisation des infrastructures,
au bénéfice du consommateur et de
la collectivité.
Le mécanisme de capacité
Autre instrument de marché que RTE
a développé dans l’exercice de ses
missions : le mécanisme de capacité.
Certains moyens de production ne
sont utilisés que quelques heures
dans l’année, en cas d’extrême pointe
de consommation. Leur exploitation
n’est donc pas rentable. Néanmoins,
ils sont indispensables à la sécurité
d’approvisionnement. Fort de ce
constat, RTE a conçu un mécanisme
pour que le prix de l’électricité intègre
non seulement le prix de l’énergie
produite, mais aussi le service rendu à
la sécurité d’alimentation au moment
des pointes de consommation.
Un système innovant et souple
Ce service, rendu possible par le
mécanisme de capacité, a ceci
d’innovant qu’il peut s’effectuer en
mobilisant des moyens de production
ou d’effacement de consommation.
En effet, pour répondre à un déséqui-
libre entre offre et demande, on peut
démarrer de nouveaux moyens de
production ou demander à certains
clients d’interrompre momentané-
ment leur consommation.
RTE est moteur dans la valorisa-
tion de la flexibilité de la consom-
mation d’électricité et conçoit de
nombreux mécanismes permettant
sa modulation. Jusque-là cantonnés
au mécanisme d’ajustement, c’est-à-
dire aux équilibrages de très court
terme (d’une heure sur l’autre), les
effacements sont appelés à devenir
de vraies offres de marché. Pour
cela, il fallait des règles du jeu qui
permettent de considérer un efface-
ment de consommation sur le même
plan qu’une production d’électricité:
ce sont les NEBEF (Notifications
d’échange de blocs d’effacement). La
maîtrise de la puissance consommée
anime aussi l’esprit d’Ecowatt, un
dispositif consistant à sensibiliser
et à solliciter les consommateurs
résidant dans des zones fragiles
électriquement (Bretagne, Paca) lors
de situations tendues. Sur le principe
du volontariat, ceux-ci sont invités à
limiter leur consommation électrique
à réception d’un message d’alerte.
Cinq questions à Jean-Paul Roubin, directeur
du Centre National d’Exploitation du Système
électrique (RTE).
Comment pilote-t-on un réseau électri-
que de plus de 100 000 km ?
Jean-Paul Roubin : D’abord, en cherchant à
anticiper les situations. La prévision est au cœur
de l’expertise de RTE et couvre des échelles de
temps différentes : du long terme, lorsque nous
publions le Bilan Prévisionnel qui nous est
demandé par les pouvoirs publics. Il permet de
les éclairer sur les mesures à prendre pour sécu-
riser l’approvisionnement électrique. Du court
terme, quand nous discutons avec l’ensemble des
acteurs du système électrique des possibilités de
production et des évolutions vraisemblables de
la consommation pour établir des prévisions que
nous affinons au cours du temps.
Cet exercice prévisionnel, comment se
déroule-t-il ?
J.-P. R. : L’exercice démarre plusieurs mois à
l’avance, en élaborant des hypothèses de produc-
tion et de consommation, jusqu’à la veille pour
le lendemain. À tout moment, nous vérifions
que les moyens de production sont suffisants
et le seront pour l’heure qui suit et ajustons nos
prévisions en conséquence. Côté consommation,
nous nous basons sur des courbes historiques,
les données météo. Vient ensuite le temps réel:
nous observons l’électricité qui circule sur le
réseau, en collectant 60 000 informations qui
sont actualisées toutes les dix secondes. Nous
pouvons ainsi réagir au moindre déséquilibre.
Justement, comment réagissez-vous si
vous constatez un déséquilibre ?
J.-P. R. : Une indisponibilité fortuite (panne d’un
moyen de production, coup de foudre sur une
ligne) ne doit pas entraîner de surcharge sur
d’autres lignes, préjudiciable à l’alimentation en
électricité ou à sa qualité. La correction des écarts
est une composante importante du pilotage du
réseau. S’il faut mobiliser de nouveaux moyens de
production ou effacer des consommations, nous
déterminons les besoins nécessaires pour équili-
brer l’offre et la demande. Le marché sélectionne
alors la solution la plus performante sur le plan
économique pour permettre de régler les écarts.
Comment ce travail s’articule-t-il avec
celui des réseaux européens voisins ?
J-P. R. : L’interconnexion des réseaux permet
d’assurer la solidarité électrique entre les pays, de
mutualiser les moyens de production et les profils
de consommation. Elle nécessite coopération et
rigueur. En effet, si un déséquilibre survenait
quelque part en Europe, cela se ressentirait à
l’autre bout. Il est donc nécessaire de piloter
cette « plaque européenne» en commun. C’est la
mission de Coreso, un centre de coordination du
réseau ouest-européen mis en place à Bruxelles
par les opérateurs de réseau de transport français,
italien, britannique, belge et allemand. Cette
vision du système électrique au niveau suprana-
tional accompagne le couplage des marchés de
l’électricité. Si les signaux économiques envoyés
par le marché montrent qu’il est judicieux, parce
que c’est moins cher ce jour-là, de solliciter des
moyens de production français pour couvrir
la demande allemande, il est indispensable de
disposer d’une gestion coordonnée des réseaux.
Comment gérez-vous la variabilité de la
production d’origine renouvelable ?
J-P. R. : En faisant des prévisions, grâce à notre
logiciel IPES. Ensuite, en exploitation, nous nous
appuyons sur la complémentarité des sources
d’énergie à l’échelon européen. Prenons un
exemple : la France dispose d’un parc nucléaire
couvrant la consommation de base, l’Espagne
d’un parc de production éolienne et photovol-
taïque, une production qu’il faut utiliser même
si la demande espagnole n’est pas suffisante. De
plus, les pointes de consommation sont décalées:
vers 21 h en Espagne et 19 h en France... quand
il y a moins de soleil. Les besoins ne sont donc
pas forcément simultanés. Le réseau permet d’y
apporter une réponse : de l’électricité française
couvrira les pics espagnols, et vice-versa. La
nouvelle liaison souterraine en courant continu
à travers les Pyrénées qui sera inaugurée en 2015
permettra de renforcer ces échanges.
AVIS D’EXPERT
« ANTICIPER, PILOTER,
CORRIGER »
Pour orir à ses clients une électricité économique, sûre et propre, RTE exerce son expertise
non seulement pour gérer les flux électriques et organiser le marché de l’électricité, mais aussi
pour développer et entretenir les infrastructures.
ASSURER L’ÉQUILIBRE
OFFRE-DEMANDE
ORGANISER ET
STRUCTURER LE MARCHÉ
RTE
GÉRER 3
JEAN-LIONEL DIAS
OLIVIER ULRICH
Mission la plus connue de
RTE, l’accès à une alimen-
tation électrique de qualité,
partout et à tout moment, passe par
un entretien minutieux des 100 000
kilomètres et plus de lignes à haute
et très haute tension. Cette mainte-
nance, qui vise à faire vivre dans la
durée le patrimoine industriel en
le fiabilisant, se fait notamment à
travers des méthodes innovantes,
par exemple à l’aide de robots et de
drones pour les interventions sur les
lignes aériennes.
Assurer l’accès à une alimentation
électrique de qualité passe aussi
par l’adaptation du réseau. Pour
répondre aux préoccupations de
nos concitoyens et limiter notre
empreinte environnementale, il est
primordial de tirer le meilleur parti
des infrastructures existantes. Au-
trement dit, il s’agit d’innover pour
étendre leur durée de vie et accroître
leur contribution à la sécurité de
l’approvisionnement électrique. Les
transitions énergétiques engagées
en France et en Europe amènent à
accélérer le développement de nou-
velles infrastructures, tout en inté-
grant le mieux possible les ouvrages
dans l’environnement.
Un réseau interconnecté
Plus le réseau sera finement maillé
et interconnecté, plus il sera facile
de faire coïncider pointes et creux
de consommation avec pointes et
creux de production. Sans réseau,
une pointe de consommation locale
devrait être couverte par un renfort
de production locale, ce qui serait
extrêmement coûteux, et la plupart
du temps techniquement impossi-
ble. Mieux vaut alors solliciter des
moyens de production distants et
bon marché, y compris à l’étranger!
En décorrélant ainsi la géographie
de la consommation et celle de la
production d’électricité, le réseau
de transport d’électricité permet
d’atteindre un optimum économique
et limite le besoin en investissements.
Le réseau au service de la
sécurité d’approvisionnement
En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, par
exemple, le réseau en vient même à
jouer le rôle de « filet de sécurité » :
située en marge des grands bassins
de production d’électricité que sont
la vallée du Rhône et les Alpes, cette
région subit en hiver de fortes con-
sommations. Au lieu de construire
des centrales de production dont
l’utilité se limiterait sur une petite
période de l’année, la région s’appuie
sur le réseau: à charge pour celui-ci
d’acheminer toute l’électricité dont
elle a besoin, produite ailleurs, en
France et en Europe.
À l’écoute de la population
RTE a pris l’engagement de ne pas
augmenter le nombre de kilomètres
de lignes aériennes en France. Ainsi,
l’aménagement de la nouvelle ligne
Cotentin-Maine, longue de 163 km,
s’est accompagné de la suppression
et la mise en souterrain de 163 autres
kilomètres de lignes aériennes
ailleurs. À l’heure où les territoires
revendiquent une plus grande maî-
trise de leur environnement, la né-
cessité d’adapter le réseau s’ac-
compagne d’un dialogue et d’une
transparence renforcés. Publications
de données et d’analyses, développe-
ment constant sur la concertation
autour des projets, association des
acteurs concernés à la conception
de nouveaux services et outils, RTE,
monopole par nature, fait de la trans-
parence le moteur de sa performance.
ENTRETENIR ET ADAPTER
LE RÉSEAU
AGENCE HDA

INNOVER COMMUNIQUÉ
PLUS D‘INTELLIGENCE
POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ
Que ce soit côté production ou côté consommation, les réseaux électriques
intelligents ont vocation à faire évoluer le système électrique pour mieux
accompagner la transition énergétique.
Un réseau électrique, c’est beau-
coup de cuivre, mais aussi, et
de plus en plus, du silicium et
des fibres optiques : les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la com-
munication accroissent son intelligence,
afin de le rendre le plus réactif possible.
Les réseaux électriques intelligents, ou
« smart grids » comme on les appelle
en anglais, permettent d’intégrer et de
coordonner intelligemment les actions
entre tous leurs utilisateurs dans le but
de fournir une énergie électrique durable,
économique et sûre.
Le grand public connait un aspect des
réseaux intelligents : l’accès à l’informa-
tion de sa consommation en temps réel.
Le réseau du futur ira bien au-delà: il
pourra suggérer ou commander des
micro-effacements de consommation
chez le client, arbitrer entre une con-
sommation de l’électricité produite chez
lui (s’il dispose de panneaux photovoltaï-
ques) et un recours à l’électricité délivrée
par le réseau, utiliser des stockages à do-
micile, y compris les batteries installées
dans les voitures électriques stationnées
dans le garage. Les «smart grids» allient
la gestion domestique à la sécurité appor-
tée par un réseau électrique européen.
Faire émerger plus de flexibilité et
favoriser le rapprochement entre
gaz et électricité
Les réseaux intelligents n’interviendront
pas que du côté de la consommation.
La production, en particulier celle des
énergies renouvelables, qui connait une
grande variabilité, sera également mieux
intégrée. Elle pourra être prédite avec une
précision plus grande – plusieurs jours à
l’avance – et sera encore mieux utilisée
à l’échelon local, national et européen.
Avec les postes électriques intelligents,
les capacités du réseau seront adaptées
en temps réel en fonction des conditions
météorologiques et de la production
d’électricité de source renouvelable. Les
processus industriels et les usages tertiai-
res de l’électricité s’adapteront à l’offre en
énergie renouvelable pour consommer
«au bon moment» et réduire la facture
énergétique et écologique.
L’utilisation de l’électricité d’origine
renouvelable en excès pour produire de
l’hydrogène, qui serait injecté à faible
dose dans les réseaux de gaz, figure égale-
ment parmi les solutions envisagées. On
réussirait ainsi le couplage des réseaux
d’électricité et de gaz. Comme l’indiquait
Dominique Maillard, président du direc-
toire de RTE, dans Les Echos le 16 juillet
dernier, « les réseaux électriques intelli-
gents amènent la flexibilité indispensable
au système électrique pour accompagner
la transition énergétique ».
Les « smart grids » : un champ
ouvert pour l’innovation
Les smart grids, ce sont aussi de nouvelles
solutions pour mieux observer ce qui se
passe en tout point du réseau électrique,
anticiper les défaillances, intervenir plus
rapidement lorsqu’elles surviennent.
L’innovation dans le domaine des cap-
teurs, des drones, des robots, couplée
aux technologies de l’information et des
télécommunications ouvre de nombreu-
ses perspectives pour mieux utiliser les
infrastructures existantes et permettre au
réseau de révéler toute sa valeur dans le
nouveau monde de l’électricité.
Pour relever le défi de l’intégration
massive des énergies renouve-
lables, il est vital d’instiller plus
d’intelligence dans les réseaux. Pour
y parvenir, la R&D s’est structurée au
niveau européen dans le cadre d’une
initiative appelée « Horizon 2020 ».
Les projets s’attachent par exemple à
étudier et rendre possible l’intégration
massive d’énergies renouvelables dans le
système électrique européen tout en as-
surant sa stabilité, à encourager la flexi-
bilité de la consommation, à prolonger la
durée de vie des infrastructures existan-
tes et à travailler à l’acceptation de projets
par la population.
Le projet « Best Paths »
RTE joue un rôle moteur dans plusieurs
de ces projets européens. Par exemple,
le projet « Best Paths » met en œuvre
de nouvelles solutions technologiques
pour permettre l’intégration massive
d’énergies renouvelables, en particulier
provenant de fermes éoliennes offshore.
Dans le cadre de « Best Paths», RTE
pilotera un démonstrateur essentiel dans
le domaine très prometteur des réseaux
à courant continu. Son objectif est de
créer les conditions pour qu’un tel réseau
puisse se développer progressivement,
par assemblage de solutions techniques
proposées par des industriels différents.
Des outils pour préparer l’avenir
Mené et coordonné par RTE, « i-Tesla»
vise, de son côté, à développer la pro-
chaine génération de plates-formes
d’étude de la stabilité du réseau européen.
Les fortes variabilités attendues tant du
côté de la production (avec variabilité
des énergies renouvelables) que du côté
de la consommation (par exemple avec le
déploiement des véhicules électriques),
amènent à traiter un nombre croissant de
données. Là où hier quelques simulations
suffisaient à porter un diagnostic sur la
stabilité et la sûreté du réseau, ce sont
aujourd’hui des millions de simulations
qui sont nécessaires.
Autre outil de simulation, « Optimate»
modélise le fonctionnement des diffé-
rents marchés de l’électricité (marchés
infrajournalier, day-ahead, ajustement et
règlement des écarts) et le comportement
des acteurs (producteurs, consomma-
teurs, gestionnaires du réseau de trans-
port, etc.) à l’échelle européenne. Il per-
mettra de tester la robustesse des règles
de marché existantes et d’en développer
de nouvelles dans un contexte de péné-
tration significative d’électricité produite
à partir d’énergies renouvelables.
Dernier exemple, RTE est partenaire
du projet « INSPIRE-Grid », dont l’objectif
est de prendre en compte les dimensions
sociétales dans la concertation entre les
opérateurs de réseau et les parties pre-
nantes. Ce projet réunit des chercheurs
de différentes disciplines, des gestionnai-
res de réseaux de transport et des ONG.
Ils ont choisi de travailler ensemble sur
une durée de trois ans pour mieux répon-
dre aux enjeux d’acceptabilité sociétale
des projets de développement de lignes
électriques.
UNE R&D PERFORMANTE AU SERVICE
DES RÉSEAUX INTELLIGENTS
Disponible en ligne, sur tablette et
smartphone, l’outil éCO2mix permet
d’accéder à une multitude de données
autour de l’électricité française et des
échanges avec nos voisins européens.
Consommation, production, émis-
sions de CO₂ associées, échanges
commerciaux avec les pays voisins…
L’application éCO2mix, développée
par RTE et gratuitement disponible
pour iPhone, iPad et Android, et sur
le site rte-france.com, rend accessible
un bouquet de données nationales et
régionales et permet de visualiser
en temps réel les évolutions de la
consommation et de la production
d’électricité en France.
Une horloge énergétique
Quelle quantité d’électricité consom-
mons-nous en ce moment même en
France ? Quelle est la part de chaque
filière de production (nucléaire, gaz,
charbon, fioul, hydraulique, éolien et
solaire) dans le mix énergétique de
l’électricité française ? Et qu’en est-il
dans chacune de nos régions ? Telle
une « horloge énergétique », l’appli-
cation éCO2mix permet de suivre,
heure par heure et au fil des saisons,
l’évolution de la consommation et
des modes de production partout en
France. Mais ce n’est pas tout ! L’outil
propose également de visualiser, en
temps réel, les échanges avec nos
voisins européens et de consulter
une estimation des émissions de CO₂
générées par la production d’électri-
cité dans l’Hexagone.
Comprendre les enjeux de la
transition énergétique
Simple et ergonomique, l’application
offre un accès rapide aux données
et permet également de mieux com-
prendre les différents enjeux liés à la
mise en œuvre de la transition éner-
gétique, à l’échelle régionale comme
au niveau national. Complétée par
une série de chiffres clés et d’analy-
ses mensuelles autour de la situation
énergétique, éCO2mix invite à (re)
découvrir le dynamisme du réseau
électrique français et européen !
ÉCO2MIX
Ferme éolienne oshore en mer du Nord.
UNE APPLICATION PÉDAGOGIQUE
POUR TOUT SAVOIR SUR LE
SYSTÈME ÉLECTRIQUE !
L’application mobile éCO2mix permet de visualiser les échanges commerciaux
sur smartphone et tablette.
Loin de se limiter aux opérateurs
de réseaux, le secteur des réseaux
électriques intelligents constitue un
écosystème englobant de multiples
métiers complémentaires : informa-
tique, électrotechnique, domotique et
télécommunications.
Les technologies du stockage de
l’électricité (batteries, électrolyseurs,
etc.) sont également concernées. Tant
et si bien que les réseaux électriques
intelligents représentent au niveau
mondial un marché à forte croissance.
25 000 emplois en 2020
À titre d’exemple, la filière française
pourra représenter, d’ici à 2020, de
20000 à 25 000 emplois directs pour
un chiffre d’affaires de 6 milliards
d’euros, soit 10 000 créations d’em-
plois, principalement dans les sec-
teurs de l’ingénierie, de la conception
et des services. Les enjeux de la filière
à l’exportation sont considérables.
Le marché mondial des réseaux
électriques intelligents est estimé à
30 milliards d’euros en 2015 avec un
taux de croissance annuelle autour
de 10 %. Les industries françaises,
qui affichent déjà 50 % de leur chiffre
d’affaires à l’exportation dans ce
domaine, doivent se positionner en
chefs de file dans cette compétition
mondiale stratégique.
Un marché estimé
à 30 milliards d’euros
Les réseaux électriques intelligents
sont au menu des 34 plans de la
Nouvelle France Industrielle, que le
gouvernement a lancés en 2013.
Et c’est justement RTE qui s’est vu
confier la mission de coordonner le
plan « Réseaux électriques intelli-
gents », sous la houlette de Domini-
que Maillard, président du directoire.
Comme quoi le réseau de transport
est bien au centre de ces formidables
mutations !
Ces évolutions nécessiteront une
organisation et la fédération de
différents moyens et secteurs. Ce
travail sera effectué avec l’ensemble
des acteurs de cette filière en devenir
(opérateurs de réseaux de transport
et de distribution, opérateurs de télé-
com, producteurs de composants,
développeurs de logiciels, centres
de recherche, etc.) pour étudier l’en-
semble des aspects recouverts par les
réseaux électriques intelligents.
Des réalisations tangibles (appels à
manifestations d’intérêts) viendront
en 2015.
LES SMART GRIDS AU
SERVICE DE LA CROISSANCE
Dominique Maillard, Président du
directoire de RTE et pilote du plan
réseaux électriques intelligents de la
Nouvelle France Industrielle
Innovation : le robot Linevue inspecte un câble électrique.
Plusieurs projets de R&D réunissent aujourd’hui des experts européens en quête
de solutions technologiques pour répondre aux enjeux énergétiques de demain.
CÉDRIC HELSLY
GUILLAUME MURAT
ALEXANDRE SARGOS
4
VSCHLICHTING
1
/
4
100%