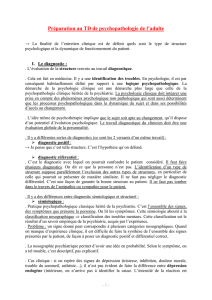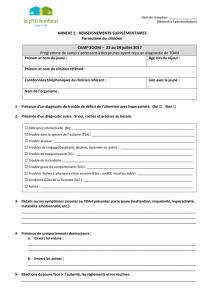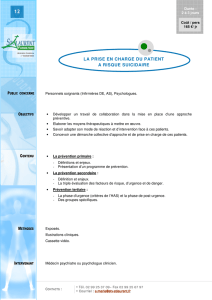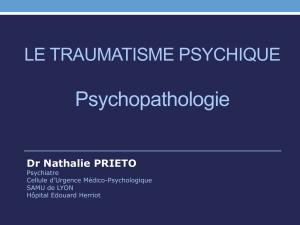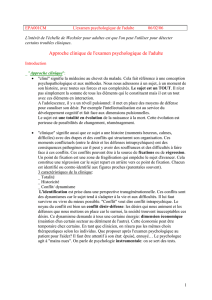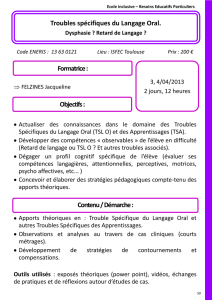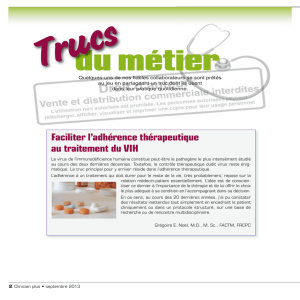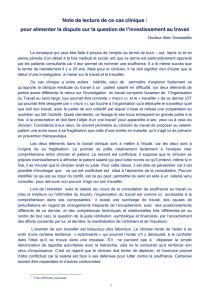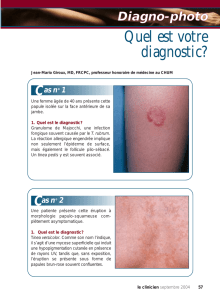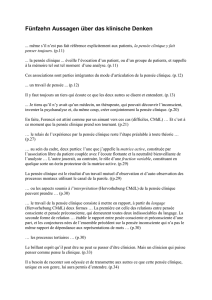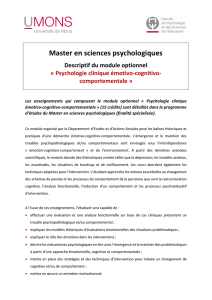13/03/03

L’entretien clinique 3èm partie : Les référentiels théoriques. Cours 2.
13/03/03
0 Plan du cours :
I. Le modèle psychodynamique et la psychanalyse.
II. Le modèle de l’entretien psychologique.
III. L’entretien psychiatrique.
IV. La perspective phénoménologique.
V. L’approche cognitive.
VI. L’entretien systémique.
1. Le modèle psychodynamique et la psychanalyse.
A. Le langage et la parole en clinique psychanalytique.
0 Plan :
Abréaction et parole => Processus cathartique.
La lecture du réel => Réalité psychique.
Acte et parole.
Le mot et la chose.
Représentation de chose/de mot.
Le lapsus dans l’entretien clinique.
Corporéité et langage.
La découpe symbolique.
1. Abréaction et parole.
Définition Abréaction (Vocabulaire de la psychanalyse, Laplanche et Pontalis) : Décharge émotionnelle par
laquelle un sujet se libère de l’affect attaché au souvenir d’un événement traumatique lui permettant ainsi de ne
pas devenir ou rester pathogène. L’abréaction, qui peut être provoquée au cours de la psychothérapie, notamment
sous hypnose, et produire alors un effet de catharsis, peut aussi survenir de manière spontanée, séparée du
traumatisme initial par un intervalle plus ou moins long.
Dans la pathologique il n’y a pas accès au langage, l’entretien clinique vise alors à la mise en mots cathartiques.
Les effets du langage dans la parole individuelle sont cathartiques, thérapeutiques. Potentiellement, le langage
peut par définition, par essence, restaurée la vertu symbolique dans la pathologie où c’est justement là le
problème.
Le langage permet alors d’historier et de commencer à prendre du recul mais il ne règle rien, il donne du sens.
2. La lecture du réel.
Le sujet met en sens, le langage est alors une lecture possible du réel, le langage clinique cherche à percer non
pas le réel pur mais la réalité psychique.
http://www.interpsychonet.fr.st 1

L’entretien clinique 3èm partie : Les référentiels théoriques. Cours 2.
13/03/03
3. Acte et parole.
La parole est un acte psychologique, parler c’est agir.
4. Le mot et la chose.
La parole a la capacité de nommer la chose dans l’imaginaire symbolique, le sujet doit se réapproprier le
signifiant (de l’autre et le sien).
5. Représentation de mot/de chose.
Nous sommes des être de langage, même (pourquoi même ? c’est pas plutôt surtout ? ) notre corps parle.
La maladie est une parole qui n’a pu se symboliser (depuis le temps on commence à comprendre).
6. Le lapsus.
Les lapsus et les silences sont des indices mais ils ne doivent pas être considérés comme des indicateurs.
7. Corporéité et langage.
La vêture est très importante, l’enveloppe corporelle aussi (surcharge pondérale de type psychologique par
exemple) etc…
8. La découpe symbolique.
Le travail du clinicien et de mettre du sens sur la souffrance qui va alors s’historiser (on a comprit !!!)
B. L’écoute en clinique psychanalytique.
0 Plan :
- Le rapport subjectif à la chose.
- La psychologie et le travail psychique.
- La situation interlocutoire et transféro/contre transférentielle.
- Empathie.
- La neutralité bienveillante.
C’est brouillon :
On parle d’attention flottante d’attention bienveillante, le tout étant de se faire l’écho de la souffrance de l’autre.
Le patient dans son élaboration comme dans sa non-élaboration rend compte de la subjectivité de son histoire. Il
faut être à l’écoute du sens que ça prend pour lui, c’est pourquoi on ne peut prétendre à une neutralité de la part
du clinicien, il y a une relation (permet d’introduire les notions de transfert et de contre-transfert : Pas folle la
bête !).
Définition Contre-transfert : Ensemble des réactions inconscientes de l’analyste à la personne de l’analysé et
plus particulièrement au transfert de celui-ci.
Définition Transfert : Désigne, en psychanalyse, le processus par lequel les désirs inconscients s’actualisent sur
certains objets dans le cadre d’un certain type de relation établi entre eux et éminemment dans le cadre de la
relation anaclitique. Il s’agit là d’une répétition de prototypes infantiles vécue avec un sentiment d’actualité
marqué. C’est le plus souvent le transfert dans la cure que les psychanalystes notamment transfert, sans autre
qualificatif. Le transfert est classiquement reconnu comme le terrain où se joue la problématique d’une cure
psychanalytique, son installation, ses modalités, son interprétation et sa résolution caractérisant celle-ci.
L’empathie doit être distingué de la sympathie, l’empathie c’est la capacité à accueillir le discours de l’autre (qui
peut être parfois freiné par nos propres défenses comme on l’a vu dans le cours précédent).
http://www.interpsychonet.fr.st 2

L’entretien clinique 3èm partie : Les référentiels théoriques. Cours 2.
13/03/03
C. Le risque interprétatif.
0 Plan :
- Intervention clinique : Intervention idéique.
- Les effets de la sidération.
- Les risques compensatoires.
1. Intervention clinique/idéique.
Il faut se préserver de la violence interprétative, il faut promouvoir la suite des idées.
2. Les effets de sidération.
Il ne faut pas, de la part du clinicien, manifester ses émotions et ses angoisses, c’est-à-dire qu’il faut veiller à ne
pas faire de grimaces par exemple qui informeraient le patient sur notre réaction à son discours (si par exemple il
s’agit d’atrocités comme le viol).
Les risques compensatoires.
L’interprétation risque de créer des effets de sidération si le clinicien s’attache à faire émerger la signification
plutôt que le signifiant, le patient est alors dans une dynamique d’évitement du travail (puisque c’est le clinicien
qui s’en occupe en bagottant des interprétations sauvages).
L’interprétation peut également produire un effet de destruction de la personne, le clinicien, comme tout un
chacun, n’est pas sans connaître les points faibles d’une personne et peut à tout moment, sciemment ou pas, les
utiliser contre lui.
D. La dynamique clinique de l’entretien.
0 Plan :
- Les figures de liaison : Mise en relation.
- Ecouter/Entendre.
- Place de la résistance dans l’entretien.
- Le processus associatif.
1. Les figures de liaison : Mise en relation.
Il ne s’agit pas d’interpréter, ni de donner une signification, on invite une personne à produire, d’elle-même et
sur elle-même, du sens. On peut l’aider dans sa tâche en mettant les éléments en relations afin de tisser une trame
signifiante : « Tisser sa propre chaîne signifiante ».
2. Ecouter/Entendre.
Il ne s’agit pas seulement d’écouter mais aussi d’entendre et de promouvoir ces figures de liaison (toujours) dans
le but de produire du sens et de le pousser à se restaurer. Il faut l’aider dans son processus associatif à
comprendre ce que ça signifie pour lui.
3. Place de la résistance dans l’entretien.
Il faut promouvoir ses mécanismes (au patient) vers quelque chose de moins pathogènes en recrédibilisant sa
confiance et la recréation des relations.
4. Le processus associatif.
Du point de vue technique, il repose sur une analyse de la chaîne signifiante qui repose à son tour sur l’apport
métonymique (association d’idée, contiguïté).
http://www.interpsychonet.fr.st 3

L’entretien clinique 3èm partie : Les référentiels théoriques. Cours 2.
13/03/03
E. La causalité en psychanalyse.
Ö Le causalisme et la causalité psychique.
Ö La temporalité et la clinique analytique.
Ö L’après-coup.
Ö La reconstruction et la logique psychique.
Non traité apparemment.
II. Le modèle de l’entretien psychologique.
A. Le modèle « Rogerien » (C. Rogers, 1968).
0 Plan :
Ö La primauté de l’expérience subjective.
Ö Le refus du réductionnisme.
Ö La valorisation « positive » du patient.
1. La primauté de l’expérience subjective.
Rogers pose le problème du rapport entre objectivité et subjectivisme, son modèle opte pour l’étude du
subjectivisme. A ses yeux on ne peut isoler le fait psychopathologique, ce qui importe c’est la relation
individuelle qu’entretien le patient avec le fait psychopathologique.
2. Le refus du réductionnisme.
On ne doit pas réduire l’analyse clinique d’une situation et c’est ce qui se produit si on tend à l’objectiver à
outrance. Par ailleurs on ne réduit pas un être à son tableau clinique (cf. dans les milieux hospitaliers où on parle
plus volontiers du syndrome de Cotard par exemple pour désigner le patient qui en est soit disant victime).
3. La valorisation « positive » du patient.
Rogers cherche à dédramatiser, à pacifier la relation pour le sujet puisse s’accorder avec sa pathologie, se la
représenter. Rogers part du principe que le fait psychopathologique est une construction aberrante, soit, mais il
est lié à l’histoire du sujet, il a sa place, on ne peut l’enlever.
B. Le paradigme de C.R. Rogers.
0 Plan :
Ö « Prime importance » de l’expérience vécue.
Ö Irréductibilité de l’expérience actuelle (expérience passée).
Ö Relation originaire positive à soi-même.
Ö Relation originaire positive à l’autre.
Ö La notion de « growth » (croissance, maturation, développement).
Actualisation Régulation
1. « Prime importance » de l’expérience vécue.
On considère que la pathologique a ses racines, sa genèse et son histoire dans l’expérience du vécu et que par la
même elle trouve un sens que le clinicien doit comprendre.
http://www.interpsychonet.fr.st 4

L’entretien clinique 3èm partie : Les référentiels théoriques. Cours 2.
13/03/03
2. Irréductibilité à l’expérience actuelle (expérience passée).
On constate à un moment t un dysfonctionnement, il faut envisager l’histoire du fait individuel.
3. Relation originaire positive à soi−même et à l’autre.
Si le patient exprime une souffrance c’est que son économie psychique est mauvaise mais il faut lui faire prendre
conscience qu’il a les moyens de dépasser ça, que le sens est potentiellement caché à l’intérieur fait
psychopathologique. Le clinicien doit afficher des attentes positives et aider à valoriser le sens possible pour le
patient. Il doit l’accompagner (étymologiquement : Compagnon de pain).
Rogers propose donc un entretien individualisé, au cas par cas.
4. La notion de croissance.
Le fait psychopathologique est une actualisation manifeste d’autres processus jusque là resté latent, le sens cache
ou potentiellement là peut être donc retrouver dans la genèse du trouble. Rogers marque ici son intention de ne
pas considérer le trouble psychique comme inné mais comme possédant une histoire.
Dans cette histoire de croissance, le clinicien doit adopter la posture d’un historien.
C. Les troubles de la régulation.
Plan :
Ö Les conditions de valeur (valorisation sélective).
Ö La notion « d’intention ».
Ö L’inter-view et l’intra-view.
Pas trop comprit…reportez-vous au bouquin de Poussin sur l’entretien.
L’histoire d’inter-view et d’intra-view renvoie aux problématiques d’intrapsychique et d’interprétation, on habite
le dehors comme on habite le dedans. On habite le relationnel extérieur comme on habite la relation intérieure.
Voui voui voui….
D. L’entretien non−directif.
Empathie Communication Congruence Valorisation
positive
inconditionnelle
Quoi ? A différencier de la
sympathie, correspond à
une attitude d’écoute
bienveillante. Pas de
jugements de valeur. Etre
toujours à l’écoute du
cheminement de l’autre.
Il s’agit d’écouter la
compréhension qu’a le
sujet de sa propre
problématique, le sens
possible, caché et
symbolique qui s’y
trouve.
Absence de
comportement
défensif.
Il faut dépasser les
« conditions de
valeur ».
Mais
encore ?
On prend en considération
le cadre de référence interne
de l’autre, c’est-à-dire que
c’est le sujet qui guide le
psychologue et non le
psychologue qui guide le
sujet comme dans le cadre
nosographique.
Il s’agit d’un échange de
compréhension.
Il faut être capable
de tout entendre, il
ne faut pas que nos
propres limites
réduisent l’espace de
parole du patient.
0 Plan :
Ö Notion de « supportive psychotherapy ».
Ö Réflexion critique sur la « méthode rogerrienne ».
http://www.interpsychonet.fr.st 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%