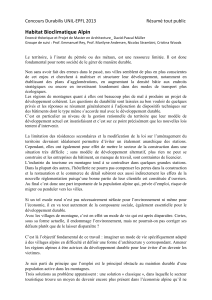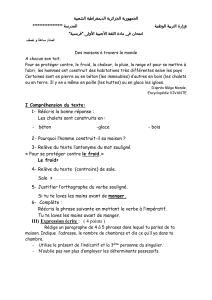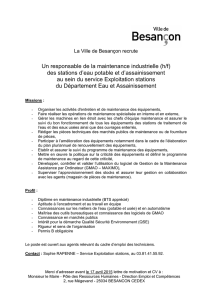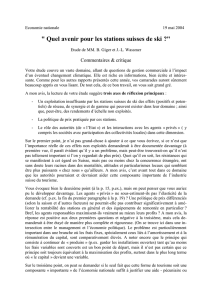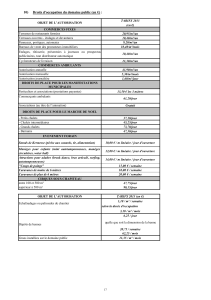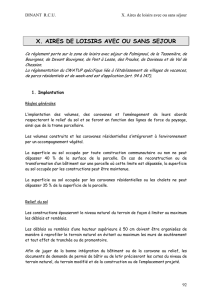Enoncé théorique travail de Master final

Habitat bioclimatique alpin
Une voie privilégiée pour le développement
de logements collectifs en station
Candidat : David-Pascal Müller
Directeur pédagogique : Emmanuel Rey
Professeur : Marilyne Andersen
Maître EPFL : Nicolas Strambini
EPFL_ENAC_AR_MA3 Enoncé théorique de Master

1
Sommaire
1. Introduction .................................................................................................................... 3
1.1 Construction bioclimatique : généralités ..................................................................... 3
1.2 Construction en région alpine : généralités .................................................................. 4
2. Problématique ................................................................................................................. 6
2.1 Construction bioclimatique ......................................................................................... 6
2.2 Développement urbain des stations de montagne ........................................................ 7
3. Historique du développement alpin ................................................................................. 8
3.1 Economie alpine traditionnelle .................................................................................... 8
3.2 Les Alpes : du monde sauvage au paradis romantique ................................................. 9
3.3 Le tourisme haut de gamme : naissance des grands hôtels et des pensions ................. 10
3.4 Le tourisme de masse : essor des stations .................................................................. 12
3.5 Le virage des années 1980 : résidences secondaires et déclin de l’hôtellerie .............. 14
3.6 Vers une régulation contraignante du développement des stations ............................. 16
3.6.1 La « Lex Weber », vers un déclin de l’économie alpine en Suisse ?................. 17
3.6.2 Vers une reconfiguration de l’économie alpine ? ............................................. 19
3.6.3 Emergence d’une société alpine de décroissance ? .......................................... 24
4. Construction alpine ....................................................................................................... 30
4.1 La densité dans les régions rurales ............................................................................ 30
4.2 Urbanisme des villages alpins ................................................................................... 36
4.2.1 Structures parallèles à la pente ........................................................................ 40
4.2.2 Structures perpendiculaires à la pente .............................................................. 41
4.3 Mobilité en région alpine .......................................................................................... 43
4.3.1 Gestion du stationnement ................................................................................ 46
4.4 Typologies fonctionnelles des constructions : généralités .......................................... 47
4.5 Habitation permanente et saisonnière en zone alpine ................................................. 48
4.5.1 Les alpages ..................................................................................................... 49
4.5.2 Le « chalet » suisse traditionnel....................................................................... 56
4.5.3 Les grands chalets de luxe ............................................................................... 64
4.5.4 Les Jumbo-chalets ........................................................................................... 67
4.6 Rapport des constructions à la pente ......................................................................... 70
4.7 Aménagements extérieurs ......................................................................................... 73

2
4.7.1 Espaces extérieurs de loisirs en région alpine .................................................. 75
4.7.2 Jardins potagers : loisirs créatifs et potentiel d’autoproduction ........................ 78
4.8 Techniques de construction en bois ........................................................................... 80
4.8.1 Construction en madriers ................................................................................ 80
4.8.2 Ossature bois .................................................................................................. 83
4.8.3 Préfabrication bois .......................................................................................... 87
5. Considérations sur la construction bioclimatique ........................................................... 89
5.1 Déperditions thermiques et isolation ......................................................................... 90
5.1.1 Locaux tempérés : serres, remises, combles froids, caves ................................ 94
5.2 Ecobilan et choix des matériaux................................................................................ 97
5.2.1 Gros-œuvre ..................................................................................................... 98
5.2.2 Structure ....................................................................................................... 100
5.2.3 Isolants ......................................................................................................... 106
5.2.4 Finitions ....................................................................................................... 109
5.3 Captage solaire passif ............................................................................................. 110
5.3.1 Influence sur les ouvertures .......................................................................... 112
5.3.2 Protections solaires ....................................................................................... 116
5.3.3 Masse d’inertie ............................................................................................. 119
5.4 Ventilation naturelle ............................................................................................... 120
5.5 Gains internes ......................................................................................................... 123
5.6 Bilan thermique ...................................................................................................... 123
5.7 Eclairage naturel ..................................................................................................... 132
5.8 Production active d’énergie .................................................................................... 135
5.8.1 Chauffage / ECS ........................................................................................... 136
5.8.2 Electricité ..................................................................................................... 140
5.9 Gestion des eaux pluviales ...................................................................................... 143
6. Site du projet .............................................................................................................. 148
6.1 Situation générale et géographie du Pays-d’Enhaut ................................................. 148
6.2 Structure urbaine de Château-d’Oex ....................................................................... 150
6.3 Le quartier de la santé à Château-d’Oex.................................................................. 153
6.4 Caractéristiques du périmètre d’intervention ........................................................... 159
6.4.1 Déroulement du projet .................................................................................. 160
7. Synthèse ..................................................................................................................... 162
8. Bibliographie .............................................................................................................. 165

3
1. Introduction
A la base de ce travail, il y a deux constats. D’une part, l’évolution du climat et
l’épuisement progressif des ressources nous conduit à diminuer de plus en plus notre
consommation énergétique et d’autre part, l’évolution de la situation dans les stations alpines
jusqu’à un point de rupture aujourd’hui.
L’objectif de ce travail est de réunir deux problématiques dans une même vision, de faire
en sorte qu’elles se répondent l’une à l’autre et s’enrichissent mutuellement pour faire
émerger une démarche projectuelle adaptée au mieux à la construction durable en montagne.
Bien que cette étude tiendra compte de lois universelles et d’éléments caractéristiques de
la construction dans l’ensemble de l’arc alpin, une part importante du travail sera orienté sur
des spécificités du cas suisse, contexte de base pour le projet de master qui suivra.
Il semble que nous sommes arrivés ces dernières années à un carrefour au niveau duquel
trois directions correspondant à autant de visions pour la Suisse de demain se présentent à
nous. Il y a bien sûr le statu quo, qui au vu notamment des votations sur les résidences
secondaires, apparait de plus en plus insoutenable pour la population. La seconde voie,
esquissée notamment par Herzog et de Meuron dans leur étude sur le territoire Suisse1,
propose quant à elle une Suisse emmenée par ses métropoles, délaissant quelque peu ses
« friches alpines », qui sans l’aide des péréquations financières déclineraient en partie, laissant
la place pour un retour du « naturel ». Mais est-ce vraiment opportun, dans un pays comme la
Suisse, longtemps fondé sur le mythe de la vie alpine et qui plus est confronté à une crise du
logement sans précédent, de laisser ainsi de côté plus de 60% de son territoire et de risquer un
exode rural de près de 20% de sa population2 ?
Pour ces raisons, et aussi parce que provenant d’un village de montagne, je considère que
ces régions offrent un modèle de vie particulier que l’on ne saurait retrouver en ville, je
souhaite dans ce travail explorer une troisième voie : celle d’un développement alpin maîtrisé,
représentatif d’une économie orientée vers la durabilité, loin de la spéculation intensive sur le
foncier. Vision utopique ? Peut-être. Dans certains cas peut-être pas tant que cela. Mais elle
m’apparait surtout nécessaire si l’on souhaite continuer d’avoir une vie dans les montagnes.
Au fond, nos stations se confrontent aux mêmes problèmes que nos villes : une croissance
spatiale à contenir, une flambée des prix à gérer. Densité et mixité alliées à l’efficience
énergétique et qualités spatiales; des réponses valables en ville, pourquoi pas en montagne ?
Les stations et villages de montagne ont, à mon avis, des attributs plus que convaincants
pour rester des lieux de vie appréciés. Le logement abordable et le travail sont deux éléments
fondamentaux pour que cela soit possible. L’emploi, problématique intéressante si l’en est, est
plus du ressort des économistes et géographes, raison pour laquelle ce travail ne fera
qu’effleurer la question. Le logement, en revanche sera au cœur des réflexions.
1.1 Construction bioclimatique : généralités
La construction bioclimatique est un domaine de l’architecture et de l’ingénierie en
expansion, notamment pour répondre aux dérèglements climatiques que le monde scientifique
attribue en partie aux activités humaines. Elle est le résultat d’une démarche qui dès le départ
1 Die Schweiz : ein städtebauliches Portait, ETH studio Basel 2005
2 Office fédéral de la statistique, 2000

4
du projet considère l’optimisation de l’efficacité énergétique et du confort intérieur comme
des critères fondamentaux. La physique du bâtiment y joue un rôle prépondérant ; elle met en
évidence les relations entre les différents paramètres qui entrent en compte dans un bâtiment.
A partir des résultats que l’on peut sortir de ce premier modèle mathématique, on peut
concevoir et mettre en place divers dispositifs pour optimiser les gains énergétiques, la
lumière naturelle ou encore la ventilation par exemple.
En rupture avec la tendance technologique introduite par la modernité, le bioclimatique
cherche à accroitre le confort sans avoir un recours systématique à des machines
sophistiquées, en utilisant au mieux les caractéristiques de l’environnement dans lequel vient
s’implanter le bâtiment. L’architecte est de ce fait plus impliqué dans la performance du
bâtiment qu’il conçoit qu’il ne l’est dans un cas plus classique où la technologie vient
complémenter l’architecture.
Les dispositifs bioclimatiques sont généralement des éléments architecturaux simples : la
gestion du rayonnement solaire pour l’éclairage et le chauffage peut être effectuée à partir de
simples pare-soleils, les dalles et murs intérieurs massifs peuvent quant à eux fournir une
bonne inertie thermique pour amortir les pics de température intérieure.
On peut ajouter qu’une disposition judicieuse des ouvertures permet une aération naturelle
efficace pour éviter les surchauffes estivales. Au-delà de tous les dispositifs imaginables, la
disposition des espaces et leur configuration géométrique (profondeur, hauteur, etc.) joue un
rôle prépondérant dans l’efficacité énergétique que peut atteindre un bâtiment.
La question de l’énergie grise est également d’une grande importance. Par le choix de ses
matériaux de construction, l’architecte a un impact sur l’offre : en favorisant l’utilisation de
matériaux peu polluants, recyclables et autant que possible de proximité, il favorise le
développement de tout un marché autour de ces matériaux, contribuant au final à réduire
l’impact écologique de l’homme sur la planète.
La question de l’énergie grise ne s’arrête pas à l’énergie de production ; la durabilité, les
coûts énergétiques d’entretien (peintures, vernis par exemple) ou encore ceux de recyclage ou
d’élimination doivent aussi être pris en compte, ce qui, on le verra plus tard, complexifie le
problème.
1.2 Construction en région alpine : généralités
La construction alpine possède des caractéristiques propres qui seront développées plus
largement dans les chapitres suivants. Ce qui nous intéresse ici, ce sont plutôt les
particularités des régions alpines et les répercussions qu’elles peuvent avoir sur le projet.
On peut tout d’abord différencier trois types d’agglomérations alpines en se basant sur le
fonctionnement de leur économie.
Les plus connues sont sans doute les grandes stations touristiques : Verbier, Gstaad,
Zermatt, etc. Ce sont également en termes de surface de zone urbaine les plus importantes.
Ces stations se sont généralement construites autour du tourisme auquel elles sont fortement
dépendantes. Cela se traduit dans une première phase, jusqu’au milieu du XXe siècle par la
construction puis la multiplication des grands hôtels de luxe. Les prix en station montent et la
population locale est petit à petit reléguée vers les villages voisins. A partir des années 1980-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
1
/
172
100%