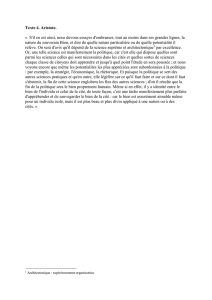L`éthique et l`évolution des cités dans le monde grec

Cet article tire de l’ouvrage « Ethique et développement », (Actes du 13
e
colloque d’éthique
économique, organisé par le Centre de recherches en éthique de l’Université Paul Cézanne (Aix-
Marseille III), à Aix-en-Provence, les 29 et 30 juin 2006), édité par la Librairie de l’Université d’Aix-
en-Provence en 2007 (ISBN : 978-2-903449-93-3)
L’éthique et l’évolution des cités
dans le monde grec
par
Jean-François MATTÉI
Professeur de philosophie à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, membre de l’Institut
Universitaire de France
Le titre de notre treizième colloque, « Éthique et développement », soulève les
mêmes questions que l’expression d’« éthique économique » pour désigner la discipline sous
laquelle il s’inscrit. Comment peut-on concilier en effet deux domaines, qui paraissent a
priori étrangers, celui de la conduite morale définie par des actions libres soumises à des
principes, qu’ils soient d’ordre religieux, philosophique ou juridique, et celui des affaires
économiques définies par des comportements déterminés soumis à la loi de l’offre et de la
demande qui renvoie peu ou prou à des intérêts conflictuels ? Il y a dans toute éthique une
dimension d’équilibre et de stabilité, disons de « mesure », alors que l’économie, du moins
l’économie moderne, semble participer d’un déséquilibre et d’une instabilité, sinon d’une
« démesure », qui tient au développement mondial de tous les échanges de produits,
d’informations et de services. Pour le dire rapidement, l’éthique propose plutôt à chacun
une règle de vie permanente, et donc statique, là où le développement de tous est
évidemment une forme de vie changeante, et donc dynamique.
Mais si l’on s’interroge sur les rapports de l’éthique et du développement, au lieu de
laisser ce dernier libre de toute attache, c’est sans doute parce qu’un développement
indéfini, et non maîtrisé, laisse craindre des débordements qui devraient être tempérés,
sinon supprimés, par des impératifs éthiques. L’opposition est celle du mode d’action
considéré : l’éthique s’adresse toujours à nous à l’impératif, et cet impératif est le plus
souvent catégorique, comme chez Kant, alors que le développement parle à l’indicatif, un
indicatif qui est plutôt hypothétique car nul ne peut garantir à l’avance la réalité, et la
justesse, d’un développement. L’avenir est gros de risques et de menaces que l’éthique
essaie d’exorciser en imposant des règles et des limites à toutes les formes de
développement techniques ou économiques.
*
Ce conflit potentiel entre une éthique, vouée d’emblée à la maîtrise, et un
développement, réduit par suite à la soumission - du moins pour ceux qui souhaitent
accorder les deux en choisissant ce que l’on appelle le « développement durable », c’est-à-
dire un développement contrôlé qui trouve ses assises en dépit des bouleversements et des
crises –, est un conflit essentiellement moderne que les Anciens n’ont jamais vécu. D’une
part, les cités antiques, et plus encore les sociétés primitives, n’ont pas connu de

développement visible à l’échelle humaine tant sur les plans économiques que politiques ou
sociaux : la notion même de « changement », quand elle existe, n’a pas le même sens que
pour nous. D’autre part, la pensée antique privilégie généralement la forme statique de
l’existence sur la forme dynamique, moins peut-être du fait de la limitation de ses moyens
techniques, comme on l’a écrit quelquefois, que pour des raisons théoriques liées à sa
conception du monde. Bergson a bien montré, dans Les deux sources de la morale et de la
religion, qu’il y avait deux sortes de sociétés, les « sociétés closes », refermées sur elles-
mêmes et qui évoluent si insensiblement que les individus ne s’en rendent pas compte, et
les « sociétés ouvertes », en contact avec les autres sociétés, et qui évoluent de plus en plus
vite puisque c’est le modèle même de l’ouverture, c’est-à-dire du changement, qui les
constitue comme telles. Les membres des sociétés closes, soumises à ce que Bergson
nomme la « pression », sont liés par des obligations strictes qui les empêchent de se
développer dans l’ordre politique, social et économique, alors que les sociétés ouvertes,
définies au contraire par une « aspiration », selon le terme de Bergson, se libèrent des
nécessités antérieures pour inventer de nouvelles formes d’échanges de plus en plus
nombreuses et de plus en plus diverses.
Les sociétés closes sont repliées sur elles-mêmes. Leurs membres sont indifférents
aux autres hommes, et voués à une attitude de défense ou d’attaque, c’est-à-dire de
« combat », parce que ces sociétés n’ont pas les outils intellectuels ou matériels qui
autoriserait un quelconque changement, que ce soit sous forme d’évolution ou de progrès. Il
en résulte qu’elles ne peuvent devenir des sociétés ouvertes « par voie d’élargissement »,
comme le remarque Bergson, puisqu’elles n’ont en elles aucun principe de développement.
Elles ne peuvent que disparaître, soit par extinction naturelle, soit par conquête culturelle,
ce qui fut le cas des cités grecques soumises à Philippe puis à Alexandre, et même de
l’Égypte séculaire conquise par le même Alexandre. Pour le dire autrement, le clos ne peut
jamais s’ouvrir à la suite d’un processus continu puisqu’il est étranger à tout principe social
de développement. Mais il peut se transformer par voie d’explosion, si l’on peut dire, à la
suite d’une révolution spirituelle ou conceptuelle qui débouche sur une transformation
sociale radicale.
C’est le christianisme qui a permis historiquement la naissance des sociétés ouvertes
en libérant les hommes de leur dépendance étroite vis-à-vis de leur société, et en leur
apportant, avec l’idée de liberté religieuse qui prendra bientôt les couleurs d’une liberté
politique et d’une liberté sociale, une ouverture sur un autre monde qui se reflète déjà en ce
monde-ci. Lorsque Bergson écrit que « la société ouverte est celle qui embrasserait en
principe l’humanité entière »
1
, il reconnaît que le christianisme, interprété comme une
« religion dynamique », a apporté l’espoir d’une libération universelle de la condition
humaine. Dès lors, cette libération spirituelle a pris les couleurs d’une libération
intellectuelle, politique, sociale, aussi bien que scientifique et technique. La possibilité d’une
ouverture économique, et donc d’un développement généralisé de toutes les sociétés à
travers un échange universel, est apparue avec la sécularisation de l’idée chrétienne de
progrès qui, à l’origine, ne concernait que le temps de la rédemption. Ce sera encore
l’hypothèse de Max Weber lorsque, dans sa Sociologie de la religion, il établira l’homologie
de structure entre l’esprit du capitalisme, en tant qu’idéal-type, et l’éthique protestante
dont le désenchantement du monde a favorisé, avec la recherche scientifique, la
1
Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, Œuvres, Paris, PUF, 1959, p. 1202.

rationalisation du travail et le développement économique. En rompant avec le rituel et le
traditionnel, le mysticisme et la magie, la prophétie chrétienne, avance Max Weber, a bien
ouvert le champ d’une histoire sécularisée qui ne connaît plus d’autre principe que celui d’un
développement humain indéfini.
On doit encore ajouter que le tournant politique qui a fait disparaître les sociétés
closes est celui de la démocratie. Bergson affirmait que « la démocratie est d’essence
évangélique » et qu’elle a pour moteur « l’amour »
2
, dans la mesure où elle a imposé l’idée
paulinienne que tous les hommes sont frères, sans considération de sexe, de race, de
situation sociale ou de richesse, et qu’en conséquence tous ont droit, avec une même
considération, à un même développement intellectuel, économique et social. Il est de fait
que les progrès conjoints de la démocratie et du capitalisme, en tant qu’ils sont les deux
principes dynamiques du même modèle libéral, ont accéléré de plus en plus, depuis
quelques siècles, l’ouverture généralisée des sociétés, seraient-elles les plus fermées, vers ce
que l’on appelle aujourd’hui la « mondialisation » ou la « globalisation ». Ce n’est rien d’autre
que le système généralisé, à l’échelle de la planète, de la libéralisation de toutes les formes
d’échange et de développement. Tocqueville avait le premier remarqué, que « la révolution
démocratique » a porté les sociétés modernes à aimer « le mouvement pour lui-même » à
un point tel que si, dans les aristocraties, « la langue doit naturellement participer au repos
où se tiennent toutes choses »
3
, les démocraties modifient leur langage pour mieux
précipiter le changement dans tous les domaines de la vie sociale. Le « mouvement », qu’il
soit sous forme d’évolution, de développement ou de progrès, est le principe et la fin des
sociétés ouvertes qui sont vouées à précipiter les formes les plus diverses d’échanges, qu’il
s’agisse des produits, des informations, des services ou des hommes.
Il n’en allait pas de même dans les sociétés du monde antique. En premier lieu, les
cités n’ont pas connu le développement économique accéléré qui est lié au capitalisme, car
les cités étaient des lieux de consommation des richesses et non de leur capitalisation. Les
activités économiques, bien que présentes dans les échanges commerciaux avec les cités
grecques ou avec d’autres terres étrangères, ont toujours joué un rôle mineur dans les
institutions de la Cité et dans la représentation que les philosophes en ont données. Comme
l’écrit Jean-Pierre Vernant dans son article « Travail et nature dans la Grèce ancienne », « la
Polis prolonge et généralise des traditions aristocratiques : elle n’est pas “bourgeoise”
comme la ville du Moyen Âge »
4
. Si la production des richesses, d’ailleurs très limitée, n’était
pas inscrite dans un processus de développement délibéré, c’est parce que les Grecs ne
connaissaient pas l’autonomie du champ économique qui était toujours subordonné à la vie
politique. Et si l’économie n’était pas le moteur de la vie sociale, c’est parce qu’elle n’était
pas considérée comme le mouvement déterminant de l’activité humaine.
Nous sommes ici aux antipodes, dans ces sociétés à dimension aristocratique, de la
célébration du mouvement que connaîtront, selon Tocqueville, les sociétés démocratiques.
Jean-Pierre Vernant rappelle justement, dans l’article cité, que la langue grecque ne connaît
2
Bergson, op. cit., p. 1215.
3
A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique II, première partie, « Influence de la démocratie sur le
mouvement intellectuel aux États-Unis », Paris, La Pléiade, 1992, chapitre XVI, p. 577.
4
J.-P. Vernant, « Travail et nature dans la Grèce ancienne », Mythe et pensée chez les Grecs, tome II, Paris,
Maspéro, 1965, note 88, p. 35.

pas de terme générique qui correspond à notre mot « travail »
5
. Un terme comme ponos
exprime la « peine » et l’« effort » dans toute activité humaine, et non la production d’une
valeur sociale utile. Un autre terme grec, ergon, dont la physique moderne a fait l’erg, l’unité
de mesure de l'énergie dans le système CGS, exprime l’activité du paysan dans son champ
ou, plus généralement, l’activité d’un être. Même le terme de demiourgos, de « démiurge »,
ne qualifie pas le travail social d’un artisan ou d’un ouvrier, bien qu’il contienne le radical
démos, « peuple » ; il désigne à l’origine, non pas une production, mais une activité publique
en dehors de l’oikos, de la maison, par exemple celle des artisans, mais aussi celle des poètes
ou des devins, des activités très diverses qui n’ont rien d’économique. S’il n’y pas d’unité de
la fonction de « travail » dans les cités grecques, il n’y a donc pas non plus d’unité de la
fonction de « travailleur », ni, en conséquence, d’unité de la fonction de l’« économie ». Le
terme d’oikonomia existe, bien entendu, et nous avons tiré de lui notre mot « économie ».
Mais il renvoie à l’ensemble des activités privées, et non publiques, qui se tiennent à
l’intérieur de l’oikos ou oikia, la « maison », et qui sont symbolisées par la figure de la femme
qui est maîtresse de son foyer.
L’oikonomia signifiait uniquement la loi, nomos, qui régit la maison, oikos, entendons
l’administration de la maison et de la famille qui y habite. On pourra parler, avec Montaigne,
de « ménagement » ou de « mesnagerie », il s’agira toujours de s’occuper des affaires
familiales et de régler les questions matérielles de la vie domestique, et non de s’intéresser
au développement de la Cité pour accroître ses richesses. Mais si l’on règle ainsi ses affaires
personnelles, en les ménageant avec une certaine prudence qui conduit à économiser ses
forces et son bien, c’est parce que le Grec s’impose une éthique rigoureuse dans sa vie
privée comme dans sa vie publique. On le constate chez Aristote tant dans la Politique que
dans l’Éthique à Nicomaque ou les Économiques. Le philosophe ne définit pas l’homme
comme une homo œconomicus, c’est-à-dire un producteur et un consommateur, mais bien
comme un « vivant politique » qui est précisément détaché des tâches serviles imparties aux
esclaves, Ce qui interdit aux cités grecques de penser leurs cités selon un modèle évolutif,
c’est leur conception du monde qui n’implique dans le temps aucun développement, tel que
nous l’entendons aujourd’hui, ni a fortiori aucun progrès. Le citoyen grec n’existe que par sa
fonction politique, sur le seul mode de l’action pratique, et non sur celui de l’action
productrice, en fonction de la polarité praxis/poièsis, le second terme étant subordonné au
premier.
On comprend les critiques qu’Aristote adresse à ce qui est pour nous le mode normal
de production, c’est-à-dire la création de richesses, et le principe de l’économie, à savoir le
développement, car de tels processus d’accumulation mettent pour lui en danger la vie
éthique de l’homme comme celle de la cité. La chrématistique, dont il combat le
dérèglement, est certes la source de richesses, l’argent engendrant l’argent, mais elle
déséquilibre la cité du fait de son développement indéfini. Alors que l’économie naturelle de
la maison trouve ses limites dans la satisfaction des besoins domestiques, la recherche des
richesses de la chrématistique s’avère illimitée. Aristote en donne la raison éthique : ceux
qui se lancent dans les affaires s’appliquent uniquement à vivre (to zen), et l’appétit de vivre
est illimité, alors que la sagesse consiste à bien vivre (to eu zen), c’est-à-dire à maîtriser ses
désirs par la vertu qui, seule, peut procurer le bonheur, eudaimonia. On ne peut réduire
toutes les activités humaines, conclut Aristote dans la Politique (I, 9, 1258 a), à des affaires
5
J.-P. Vernant, « Travail et nature dans la Grèce ancienne », op cit., p. 16-17.

d’argent sous le prétexte que « gagner de l’argent est leur fin et que tout conspire pour
atteindre ce but ».
Si le développement économique n’est jamais le but des cités ni le souci des
philosophes, c’est parce que la vie de production de biens qu’un moyen, et non une fin en
soi. Aristote n’hésite pas à dire que « la vie de l’homme d’affaires », car il y en avait tout de
même en Grèce, trafiquants, importateurs, gros commerçants, est une vie « contre nature »
(para phusin), car « la richesse [...] est utilisée comme moyen en vue d’une autre chose »
6
. Le
critère de la condamnation s’avère ici uniquement moral. L’économie, comprise comme la
création continue de richesses sociales, demeure toujours soumise à l’ordre de la nécessité,
manifesté, pour reprendre les termes de Bergson, par la « pression » de la vie, là où la
politique et, plus encore, la philosophie, en tant que pratique du bien, s’ouvre sur l’ordre de
la liberté, manifesté par l’« aspiration » au loisir.
*
On peut pousser plus avant l’analyse. Les cités grecques, comme les théoriciens qui
ont réfléchi sur leur origine et leur constitution, n’ont pas choisi le chemin du
développement économique ni celui du progrès technique, non pas seulement du fait de
l’absence de la catégorie générale du « travail », mais en raison de leur conception du
monde et du temps. Leur vision du kosmos est celle d’un monde clos, comme l’a montré
Alexandre Koyré, centré sur la terre vouée à la déesse Hestia, qui n’est pas susceptible de
changement, de développement ou de progrès. Dans toutes les cosmologies archaïques,
puis dans les théories physiques qui leur ont succédé, l’univers matériel est fini, achevé et
immobile. La sphère des étoiles qui borne le monde est la « sphère des fixes », car les
étoiles, dans leurs différentes galaxies, conservent les mêmes rapports mathématiques que
l’astronomie mesure de la manière la plus exacte, bien que toutes les observations aient été
faites à l’œil nu. La constance de ces rapports est manifestée, dans la nuit étoilée, par les
douze constellations où siègent les signes célestes du Zodiaque, de 30° chacun, et les douze
maisons qui composent le Zodiaque terrestre. L’équilibre du kosmos est mis en évidence par
la position centrale de la Terre qui est immobile. Toute la sphère du monde a ainsi un foyer
fixe qui est dévolu à la déesse Hestia dont le nom même signifie, dans sa racine indo-
européenne, la permanence : la racine *st se retrouve, parmi bien d’autres termes, dans
« stabilité », « station », « statut », « institution » ou, simplement, « stop », pour évoquer
l’immobilité et l’équilibre. La contemplation nocturne du « ciel étoilé », qui remplissait l’âme
de Kant d’admiration au même titre que la loi morale, est ainsi pour les Anciens la preuve
vivante de la permanence et de la stabilité de toute chose. On comprend la sagesse
éternelle de l’Ecclésiaste que le monde grec partageait :
« Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève,
le soleil se couche; il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le
midi, tourne vers le nord; puis il tourne encore, et reprend les mêmes circuits. Tous les
fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie ; ils continuent à aller vers le lieu où ils se
dirigent. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire; l'œil ne se rassasie pas
de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est
fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise :
“Vois ceci, c'est nouveau !” cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés ».
6
Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 1096 a.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%