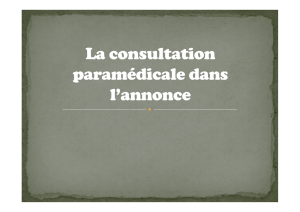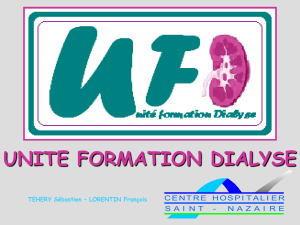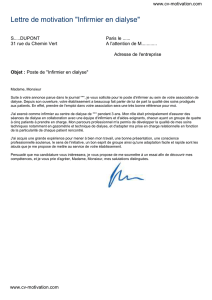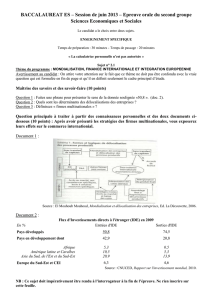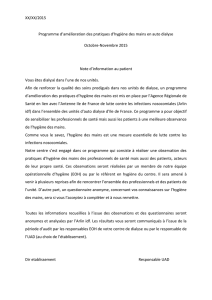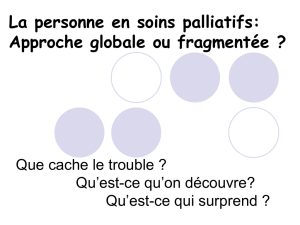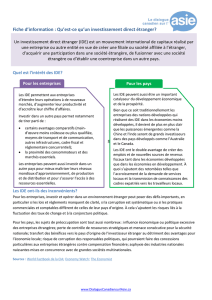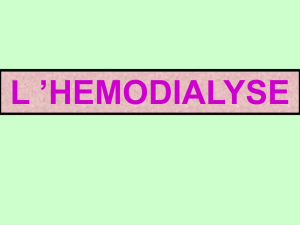Mise en page 1 (Page 1 - 2)

DDDDDDD
<CARNET DE FAMILLE
GROUPE HOSPITALIER SAINT-VINCENT
29 rue du Faubourg National • 67083 Strasbourg Cedex
TÉL. 03 88 21 70 00 • FAX. 03 88 21 71 70
CLINIQUE SAINTE-ANNE •CLINIQUE SAINTE-BARBE •CLINIQUE BÉTHESDA
CLINIQUE DE LA TOUSSAINT •CLINIQUE SAINT-LUC •I. F. S. I. SAINT-VINCENT
Conception graphique et illustrations > Blás Alonso Garcia • Impression > OTT Imprimeur - Wasselonne
≥Bienvenue !
À Sainte-Anne
CEVALLOS Ramiro /Médecin Interniste, le 01/08/2007,
FRANTZ Anne-Laure /Préparatrice en Pharmacie, le 25/06/2007,
REIBEL Pauline /AS en Oncologie, le 01/10/2007.
À Sainte-Barbe
AESCHELMANN Véronique, Responsable-IDE en Réanimation,
le 01/06/2007, (mutée de Sainte-Anne),
DE MAIO Martine, Responsable-IDE à l’ORL,
le 15/08/2007, (mutée de Béthesda),
FRET Violetta, IBODE au Bloc Opératoire, le 04/06/2007,
GRONIER Olivier, Médecin Gastro-Entérologue, le 29/05/2007,
HARTMANN Dominique, Ouvrier aux Services Techniques, le 04/06/2007,
KAUFFMANN Sophie, IDE en Gastro-Entérologie, le 06/08/2007,
(mutée de Sainte-Anne),
NAEGELY Sabrina, IDE à l’ORL, le 01/07/2007,
PIRON Sandrine, IDE à l’EMR, le 01/09/2007,
PIERREL Delphine, IDE en Gastro-Entérologie, le 24/09/2007,
WENDLING Julie, IDE en Gastro-Entérologie, le 01/09/2007,
(mutée de l’EMR),
WENDLING Valérie, IBODE au Bloc Opératoire, le 20/08/2007,
(mutée de Béthesda).
À Béthesda
BERNHARD Aurélie, IDE en Dialyse, le 19/06/2007,
BLAISE Isabelle, AS en Médecine Interne, le 18/06/2007,
ETIENNE Arnaud, IDE en Dialyse, le 03/09/2007,
FALK Aude, IDE en Dialyse, le 13/08/2007,
FERREIRA DE CARVALHO Hélène, IDE en Dialyse, le 04/06/2007,
GRANDIDIER Thomas, IDE en Dialyse, le 14/05/2007, (muté de l’EMR),
MARTIN Nicolas, IDE à l’USC, le 01/09/2007,
MELCHY Olivier, IDE en Dialyse, le 19/06/2007,
À Saint-Luc
SCHEER Sylvie, IDE à l’HAD, le 09/07/2007,
VILLEMAIN Danièle, Assistante Sociale à l’HAD, le 01/09/2007.
À La Toussaint
DI FRANCESCO Sandrine, AS au Long-Séjour, le 09/07/2007,
GEORGIOU Marie-Rose, Animatrice au Long-Séjour, le 01/06/2007,
LEGRAND Claire, Educateur au SSR, le 17/09/2007,
OSTERTAG Corinne, IDE en Santé Mentale, le 01/06/2007.
≥Mariage
À Sainte-Anne
DREYER Martine épouse PAULIN, IDE à l’USC, le 15/09/2007,
LOTZ Elisabeth épouse KREMER, SF en Maternité, le 20/07/2007.
À Sainte-Barbe
HOFFMANN Virginie épouse PFLUMIO, IBODE au Bloc Opératoire,
le 07/07/2007,
JEANMOUGIN Morgane épouse BRANDT, IDE en Réanimation,
le 04/08/2007,
SCHUCH Valérie épouse MEYER, IBODE au Bloc Opératoire, le 17/08/2007.
À La Toussaint
ADZINI Yawa épouse ADZINI, AS au SSR, le 21/06/2007.
≥Naissances
À Sainte-Anne
Ahmed, né le 25/05/2007, fils de Johanna BELAKHDAR,
AP en Pouponnière,
Jules, né le 15/07/2007, fils d’Hélène BREITWILLER, SF en Maternité,
Yann et Alexis, nés le 26/06/2007, fils de Joëlle DELAUTRE,
AP en Pouponnière,
William, né le 21/05/2007, fils de Carla HOMSI, IDE au Bloc Opératoire,
Sarah, née le 01/07/2007, fille d’Anne-Sophie LEROY, SF en Maternité,
Camille, née le 13/09/2007, fille de Sabine MAURY,
Puéricultrice en Pouponnière,
Léa, née le 09/07/2007, fille Véronique TROST, IDE en Oncologie.
À Sainte-Barbe
Diane, née le 24/07/2007, fille de Pierre BARSOTTI, Médecin-Chirurgien,
Sude-Nisa, née le 30/03/2007, fille de Hayriye COKSOLAK, ASH en Réa,
Lucas, né le 26/08/2007, fils de Stéphane HALLER,
IADE au Bloc Opératoire,
Mathilde, née le 06/08/2007, fille d’Isabelle MANGEONJEAN,
Responsable-IDE en Ophtalmologie,
Victoire, née le 10/06/2007, fille de Martial WAGNER,
IDE au Bloc Opératoire.
À Béthesda
Eva, née le 15/09/2007, fille de Laetitia PREVOST, IDE en Dialyse,
Chloé, née le 05/09/2007, fille de Christelle SCHOENY,
Préparatrice en Pharmacie.
≥Au revoir...
À Sainte-Anne
CLEVER Brigitte, Médecin Anesthésiste, le 04/06/2007,
HUMBLOT Sophie, Médecin Interniste, le 02/09/2007,
KIEFFER Stéphanie, Auxiliaire de Puériculture en Pouponnière,
le 23/02/2007,
UNBEKAND Noëlle, IDE à l’USC, le 14/03/2007,
URSAT Stéphanie, Sage-Femme, le 18/06/2007.
À Sainte-Barbe
ABBRUCIATI Josée, IDE au Bloc Opératoire, le 31/07/2007, (retraitée),
CHEMORIN Claude, Médecin-Chirurgien, le 30/06/2007, (retraité),
COLLADO Emilie, IDE à l’EMR, le 31/08/2007,
HECKEL Stéphanie, IDE en Gastro-Entérologie, le 20/06/2007,
MEYER Rachel, IDE à l’ORL, le 14/09/2007,
WINLING Geneviève, AS en Chirurgie Digestive, le 30/09/2007, (retraitée),
WOLFF Anne, IDE en Gastro-Entérologie, le 30/06/2007.
À Béthesda
ARMENIA Cécile, IDE en Dialyse, le 25/07/2007,
BANKHAUSER Sophie, IDE à l’USC, le 14/07/2007,
BECKRICH Caroline, IDE en Dialyse, le 18/08/2007,
BEYER Sophie, IDE en Dialyse, le 30/09/2007,
GUILLARD Sylviane, IDE en Dialyse, le 31/07/2007,
HEGE Christiane, Responsable IDE, le 06/07/2007,
LENCLUD Camille, IDE en Dialyse, le 31/07/2007,
LERGENMULLER Peggy, IDE à l’USC, le 04/07/2007,
NEBIA Abderrahim, IDE à l’USC, le 30/09/2007.
SINGER Frédérique, IDE en Dialyse, le 08/07/2007.
À Saint-Luc
DROGUE Nicole, Pharmacienne, le 30/06/2007,
SIAT Céline, IADE au Bloc Opératoire, le 27/08/2007.
À La Toussaint
DEVILLIERS Christophe, AS au Long-Séjour, le 30/09/2007,
HAMOUDI Nadia, AS au Long-Séjour, le 30/09/2007,
POCHET Marc, IDE au SSR, le 22/08/2007.
À l’IFSI
CHAVANNES Pierre, Formateur, le 03/09/2007,
ISENMANN Pierre, Conseiller de Formation, le 30/06/2007, (retraité).
la lettre
JOURNAL D’INFORMATION DU GROUPE HOSPITALIER SAINT-VINCENT
K
ÉDITORIAL
Saint-Vincent
>OCTOBRE 2007
D
>P. 11 : LES 10 ANS
DE LA RÉSIDENCE SOCIALE
>P.6-7 : LE PÔLE DE NÉPHROLOGIE
... Au revoir...
Cet air, c’est peut-être
cette petite musique apportée
par chacun auprès des malades
et qui dit que
« le bonheur est possible »
Le problème de la vie consiste à ralentir le temps.
Au moment de quitter Strasbourg et la Fondation Vincent de Paul, c’est à
cela que je pense. Cinq ans déjà ! Les mois sont passés comme des
éclairs. On a fait beaucoup ensemble, résolu nombre de situations institu-
tionnelles complexes, d’autres demeurent, certains pointant le bout du
nez pour demain.
Un bilan ne sert à rien, sauf à s’auto-satisfaire.
En revanche, demeureront des connivences fortes avec quelques-uns :
ils m’auront aidé à grandir.
De quoi demain sera fait ? Je ne sais, ni pour vous, ni pour moi. Tout
juste peut-on esquisser quelques traits. Même si ce ne fut pas toujours
simple, j’ai pu avoir avec le corps médical des échanges francs et
directs. Celui-ci est au cœur du Groupe Hospitalier Saint-Vincent et il
aura, à l’avenir, à poursuivre sa réflexion médico-économique, ainsi que
sa recherche d’innovation thérapeutique. Les sociétés modernes sont
ainsi faites qu’elles cumulent l’individu roi, son vieillissement et une
crise majeure des financements. Il ne faut pas se voiler la face : les équi-
pes médicales qui gagneront seront celles qui s’attraperont la question
du rapport qualité de la prise en charge médicale / écoute de l’usager /
vigilance médico-économique.
Ce qui est évident et capital pour les médecins, l’est aussi pour le corps
infirmier et l’ensemble des acteurs du Groupe Hospitalier Saint-Vincent.
On peut ronchonner sur la T2A, l’accréditation, la technocratisation de la
santé. Ils font partie de notre horizon. Être vieux, c’est penser que c’était
mieux avant.
Cinq années à piloter le Groupe Hospitalier Saint Vincent me l’ont appris :
ces défis là, nous pouvons et savons les relever. Sans doute parce que
nous puisons nos forces dans autre chose que le faire et le dire.
On respire « un certain air » au Groupe Hospitalier Saint-Vincent. Il suffit
d’aller gambader ailleurs pour s’en rendre compte. Cet air, c’est peut-
être cette petite musique apportée par chacun auprès des malades et
qui dit que « le bonheur est possible », malgré tout.
Au revoir, et si vous passez du côté de Lille ou de St Malo…
DJACQUES-YVES BELLAY
> P.4 : LE PROJET ORBIS
Le Projet Orbis
N°58

la lettre Saint-Vincent > N°58 / OCTOBRE 2007
P. 02 P. 03
≥La commission des Relations avec les Usagers et
de la qualité de prise en charge (CRUQ) a organisé
une demi-journée de travail pour mieux comprendre
les évolutions de l’Hôpital ces dernières années.
Monsieur Gérard SACCO, conseiller Général des Etablissements
de santé (professionnel de Santé à la disposition du Ministère
pour des missions d’appui et de conseil dans les établissements)
est intervenu à titre personnel pour nous présenter son analyse
de l’Hôpital d’aujourd’hui :
>L’hôpital dans la tourmente : image du rafting, descente
d’un torrent inéluctable avec un parcours difficile et dans
un environnement compliqué. Une institution séculaire, avec
de nombreuses cultures professionnelles différentes, une
institution à caractère hybride : administration/entreprise.
>L’hôpital bousculé : par les évolutions technologiques, juri-
diques, sociologiques et démographiques, où les cadres
intermédiaires connaissent des problèmes majeurs, étant
au cœur de toutes les préoccupations du monde hospitalier.
>L’hôpital interpellé : sur ses coûts, sur la sécurité, sur la
qualité, mais aussi sur sa performance, son efficience.
>L’hôpital en analyse pour trouver des organisations nouvelles,
en recherche de productivité, pour manager le changement.
Un enjeu : « faire concorder les horloges » en mettant le
temps du patient au centre de tous les autres temps, celui
des médecins, de la direction, de l’État.
>L’hôpital sous contrat : contractualisation externe (CPOM)
mais aussi interne, qui implique dialogue et coopération.
>L’hôpital maîtrisé, par rapport à la concurrence, au mana-
gement, au dialogue social et sociétal, aux logiques de la
T2A , mais aussi dans la transparence de sa communication.
Et pour conclure cette citation qui nous interpelle :
« Préoccupé par ses propres besoins, l’hôpital évolue dans un uni-
vers parallèle à celui de ses patients » J.G. BALLARD
À la suite de cette présentation, Sylvie CHAPUIS, Directrice
des services de soins, a retracé le panorama des Droits des
patients de 1789 à nos jours.
Si les droits fondamentaux restent identiques, depuis la
déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et
la Constitution de 1948, on constate dans ce domaine
comme dans d’autres, une accélération récente des textes
qui traitent des droits du patient :
>Charte du patient hospitalisé en 1995
>Lois de bioéthique en 1994 et 2004
>Loi du 4 mars 2002
>Loi Léonetti 2005
L’évolution principale que traduisent ces textes est le droit
du patient à savoir et à décider jusqu’à la fin de sa vie.
La matinée de travail s’est achevée par une table ronde réu-
nissant le Docteur Jean-Philippe WAGNER, oncologue,
Monsieur Gérard SACCO et Monsieur Jacques-Yves BELLAY,
directeur du Groupe Saint-Vincent, sur «l’Hôpital du futur ».
Une vision de l’hôpital de demain intégrant les évolutions
médicales en cours, s’est dessinée autour de 3 pôles princi-
paux : la maternité, la gériatrie et la chirurgie « prothétique »
ou « bionique » comme l’appellent différents auteurs. Elle
s’organise autour de plateaux techniques optimums et opti-
misés, une hospitalisation pour les pathologies aiguës , et
des solutions à trouver pour abattre les murs, entre médical
et social pour la prise en charge des pathologies chroniques
type Altzheimer, diabète, etc…., dont on peut prévoir l’explo-
sion.
Bien sûr, la qualité de l’hôtellerie et les parkings (accès tram -
train) resteront annexes mais essentiels dans ce schéma.
Ces évolutions sont à penser dans une évolution de l’individua-
lisme de tous les acteurs, et de recherche d’autonomie.
La matinée de travail très riche, s’est prolongée autour d’un
buffet, où la parole a continué à circuler.
Un grand merci à tous pour leur participation active.
DSYLVIE CHAPUIS
DDDD
≥ L’ÉVÉNEMENT
« Regard sur l’hôpital »
Une conférence pour les usagers
Elle a réuni le 28 septembre des cadres soignants, des médecins,
des enseignants de l’IFSI et aussi des représentants des usagers.
DDDD
≥ L’ÉVÉNEMENT
Plan Blanc /Pandémie Grippale
« Mettre le temps du patient
au centre de toutes les autres contraintes »
Le risque La circulation en Asie du sud-est, depuis quelques années, du virus de la grippe aviaire laisse craindre l’apparition d’un nouveau virus,
le virus de la pandémie grippale. Si cet évènement survient, il s’agira d’un virus mutant, à transmission interhumaine, contre lequel la population ne pos-
sèdera pas d’anticorps. Par conséquent, 15 à 30% de la population risquera d’être atteinte avec un taux de mortalité de 1%.
L’organisation régionale
Pour faire face à un afflux de patients grippés, le Ministère de la Santé et des Solidarités a mis en place le plan blanc pandémie grippale. Celui-ci doit se
décliner dans chaque établissement de soins en s’inscrivant dans une organisation régionale qui, pour l’Alsace, est la suivante :
Niveau 1 1 à 10 cas régionaux : Hospitalisation de tous les grippés aux HUS
Niveau 2 10 à 190 cas régionaux : • Hospitalisation de tous les grippés aux HUS
• Les établissements de santé deviennent hôpitaux d’accueil pour les patients non grippés critiques des HUS
Niveau 1 190 cas régionaux : Les HUS sont saturés, les établissements de santé ouvrent des secteurs d’hospitalisation HDV et restreignent toutes
les hospitalisations aux patients critiques : grippés (HDV) et non grippés (BDV)
Abréviations BDV = Secteur de basse densité virale CCP = Consultations périnatales de proximité
HDV = Secteur de haute densité virale HUS = Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Le plan blanc du Groupe Saint-Vincent (par niveau en fonction du nombre de cas de pandémie grippale)
• Idem niveau auquel s’ajoute :
• Déprogrammation et renvoi à domicile des patients non grippés dont l’hospitalisation n’est pas impérative
pour accueil des patients non grippés du CHU
>SA : Chirurgies plastique, gynécologique et orthopédique
>BE : Chirurgie urologique
>SB : ORL, ophtalmologie, chirurgie générale et digestive
• Idem niveaux 1 et 2 auxquels s’ajoutent :
• Modification du tri : Validation + régulation par médecin GHSV
• Modification des secteurs HDV : Ouverture de SB comme secteur HDV sauf administration
• Prise en charge des grippés :
>Idem niveaux 1 et 2 pour prise en charge initiale maternité, dialyse, policlinique SL et CPP SL
>Modification concernant l’hospitalisation :
• Grippés non graves : Retour à domicile
• Grippés graves : Hospitalisation non plus aux HUS, mais à SB (SA pour CPP SL et obstétrique SA)
• Idem niveau 3 auquel s’ajoutent :
• Modification des secteurs HDV : Ouverture de services d’hospitalisation HDV sur chaque site (Cf. annexe) :
>SA : Chirurgie (27 lits)
>T : Santé mentale (16 lits) + SSR (29 lits)
>BE : Médecine D (33 lits)
>SL : Court séjour (17lits)
• Prise en charge des grippés :
>Idem niveau 3
>Modification pour grippés graves : Hospitalisation HDV sur site (SA pour CPP SL)
DDOCTEUR BÉATRICE POTTECHER,
ERIC DEL BONO
Clinique
GHSV
SA
BE
SB
T
SL
Services HDV
Accueil -Tri
S. naiss.
Maternité
Poup 1
Dialyse
Radiologie
Hosp ≠ Mat
Dialyse
Radiologie
Hospit.
Hospit.
Poli
CPP
Radiologie
Hospit.
Localisation du secteur HDV selon niveau de risque
0 1 2 3 4
Tente Accueil et Tente Tri
Ambulatoire
AURAL
1 salle dédiée
Chirurgie
AURAL
1 salle dédiée
Médecine D
Tout sauf administratif
Santé mentale / SSR
Côté « urgences » du court séjour (CS)
1 salle dédiée Extension CS
Secteurs protégés de haute densité virale par site pour les niveaux d’alerte régionale de 1 à 4
Niveau 0
> 1 cas national
Niveau 1
> 1 à 10 cas régionaux
Niveau 2
> 11 à 190 cas régionaux
Niveau 3
> 190 cas régionaux
Niveau 4
> 120 cas à SB
• Limitation des visites : Registre quotidien des visites autorisées
• Activation des tentes d’accueil et de tri
• Restriction des accès cliniques : Fermeture des portes
• Tri des patients : Validation + régulation par le SAMU
• Prise en charge des grippés :Tous les grippés devraient être hospitalisés aux HUS pour observation,
mais le Groupe Saint-Vincent fait les choix suivants :
>Dialyse (SA-BE), maternité (SA), policlinique (SL) et CPP (SL) : Prise en charge initiale GHSV
puis hospitalisation secondaire aux HUS
>Autres : Hospitalisation d’emblée aux HUS
• Réinformation sur les procédures
• Montage des tentes d’accueil
• Montage des tentes ou locaux de tri
• Signalisation entrées, ascenseurs, escaliers, services HDV
• Stocks prévisionnels (pharmacie - économat) en prévision possible du niveau 1
Se préparer

la lettre Saint-Vincent > N°58 / OCTOBRE 2007
P. 04 P. 05
DDD
<L’AVANCÉE
Le projet ORBIS
Le projet de mise en place du
« Dossier Patient Informatisé »
vous a été présenté dans le numéro 54
≥Le 25 juin 2007, les services « pilotes » de Chirurgie générale
et digestive de Sainte Barbe ont commencé à utiliser l’outil Orbis en
fonctionnement réel. Ceci a permis de préciser les points d’améliora-
tion ainsi que de vérifier le fonctionnement en environnement réel de
l’application (sa fiabilité et sa rapidité).
Les fonctions offertes par Orbis dans le palier 1 sont essentielle-
ment des fonctions de gestion de RDV pour les consultations
externes et de gestion de la documentation médicale. Ceci consti-
tue une première étape avant la mise à disposition de fonctions de
prescriptions, de gestion des plannings de bloc opératoire, etc...
Les enjeux de ce premier déploiement sont principalement l’appren-
tissage et l’adhésion à l’utilisation d’un dossier patient informatique.
Construction
Saisies structurées et logiques des informations médicales
Partage
Faciliter la gestion du dossier patient au sein d’une UF et inter-UF
Optimisation
Réduire les flux papier
Sécurité
Améliorer la traçabilité, la sécurité du dossier patient au GHSV
La stratégie de mise en place de l’outil a donc été évalué service
par service sur la base des critères présentés ci-dessous :
Critères de pertinence (par ordre de priorité décroissante) :
Critères de pertinence (par ordre de priorité décroissante) :
•Les projets périphériques en cours
(déménagement, réorganisation, accréditation,….)
•Les fonctions apportées par Orbis dans le palier 1
comparées au fonctionnement actuel du service concerné
•La structure des équipes médicales et des secrétariats
(libéraux et salariés)
•Les flux de documents médicaux générés par/vers
les cabinets de ville (nécessitant un accès distant sécurisé spécifique).
•Les interdépendances entre les services
(exemple : chirurgie / anesthésie)
À noter que le chantier de mise en place d’un accès sécurisé per-
mettant les échanges de données avec les cabinets de ville pour
les médecins libéraux du GHSV est actuellement à l’étude. Ce
chantier a dû être complètement revu car de nouvelles réglemen-
tations viennent de voir le jour (décret confidentialité du 15/05/07).
Dès que ce chantier aura abouti, nous formerons l’ensemble des
médecins concernés dans le cadre d’un palier 1 bis.
La communication
Des réunions de communication se tiendront sur chaque site
pour présenter les services concernés par le déploiement, les
populations formées ainsi que la logistique de formation dédiée.
Comment déployer ?
Le démarrage des services retenus se fera par site et de manière
décalée afin de :
• delisserleschargesdeformationetdesupportaudémarrage
• d’assurer un temps suffisant de support de proximité aux utilisateurs
• decapitalisersurlespremièresmisesenservice
• de corriger et ajuster les fonctionnalités d’ORBIS
La démarche de déploiement
Le planning de mise en œuvre
Quelques chiffres : environ 240 personnes à former
sur 35 journées de formations
L’ équipe de projet : l’équipe de projet se renforce dès à présent et pour les
paliers 2 et 3 à venir de référents métier :
Pour les secrétariats :
•Karin SANCHES (Béthesda) •Florence DELONG (Ste Barbe)
•Claudine FILLINGER (Béthesda) •Catherine EY (La Toussaint)
•Marlène DREYER (Ste Anne) •Martine FINCK (Ste Anne)
•Pascal STUTZMANN (Ste Anne) •Delphine HUBER (Béthesda)
•Sandrine KANY (Ste Barbe) •Rachel KIENTZI (St Luc)
•Yvonne NSENGIYUMVA (Toussaint)
•Dr Marie Claude PADELLEC (St Luc)
•Martine HENNING (St Luc)
Les rôles et les missions des référents métiers :
•Formateur pour les populations dites « regroupées » (IDE, Kiné, …)
•Assistance aux utilisateurs lors des phases de démarrage
•Expert utilisateur relais avec l’équipe de projet concernant l’évolution Orbis
•Expert métier dans le cadre des phases d’étude et de préparation des paliers 2 et 3
Nous comptons sur l’appui et l’enthousiasme de tous pour que ce changement
d’envergure se réalise dans les meilleures conditions possibles et avec succès.
La stratégie de déploiement
Qui déployer ?
DQue faisons-nous ?
Auto-évaluation de Mai à Décembre 2007 (7 groupes de synthèse, 78 personnes impliquées,
56 réunions prévues dont 27 réalisées)
Engagement dans 18 évaluations de pratiques professionnelles (EPP) (18 groupes de travail,
77 personnes impliquées dont 35 médecins et 68 réunions réalisées à ce jour)
DOù en sommes-nous ?
Auto-évaluation : 203 critères analysés sur 454 (55% restant à analyser)
Evaluation des pratiques professionnelles : sur les 18 groupes de travail
• 3 groupes de travail en sont à l’élaboration des grilles d’évaluation
• 5 groupes de travail commencent leur évaluation
• 7 groupes de travail ont défini leur plan d’actions d’amélioration
• 1 groupe de travail est arrivé à la mise en œuvre de son plan d’actions
• 2 EPP concernant l’HAD vont démarré leur projet en Octobre 07
DRésultats
Comparatif des résultats des cotations de 70 établissements en France (18639 cotations)
par rapport aux cotations déjà définies par le GHSV sur les 203 critères analysés.
Les résultats des différents groupes de travail seront présentés aux instances ainsi que
lors d’une conférence au personnel.
DEchéancier
>Fin 2007 •Réunions régulières du Comité de pilotage certification pour relecture du rapport et élaboration
et mise en œuvre d’un plan d’actions d’améliorations suite aux écarts relevés
>Janvier 2008 •Envoi du rapport à la HAS avec le planning de la visite
>Février 2008 •Préparation des fiches de synthèse sur la sécurité
•Préparation de la présentation des EPP aux experts visiteurs
•Mise à disposition de la documentation aux experts visiteurs et organisation de la visite
>Mars 2008 •Visite des experts visiteurs
Auto-évaluation
EPP
Auto-évaluation
EPP
Auto-évaluation
EPP
Points positifs
• la place du patient et de son entourage,
• la politique du système d’information et du dossier du patient,
• la politique d’amélioration de la qualité et de gestion des risques
et son organisation,
• le dialogue social,
• les fonctions hôtelières,
• les approvisionnements,
• le programme de surveillance et de prévention du risque infectieux,
• l’évaluation de la politique des ressources humaines, des fonctions
logistiques, du dossier patient, de la satisfaction du patient et de la
mise en oeuvre des orientations stratégiques.
Points critiques à améliorer
• la politique de communication interne et externe,
• la formation continue médicale,
• la confidentialité des informations patient,
• l’accueil et les locaux adaptés aux handicaps,
• la formation des professionnels aux droits des patients,
• l’amélioration de l’adéquation de l’affectation des professionnels
aux compétences requises,
• la participation à des réseaux de santé,
• l’évaluation de l’efficacité de la gestion des risques et des vigilances,
• l’évaluation des délais d’attente, de l’implication des correspondants
externes, de la satisfaction des utilisateurs du système d’information.
DDDD
≥ L’ÉVÉNEMENT
Certification V2 /J-6mois

La Dialyse à Béthesda,
un service novateur
Au mois de Juin dernier, le service de dialyse de la clinique Béthesda a présenté
au 29ème Congrès National Infirmier de l’AFIDTN (Association Française des
Infirmier(e)s de Dialyse Transplantation et Néphrologie) une façon innovante
de ponctionner les FAV (Fistule Artério-Veineuse) à l’aide d’un échographe.
la lettre Saint-Vincent > N°58 / OCTOBRE 2007
P. 06 P. 07
DDDD
≥ENSEMBLE
Le pôle de néphrologie
Clinique Béthesda
Qu’est ce que la dialyse ?
DLa dialyse permet de débarrasser le sang des déchets (toxines) et de l’eau en
excès qui s’accumulent dans le corps à cause de l’insuffisance rénale.
Deux solutions :
•Fistule artério veineuse (FAV) :
La fistule artério-veineuse est créée chirurgicalement en abouchant une veine du bras
dans une artère. Elle permet ainsi d'augmenter le débit sanguin et d'obtenir une dila-
tation veineuse importante pour permettre un traitement par hémodialyse (circuit
extra corporel).
•Le cathéter :
Est un «tuyau souple» introduit dans une grosse veine pour permettre d’aspirer le
sang, de le faire passer dans un circuit de circulation extra corporelle pour être épuré
avant d’être restitué (= injecté) au patient.
DLa mise sous dialyse est une prescription médicale. Une fois le patient informé,
il s’agit de lui montrer, de lui expliquer la prise en charge au service (UTIREC). Les
patients et/ou leur famille peuvent bénéficier (s’ils le souhaitent) d’une information
pré dialyse qui a lieu une fois par trimestre.
Cette réunion consiste à leur donner des informations, en équipe pluri disciplinaire,
sur leur pathologie (rappel), les différents modes de dialyse (hémodialyse, DP), la
diététique et la prise en charge sociale. Pour laisser au patient le choix de son mode
de dialyse en tenant compte de sa vie familiale, sociale et / ou professionnelle.
La dialyse à Bethesda c’est tout d’abord la gestion de 140 patients chroniques pris
en charge par 4 médecins, 32 IDE, 2 AS (au premier octobre) et une équipe d’ASH.
Les patients sont répartis sur cinq roulements, à raison de trois séances par
semaine dont la durée varie entre quatre et huit heures pour les roulements de nuit.
Ce suivi, très spécifique au service, entraîne une relation privilégiée mais parfois
difficile voire envahissante.
Ces 140 patients ne bénéficient pas tous de la même technique de dialyse. Le choix
de cette technique se fait selon le souhait de patient mais essentiellement au
regard des indications médicales posées.
Nous proposons :
• la dialyse péritonéale (Aural)
• l’hémodialyse en centre lourd (GHSV)
• l’unité médicalisée (Aural)
• l’autodialyse
Le patient peut passer d’une technique à l’autre selon les étapes de sa pathologie.
D’où l’importance de notre collaboration avec l’Aural. Collaboration qui se situe tant
dans la gestion des ressources humaines (l’ensemble des infirmiers est salarié du
GHSV), que dans la prise en charge des patients (projet médical et projet de soins).
Cette prise en charge globale se fait au sein du pôle de néphrologie qui comprend
également une unité d’hospitalisation, qui prend en charge les patients quelque soit
leur pathologie associée.
Outre les 140 patients, nous accueillons tout au long de l‘année des vacanciers. Nos
patients aussi voyagent. Ces échanges permettent une certaines flexibilité de cha-
cun d’entre nous. Nous sommes soumis à comparaison, certains de nos patients
n’hésitent pas à faire un « Michelin » des centres de dialyse.
DTout a commencé il y a maintenant 4 ans, avec la créa-
tion d’un « Comité Fistule » regroupant 8 infirmières et 2
néphrologues du service de dialyse de la clinique Béthesda.
Ce groupe de réflexion travaille sur l’amélioration des ponc-
tions de FAV, acte essentiel pour une séance de dialyse effi-
cace et le confort du patient.
Au fil du temps et à l’initiative des néphrolo-
gues, le comité a testé, en avant première en
France pour des infirmières, une nouvelle
technique de ponction : la « ponction écho-
guidée ». Celle-ci consiste à l’utilisation d’un
échographe pour ponctionner au plus juste les
FAV.
Suite à cette nouvelle pratique, une étude a
été menée au sein du service. Le bilan de
l’utilisation de l’échographe par des infirmiè-
res étant très positif, l’équipe obtenant 100%
de réussite des ponctions avec l’échographe,
il nous a été proposé de venir présenter notre
travail lors du congrès annuel infirmier de
dialyse se tenant cette année à Marseille.
Caroline DIETSCH et Aline SCHWENTZEL, 2
infirmières du comité, ont donc fait découvrir
à une assemblée attentive et très intéressée
la « ponction écho-guidée ».
Suite à cette présentation et à l’engouement
qu’elle a suscité, de nombreux contacts ont
été pris avec d’autres centres de dialyse en
France et même en Europe. Le comité est
actuellement en train de travailler sur la pos-
sibilité de créer des « formations à la ponc-
tion écho-guidée » à Béthesda et plus tard à
Sainte-Anne, faisant ainsi du service de dia-
lyse un service pilote sur le sujet.
DSÉVERINE RUST
IDE EN DIALYSE
DVécu d’une patiente
du centre de dialyse
Mme U est arrivée chez nous pour sa pre-
mière séance à la mi août.
« J'ai appris la nécessité de me faire dialyser
une semaine avant de venir chez vous. J'ai
essayé de faire retarder cette première séance
le plus possible tellement j'appréhendais. Le
premier jour, la peur au ventre, je me suis
assise en salle d'attente. Puis on a appelé mon
nom. Une infirmière souriante m'a accueillie et
installée dans un lit. J'étais tellement stressée,
que la machine sonnait tout le temps : mon
débit sanguin était trop bas.
Au fil des séances, mon appréhension a diminué
mais j'ai toujours peur de la piqûre (ponction de
la fistule). Aujourd'hui je suis à mon deuxième
mois de dialyse et je me rends compte que ce
n'est pas aussi terrible que ça même si ce n'est
pas facile pour autant.
Je viens trois jours par semaine, les quatre
autres jours sont pour moi des moments de
répit, j'en profite un maximum. Je fais même
des choses que je ne faisais pas avant. Je
suis moins fatiguée qu’avant. Les séances se
passent d'autant mieux que le personnel est
chaleureux, gentil et à l'écoute. Dès le début
j'étais étonnée de toutes les précautions qui
étaient prises (hygiène, surveillance des
bilans, ...) »

la lettre Saint-Vincent > N°58 / OCTOBRE 2007
P. 08 P. 09
DDDDDDDDDDDD
< LES MÉTIERS DE SAINT-VINCENT
Dr Françoise PIERI,
pharmacien à Sainte -Barbe
et Toussaint
1/ Comment se déroule votre journée
en pharmacie ?
Il est particulièrement difficile de répondre
car en pharmacie, aucune journée n’est à
aucune autre pareille. L’ennui de la routine,
je ne sais pas ce que cela signifie. L’imprévu
pointe souvent son nez.
Pour schématiser, ma mission essentielle
quotidienne consiste à assurer avec les pré-
parateurs en pharmacie, la dispensation des
médicaments et des dispositifs médicaux
aux différents services de soins.
Ceci implique en amont des activités de ges-
tion (achats, approvisionnements, gestion
des stocks et des budgets), et d’information
médicothérapeutique sur le bon usage des
médicaments .
En dehors de cette activité, je suis amenée
plusieurs fois par semaine à participer à
des réunions pluridisciplinaires.
J’essaie dans la mesure du possible de
réserver un temps dans la journée pour la
lecture de revues pharmaceutiques.
2/ Quelles grandes évolutions a connu
votre métier ces dernières années ?
Au cours des dernières années, le métier
de pharmacien hospitalier a connu de pro-
fondes transformations. Toujours respon-
sable et spécialiste du médicament, ses
missions ont cependant évolué.
Autrefois essentiellement gestionnaire et
chargé de faire appliquer les dispositions
réglementaires, il est de plus en plus impli-
qué dans des activités transversales pluri-
disciplinaires : participation à différentes
commissions, rôle dans les vigilances, …
Des responsabilités nouvelles sont appa-
rues : la stérilisation, la reconstitution des
cytotoxiques.
Les exigences du contrat de bon usage et
de la T2A l‘ont conduit à faire évoluer sa
compétence dans des secteurs différents
de celui du seul médicament : informatisa-
tion du circuit du médicament, traçabilité,
démarche qualité (élaboration de protoco-
les, de fiches de bon usage ).
Dans le même temps, les échanges entre
le personnel pharmaceutique et le corps
médical et soignant sont devenus plus fré-
quents et fructueux.
3/ Aujourd’hui, comment voyez-vous
votre métier dans quelques années ?
Le pharmacien hospitalier sera de plus en
plus sollicité pour assurer la traçabilité
des produits pharmaceutiques de la fabri-
cation par l’industriel jusqu’à son utilisa-
tion pour le malade, traçabilité qui aura le
double rôle d’assurer une maîtrise des
coûts et un augmentation de la sécurité.
Il pourra avec l’informatisation prochaine
du circuit du médicament assurer la vali-
dation pharmaceutique de la prescription .
De façon globale, l’implication du pharma-
cien hospitalier sera de plus en plus forte
pour prévenir au maximum la iatrogénie
médicamenteuse.
Et dans cet objectif, différentes pistes
d’avenir s’offrent à lui : développement de
la pharmacie clinique, plus de présence
dans les services, mise en place de l’édu-
cation thérapeutique au lit du malade,
avant sa sortie de l’hôpital, travail en
réseau avec ses confrères d’officine pour
assurer la continuité des soins.
Être ou ne pas être
pharmacien hospitalier...
DDDD
<INTERVIEW
DÊtre pharmacien hospitalier… Qu’est-ce qui
fait la particularité de notre exercice ? Et si
nous devions l’expliquer à un public non initié,
comment décrire un pharmacien hospitalier ?
Il y a dans notre profession bien des aspects
différents qui se complètent et parfois s’oppo-
sent.
D’une part, la gestion. Au sens large, on peut y
inclure tous les aspects matériels, depuis le
choix des médicaments et des dispositifs
médicaux stériles en collaboration avec le
corps médical et soignant, en passant par les
achats avec les mises en concurrence,
l‘approvisionnement et la gestion des stocks
tant dans les pharmacies que dans les unités
de soins, jusqu’au suivi des consommations et
les tableaux de bord qui en résultent.
Et puis, il y a l’aspect scientifique. Au premier
chef, la pharmacie clinique qui s’intéresse
principalement à l’optimisation de la thérapeu-
tique médicamenteuse, tout en assurant la
qualité de la distribution et de la dispensation
des produits pharmaceutiques. La validation
de l’ordonnance est le fondement même de
notre métier : respect des contre-indications,
des posologies en fonction de l’état physiopa-
thologique du patient, gestion des éventuelles
interactions médicamenteuses et prévention
des précautions d’emploi et mises en garde.
Mais aussi tous les aspects de pharmacotechnie
(préparations, stérilisation, contrôle de la qua-
lité des eaux de dialyse, …) qui nécessitent une
formation pointue. Nos activités prennent aussi
en compte une participation active au sein des
différentes instances hospitalières (Comedims,
CLIN, CLUD, …). De nouveaux domaines d’acti-
vité transversaux ont émergé ces dernières
années, telles les vigilances sanitaires, la lutte
contre l’iatrogénie médicamenteuse et tout ce
qui concerne la qualité des soins, avec notam-
ment la mise en place des contrats de bon
usage et en particulier l’informatisation du cir-
cuit des produits pharmaceutiques.
Il faut également souligner l’importance de la
formation / information professionnelle, pour
soi-même ou à destination de nos collabora-
teurs sur le bon usage des produits pharma-
ceutiques.
Alors parmi tout cela, où est l’essentiel ? A
notre sens, c’est justement cette polyvalence :
ce qui fait la force de notre profession, c’est pré-
cisément d’être capable d’être aussi compé-
tents depuis le coût d’achat des produits de
santé jusqu’à leur bon usage, en passant évi-
demment par la sécurisation des modalités
d’approvisionnement. Et ce, dans le but d’ap-
porter aux patients les meilleures thérapeuti-
ques à un coût supportable pour la collectivité,
sur les principes de transparence et de traçabi-
lité, en veillant à limiter les risques iatrogènes.
Et tout ceci, nous le faisons avec l’aide d’une
équipe de préparateurs de plus en plus
investis dans leurs tâches.
DFRANCK COUTURIER
DDDD
< ENSEMBLE
Sainte-Barbe :
6 ans de travaux pour une inauguration
Deux juillet 2007, onze heures
Nous attendons Mme Annie PODEUR
Qui, du Ministère fut invitée
Pour, enfin ! inaugurer
Une certaine fébrilité se fait sentir
Pour les derniers préparatifs réussir
Sœur DENISE, Mr HEINRY, Mr BELLAY
Le CODIR et l’encadrement, à l’accueil sont préposés.
La plus ancienne et la plus nouvelle des soignants
Sur le parvis tendent le ruban
Tout est prêt pour ce moment fatidique
L’ inauguration de la clinique !
Devant l’assistance, Mme PODEUR le coupe avec élégance
Puis, dans le hall, vers l’exposition s’avance
« Sainte Barbe du XIX ème à nos jours » présentée
Par votre serviteur , désigné.
Par petits groupes, une visite guidée
Des services de soins est organisée
Pour présenter les belles réalisations
D’un chantier long…. si long….
Après les discours en salle de conférence
Et un bel hommage de reconnaissance
De Sœur DENISE aux acteurs impliqués
Dans le suivi du chantier
Un magnifique buffet
En salle de réunion nous attendait
Pour clore cette matinée
De fête annoncée.
DMARTINE SENGLER
L’ESCALE SAINT-VINCENT
L’Escale Saint-Vincent rouvre 5 lits « halte soin santé »
en prolongement de la clinique de la Toussaint
du 1er novembre 2007 à fin janvier 2008,
en attendant la fin des travaux de l’Escale à Sainte-Barbe.
Une équipe salariée de travailleurs sociaux assurera
la prise en charge 24h/24 avec l’aide du Groupe Saint-Vincent.
Le chantier de Sainte-Barbe en quelques chiffres :
• Durée : 6 ans (Septembre 2000 - Septembre 2006) • Coût 12,15 millions d’euros
• 17 000 m2 rénovés • 2000 m2 rajoutés • 2/3 chambres individuelles
Madame Annie PODEUR, Directrice de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS)
Monsieur AOUN, Directeur Régional de l’Hospitalisation d’Alsace.
 6
6
1
/
6
100%