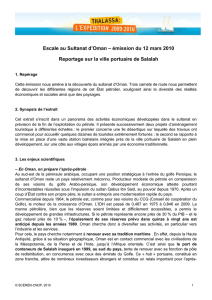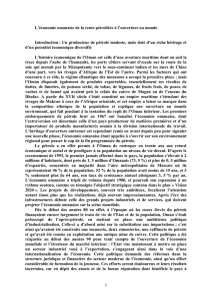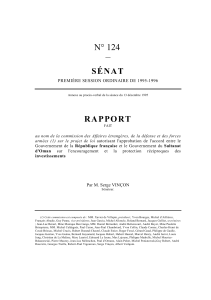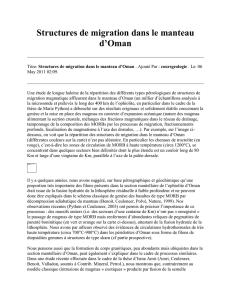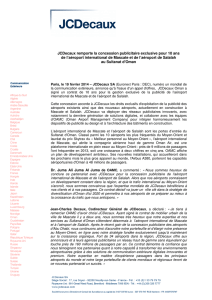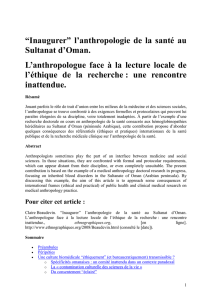L`économie omanaise de la rente pétrolière à la

1
L’économie omanaise de la rente pétrolière à la mondialisation
Marc Lavergne
L’histoire économique de l’Oman est celle d’une aventure maritime dont on suit la trace
depuis l’aube de l’humanité, les ports côtiers servant d‘escale sur la route de la soie qui
menait par la Mésopotamie vers le sous-continent indien et les mers de Chine d’une part, vers
les rivages d’Afrique de l’Est de l’autre. Parmi les facteurs qui ont concouru à ce rôle, le
régime climatique des moussons a occupé la première place ; mais l’Oman disposait
également de produits exportables, essentiellement ses récoltes de dattes, de limettes, de
poisson séché, de tabac, de légumes, de fruits frais, de peaux de vaches et de henné qui
avaient pris le relais du cuivre de Magan1 ou de l’encens du Dhofar. A partir du XVIè siècle
s’était constitué un empire maritime s’étendant des rivages du Makran à ceux de l’Afrique
orientale. Cet empire a laissé sa marque dans la composition ethnique de la population et
explique son ouverture au monde environnant, qui fait pendant à la tentation du repli de
l’Oman intérieur. Les premiers embarquements de pétrole brut en 1967 ont banalisé
l’économie omanaise, dont l’extraversion est désormais celle d’un pays producteur de
matières premières et d’un importateur de produits manufacturés. L’héritage d’ouverture
outre-mer est cependant remis en avant depuis peu pour signaler une nouvelle phase,
l’économie omanaise étant appelée à s’ouvrir sur son environnement régional pour passer le
cap de la fin programmée du pétrole.
Le pétrole a permis à l’Oman de rattraper en trente ans son retard économique et social
et d’assurer un niveau de vie décent à sa population, qui d’après le recensement de 1993, le
premier jamais effectué dans le pays, s’élevait à 2 millions d’habitants, pour près des trois
quarts omanais (plus de 0,5 million d’expatriés se concentraient en majorité dans l’aire
métropolitaine de Mascate où ils représentaient 46 % de la population). L’économie omanaise
a triplé de volume depuis 1980 et poursuit son expansion à un rythme soutenu. Les projets de
développement, souvent très ambitieux, focalisent l’attention autant sinon plus que les
réalisations, déjà souvent impressionnantes. Après l’ère des infrastructures débute celle des
grands projets industriels et de services, qui doivent projeter l’économie omanaise sur la scène
mondiale, comme en témoigne l’objectif stratégique contenu dans le plan « Vision 2020 ».
Dès le début des années 1980, à l’époque où les cours élevés du pétrole finançaient encore
largement le train de vie de l’Etat et de la population, Oman s’était préoccupé de l’après-
pétrole, en mettant en place une ambitieuse politique d’industrialisation. Celle-ci a d’abord
misé sur la substitution aux importations ; c’est ainsi qu’avaient été construits une meunerie,
deux cimenteries, une raffinerie de pétrole et qu’avait été remise en exploitation une antique
mine de cuivre. Cette politique a été réajustée au début des années 1990 pour tenir compte de
l’ouverture de l’économie mondiale et l’étroitesse du marché intérieur : l’Etat vise maintenant
à mettre en place un secteur industriel voué à l’exportation2, s’engageant ainsi dans la voie
d’une internationalisation de l’économie.
1Des tablettes cunéiformes mésopotamiennes du IIIe millénaire av. J.C font allusion à trois partenaires
commerciaux méridionaux : Malouha, Dilmoun et Magan. La localisation de ces « pays » a alimenté les
spéculations des archéologues jusqu’à ce que la multiplication des fouilles fasse progresser spectaculairement la
connaissance archéologique de cette partie du monde à partir des années 1970. Selon toute vraisemblance ,
Malouha se trouvait sur la côte occidentale de l’Inde et on peut identifier avec certitude Dilmoun à Bahrein.
L’identification de la péninsule omanaise avec Magan., le pays du cuivre, mais aussi des pierres semi-précieuses
dont les tablettes donnent la liste (hématite, stéatite, serpentine, diorite, jaspe) est maintenant admise par les
archéologues et les historiens.
2 Au total, Oman comptait, lors du recensement de 1993, 1416 entreprises industrielles employant plus de 26 000
personnes. Plus de la moitié de ces entreprises appartenaient au secteur des matériaux de construction, mais c’est
l’industrie de la confection qui employait le plus de main d’œuvre.

2
Cette politique demande des réformes dans la structure juridique et financière du secteur
moderne de l’économie, ainsi qu’un effort considérable de formation de la jeunesse. Ces
efforts seront douloureux et leurs résultats incertains, car en dépit des atouts et de la bonne
réputation dont bénéficie le pays à l’extérieur, nul ne peut garantir que le passage d’une
économie de rente à une économie de production et l’insertion de celle-ci dans le système
économique mondial se feront sans heurts. Le sultanat est, en effet, confronté à l’échéance
prochaine de la fin de sa production pétrolière que ne pourra pas totalement compenser
l’exportation gazière et à l’arrivée sur le marché de l’emploi d’une génération née à l’époque
de la prospérité, élevée dans le confort, mieux formée et surtout plus exigeante que ses aînés,
d’autant plus qu’elle compare son sort avec celui de ses voisins des Emirats ou d’Arabie. Ces
jeunes sont nombreux : au recensement de 1993, 52 % de la population avait moins de 15 ans
et 3 % seulement plus de 64 ans.
Le taux de croissance annuel de la population atteint 3,5 % selon les données du
recensement de 1993. Cette croissance est due à la conjonction d’un solde migratoire très
largement positif et d’un fort accroissement naturel. L’Oman avait jusqu’en 1980 un des taux
de fécondité les plus élevés au monde avec un nombre moyen de 7,8 enfants par femme. La
scolarisation féminine, l’accès à l’enseignement supérieur, le recul de l’âge au mariage, sont
des facteurs majeurs de la baisse spectaculaire de la fécondité omanaise depuis une vingtaine
d’années3. Selon les estimations gouvernementales de 1999, le nombre moyen d’enfants par
femme est désormais de l’ordre de 5. Mais compte tenu de la structure par âge, la natalité,
estimée à 3% en 1999, reste forte, tandis que les progrès sanitaires se traduisent par un baisse
de la mortalité, en particulier un recul rapide de la mortalité infantile, si bien que la croissance
démographique se poursuit à un rythme soutenu. En 1994, a été mis en place un programme
d’espacement des naissances dans l’intérêt de la santé de la mère : divers moyen contraceptifs
sont mis gratuitement à la disposition de la population dans les hôpitaux et les dispensaires, y
compris dans les localités les plus reculées.
Fig. 1 - Evolution de la population du Sultanat d'Oman (1977-1999)
0
500
1000
1500
2000
2500
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
en milliers d'hab.
Omanais Etrangers
Source : Ministère de l’Economie du Sultanat d’Oman.
3 Sur les déterminants proches ou lointains de l’évolution démographique omanaise, on lira l’article de
Y.Courbage, Baisse de la fécondité dans la péninsule Arabique, Population, 1995/2, pp. 415-446.

3
L’Etat omanais, conscient de ces défis, a établi une stratégie à long terme, fondée sur
l’investissement industriel, seul à même d’occuper la jeunesse. Mais l’industrie lourde, les
industries de transformation et les services financiers ne doivent pas faire oublier que l’Oman
n’est pas un mirage surgi des sables à la faveur de la richesse pétrolière. Agriculture, élevage,
pêche et commerce maritime ont été durant des siècles les piliers de l’économie et continuent
de manifester une grande vitalité. Alliées au tourisme, nouveau venu, ces spéculations
traditionnelles pourraient fournir de nombreux emplois et assurer une répartition spatiale et
sociale moins inégale du revenu national.
Une économie dépendante des fluctuations des recettes pétrolières
Le sultanat d’Oman a affiché en 1998 un P.N.B. de 10,6 Md $, soit 4 950 $/hab. Cet
indicateur place le pays entre le Brésil (4 630 $) et le Chili (4 990 $). Le graphique permet de
situer l’Oman dans un contexte macro-régional. Mais le P.N.B. présente une nette distorsion
avec le P.I.B. qui s’élevait en 1998 à 14,1 Md $, soit 5 772 $/hab., ce qui reflète la place des
entreprises étrangères dans le pays.
Fig. 2 - P.N.B. / hab. de l'Oman en 1999 en $
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
E.A.U. Bahrein Arabie
Saoudite Oman Egypte Jordanie Pakistan Inde Yemen
Source : Images économiques du monde

4
En 1970, le P.I.B./hab. s’élevait à 123 R.O. En 1990, il était de l’ordre de 2 000 R.O. et,
du fait de la croissance démographique rapide, cet indicateur n’a guère progressé depuis. Les
écarts que l’on constate d’une année sur l’autre prouvent le caractère aléatoire des recettes du
pays et la difficulté que peut éprouver l’Etat omanais à mettre en œuvre une politique de
développement à partir de recettes qui ne sont ni maîtrisées ni garanties : le prix moyen de
l’Omani Blend a ainsi chuté de 18,61 $/baril en 1997 à 12,09 en 1998, pour remonter à 16
environ en 1999.
Tabl.1 – P.I.B. et P.I.B./hab. de 1996 à 2000 (prix constants, base 1998)
ANNEE P.I.B. EN
MILLIERS DE R.O.
VARIATION INTER-
ANNUELLE EN % P.I.B. / HAB. EN R.O. VARIATION INTER-
ANNUELLE EN %
1996 4 923 + 2,9 2 178 - 3
1997 5 227 + 6,2 2 283 +4,8
1998 5 368 +2,7 2 347 +2,8
1999 5 316 - 1,0 2 286 -2,6
2000 5 566 +4,7 2 319 +1,4
Source : Economic Intelligence Unit, Country Profile, 2000-01
Il reste à signaler une constante majeure de l’économie omanaise, qui est la part
considérable du budget (40 % en moyenne) affectée à la défense et à la sécurité. La position
stratégique du Sultanat, qui contrôle l’accès au détroit d’Ormuz, mais aussi son histoire
troublée qui garde vivace le souvenir de menaces récentes sur l’unité et l’intégrité nationale
explique l’ampleur de ces dépenses, sans toujours justifier qu’elles obèrent si lourdement les
efforts de développement.
Les hydrocarbures, une ressources de base
Le pétrole, des réserves bientôt épuisées
Le pétrole assure encore 35 à 40 % du PIB et fournit 70 à 80 % des recettes budgétaires
et 75 % des exportations. Il a ainsi rapporté 7 Md $ à l’exportation en 2000, contre 5 en 1999.
Les réserves prouvées sont de 5, 5 Md de barils, soit 18 à 20 ans de production au rythme
actuel (autour de 900 000 barils/jour4), réparties sur 95 petits champs situés pour la plupart
dans l’intérieur du pays ; les principaux sont Yibal, Nimr, Fahud, Lekhwair et Bahja/Rima,
qui fournissaient 75 % du total en 1999. Un réseau d’oléoducs conduit le brut à la raffinerie5
et au port d’embarquement de Mina el-Fahl, près de Mascate. C’est un brut léger, de bonne
qualité, mais son coût d’extraction est élevé (3,5 $/baril), comparé aux autres gisements du
Golfe, à cause de sa grande profondeur (souvent plus de 5000 m). Un puits moyen produit
moins de 500 barils par jour, contre plus de 5 000 dans certains pays voisins. La société
Petroleum Development of Oman (PDO) fondée en 1974, assure 90 % de la production ; elle
4 De 685 000 b/j en 1990, elle est passée à 890 000 en 1999 et 910 000 en 2000.
5 Entrée en activité en 1982, sa capacité est passée à 80 000 B/j en 1987 pour couvrir les besoins intérieurs.

5
appartient pour 60 % à l’Etat omanais, 34 % à Royal Dutch Shell, 4 % à Totalfinaelf et 2% à
l’entreprise portugaise Partex.
Il semble que ces réserves ne puissent plus beaucoup être développées ; malgré les
investissements d’exploration-développement faits par l’Etat, les résultats sont minces (mise
en exploitation du champ de Burhan en juin 2000). L’exploration se poursuit désormais à un
rythme modéré, les retours sur investissement n’étant pas assurés. Aussi l’Etat est-il tenté de
pousser la production, pour engranger le maximum de recettes en période de cours élevés, de
manière à disposer des capitaux dont il a besoin pour assurer sa diversification économique.
Le gaz naturel, un relais du pétrole, mais pas une panacée
Le gaz devrait prendre la relève du pétrole, avec des réserves évaluées actuellement à 0,
76 billions de m3*, dont 0, 69 sous forme de gaz non associés. PDO, l’unique exploitant, fait
preuve d’un optimisme sans faille vis-à-vis des perspectives gazières : selon cette société, les
réserves prouvées devraient passer à 29 trilliards de pieds cubes en trois ans*, puis à 40 en
2015 ; le gaz fournirait alors 10 % du PIB, contre 20 % pour le pétrole. Pour parvenir à ce
résultat, l’Etat omanais a consenti des conditions très favorables aux opérateurs étrangers. Il
s’agit certes là encore d’une rente d’hydrocarbures, mais le marché de ce produit est très
différent de celui du pétrole, puisqu’il repose pour une large part sur des contrats à long
terme, à prix fixe, de gaz liquéfié, dont la production demande la mise en place d’installations
lourdes et coûteuses. Produit beaucoup moins sujet à la spéculation, le gaz naturel est présenté
comme l’énergie de l’avenir, car moins polluant, donc beaucoup plus attractif pour les pays
industrialisés.
Entrée en production en 2000, la nouvelle usine de GNL de Qalhat, près de Sour , a
constitué le plus important projet de développement du pays et l’un des plus vastes projets de
ce type au monde. Elle est alimentée par gazoduc depuis le gisement de Saih Rawl, à 360 km
dans l’intérieur et possède les deux plus grands trains de liquéfaction du monde, d’une
capacité totale de 6, 6 Mt/an. Ce gigantesque projet industriel, d’un coût de 2, 5 Md $, a été
financé à 80 % par un consortium bancaire, l’Etat omanais, qui possède 51 % des parts et la
société Shell qui en possède 30%, n’apportant à eux deux que 20 % de l’investissement. Mais
l’exportation du GNL devrait rapporter 1 Md $ par an à partir de 2001.
Les principaux clients sont :
- KOGAS (Corée du Sud), qui détient 5 % du capital de l’usine à travers une filiale, a
signé un contrat d’importation de 4, 1 M t par an pendant 25 ans ;
- Enron (Etats-Unis), qui fournit la centrale électrique indienne de Dabhol Power Co, au
Sud de Bombay, enlèvera 1, 6 M t par an durant 20 ans, à partir de la fin 2001 ;
- Osaka Gas (Japon), qui a signé un contrat de 0, 7 M t par an pendant 25 ans .
Mais le gaz naturel se prête également à une transformation industrielle, et 3 trilliards de
pieds cubes devraient être réservés, comme source d’énergie ou comme matière première, aux
besoins de l’économie nationale. Il est par ailleurs question d’implanter dans l’agglomération
de Mascate un réseau de distribution de gaz de ville, comme il en existe à Charjah, dans les
EAU. Le secteur gazier en Oman pourrait même prendre une dimension nouvelle, au cas où le
gazoduc Dolphin en projet entre le gisement géant du North Field, au Qatar, et la côte des
EAU, entre Dubaï et Abou Dhabi, serait prolongé jusqu’à Sohar, en Oman, voire au-delà
jusqu’au Pakistan. Exportateur de gaz naturel, Oman serait en même temps importateur, pour
répondre aux besoins de son industrie….
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%