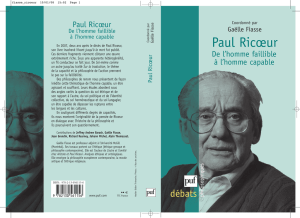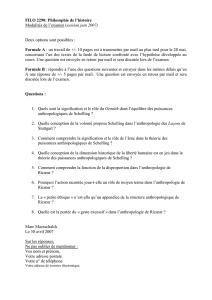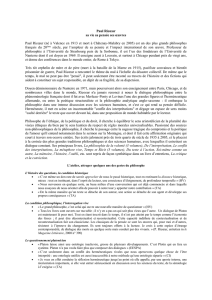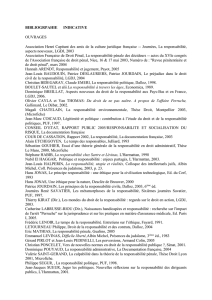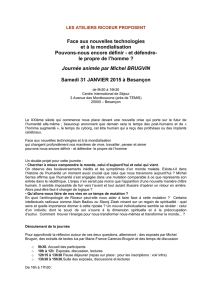L`Herne Ricœur - Yakama Nation Legends Casino

L’Herne
Ricœur
49 €
ISBN 2-85197-097-6 SODIS Y202685
L’Herne Ricœur
81
Couverture : © Andersen, Gamma, 4e: © Lionel Charrier
Textes de :
Olivier Abel
François Azouvi
Pierre Bouretz
Andris Breitling
Stanislas Breton
Marc Crépon
Françoise Dastur
Jacques Derrida
Vincent Descombes
Jacques Dewitte
François Dosse
Jean-Claude Eslin
Michaël Fœssel
Antoine Garapon
Rose Goetz
André Green
Marcel Hénaff
Jaakko Hintikka
Richard Kearney
Peter Kemp
Julia Kristeva
André LaCocque
Jean Ladrière
Marc de Launay
Olivier Mongin
René Rémond
Myriam Revault d’Allonnes
Jean Starobinski
Frédéric Worms
Entretiens de Paul Ricœur avec :
Nathalie Crom, Bruno Frappat et
Robert Migliorini
Bruno Clément
Textes de Paul Ricœur :
Discours et communication
Le Juste, la justice et son échec
Chronologie
Iconographie
Bibliographie
Cahier dirigé par Myriam Revault d’Allonnes et François Azouvi

L’Herne


Paul Ricœur
Ce Cahier a été dirigé par Myriam Revault d’Allonnes
et François Azouvi

Ouvrage publié avec le soutien du Centre National du Livre
L’iconographie de ce Cahier est particulièrement redevable à Catherine Goldenstein
qui a contribué à la sélection et à la datation des photos, ainsi qu’à l’identification
des diverses personnalités et des circonstances de leur rencontre avec Paul Ricœur.
©Couverture, Ulf Andersen/Gamma ; 4ede couverture, ©Lionel Charrier.
Tous droits de traduction, de reproduction
et d’adaptation réservés pour tous pays.
©Éditions de l’Herne, 2004
22, rue Mazarine 75006 Paris
NoISBN : 2-851-97-097-6
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%