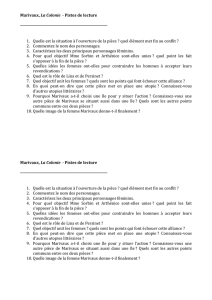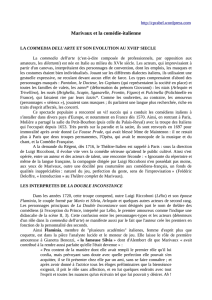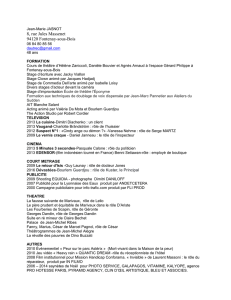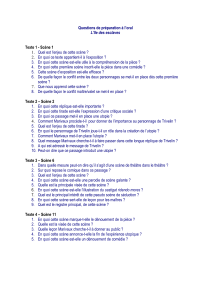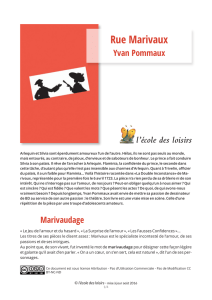l`épreuve, la dispute, les acteurs de bonne foi



L'ÉPREUVE
LA DISPUTE
LES ACTEURS
DE BONNE FOI

Du même auteur
dans la même collection
LA DOUBLE INCONSTANCE (édition avec dossier).
LA FAUSSE SUIVANTE. L'ÉCOLE DES MÈRES. LA
MÈRE
CONFIDENTE.
LES FAUSSES CONFIDENCES (édition avec dossier).
L'ÎLE DES ESCLAVES (édition avec dossier).
L'ÎLE DES ESCLAVES. LE PRINCE TRAVESTI. LE TRIOMPHE
DE L'AMOUR.
LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD (édition avec dossier).
JOURNAUX (2 vol.).
LE PAYSAN PARVENU.
LA VIE DE MARIANNE.

MARIVAUX
L'ÉPREUVE
LA DISPUTE
LES ACTEURS
DE BONNE FOI
Édition établie
par
Jean GOLDZINK
Bibliographie mise à jour en 2017
GF Flammarion
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%