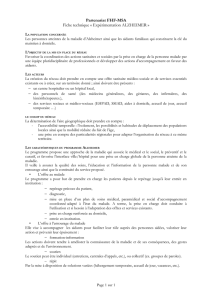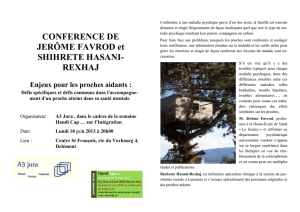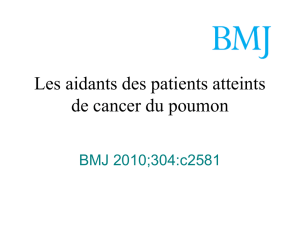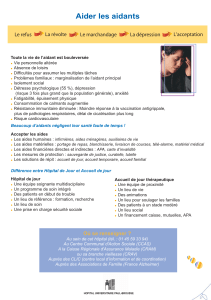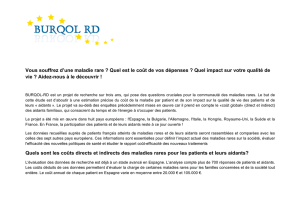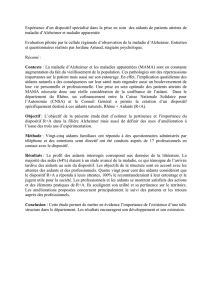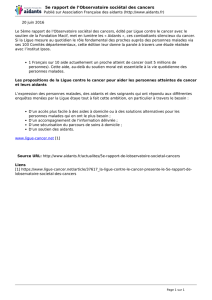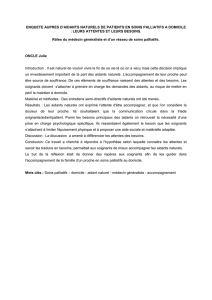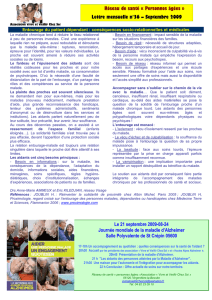la cigogne libérée n°8

P2 ETP et personnes âgées de plus de 60 ans
P1 quelques mots d'introduction...
P4 D’UNE ACTION D’AIDE AUX AIDANTS [...]
P6 Rivage, plateforme d’accompagnement et de répit [...]
P8 Careacting
11
millions de personnes prennent soin au quotidien d’un proche
en situation de maladie ou d’handicap. la loi n° 2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
aborde notamment le renforcement du soutien aux aidants et
l’accompagnement en cas de perte d’autonomie.
Afin d’être au plus prêt de l’actualité et notamment de la journée
nationale des aidants qui se tiendra le 6 octobre 2016, le numéro
8 de notre newsletter vous propose quatre articles sur ce thème.
Y seront présentés le programme d’éducation thérapeutique des
patients fragiles et diabétiques de type II âgés de plus de 60 ans
du pôle de Gériatrie de Mulhouse, le programme d’aide aux aidants
de L’Hôpital de Jour (HDJ) Michel Philibert de l’ABRAPA et enfin les
plateformes Rivage (d’accompagnement et de répit) à disposition
des aidants et Careacting (numérique participative et collaborative).
Cette newsletter sera également pour nous, l’occasion de vous
proposer notre nouveau calendrier de formations 2016/2017 et de
vous soumettre un appel à communication pour la journée «Santé
en Alsace» du 16 mars 2017 dont la Plateforme est promotrice.
En vous souhaitant bonne lecture!
L'ÉQUIPE DE LA PLATEFORME ETP ALSACE
P9 Journée nationale des aidants
P10 Appel à communication "santé en alsace"
P11 calendrier et actualités
Quelques mots
d'introduction...
La Cigogne Libérée n°8 pLATEFORME ETP ALSACE 1
LA CIGOGNE LIBÉRÉE N°8

ETP et personnes âgées de plus de
60 ans
NATHALIE DANNENBERGER, CADRE DE SANTÉ
CH DE MULHOUSE
DR YANN LOÏC GROC COORDINATEUR DU PROGRAMME
L
a personne âgée de plus de 60 ans ayant une voire des
pathologie(s) chronique(s) se trouve au carrefour de
sa vie lorsque vulnérabilité et fragilité manifestent leurs
premiers signes, elle doit continuer à faire face à une situation
personnelle qui se transforme du fait des pertes à affronter
et du déclin de sa santé. Il n’est pas rare que nous entendions
dans les services de soins des patients nous dire «tant que la
santé va, tout va», suggérant l’idée que la notion de santé ne
revêt pas les apparats d’une vie active (au sens professionnelle
du terme) mais d’une vie suffisamment bonne pour permettre
liberté et autonomie.
Le pôle de Gériatrie de Mulhouse s’est inscrit dans
une démarche de promotion et de création d’un
programme d’éducation thérapeutique des
patients fragiles et diabétiques de type II âgés
de plus de 60 ans.
Cette démarche intervient dans un contexte
régional et national, la prévalence du diabète
ne cessant d’augmenter en France. La situation
est particulièrement préoccupante en Alsace,
qui se situe au 3ème rang des régions ayant le
taux de prévalence le plus important: 7,5% de la
population en 2015 contre 6,2% dans le reste de la France
(sources: ARS). La prévalence est maximale entre 75 et 79 ans,
atteignant 18 % des hommes et 13 % des femmes en 2007. 83,2 %
de ces personnes sont prises en charge par l’Assurance Maladie
en Affection de Longue Durée (ALD). Il convient de souligner
que ces chiffres de prévalence sont eux-mêmes sous-estimés,
dans la mesure où ils ne prennent pas en compte les personnes
non traitées. L’Alsace est la région qui enregistre les taux de
mortalité par diabète les plus élevés de métropole (ORS Alsace,
2010, fiche 8.9).
En conséquence, le Projet Régional de Santé Alsace 2012-2016
a priorisé la prise en charge des personnes diabétiques et la
création de programmes d’éducation thérapeutique.
Les Services de Soins de Suite et de Réadaptation font partie de
la filière gériatrique et sont tenus de développer ces programme
d’ETP. Aussi avons-nous conçu, en partenariat avec l’Hôpital
local de Sierentz, un programme d’ETP particulier, celui du
patient âgé fragile, diabétique de type 2, présentant ou non
des troubles cognitifs mineurs et/ou de son/ses aidants. Le
programme a été validé par l’ARS en mars 2015.
Les objectifs généraux sont de permettre au patient de
conserver une qualité de vie et de préserver son autonomie
afin d’éviter le passage à l’état de dépendance et d’améliorer la
prise en soins, en pleine collaboration avec lui-même et selon
ses besoins exprimés.
Nous nous sommes également fondés sur une pratique
éminemment sociale dans le sens où ces patients sont définis
dans notre société comme des personnes du 3ème voire du
4ème âge.
Dans les manuels que nous avons pu parcourir,
cette dimension nous a permis par exemple de
définir notre programme de façon intuitive, mais
également en lien avec les recommandations de
la HAS : un programme centré sur la population
qui nous paraissait la plus pertinente à inclure
dans un processus éducatif.
Pour le programme: concernant l’entretien de diagnostic
éducatif, nous avons pris le temps de le tester afin qu’il soit un
outil d’aide à la compréhension du patient, de ce qu’il sait et vit
avec sa maladie. L’intérêt premier étant d’identifier ses besoins,
ses attentes. Nous avons ciblé 7 compétences à développer avec
le patient, des compétences d’auto-soins et des compétences
d’adaptationpuis créé 7 ateliers en lien avec les complications
les plus souvent rencontrées et circonscrit chaque compétence
requise et 1 atelier de protolangage permettant d’évaluer les
effets du programme sur les patients l’ayant suivi. Nous avons
réfléchi aux techniques pédagogiques que nous allions utiliser
pour chaque atelier d’activités. Il nous a semblé important
d’adopter une posture de formateurs ouverts et disponibles,
tolérants et se fondant sur un principe qui nous paraissait
évident et simple : commencer notre accompagnement à partir
de là ou était le patient.
"Permettre
au patientde
conserver une
qualité de vie et de
préserver son
autonomie"
La Cigogne Libérée n°8 SEPTEMBRE 2016 2

Depuis septembre 2015, nous avons pu proposer ce programme
à 61 patients.
Pour les patients ayant consenti à suivre le programme, les IDE
en charge de leur suivi ont noté plusieurs points paraissant à
l’origine de leur consentement:
•
un temps de réflexion a été systématiquement accordé
entre la première proposition d’entrer dans le programme
et l’entretien diagnostic.
• Les patients ont eu le temps de développer une relation
de confiance avec les infirmières
et de leur poser des questions concernant le programme.
•
Lors de l’entretien diagnostic, les ateliers sont présentés et
les infirmières les mettent en lien avec le récit du patient.
•
Les ateliers font écho à des soins et des connaissances
déjà abordés par les patients.
•
Les infirmières disent «donner envie » aux patients,
éveillant leur curiosité tout en basant leur discours sur ce
qu’ont pu dire les patients durant l’entretien.
➡ Les ateliers proposés sont en lien avec des problèmes
quotidiens rencontrés par les patients, y apportant des
réponses pragmatiques, compréhensibles et réalisables.
Durant les ateliers, principalement suivis en collectivité à la
demande des patients, les infirmières ont pu recueillir leurs
impressions :
WIls apprécient de se retrouver et de discuter entre eux.
WCela leur permet de regarder leur maladie.
WUn patient a déclaré que les propositions qui lui ont été
faites après l’atelier «nutrition» ont «changé sa vie».
Il est vrai que proposer ces ateliers aux patients fragiles revêt
parfois un caractère délicat, de par leur situation précaire,
tant physique, psychique qu’environnementale, mais cela peut
concourir à les aider à mieux vivre voire à surmonter ce temps
de vie fragilisé, car nous y mettons du sens: sens dans notre
manière d’aborder le programme, sens dans la manière de
le proposer aux patients, et sens dans notre réflexion pour
l’améliorer. Ceci implique également humilité et patience.
Pendant toute cette année de création, nous avons côtoyé
des personnes de notre famille, des soignants, et nous avons
régulièrement entendu deux questions «c’est quoi l’ETP?» et
«ah!... et c’est vraiment utile chez les vieux?».
Le sentiment de «perte de l’utilité sociale» est un risque
fort chez le sujet âgé. Si nous apposons le terme d’utilité à ce
que se rapportent à nos semblables, vers quelle société nous
dirigeons-nous? Pourquoi nous poserions nous la question
de l’utilité de l’ETP chez les personnes de plus de 60 ans? Le
faisons-nous quand il s’agit d’enfants? D’adultes jeunes?
L’ETP est une chance proposée aux patients souffrant de
maladies chroniques de mieux les appréhender et de mieux
vivre avec elles, puisque faisant de toute façon partie de leur
vie. Sachant que les personnes âgées sont (et seront) de plus en
plus nombreuses à vivre avec une maladie chronique, n’est-ce
pas à nous de leur offrir cette chance? Si nous commençons
à présupposer le bien de l’autre, l’utilité pour l’autre, sommes-
nous encore dans la bienveillance et le soin?
La Cigogne Libérée n°8 pLATEFORME ETP ALSACE 3

A
ctuellement, 850 000 personnes sont atteintes de démence
en France et en 2050 elles seront 1 813 000. La maladie
d’Alzheimer touche 18% des plus de 75 ans et 25% des plus de 85
ans (1), c’est la plus fréquente des maladies neurodégénératives.
Il s’agit d’une priorité nationale, en témoignent les différents
plans Alzheimer successifs. Cette maladie se caractérise par
une atteinte progressive des fonctions cognitives, une perte
progressive des capacités fonctionnelles et des troubles du
comportement. 75% des malades vivent à domicile1 ce qui est
souvent rendu possible par l’implication des aidants. Quand
des maladies des fonctions supérieures génèrent des troubles
de la compréhension et des difficultés dans les prises de
décisions pour sa propre santé, la démarche éducative directe
au patient connaît des limites2. Elle s’est donc naturellement
portée sur les aidants.
Des études ont confirmé depuis une quinzaine d’années que
l’intégration de l’aidant dans la prise en charge du patient
Alzheimer permet un gain conséquent pour la vie de celui-
ci. En 2002, une méta-analyse réalisée à partir de 78 études3
a montré que des programmes d’intervention combinant
éducation, soutien psychologique et répit permettent d’alléger
le fardeau ressenti par l’aidant, de diminuer le risque dépressif,
et d’améliorer son bien-être. De plus, ils permettent de
diminuer les symptômes du patient, voire de faire reculer sa
date d’entrée en institution. Toutefois, des prises en charge
trop standardisées et ne tenant pas suffisamment compte des
attentes réelles des aidants peuvent conduire à des résultats
mitigés. Les interventions qui semblent les plus efficaces sont
de type multicomposantes ou éducatives, à nombre important
de séances et avec prises en charge individuelles. L’éducation
thérapeutique constitue une modalité d’intervention
prometteuse dans ce contexte, car « il n’y a pas de prêt-à-porter
de l’aide aux aidants »4.
L’Hôpital de Jour (HDJ) Michel Philibert de l’ABRAPA (Association
Bas-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées) est une structure de
Soins de Suite et de Réadaptation spécialisée dans la prise en
charge de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées. Le projet de mise en place d’une action
d’aide aux aidants s’inscrit dans une démarche lancée en 2013.
Un groupe de travail pluridisciplinaire comprenant médecin,
infirmières, aide-soignante, neuropsychologue, psychologues,
ergothérapeute et coordinatrice sociale a été constitué. Ces
onze professionnels sont issus de trois structures de l’ABRAPA
spécialisées dans la prise en charge de patients atteints de
troubles cognitifs: l’HDJ Michel Philibert, l’Équipe Spécialisée
Alzheimer (ESA) du Phare et l’Accueil de jour du PréO. Ils ont
été ou seront formés à l’ETP d’ici début2017.
Une étude des besoins auprès de l’ensemble des aidants des
patients pris en charge dans les trois structures a été réalisée
afin de déterminer leurs attentes. Nous avons eu 112 réponses
sur les 177 questionnaires distribués (63,3% de participation).
L’objectif était la mise en place d’un programme d’aide aux
aidants avec un but non seulement de formation, mais aussi
d’éducation centrée sur les attentes des aidants.
Notre Programme d’Aide aux Aidants:
•
Nous proposons un entretien individuel préalable
à l’inclusion dans le cycle d’aide aux aidants par un
professionnel formé à l’ETP. L’aidant doit avoir la possibilité
de verbaliser son vécu, ses émotions, ses angoisses et ses
craintes. Il s’agit d’identifier les besoins et les envies des
aidants, les potentialités, les leviers et les freins à la prise
en charge « éducative ». En complément de cet entretien,
nous proposons à l’aidant une échelle d’évaluation du
risque dépressif (Mini GDS), une Echelle Visuelle Analogique
(EVA) sur sa qualité de vie, une évaluation du fardeau
de l’aidant (ZARIT) et une évaluation des troubles du
comportement de l’aidé par l’intermédiaire de l’Inventaire
Neuro-Psychiatrique (NPI). Une synthèse de l’entretien
type « diagnostic éducatif » est élaborée.
•
5 ateliers collectifs sont proposés pour permettre
aux aidants d’acquérir des compétences afin de mieux
vivre avec leur proche, de se préparer à faire face à des
situations de crise de façon adéquate, de renforcer leur
confiance en leurs capacités, de décrypter le sens de
certains comportements de leur proche pour permettre
une communication plus adaptée, d’éviter les conflits,
d’apprendre à se faire aider et de tirer parti des ressources
existantes (médicales, sociales et juridiques).
D’UNE ACTION D’AIDE AUX AIDANTS DE MALADES ATTEINTS DE MALADIE
D’ALZHEIMER OU D’UNE AFFECTION APPARENTÉE, À DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DR CHRISTINE ASTIER, HÔPITAL DE JOUR ABRAPA, STRASBOURG
Atelier1: Connaître et comprendre la maladie.
Atelier2 : Les troubles de la mémoire et leurs
répercussions dans la vie quotidienne.
Atelier3: Les aides et services pour l’accompagnement
de la maladie. Ressources et limites de l’aidant.
L’association Alsace Alzheimer intervient au cours de
l’atelier.
Atelier 4: Les troubles du comportement: faire face
aux troubles du comportement et attitudes à avoir.
Le groupe bénéficie d’une présentation d’une technique
de respiration et de relaxation par un professeur de
yoga.
Atelier5: Comment permettre une meilleure
communication avec vos proches.
La Cigogne Libérée n°8 SEPTEMBRE 2016 4

Nous avons privilégié l’utilisation de méthode d’animation
des ateliers de type Métaplan ou de mises en situation. Il
est important d’adapter au fur et à mesure notre pratique en
fonction des demandes des aidants et de leur âge. L’évaluation
des ateliers est réalisée à l’aide d’un questionnaire de
satisfaction et d’une évaluation des acquis de l’atelier.
•
La prise en charge de l’aidé est proposée pendant les
ateliers des aidants, dans une unité protégée.
• Entretiens individuels: Les aidants ont la possibilité, en
plus de l’entretien initial et final, de bénéficier d’entretiens
individuels avec une psychologue clinicienne, un
ergothérapeute et la coordinatrice sociale de l’HDJ.
•
Évaluation finale du programme : À la fin du
programme, un entretien est proposé avec le
même professionnel que lors de l’entretien
initial. Une synthèse avec une évaluation des
compétences acquises est réalisée. Un recueil
final de données de l’aidant est renseigné sur le
même modèle que le recueil initial. Cela permet
d’apprécier les effets de notre programme sur
l’aidant, les aides éventuellement mises en place,
son risque dépressif, sa qualité de vie, le fardeau
de l’aidant, mais également d’apprécier si le programme
a permis d’améliorer les troubles du comportement du
malade. Enfin, un questionnaire de satisfaction est remis
à l’aidant.
•
Nous proposons 3 sessions annuelles incluant chacune
10 patients. Nous réalisons le cycle des ateliers collectifs
pour les aidants sur 15 semaines au rythme d’une séance
toutes les 3 semaines.
Les impacts sur les aidants et les patients
-
Les 4 premiers cycles d’aide aux aidants ont permis
d’inclure 39 aidants. 56,4% sont des femmes avec un âge
moyen de 66 ans (de 35 ans à 85 ans), 56,4% sont des
conjoints et 35,9% des enfants. 38,5% sont en activité
professionnelle. Ils sont aidants depuis 1,9 an en moyenne.
- 79,5% des patients sont atteints de maladie d’Alzheimer.
L’atteinte cognitive est à un stade modéré (Folstein moyen
à 19,4/30).
-
L’évaluation du risque dépressif effectuée (mini GDS)
a permis d’objectiver un risque dépressif chez 69,2%
des aidants à l’inclusion. Après le programme, le risque
dépressif a diminué à 51,3%.
-
L’évaluation du fardeau de l’aidant (ZARIT) a permis
d’objectiver un score moyen à l’inclusion de 35,9/88
(fardeau léger à modéré). Après le programme, le score a
légèrement diminué à 32,2/88.
- L’évaluation des troubles du comportement des patients
a été effectuée à l’aide de l’inventaire neuropsychiatrique
(NPI). Le NPI initial moyen est de 29,7/144. Après le
programme, il diminue à 25,5/144.
- 79,3% des aidants déclarent que leur appréhension face à
la maladie et ses manifestations a globalement diminué.
-
Les ateliers et les temps d’accompagnement individuel ont
permis d’apporter dans 93,1% des cas une réponse aux
questions des participants.
-
65,5% des aidants ont modifié leurs habitudes de vie suite
au programme d’aide aux aidants.
Conclusions et perspectives
Cette expérience a été un élément positif pour l’ensemble des
professionnels qui se sont fédérés autour du projet. Elle a
été appréciée de tous et a été le déclencheur d’un élan de
dynamisme et de complémentarité au sein d’un
groupe de travail interdisciplinaire associant
des professionnels de trois structures
différentes de l’ABRAPA. Des motivations
de formation à l’ETP sont nées. En même
temps, de nouvelles interrogations sont
apparues, et au vu des résultats positifs
des premières évaluations aussi bien
pour les aidants que pour les patients, de
futurs projets se sont dessinés comme la
formalisation d’un programme d’« Éducation
Thérapeutique destinée aux Patients atteints de
maladie d’Alzheimer ou d’une affection apparentée et à
leurs Aidants ». Une demande d’autorisation a été adressée à
l’ARS en juillet 2016 dans le cadre d’un appel à projets du plan
maladies Neurodégénératives.
1. Ramaroson H, Helmer C, Barberger-Gateau P, Letenneur L, Dartigues JF.
[Prevalence of dementia and Alzheimer’s disease among subjects aged 75 years
or over: updated results of the PAQUID cohort]. Rev Neurol (Paris) 159 (4): 405-
11, 2003.
2. Pariel S, Boissières A, Delamare D, Belmin J. L’éducation thérapeutique en
gériatrie: quelles spécificités ? La Presse Médicale42 (2): 217-223, 2013.
3. Sorensen S, Pinquart M, Duberstein P. How effective are interventions with
caregivers? An updated meta-analysis. Gerontologist42 (3): 356-72, 2002.
4. Pancrazi M-P. Education pour la santé des proches de patients atteints de la
maladie d’Alzheimer. Neurologie — Psychiatrie - Gériatrie8: 22-26, 2008.
La Cigogne Libérée n°8 pLATEFORME ETP ALSACE 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%