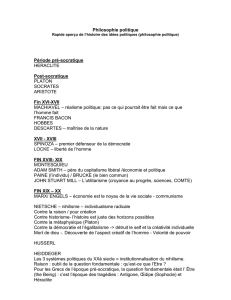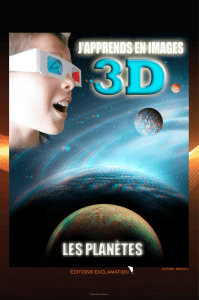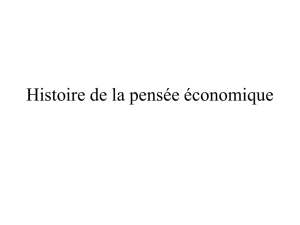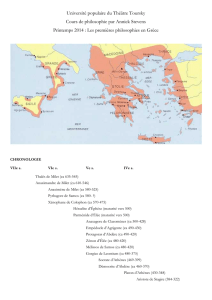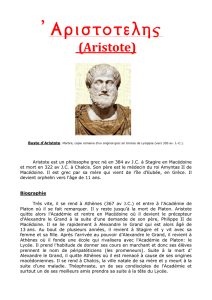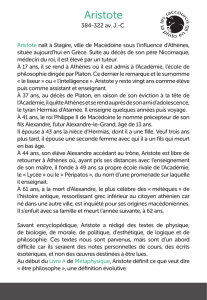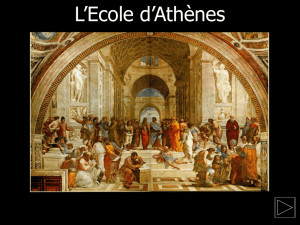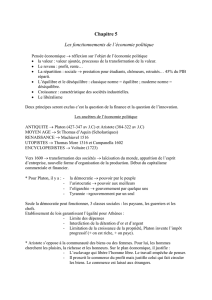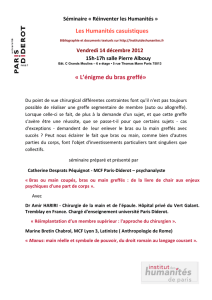Séminaire « Archéologie des Humanités » Institut des Humanités de

Séminaire « Archéologie des Humanités »
Institut des Humanités de Paris
atelier du 28 janvier 2011
« Le partage Humanités/Science au prisme de l’histoire et de la philosophie des sciences»
Présenté par David Rabouin (SPHERE, CNRS, Paris 7) avec la collaboration de Pascal
Crozet (SPHERE, CNRS, Paris 7) et de Koen Vermeir (SPHERE, CNRS, Paris 7).
Compte-rendu par Florence Dupont.
La stabilisation de la notion actuelle de « Science » est, d’un point de vue historique, relativement récente. Elle a
d’ailleurs fait l’objet, au cours des siècles, de débats et de négociations qui sont loin d’être clos. Une des missions
de l’histoire des sciences est de rappeler la fragilité et la labilité de ces découpages disciplinaires que les derniers
venus, toujours persuadés d’avoir atteint l’état achevé du savoir, ont tendance à dénier. L’opposition des «
humanités » et des « sciences » hérite de cette fragilité et rend difficilement compte de la manière dont les
différentes disciplines se sont nourries et interpénétrées au cours des âges. Ainsi se distinguent clairement deux
projets de constitution des « humanités » : l’un, par démarcation, qui entendrait constituer et défendre un domaine
face à un autre ; l’autre, par intégration, qui, prenant acte de la fragilité des découpages disciplinaires, prendrait
son départ dans ce dialogue parfois conflictuel entre les disciplines (qu’elles soient « scientifiques » ou « littéraires
», « dures » ou « molles » , etc..). Dans cette séance, trois historiens des sciences exposeront brièvement trois
moments de découpage des savoirs (Grec, Arabe et Médiéval, Classique) afin de nourrir la discussion sur le
partage « Humanités/Science » et la manière dont nous pouvons l’appréhender et l’utiliser aujourd’hui.
David Rabouin : Mondes anciens
On ne trouve jamais un concept science qui soit stabilisé. Que ce soit un concept
englobant et général, ou un concept pluriel « les sciences ». Même pour une seule
discipline. L’idée selon laquelle il y aurait un moment ou l’autre de l’histoire où ce concept
se serait stabilisé ne se vérifie pas. Que ce soit en Grèce, aux 4ème et 3ème s av JC, où
l’on a cru voir la naissance de la science moderne. De façon arbitraire – fameux « miracle
grec » qui a fait son temps - car on pourrait aussi bien l’assigner avant et ailleurs, par
exemple chez les Mésopotamiens dont les pratiques intellectuelles ne sont ni moins ni
plus « scientifiques » que celles des Grecs.
On a cru voir dans le mot grec epistémè, la notion de sciences. Or il s’emploie pour
bien d‘autres pratiques intellectuelles où nous ne reconnaîtrions pas un « sciences ». La
dialectique, par exemple, chez Platon est une epistémè, Et chez Aristote la métaphysique
aussi est une épistémè.
Un autre concept grec semble plus stable signifié par le neutre pluriel : mathèmata
(savoirs) sur le radical du verbe manthanein (apprendre, faire connaître). Correspond au
latin disciplina et discere. Il s ‘agit de savoirs enseignables, donc positifs, susceptibles
d’être transmis par des livres et traités. Cette idée de savoir enseignable, mathèmata
remonterait au rhéteur Isocrate. Cf. Bernard Vitrac. (Biblio sur internet)
Cette notion plurielle – mathèmata -, de savoirs transmissibles, conduit les Anciens à
établir des catalogues de mathèmata. Ces catalogues varient d’un auteur à l’autre, avec la
même question : qu’inclut-on ? Et qu’exclut-on ? La géographie entre et sort, comme la
physique. Ces catalogues ne permettent même pas de définir un noyau dur de mathèmata
présent dans tous, sauf un seul mathèma : la musique (jusqu’à Rameau).
La question de la classification des sciences est donc très ancienne, présente en
Grèce ancienne, liée à une réflexion sur les mathèmata comme catégorie plurielle des
savoirs, dont le contenu de chacune est aussi variable. Il ne faut pas être victime de la
similitude des dénominations.

2 exemples = 2 types différents de « culture générale », si on désigne par ce terme
l’ensemble des mathèmata offert par deux écoles philosophiques, celles de Platon et celle
d’Aristote. Avec dans chaque école une réflexion différente sur l’unité des savoirs.
Platon : Au départ, il place l’apprentissage des contenus des savoirs, dont l’unité sera
ensuite saisie par la dialectique.
Aristote : définit chaque savoir par son domaine d’étude hypokeimenon et classe ainsi les
sciences qui ne communiquent pas comme par exemple de l’arithmétique à la géométrie
rien ne circule.
Il définit deux types de savoirs : les savoir théoriques – épistémai - physique,
mathématique et la métaphysique -. et les savoirs pratiques, très nombreux - praxeis.
Il y a de nombreuses classifications des mathèmata dans l’antiquité, ex celle de Proclus
(Commentaires sur les Éléments d’Euclide). Va-t-on insérer la tactique ? La médecine ?...
profusion de réponses. Aucunes disciplines qui font consensus, même l’arithmétique et la
géométrie.
Pascal Andrieux : Monde arabe et médiéval
La situation est comparable à celle qui prévalait en Grèce ancienne. Il n’y a pas de
terme spécifique en arabe pour dire sciences, en fait le mot utilisé désigne un « savoir »,
rien ne distingue ce que nous appelons les sciences, des autres savoirs : histoire,
linguistiques, mathématiques sont tous des savoirs. Avec là aussi la question de la
classification des savoirs selon leur usage. Pas de différences de nature entre les
différents savoirs
Ces classifications sont connues par des biographies d’auteurs, incluant leurs
ouvrages classés. Et aussi par les lexicographes spécialisés. Ou encore les
encyclopédies. Dans les ouvrages philosophiques, la classification des savoirs y est un
objet philosophique en tant que tel. Avec des systèmes différents. Par exemple : les
savoirs théorétiques, définis comme savoirs sans « l’homme », vs savoirs « liés à
l’homme ».
On trouve de nombreuses classifications à la suite de Platon et d’Aristote, et de
leurs écoles.
Un exemple, celui d’Al Fârâbî (10ème s ap.JC, philosophe turc de langue arabe) : le
2d maître (après Aristote). Écrit une énumération des sciences. Traduite en latin et en
hébreu au XIIème s. Texte important pour l’histoire de la philosophie. Il part de six savoirs
linguistique, logique, mathématiques, physiques, théologie, science politique. Il en exclut
la médecine. Il suit la classification aristotélicienne (par le domaine). La physique vs
mathématiques: science des corps naturels. Mais un problèmes se pose à lui : que faire
de l’algèbre - science non-grecque- qui ne peut pas se définir par son objet selon la
méthode aristotélicienne ? car étant une science du calcul elle a pour objet, l’inconnue, qui
est soit un nombre soit une grandeur géométrique. Il crée une catégorie : la « science des
procédés ingénieux » pour y placer l’algèbre.
Avicenne - connu sous le nom de Ibn Sīnā ou Avicenne (forme latinisée), né en 980
en Perse -, définit lui une catégorie : parties secondaires de la science = instruments.
Un constat certain : l’histoire des sciences ne peut pas être isolée de la philosophie.
David Rabouin pour Koen Vermeir, e(xcusé) : L’âge classique
Le XVIIème est souvent conçu comme le premier siècle scientifique, autour de la
figure emblématique de Descartes. Or les pratiques intellectuelles des savants de cette
époque ne répondent pas aux délimitations que nous exigeons aujourd’hui de « l’esprit
scientifique ». Par exemple la théorie du magnétisme mélange la magie naturelle,

théologie naturelle et la physique. Cette association entre physique et théologie naturelle
se retrouve dans les manuscrits alchimiques de Newton. Ou encore les œuvres de
Kepler. Par ailleurs on sait que Leibniz était historien.
Aujourd’hui à Paris-Diderot... et ailleurs
Ce problème épistémologique – définition et classification des sciences - reste
actuel : en particulier celui de la démarcation des sciences entre disciplines. Ce problème
posé depuis un siècle, n’a toujours pas de réponses depuis 1er siècle. Chacun accuse les
autres « de ne pas faire de la science ». De laboratoire à laboratoire, il arrive qu’on ne se
parle plus.
Au contraire les frontières s’estompent plus que jamais. Par exemple : qu’est-ce qui
sépare la vraie et la fausse science (cf. vaccins). Aucune discipline ne peut se définir par
rapport à une Science bien posée et définie. « La partie n’est pas gagnée ».
Suit une longue et très riche discussion, comme on les aime (cf. enregistrement du
séminaire) et qu’il est impossible de résumer. Voici quelques points forts :
*Autour des notions d’invention, et de l’histoire des théories qui apparaissent et
disparaissent ex : les proportions d’Euclide. Qu’une théorie se maintienne longtemps ne
signifie rien. Ce qui est reconnu c’est un « résultat » dont souvent la démonstration nous
semble aujourd’hui aberrante ex : les lois de Kepler. Histoire idéologique des sciences liée
aux institutions, avec des héros découvreurs.
*Autour de la question des institutions. Rôle central de la Royal Society. Dogmatique
utilitariste au XVIII ème s. qui caractériserait les sciences, n’est pas nouvelle. Cf . Platon.
Le mépris pour les lettres serait lié au refus de la théologie et des conflits qu’elle entraîne.
*Autour des essais de délimitation.
Une Histoire de l’Occident où l’universalité des mathématiques ferait date comme
langage ? Croyance remise en cause de la « révolution scientifique » présente chez
Husserl et Koyré.
Des concepts stabilisés seraient nécessaires pour qu’il y ait des lois ? Pas du tout.
On n’en a pas besoin cf. Putnam (H.). « Langage et réalité ». In S. Laugier, P. Wagner
(eds), Philosophie des sciences. Naturalismes et réalismes. Vrin, 2004. Ex : infinité des
nombres premiers chez Euclide et aujourd’hui, or le concept d’infini n’est pas stabilisé, car
il n’est pas le même chez Euclide qu’aujourd’hui. Les résultats sont les mêmes mais les
concepts ne sont pas les mêmes. Il ne peut y avoir de stabilisation des concepts, car le
principe du « progrès scientifique » est la critique des concepts. Le vrai problème est
pourquoi une stabilisation à certains moments.
Sens du mot progrès ? Question du progrès des sciences : temps irréversible ? Qui
ne serait pas présent en lettres où sans cesse il y a de réappropriations. Or on constate
une rétroaction aussi en sciences, un retour, des réappropriations ? Oui exemple de la
théorie des proportions d’Euclide (cf. supra). Ou Aristote « topologue ».
Traditions conceptuelles ?
Les intervenants, en conclusion, se défendent d’affirmer une philosophie
constructiviste ; leur seul but : faire vivre les problèmes.
Le séminaire arrive à un consensus sur un point :
* le fanatisme disciplinaire est un frein à l’esprit critique et à la vie intellectuelle d’une
université.
* il faudrait introduire un enseignement systématique de l’histoire et de l’épistémologie de
la discipline dans tous les cursus et cela dès la première année de licence. En ce sens il
conviendrait que chaque UFR recrute en priorité un enseignant susceptible de donner et
d’organiser cet enseignement. Le futur Institut des Humanités pourrait veiller à
l’installation et au développement d’un tel enseignement, et encourager les
programmes de recherche en ce domaine.
1
/
3
100%