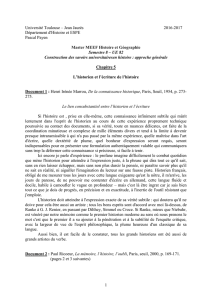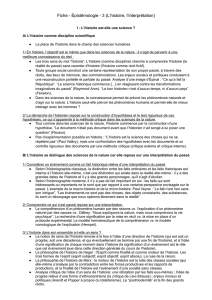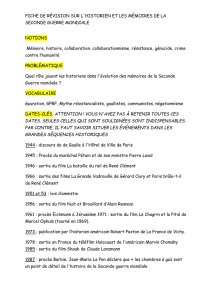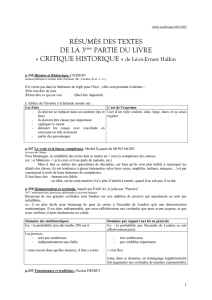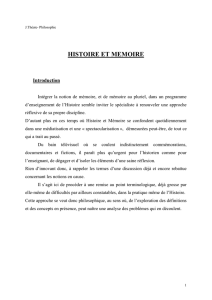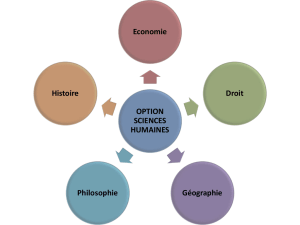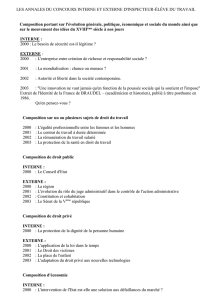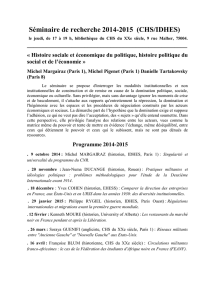Textes Venayre

Première version de l’ego-histoire de Georges Duby (1983/2011)
Dans l’été 1914, quelques jours avant la mobilisation générale, les parents de Georges
Duby avaient fêté leurs noces. Leur unique enfant vint au monde le 7 octobre 1919, à Paris,
dans le
X
e
arrondissement. Le père avait alors trente-six ans, la mère vingt-neuf. Elle était
parisienne. Mais fille de Barbe Lang, villageoise alsacienne transplantée jadis dans le Paris de
la défaite pour ne pas vivre sous le joug prussien, et d’un grand Franc-Comtois, Claude
Dimanche, ancien dragon, qui longtemps gouverna, au pied de la tour Eiffel, la forte cavalerie
des Grands Magasins du Louvre et finit ses jours, solitaire, en Vendômois. De ce côté, la
généalogie est fort courte. De l’autre, tout provincial, elle monte d’un cran jusqu’aux deux
arrière-grands pères : Michel Duby, boulanger à Neuville-les-Dames, aux lisières de la
Dombes, Benoît Radix, aubergiste, faubourg de Mâcon, à Bourg-en-Bresse. Dans ce milieu,
on plaçait un court moment les fils au collège ou au lycée, puis ils partaient apprendre sous un
maître le tour de main qui leur valait, vite car ils travaillaient dur et bien, une robuste aisance
et de se retirer très tôt pour, de larges chaînes d’or sur le ventre, présider des associations de
secours mutuel et surtout fumer leur pipe à l’aise. Ce qu’avaient fait Michel II, établi sellier à
Bourg, place Grenette, puis son fils aîné Louis, le père de Georges. Louis commença de
façonner le cuir sous l’œil de son père, fila vite à Genève pour avoir la paix, puis dans la
banlieue parisienne, passa naturellement – c’était le progrès – de la sellerie hippomobile à
celle des premières autos, gagna rapidement de quoi se rendre indépendant tout à fait, devenir
patron, mais dans une branche différente (pourquoi cette bifurcation ? ou bien la volonté de
marquer mieux ses distances à l’égard de l’adolescence, de la puissance paternelle, l’intention
de rompre aussi avec la tradition provinciale, de s’affirmer plus parisien ?). En effet, dans
l’atelier où il s’installa en haut de la rue Saint-Martin, près de la porte, on teignait
excellemment, pour la haute mode, les théâtres et le café-concert, des plumes d’autruche, des
aigrettes, des boas. Il proclama sa liberté d’autre manière, en prenant son épouse dans Paris,
sans consulter sa parenté, fort inquiète de voir quelle sorte de créature lui serait amenée de la
capitale. Cependant, ce fut à son premier métier qu’il dut, passés les premiers Charlerois
auxquels il survécut par miracle, de fabriquer jusqu’à l’armistice, à l’abri de l’arsenal de
Besançon, des ceinturons et des cartouchières. Ainsi, par hasard, le père échappa à la tuerie et
le fils dont je parle put naître.
En ce point, il convient de noter d’abord que toutes les racines plongent dans cette
France de l’Est dont Lucien Febvre évoquait jadis les singularités profondes, que les paysans
ne sont pas loin, mais que le souvenir ne les atteint pas, qu’il butte contre un infâme patriciat
de bourgade, un bloc d’hommes bien plantés dont aucun ne put dans sa jeunesse compter que
sur lui-même, qui se haussaient à force de labeur et d’épargne, qui dominaient leurs femmes
et leurs enfants comme ils dominaient, dans l’atelier ou l’écurie, les compagnons et les
piqueurs, qui tenaient la bourse serrée, soucieux d’abord de sécurité puis de loisir. A leurs
yeux, le labeur bien fait avait valeur fondamentale. Pour avoir longtemps vécu en étroite
commensalité avec les ouvriers et les plus humbles, à la caserne, à l’usine, dans la maison où
leur mère nourrissait, blanchissait toute l’équipe, ils ne se sentaient jamais, si fortunés fussent-
ils devenus, coupés du peuple, attentifs à ne point franchir l’invisible barrière qui les en eût
séparés, mal à l’aise parmi les bourgeois dont ils partageaient pourtant le goût pour les
courses de chevaux et les repas fins. Ils s’effaçaient volontiers pour demeurer plus libres,
attachés très fort à cette liberté, amassant prudemment pour l’acquérir le plus tôt possible, de
ne plus agir qu’à leur guise dans une totale maîtrise de leur temps.
Remarquons aussi comment s’établissait, au sein du couple parental, le rapport Paris-
province. La province y était apparemment rejetée, en tout cas dénigrée. Et, pourtant, le
parisianisme se trouvait en doses inégales, et la dissemblance des caractères accusait cette

dénivellation. Le père, sérieux, sévère, et quoi qu’il en eût, malgré tout ce par quoi il adhérait
à la grande ville, reconduit irrésistiblement aux gestes, aux intonations, aux partis pris des
origines, bressan de Paris, comme ses meilleurs amis, plus que parisien ; la mère – et ses
sœurs – au contraire, authentiquement du Gros-Caillou, toute de primesaut, aimant le jeu,
riant sous cape. En fin de compte, plutôt sinistre, le premier étage sur cour de la rue des
Marais, sinistre aussi l’école paroissiale où G. D. apprit à lire, à compter, et la morale. Ses
parents l’avaient placé là afin qu’il fût conduit à la première communion sans qu’ils aient à
s’en soucier, car de la religion ils ne se souciaient guère, la mère un peu, par bouffées, mais
d’une religion plutôt mérovingienne et frivole. Cette indifférence, cette légèreté, valut à leur
fils de n’avoir pas été longtemps ni souvent contraint de chanter des cantiques ; avant même
la puberté il s’était trouvé dispensé de tels exercices ; pour cette raison, ses critiques à l’égard
des prêtres demeurèrent toujours froides et raisonnables, plus goguenardes que rancunières, il
ne laissa jamais très longtemps fermé le livre des Ecritures et se refuse encore aujourd’hui à
se dire incroyant.
Comment, méditant sur une existence, estimer à sa juste mesure le poids des premières
années et celui de l’ascendance ? Cette enfance fut emprisonnée dans le Paris le plus resserré,
comme étouffé en ce quartier encore central où se mêlait le populaire et le demi-monde, les
fureurs ouvrières de la rue Grange-aux-Belles et les plaisirs faisandés du faubourg Saint-
Denis. Chaque été c’était la délivrance, le départ pour une ville minuscule, assoupie, toute
pénétrée par la campagne bressane. Un bol de grand air et de paix. De là, peut-être, cette
attitude à l’égard de Paris, qui ne fut pas sans infléchir le déroulement d’une carrière (et c’est
bien à l’histoire d’une carrière qu’entend se limiter mon récit). Attitude ambiguë ou
s’entrecroisent attirance et répulsion : la fierté naïve, avivée bientôt par l’exil en province,
d’être né de cette ville, la plus belle évidemment de l’univers, la ville-lumière, comme on
disait dans cette enfance, mais en même temps la nostalgie de la ruralité, l’incoercible désir de
courir dans l’herbe, de respirer l’odeur de la terre et du blé mûrissant. Cet appétit – celui de
son père qu’il accompagnait dans d’interminables randonnées en forêt de Senlis ou de
Chantilly –, la lecture, dans la salle de classe sans soleil, du livre de leçon de choses
l’aiguisait : conçu pour les garçons d’une France encore plus qu’à demi paysanne,
n’enseignait-il pas, tout près de la République, comment traiter les fibres du lin et celles du
chanvre, les avantages de l’assolement triennal, et que la chouette est un animal utile ?
Aller plus loin, analyser moins sommairement le retentissement des sensations
enfantines exigerait d’être plus extérieur et détaché que je ne suis. Est-ce d’ailleurs jamais
possible ? Toute biographie se veut objective. Aucune ne l’est. Car son auteur, toujours, au
départ a pris fait et cause ; il s’est inéluctablement compromis puisqu’il n’a pas innocemment
choisi de prendre pour héros ce personnage. Peu ou prou donc, il s’identifie à lui, il l’anime de
ses propres passions ; le chérissant, le haïssant, comment pourrait-il porter sur lui le regard
froid ? Serais-je plus lucide, si j’avais décidé d’écrire la vie de Pierre Chaunu, de Jacques Le
Goff ? L’homme dont je parle, en tout cas, ne repousse pas l’idée, triturant lui-même sa
mémoire, d’évoquer un jour les premiers temps de son existence dans le Paris rouge et noir
sur lequel il ouvrit les yeux. Mais sans illusion, ni souci de débusquer, parmi ces images
pâlies, les pulsions initiales qui l’auraient porté à devenir historien. Car il ne croit pas pouvoir
découvrir dans ce passé lointain d’autres germes que ceux d’une propension jalouse à la
solitude, associée à son contraire, à la tension, au désir de briser l’enveloppe, un désir intense,
douloureux, exacerbé par l’étroit repliement sur soi.
Georges D
UBY
, « Ego-histoire. Première version inédite. Mai 1983 »,
Le Débat, n° 165, mai-août 2011, p. 102-104

Version publiée de l’ego-histoire de Georges Duby (1987)
…Le récit qu’il m’en fit fut sans doute lui-même faux,
artificiel, comme est condamné à l’être tout récit des
événements fait après coup, de par le fait même qu’à
être racontés, les événements, les détails, les menus faits
prennent un aspect solennel, important, que rien ne leur
confère sur le moment… Claude Simon.
Georges Duby est né le 7 octobre 1919, à Paris, à deux pas de la République.
L’appartement donnait sur la cour. Cette cour fut son premier terrain de jeu. Un rayon de
soleil y venait parfois ; trois rangées de plantes vertes s’alignaient devant la loge de la
concierge ; entre les pavés, un peu de mousse ici et là, et puis cette odeur de cuir, sauvage et
douce, exhalée par des entrepôts qui lui paraissaient insondables…
Longtemps – à vrai dire jusqu’à cet instant où j’entreprends la rédaction définitive –,
mon projet fut d’écrire à la troisième personne, dans le dessein de mieux garder mes
distances. J’ai renoncé, craignant de sembler affecté. Je reste du moins décidé à tenir l’écart.
Tout de suite, ce point capital : je ne raconte pas ma vie. Il est convenu que je n’exhiberai
dans cette ego-histoire qu’une part de moi. L’ego-laborator, si l’on veut, ou bien l’ego-faber.
Parce que je ne parle pas de peinture, par exemple, de théâtre ni de musique, parce que je ne
dis rien de ceux que j’aime, il est bien évident qu’ici l’essentiel sera tu.
Je vais donc parler de ma vie publique, tentant de montrer comment ce qu’on appelle
une carrière s’est déroulé durant une phase, courte, de l’histoire générale. On croirait cela
simple. Ça ne l’est pas. Car j’ai bien dû, à tel ou tel moment, m’accommoder, biaiser, me
faufiler, prendre la place d’un autre. Comment ne pas me donner le beau rôle ? Ego faber
gloriosus. Tout historien s’exténue à poursuivre la vérité ; cette proie toujours lui échappe. Je
me juge près de la saisir quand j’essaie d’établir ce que fut la bataille de Bouvines ou celle
d’Austerlitz. Mais si je cherche à découvrir comment les hommes aimaient ou croyaient aimer
au
XII
e
siècle, je la vois déjà s’éloigner. Et la distance s’élargit encore lorsque je me risque à
relater mes aventures professionnelles, m’adressant non pas à des êtres qui me connaissent,
qui me sont chers, mais à des gens que je n’ai jamais vus et dont la plupart liront rapidement
ces pages. Nul ne parvient aisément à ordonner sa propre mémoire. Comment se dire ? Ce
sentiment que j’ai d’impuissance est pénible. Aussi suis-je très fortement tenté de truquer,
persuadé d’ailleurs que, sans en être conscient, je truque, que je bricole mes souvenirs, qu’ils
se sont d’eux-mêmes bricolés tandis que je menais ma vie. J’appelle donc ceux que cette
histoire intéresse à porter sur ce qui suit un regard circonspect.
Mettant au net les résultats de mon enquête, je suis frappé du rôle qu’a tenu dans mon
cas le hasard. Certains de mes camarades savent discerner ce qui les prédestina très tôt à
devenir historien. Je cherche en vain. Mes premières lectures de romans historiques ne m’ont
nullement troublé. Je ne me souviens pas m’être plu à rêver parmi les vestiges du temps passé
qui m’environnaient dans Paris. Les événements furent longtemps sans me frapper. Voyons
ceux qui se tiennent au fin fond de ma mémoire. Mémoire auditive : transmis par le poste à
galène, l’écho de l’atterrissage de Lindbergh. Mémoire visuelle : un cercueil de général – l’un
des vainqueurs de la Grande Guerre, je ne sais plus lequel – traîné sur un affût de canon, dans
la pluie grise (il y a bien, enfouie plus profondément, l’image de gardes républicains
chargeant les grévistes sur le boulevard Magenta, mais je ne suis pas certain d’en avoir été le
témoin direct). Premier soubresaut politique dont j’ai conservé une claire conscience : le 6

février. Le plus ancien où je me sentis impliqué : l’avènement du Front populaire. On le voit,
ma mémoire est courte. Mes souvenirs ne sont pas ceux d’un historien-né. Quelques-uns,
beaucoup plus lointains, me furent légués oralement, à la maison. J’en retiens un, l’invasion
des cosaques : ma grand-mère l’avait entendu raconter par la sienne. Les plus vieux
« papiers » de ma famille datent de la fin du
XVIII
e
siècle ; je n’ai jamais eu le goût de
chercher plus haut. Lorsqu’il me fallut gagner ma vie, rien, j’en suis convaincu, ne me
désignait pour cette étrange occupation qui consiste à se retirer, à s’enfoncer dans le silence
pour essayer, mal informé, perdu parmi des traces embrouillées, ternies, disparates, de
comprendre ce qui s’est passé il y a des siècles. Tout semble se réduire à une série de chances
imprévues que j’ai saisies.
On me dira que, pour les saisir, il fallait que je fusse déterminé. Oui, mais par quoi ? Je
ne refuse pas l’idée, lorsque viendra l’âge où les images de l’enfance remontent
irrésistiblement des fondations de la conscience, d’évoquer, pour moi et pour les miens, les
premiers temps de mon existence dans le Paris rouge et noir sur lequel mes yeux se sont
ouverts. Mais si je le fais, ce sera sans nourrir l’illusion, et sans d’ailleurs me soucier, de
débusquer là des pulsions qui aient été de quelque conséquence sur ce dont il est ici question.
Je crois devoir, toutefois, dans ce préambule, placer deux remarques, peut-être explicatives.
Primo, du côté paternel comme du côté maternel, les racines familiales plongent dans
cette France de l’Est dont Lucien Febvre a décrit les singularités. Les paysans ne sont pas
loin. Le souvenir toutefois ne les atteint pas. Il s’arrête à de tout petits notables de bourgade,
des hommes aux grosses moustaches dont aucun ne put dans sa jeunesse compter sur d’autres
que sur lui-même, qui se haussèrent à force d’épargne, dominant leur femme, leurs enfants et
les auxiliaires de leur travail, soucieux d’abord de sécurité, puis de loisir. A leurs yeux, la
tâche bien faite avait valeur fondamentale. Pour avoir longtemps vécu en étroite commensalité
avec les ouvriers, ils ne se sentirent jamais coupés du peuple, attentifs à ne point franchir
l’invisible barrière qui les en eût séparés, mal à l’aise parmi les vrais bourgeois dont ils
partageaient pourtant certains goûts. Préférant s’effacer pour demeurer plus libres, attachés
très fort à cette liberté, amassant prudemment pour acquérir au plus tôt le droit de ne plus rien
faire que par plaisir, dans une totale maîtrise de leur temps.
Secundo, mon enfance fut emprisonnée dans le Paris le plus resserré, comme étouffée
dans un quartier encore central où le populaire se mêlait au demi-monde. Chaque été, partant
pour une ville minuscule, assoupie, toute pénétrée par la campagne, j’avais le sentiment d’une
libération, de respirer. De là, peut-être, cette attitude à l’égard de Paris, qui ne fut pas sans
compter lors de choix décisifs. Attitude ambiguë, où l’attirance et la retenue s’entrecroisent.
Georges D
UBY
, « Le plaisir de l’historien », dans P. N
ORA
(dir.), Essais d’ego-histoire,
Paris, Gallimard, 1987, p. 109-112.

La critique de l’ego-histoire par Pierre Bourdieu (1997)
Pour dépouiller de sa brutalité objectivante l’analyse que j’ai esquissée ici de l’habitus
philosophique d’une génération de philosophes français qui a la particularité d’avoir imposé
ses particularités à tout l’univers, et, peut-être, faire tomber ainsi quelques résistances, je crois
qu’il n’est pas inutile de procéder à un exercice de réflexivité en essayant d’évoquer à grands
traits mes années d’apprentissage de la philosophie. Je n’ai pas l’intention de livrer des
souvenirs dits personnels qui forment la toile de fond grisâtre des autobiographies
universitaires : rencontres émerveillées avec des maîtres éminents, choix intellectuels
entrelacés avec des choix de carrière. Ce qui a été présenté récemment sous l’étiquette d’ego-
histoire me paraît encore très éloigné d’une véritable sociologie réflexive. Les universitaires
heureux, les seuls à qui l’on demande cet exercice d’école, n’ont pas d’histoire. Et ce n’est pas
nécessairement leur rendre service, ni à l’histoire, que de leur demander de raconter sans
méthode des vies sans histoires.
Je ne parlerai donc que très peu de moi, de ce moi singulier en tout cas, que Pascal dit
« haïssable ». Et si je ne cesse pourtant de parler de moi, il s’agira d’un moi impersonnel que
les confessions les plus personnelles passent sous silence, ou qu’elles refusent, pour son
impersonnalité même
1
. Paradoxalement, rien ne paraît sans doute plus haïssable, aujourd’hui,
que ce moi interchangeable que dévoilent le sociologue et la socio-analyse (et aussi, mais
c’est moins apparent, donc mieux toléré, la psychanalyse). Alors que tout nous prépare à
entrer dans l’échange réglé des narcissismes, dont certaine tradition littéraire, notamment, a
établi le code, l’effort d’objectivation de ce « sujet » que nous sommes portés à croire
universel parce que nous l’avons en commun avec tous ceux qui sont le produit des mêmes
conditions sociales se heurte à de violentes résistances. Celui qui prend la peine de rompre
avec la complaisance des évocations nostalgiques pour expliciter l’intimité collective des
expériences, des croyances et des schèmes de pensée communs, c’est-à-dire un peu de cet
impensé qui est presque inévitablement absent des autobiographies les plus sincères parce
que, allant de soi, il passe inaperçu et que, lorsqu’il affleure à la conscience, il est refoulé
comme indigne de sa publication, s’expose à blesser le narcissisme du lecteur qui se sent
objectivé malgré lui, par procuration, et de manière d’autant plus cruelle, paradoxalement,
qu’il est plus proche, dans sa personne sociale, du responsable de ce travail d’objectivation. A
moins que l’effet de catharsis que produit la prise de conscience ne s’exprime, comme il
arrive parfois, dans un rire libéré et libérateur.
Je dois dire d’abord, et ce sera ma seule « confidence », qu’il est probable que si je
puis former aujourd’hui, avec quelques chances de succès, le projet de restituer la vision du
monde universitaire et du monde intellectuel qui était la mienne dans les années cinquante,
non dans ce qu’elle pouvait avoir d’illusoirement unique, mais dans ce qu’elle avait de plus
banalement commun, jusque dans l’illusion de la singularité, c’est que je n’ai pas su me
complaire très longtemps dans les émerveillements de l’oblat miraculé. Expérience assez rare,
sans être pour autant unique (je l’ai retrouvée chez Nizan, à travers notamment la très belle
préface de Sartre à Aden Arabie), qui inclinait sans doute à une distance objectivante – celle
qui fait d’ordinaire le bon informateur – à l’égard des séductions trompeuses de l’Alma mater.
C’est en m’appuyant sur cette expérience que je vais essayer de reconstruire l’espace
des possibles tel qu’il apparaissait au membre que j’étais d’une catégorie particulière
d’adolescents, les « normaliens philosophes », possédant en commun tout un ensemble de
propriétés, liées au fait d’être situé au cœur et au sommet de l’institution scolaire, et séparés,
entre eux, au demeurant, par des différences secondaires, associées notamment à leur
1
Louis Marin, à qui je dédie ce post-scriptum, a superbement élaboré, à propos de Pascal, la question de savoir
« qui est ‘je’ ? » (cf. L. Marin, Pascal et Port-Royal, Paris, PUF, 1997, spécialement p. 92 sq.)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%