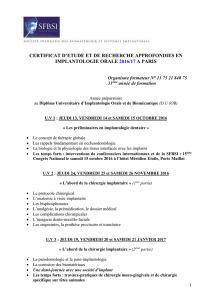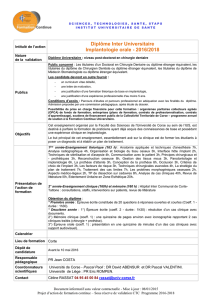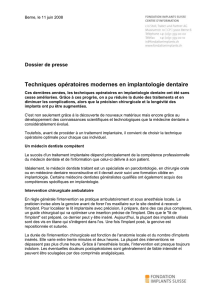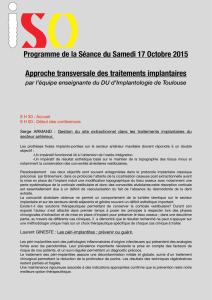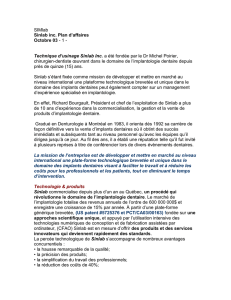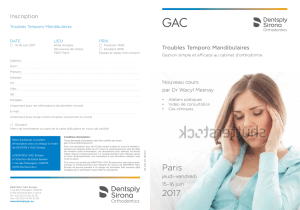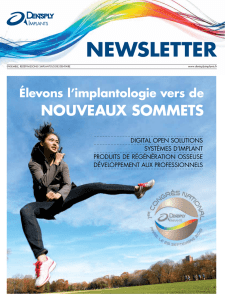NEWSLETTER - DENTSPLY Implants

NEWSLETTER
ENSEMBLE, REDÉFINISSONS L’IMPLANTOLOGIE DENTAIRE www.dentsplyimplants.fr
Édition spéciale

2
1ER CONGRES NATIONAL DENTSPLY IMPLANTS
Promesse de liberté
et de solutions personnalisées et pérennes…
“La mondialisation,
longtemps synonyme
de production de masse,
évolue pour répondre
à une demande pressante
de différenciation.”
“Notre objectif : devenir
le leader en implantologie.”
THIERRY CAUCHE
Directeur France DENTSPLY Implants
WERNER GROLL
Vice-Président Groupe
DENTSPLY Implants
Comment est né DENTSPLY Implants ?
DENTSPLY Implants est né suite à l’acqui-
sition d’Astra Tech Dental par DENTSPLY
International et à la volonté du groupe
DENTSPLY de créer un nouveau leader
mondial de l’implantologie dentaire.
L’annonce de ce rachat a été faite en sep-
tembre 2011, mais l’intégration des deux en-
tités ne date que du 1er janvier 2013 en France.
Quel est votre positionnement sur le marché
implantaire ?
DENTSPLY Implants est désormais solide
N° 3 mondial, loin devant les N° 4 et 5 du
marché et à quelques points seulement
des deux leaders historiques. En France,
la situation est différente, car nous y
sommes clairement N° 2 avec la ferme
intention d’être leader du marché dans
les prochaines années. Nous avons l’offre
produits la plus riche du marché, l’une
des équipes les plus expérimentées. Nous
avons donc tous les atouts pour y parvenir.
Projets de futures acquisitions ?
Ce type de décisions n’est pas pris en
France ni même en Europe, mais par le
siège américain situé à York, en Pennsyl-
vanie. Je n’ai pas d’informations à ce sujet.
Ce qui est par contre vraisemblable, c’est
que DENTSPLY International continue sa
politique d’acquisitions comme cela a été
le cas ces dernières années. DENTSPLY
rachetant toujours des entreprises connues
pour l’excellence qualitative des produits
qu’elles fabriquent.
Axes de développement, notamment
dans le numérique ?
Cela constitue notre principal axe de dé-
veloppement et explique en partie notre
succès actuel. Les solutions prothétiques
sur mesure ATLANTISTM et ATLANTISTM
ISUS sont l’état de l’art de la discipline. Je
suis convaincu que les solutions standards
et les prothèses surcoulées auront disparu
des cabinets dans peu de temps.
L’intégration de la prothèse dans la
chirurgie guidée SIMPLANT® va rendre
de grands services à nos utilisateurs. Les
gains de temps, l’amélioration des résul-
tats esthétiques et la simpli cation sont
les principales conséquences positives de
cette évolution.
Pourquoi avoir choisi le Musée du Quai
Branly pour ce premier congrès ?
DENTSPLY Implants veut être dans son
époque c’est-à-dire dans le XXIe siècle.
Le Musée du Quai Branly est un endroit
paradoxal : il retrace l’histoire des civi-
lisations, dites primitives, mais il nous
communique surtout le message d’uni-
versalité de l’humanité. Dans le village
mondial, où la culture occidentale domi-
nante a perdu sa suprématie, il est impor-
tant que nous trouvions tous un socle de
valeurs communes à partager. L’analogie
est forte avec DENTSPLY Implants qui
est une société nouvelle et riche de deux
cultures originelles fortes. C’est la raison
pour laquelle j’ai aussi souhaité la présence
du paléoanthropologue Pascal Picq pour
resituer notre quotidien dans la lignée de
l’évolution et dans la nécessité de celle-ci.
Quels sont, selon vous, les prochains défi s
en implantologie ?
L’implantologie reste trop marginale dans
l’arsenal thérapeutique du praticien fran-
çais. Pourquoi tant de freins alors que
tout praticien, d’un point de vue déonto-
logique, admet que l’implantologie est la
meilleure solution aux situations d’éden-

3
Implanter le changement
ou quand les poules avaient des dents
Trois façons de penser le rapport au
monde : fi xisme (le monde est stable
ou évolue selon des cycles réitératifs),
transformisme (évolution selon un
destin, une fi nalité) et évolutionnisme
(changements aléatoires).
L’évolution est en fait le résultat de
nombreux éléments, des catastrophes
naturelles à celles provoquées par
l’Homme en passant par la tendance
forte à vouloir dépasser son prochain,
son voisin, son concurrent. Lamarck
pose les principes du transformisme :
la fonction crée l’organe et les
caractères acquis qui se révèlent
favorables sont transmis à la postérité.
De nombreux exemples viennent
contredire cette conception
de l’évolution qui conserve néanmoins
de nombreux adeptes.
Il faut attendre Darwin, Adam Smith et
d’autres grandes fi gures scientifi ques et
industrielles réunies au sein du Club de
la Lune, pour défi nir les bases
de l’évolution, qu’elle soit médicale
ou technique… pour aboutir
à la notion de progrès.
La sélection naturelle repose sur une
multitude de facteurs, des différences
entre individus aux conditions d’accès
aux partenaires sexuels ! L’innovation
regroupe une grande variété de
situations… qu’elle relève du bricolage
comme pour l’invention de l’ordinateur
personnel ou de la coaptation comme
l’apparition de la bipédie chez
l’Homme ! La question qui se pose
est souvent celle de leur implantation,
sans jeu de mots. La découverte de
l’ostéointégration relève du hasard,
mais elle n’aurait probablement pas
émergé sans le contexte
médico-scientifi que de l’époque
et les personnalités impliquées !
La stratégie d’adaptation doit être
qualitative : fort investissement
des acteurs, eux-mêmes très qualifi és,
échangeant librement pour favoriser
l’émergence de solutions à haute
valeur ajoutée, qu’elle soit fi nancière
ou médicale !
tement des patients ? Les industriels ont
certainement une responsabilité, mais la
formation initiale est également respon-
sable de la situation.
Pour ce qui concerne la formation, il nous
faut agir pour que l’université française
ne considère plus l’implantologie comme
une discipline à part. Je reste frustré
lorsqu’une université m’annonce que tous
les étudiants de 6è année auront posé au
moins un implant, alors qu’en Suisse par
exemple, l’implantologie est enseignée
dès le début du cursus universitaire.
Dans le même temps, les industriels
doivent se poser la question : pourquoi
tant de praticiens ne franchissent pas le
pas ? Même après une formation de type
DU ou les formations que nous organi-
sons ou supportons, seuls 30% environ
des participants posent des implants.
Nous devons absolument rendre la pra-
tique de l’implantologie plus accessible.
Par ailleurs, nous constatons également
que la proportion de femmes posant
des implants est plus faible que chez les
hommes. Compte tenu de la féminisation
rapide de la profession, c’est un autre dé
à relever.
Je suis convaincu que la numérisation
abaissera les dif cultés d’accès à cette
technique. Nous devons agir en ce sens
pour que la profession puisse offrir la
meilleure offre de soins possible aux pa-
tients.
UN INVITÉ PRESTIGIEUX
PASCAL PICQ
Paléoanthropologue au Collège de France
Promesse de liberté
et de solutions personnalisées et pérennes…

4
COMPTE RENDU DU CONGRÈS
SESSION CHIRURGIE
PRÉ-IMPLANTAIRE
Modérateur Dr Georges
Khoury (Paris)
Avec la participation du
Pr Armand Paranque (Paris)
Le développement
de l’implantologie repousse
chaque jour les limites de nos
thérapeutiques. Parallèlement,
les techniques chirurgicales sont de
plus en plus complexes et délicates,
demandant une véritable expertise,
non seulement dans leur indication,
mais aussi dans leur enchaînement
au sein du plan de traitement.
PRÉLÈVEMENTS OSSEUX ET TECHNIQUES DE GREFFE
Dr Pierre Keller (Strasbourg)
COMBLEMENT DE SINUS : GESTION DU TEMPS DE TRAITEMENT ET DES RISQUES
Dr Antoine Diss (Nice)
Difficile de parler d’os sans parler
de biomatériau : leur utilisation fait
maintenant partie de notre arsenal
thérapeutique. Il faut en revanche être
conscient de leurs limites et ne pas
leur en demander trop ! L’os autogène
reste le Gold Standard pour tous les
cas extrêmes.
Mais la démarche doit être préventive
en limitant les pertes osseuses lors
des étapes chirurgicales préliminaires,
avec une technique de volet osseux
par exemple. De même, l’utilisation
d’un trépan lors du forage doit veiller
à conserver la carotte osseuse qui
peut servir à aménager le site et, par
exemple, combler un défaut ponctuel
vestibulaire.
Le prélèvement d’un bloc d’os
autogène reste la solution
incontournable : la zone rétro-molaire
offre de nombreux avantages dont
un volume disponible important avec
un protocole chirurgical simple. Les
ostéotomies sont réalisées avec une
scie chirurgicale, la Micro-Saw®.
Une série de perforations permet
au ciseau à os de libérer le bloc
cortical vestibulaire. Le prélèvement
mentonnier est plus délicat, même s’il
offre un os plus spongieux dont la
revascularisation est théoriquement
plus facile à obtenir.
Le greffon est ensuite dédoublé
et fixé à distance de l’os résiduel :
l’interstice est ensuite comblé avec
des particules osseuses. Trois à quatre
mois plus tard, la réintervention
confirme l’augmentation de volume
et la bonne qualité du site opératoire,
prêt à recevoir les implants. Cette
technique permet de réduire les
défauts horizontaux comme verticaux,
associée bien évidemment
à une gestion des tissus mous.
Les comblements de sinus ont été
proposés au tout début des années 80.
En plus de trente ans, les publications,
conférences de consensus et méta-
analyses ont permis de valider des
protocoles opératoires plus simples.
L’implantation différée reste indiquée
en cas de manque de hauteur osseuse,
sans qu’une valeur minimale soit
définie dans la littérature. En 2012.
une revue de littérature de Wallace
et coll. introduit la notion de stabilité
primaire minimale de l’implant comme
indication de l’implantation simultanée.
Plus que la hauteur osseuse, il apparaît
que l’obtention d’une bonne stabilité
est le facteur le plus important
pour envisager une implantation
dans le même temps chirurgical
que le comblement sinusien. Le
sous-forage léger du site, réalisé
précautionneusement, permet de visser
l’implant en préservant la corticale
osseuse. Le design du col implantaire
peut comporter des micro-spires
favorisant, avec un profil cylindro-
conique, une excellente stabilité
primaire dans une faible hauteur
osseuse.
Ces techniques paraissent
incontournables actuellement,
pour la restauration des secteurs
postérieurs maxillaires comme en cas
d’édentement complet :
la réduction des délais de traitement,
lorsqu’il est possible d’implanter
simultanément au comblement de sinus,
apporte un véritable avantage, et ce
pour des taux de succès identiques !
Lorsque la mise en charge est
envisageable, les délais de traitement
peuvent descendre à 3/4 mois :
la prothèse provisoire ou, dans certains
cas, la prothèse d’usage, peut être
mise en place, voire en charge, à
l’issue de l’intervention.
Dans sa propre pratique
de comblement de sinus,
les implantations simultanées
représentent 94% des cas, dont 18%
avec une mise en charge simultanée.
Vivez en direct les débats des tables rondes sur www.dentsplyimplants.fr

5
SESSION
PARODONTOLOGIE
Modérateur Dr Jean-Louis
Giovannoli (Paris)
Avec la participation du
Dr Marie-Odile Girard
(Bellignat)
L’ostéointégration fait aujourd’hui
partie des acquis. Il est toujours
possible de discuter de points précis,
comme le design de l’implant, sa
connectique et son état de surface,
mais ce qui nous importe est de
limiter les suites et complications
postopératoires, à court, à moyen
et à long terme.
APPROCHE BIOMÉCANIQUE DE LA LIAISON
PILIER-IMPLANT : CONSÉQUENCES CLINIQUES
Dr Thierry Gotusso (Manosque)
PÉRENNITÉ DE LA SANTÉ DES TISSUS PÉRI-IMPLANTAIRES
Dr Jean-Pierre Albouy (Montpellier)
Autant la gestion des tissus mous
et de l’esthétique pour une prothèse
dento-portée est bien codifiée et les
résultats prévisibles, autant la situation
est toute autre pour la prothèse
implanto-portée. Rappelons que
l’implant est posé dans l’os, que la
restauration qu’il porte évolue dans un
milieu très contaminé… Alors que la
prothèse dento-portée, souvent juxta
voire supra-gingivale, bénéficie de
conditions beaucoup plus favorables
grâce à l’attache épithéliale, entre
autres.
L’accumulation de bactéries
et des toxines associées va facilement
provoquer une inflammation puis une
perte osseuse autour de la restauration
puis de l’implant. Le biofilm se
constitue, se développe et entraîne une
destruction de l’épithélium d’abord,
de l’os de soutien ensuite.
En fait, c’est le système immunitaire
du patient qui va provoquer la perte
osseuse, stimulée comme elle est
par la simple persistance du biofilm.
Les études sur la prévalence des
péri-implantites donnent des résultats
discordants, de 9 à plus de 50%
des patients observés, selon les études.
Assez inquiétant pour justifier un suivi
systématique et continu des patients
implantés ! Rien de tel que de réaliser
une prophylaxie locale en renforçant
périodiquement les instructions
d’hygiène orale.
En cas d’inflammation, même sévère,
sans perte osseuse, ces mesures
permettent de conserver, ou retrouver,
une bonne santé péri-implantaire,
car la diminution de la charge
bactérienne va classiquement
provoquer une régression
de l’inflammation.
Recommandations de lecture :
Manuel de suivi thérapeutique
en implantologie dentaire
DENTSPLY Implants
Les échecs qui sont présentés
correspondent presque toujours
à des fautes, des écarts par
rapport
à
des protocoles opératoires validés
et des recommandations cliniques.
Ils interviennent le plus souvent à court
terme, sanctionnant le patient autant
que le praticien.
Parmi les facteurs influençant la
pérennité d’un traitement
implantaire,
le mode de liaison pilier/implant a été
largement étudié.
La géométrie « Switching Platform »
favorise l’organisation
d’un réseau
de fibres collagéniques
à proximité
de la jonction implant/pilier et non
plus au niveau de la première spire
de l’implant. Le niveau osseux suivra
en conséquence, c’est la composante
biologique.
Le mode de connexion, à hiatus
horizontal ou vertical, conditionne
également la santé
des tissus
péri-implantaires dans la mesure
où un hexagone, interne ou externe,
présentera un plus grand hiatus que
les liaisons coniques et cela sous l’effet
d’un chargement mécanique.
Ce hiatus est susceptible d’être
colonisé par des micro-organismes qui
vont libérer leurs toxines et provoquer
des remaniements tissulaires, ce qui
peut compromettre la bio-intégration
de la prothèse ostéo-intégrée :
c’est la composante microbiologique.
D’autre part, l’ensemble des
études par
éléments finis confirme la composante
mécanique de la connexion.
En effet, les contraintes exercées par
l’intermédiaire de
l’implant sur l’os
crestal sont largement supérieures
pour un implant à connexion
hexagonale interne ou externe.
Le « Switching
Platform » réduit
dans la zone cervicale de l’implant,
les contraintes ressenties dans le tissu
osseux, et cela quel que soit le mode
d’assemblage pilier-implant.
Toutefois l’association entre la
géométrie « Switching
Platform »,
la réduction du hiatus et l’effet cône
morse de la liaison conique semble
être le trio gagnant pour la stabilité
des tissus péri-implantaires.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%