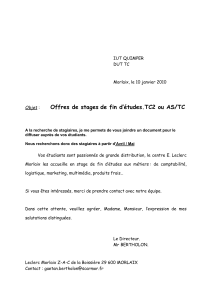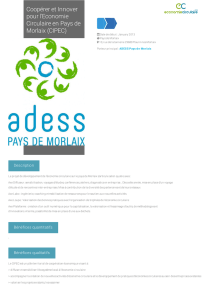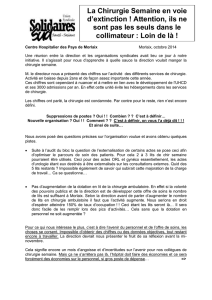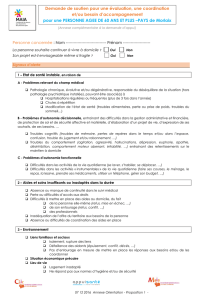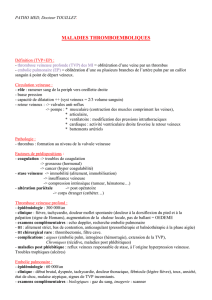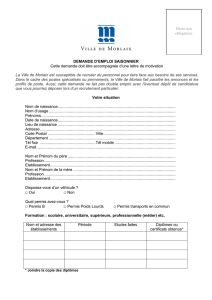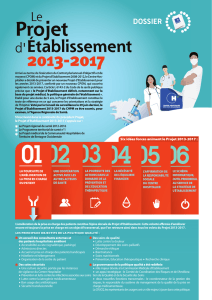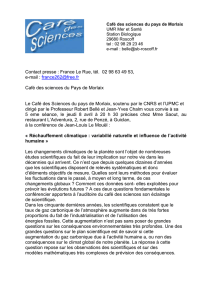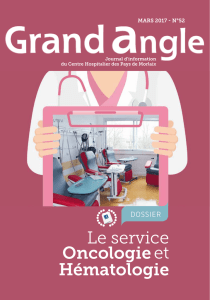Voir - Centre Hospitalier des Pays de Morlaix

Journal d'information
du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
externe et
Évaluation
Certification
...À vos marques !
2014V
DOSSIER
OCTOBRE 2014 - n°42

EDITO
S’ il est à ce jour dicile d’extrapoler ce que sera la situa-
tion nancière du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
à la n de l’exercice 2014, la situation nancière connue au
31 août 2014, nous laisse entrevoir des dicultés majeures.
Si les dépenses sont contenues et notamment les dépenses
de personnel qui représentent, rappelons-le, 73 % du
budget, les recettes ne sont pas au rendez-vous : une
activité stable, voire en légère diminution, couplée à une
baisse des tarifs, le gel depuis 2012 des dotations SSR et en
psychiatrie, ne permettront pas, à coup sûr, de réaliser les
recettes prévues.
Cette situation ne pourra entrainer qu’un décit qui sera
nettement supérieur, à celui observé en 2013.
Certes cette situation n’est pas spécique au Centre Hospi-
talier des Pays de Morlaix, de plus en plus d’établissements
étant confrontés à ce type de dicultés.
Il n’empêche que le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
ne pourra rester immobile face à cette situation qui ne
pourrait qu’aaiblir la position de l’établissement.
Je suis convaincu que, comme d’habitude, notre Centre
Hospitalier saura relever cet important dé !
Comité de rédaction
Directeur de la publication : Richard BREBAN, Directeur.
Rédacteur en chef : André-Dominique ZARRELLA, Directeur Adjoint.
Membres :
•
Bernard BINAISSE, Psychologue, secteur 5
•
Christine MOGUEN, Directrice IFSI
•
Hervé CARLUER, Contremaître P. Services Techniques.
•
Michel LEMERCIER, Cadre Supérieur Coordonnateur du pôle Psychiatrie Addictologie
•
Mariannic LANDIÉ, Cadre Supérieur Coordonnateur des pôles Médico-techniques
et Chirurgie Mère-Enfant
•
Rémi RIVOALEN, Cadre Supérieur Coordonnateur du pôle SSR Personnes Agées
•
Brigitte ORY, Cadre Socio Educatif, Service Social
•
Yannick LE GUEN, Responsable des services intérieurs
•
Albert ADENET, Responsable Cuisine Centrale
Conception et réalisation : Florence MAUSSION, Graphiste, Brest.
Impression : Cloitre Imprimerie - Tirage : 1 000 exemplaires.
15, rue de Kersaint Gilly - BP 97237 - 29672 Morlaix Cedex
Tél. 02 98 62 61 60 - Fax 02 98 62 69 18
www.ch-morlaix.fr
SOMMAIRE
12
6
8
10
11
13
14
15
15
DOSSIER
La certication est une procédure d’évaluation externe d’un établissement de
santé, obligatoire, indépendante de l’établissement. Tout le Centre Hospitalier
des Pays de Morlaix est concerné en dehors des structures sociales et médico-
sociales, soumise à des exigences spéciques (ANESM). Des professionnels de
santé mandatés par la Haute Autorité de Santé (HAS) réalisent les visites de
certication sur la base d’un manuel. Ce référentiel permet d’évaluer le fonction-
nement global de l’établissement de santé. Le CHPM a déjà satisfait à trois visites
de certication en 2003, 2007 et 2010. Nous préparons actuellement la quatrième
procédure, dite V2014. Cette visite, initialement prévue en décembre 2014, a été
reportée en juin 2015 par la Haute Autorité de Santé. Le niveau d’exigence est
homogène pour tous les établissements de santé.
• Evaluation grille V2014
• Bilan V2010 - Eléments de preuves
• Identication des principaux risques
• Détermination du niveau de criticité du risque
• Evaluation du niveau de maitrise du risque
• Détermination ou non d’un plan d’action
• Mise en œuvre des actions d’amélioration
• Formalisation du compte qualité
• Priorité aux Pratiques Exigibles Prioritaires
• Formalisation du compte qualité
Priorité aux Pratiques Exigibles
Prioritaires
• Mise en œuvre des actions
d’amélioration
• Formalisation des processus
• Suivi du plan d’action
• Mise à jour du compte qualité
• Retour d’expérience Evaluation
RAPPELS
RAPPELSECHÉANCIER
DE MAI À NOVEMBRE 2014
Evaluation externe des unités médico-sociales
DÉCEMBRE 2014 À MAI 2015
DÉCEMBRE
2014-2015
JUIN 2015
NOVEMBRE 2014
APRÈS JUIN 2015
Réalisation de l’autodiagnostic (ancien-
nement auto évaluation) par des groupes
créés sur une thématique donnée ou par
des instances / structures déjà en place
dans l’établissement.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale rend obligatoire l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux : FAM du Triskel, SSIAD, EHPAD de Belizal et de l’Argoat, CSAPA.
Les services susmentionnés se sont donc engagés dans cette démarche d’évaluation qui se déploie en deux temps :
L’évaluation externe est une procédure obligatoire, qui concerne l’ensemble des
établissements médico-sociaux, et qui interviendra désormais tous les 7 ans.
L’évaluation externe s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la
qualité : elle permet de valider la réponse du service aux attentes et besoins des
usagers, l’organisation et les moyens déployés. Elle met en avant les points forts
et les points à améliorer. L’objectif nal est de vérier que les droits des usagers
sont respectés et que le projet de service y répond. L’évaluation externe n’a pas
pour but d’évaluer des pratiques individuelles. Le programme d’évaluation
externe comporte des temps d’analyse documentaire, d’observations et de
rencontres avec les professionnels, les usagers, leur entourage et les partenaires.
Un rapport d’évaluation est élaboré et adressé ensuite aux autorités publiques
(ARS, Conseil Général).
Envoi du
compte qualité
Visite de
certication
Déploiement du compte qualité,
tenant compte de l’évaluation de
nos risques, des audits et des autres
démarches qualité en cours dans
l’établissement
Poursuite de la démarche
qualité avec actualisation du
compte qualité. Transmis-
sion à la HAS tous les 24 mois
Management stratégique, gouvernance
Santé, sécurité et qualité de vie au travail
Management et gestion de la qualité et des risques
Gestion du risque infectieux
Droits des patients
Parcours du patient
Prise en charge de la douleur
Prise en charge et droits des patients en n de vie
Gestion du dossier du patient
Identication du patient à toutes les étapes de sa
prise en charge
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient
Biologie médicale
Imagerie
Prise en charge du patient aux urgences et soins non programmés
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire
Management de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque
Dons d’organes et de tissus à visée thérapeutique
Gestion des ressources humaines
Gestion du système d’information
Gestion des ressources nancières
Processus logistiques
GRAND ANGLE N°42 - OCTOBRE 2014
3
2
RAPPELS
LES 20 THÉMATIQUES DU MANUEL DE CERTIFICATION 2 :
PRINCIPE GÉNÉRAL D’ANALYSE D’UNE THÉMATIQUE 1
THÉMATIQUES V2014 = PROCESSUS
= CLASSEMENT DES DOCUMENTS SUR ENNOV
Du cÔté Des affaires
méDicales
fOcus
eN Direct De la DrH
BrÈVes-actualités
Les 20 ans de Belizal !
Fonction restauration et nutrition
L’insuffisance veineuse
POur eN saVOir +
éVÈNemeNt
La disparition du privilège de la
boîte du Roi
HistOire
3
Evaluation externe et Certification V 2014
...À vos marques !
actualité Des PÔles
actualité De l’ifsi
DOSSIER
réalisation d’une évaluation interne ou « auto-évaluation »
(fait en 2012/2013).
réalisation d’une évaluation externe sur site par un organisme
indépendant habilité par l’ANESM.
Cette seconde étape va s’organiser comme suit :
1 2
Cabinet ANALYS SANTÉ
Mme BAGOT, Cabinet MQS
Dates de l’évaluation
externe sur site EvaluateurService
Mme BAGOT, Mme BERTHELOT
Cabinet MQS
M. SOREL, cabinet MQS
M. SOREL, cabinet MQS3 et 4 novembre 2014
FAM du Triskel
EHPAD Argoat
CSAPA
SSIAD
EHPAD de Belizal
2015 (dates à déterminer)
2015 (dates à déterminer)
17 novembre après-midi
et 18 novembre 2014
15 décembre après-midi,
16 et 17 décembre 2014
Le Directeur,
Richard BREBAN

GRAND ANGLE N°39 - OCTOBRE 2013
GRAND ANGLE N°42 - OCTOBRE 2014
5
4
Les évolutions de la V2014
DOSSIER
IPAQSS 2014
Toutes les démarches d’amélioration qu’il s’agisse de la certication, du
DPC, gestion des risques (RMM, CREX…), formation, accréditation des
médecins... sont inclues dans le Programme d’Amélioration de la Qualité
et la Sécurité des Soins « PAQSS » de l’établissement.
La mise en œuvre d’une de ces démarches peut permettre à la fois de
satisfaire à l’obligation de DPC du professionnel et d’être prise en compte
et valorisée dans la certication.
Chaque année, l’établissement mesure des indicateurs de Performance pour l’Amé-
lioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (IPAQSS) instaurés depuis 2008 au
niveau national. Ils seront intégrés automatiquement au « COMPTE QUALITÉ ».
L’utilisation des indicateurs dans le cadre de la certication doit permettre :
• d’alimenter le PAQSS de l’établissement et servir de base de dialogue avec
les experts visiteurs lors de la visite,
• d’évaluer la capacité de l’établissement de santé à intégrer les indicateurs
de qualité comme outils de management de la qualité,
• de se substituer à certains critères ou éléments d’appréciation du référentiel.
Les critères aujourd’hui en lien avec les indicateurs généralisés sont
les suivants :
• Critère 2.e Indicateurs, tableaux de bord et pilotage de l’établissement.
• Critère 8.g Maîtrise du risque infectieux.
• Critère 8.h Bon usage des antibiotiques.
• Critère 12.a Prise en charge de la douleur (IND TRD).
• Critère 14.a Gestion du dossier du patient (IND TDP).
• Critère 19.b Troubles de l’état nutritionnel (IND TDN Niveau 1).
• Critère 20.a Management de la prise en charge médicamenteuse du patient.
• Critère 20.a bis Prise en charge médicamenteuse du patient
(Critère « Prescriptions médicamenteuses établies pendant l’hospitalisation» - IND TDP)
• Critère 24.a Sortie du patient (IND DEC).
• Critère 26.a Organisation du bloc opératoire (IND DAN).
• Critère 28.a Mise en œuvre des démarches d’évaluation des pratiques
professionnelles (IND RCP Niveau 2).
• Critère 28.c Démarches EPP liées aux indicateurs de pratique clinique.
C’est une méthode d’évaluation des processus de soins et
des organisations qui s’y rattachent à partir d’un séjour de
patient hospitalisé
• Elle étudie la satisfaction aux attentes du manuel en situa-
tion concrète
• Elle permet d’observer les interfaces et la collaboration
interdisciplinaire tout au long de la prise en charge
L’analyse du prol de risque de l’établissement dénit des
sujets (thématiques, secteurs, unités, activités, populations)
prioritaires à investiguer. La durée moyenne d’un parcours
« patient traceur » est d’environ 2 heures. Dans chaque pôle
de soins, deux « patients traceurs » seront réalisés prochai-
nement, an de mettre en oeuvre la visite de certication.
LE COMPTE QUALITÉ
LES PRATIQUES EXIGIBLES PRIORITAIRES EXIGIBLES
ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EPP
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DPC
Le compte qualité est une innovation de la V2014 : il doit par-
ticiper à rendre la procédure de certication plus continue et
va constituer, pour la Haute autorité de santé, l’outil de pilo-
tage de la démarche de certication de chaque établissement.
Il porte une double ambition :
• Favoriser la simplicité et l’ecacité en évitant de multiplier
les approches et les supports en se substituant à des étapes
actuelles de la procédure (autoévaluation, suivi…) ;
• Rendre le programme qualité et sécurité des soins, comme
les axes d’évaluation, lisibles et mobilisateurs pour les pro-
fessionnels de santé.
Il a pour nalités de contribuer au pilotage et à l’animation
du Programme d’Amélioration de la Qualité et la Sécurité
des Soins « PAQSS » et de mieux dénir les besoins dans le
cadre de la visite de certication.
Niveau Description synthétique
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
On sait faire face, bonne maîtrise : plans avec exercices et formations,
veille, contrôle, amélioration continue
On a tout prévu : plans d’action en place avec indicateurs
On a organisé : organisation en place sans évualuation
On est en alerte : quelques actions mais insusantes - veille mais sans actions
On découvre le risque : auncune action en place - étuses en cours - actions inecaces ...
Champ - il porte à minima sur les 12 thématiques auxquelles sont
rattachées les Pratiques Exigibles Prioritaires (2) :
• Il est tenu à jour régulièrement.
• II est adressé à la HAS tous les 24 mois pour le suivi des actions
et des résultats. Premier envoi : 15 janvier 2014.
PASS
Programme
d’Amélioration
de la Qualité et la
Sécurité des
Soins
Gestion Des Risques
A priori (analyse de
processus, AMDEC)
Cartographie des risques
A posteriori
(Événements
indésirables, EIG)
EPP
Audit clinique,
RMM, CREX, REMED,
chemin clinique, RCP,
revue de pertinence,
patient traceur...
DPC
Accréditation -
Formation
Inspections
(ARS, ASN, DDPP…)
autres évaluations
externes
Évaluations
Audits, enquêtes,
Indicateurs internes
Indicateurs régionaux / nationaux
Suivi des
recom-
mandations
Point de vigilance Formalisation et déploiement des EPP, patients traceurs… • Actualisation des procédures / protocoles dans chaque service
• Suivi des actions d’amélioration retenues, notamment suite aux visites / inspections récentes.
DÉMARCHE QUALITÉ GESTION DES RISQUES CERTIFICATION / ACCRÉDITATION
Autodiagnostic, visites sur le terrain, évaluation des processus
Les PEP sont identiques à celles de la V2010, il faut consolider
nos acquis et prouver notre évolution !
Objectifs de la V2014 :
Evaluer la structuration institutionnelle de l’EPP/DPC,
Mesurer le déploiement eectif et l’engagement des professionnels,
Mesurer l’impact et les progrès accomplis
Un thème d’impulsion est un sujet comportant une forte
dimension d’ordre culturel :
Importance de la mise en place de projets
et de démarches d’amélioration
Changement culturel et organisationnel à conduire.
Les thèmes d’impulsion de la V2014 sont :
Bientraitance
Qualité de vie au travail.
LES THÈMES D’IMPULSION
Le thème management de la qualité et des risques devient une
Pratique Exigible Prioritaire « PEP » dans son ensemble et inclut les
exigences relatives à l’évaluation des pratiques professionnelles. Les
établissements de santé doivent travailler sur leurs risques majeurs
sans négliger la priorisation de leurs actions. Cela signie :
Connaître ses risques (8d)
Mettre en place un processus de maîtrise des risques résiduel
Réaliser une approche système (processus) avec un accent mis
sur les interfaces.
LE MANAGEMENT QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
Certaines organisations ou secteurs identiés (Prise en charge médi-
camenteuse, Service d’Accueil des Urgences, Bloc opératoire, Prise en
charge du patient en endoscopie).
La Haute Autorité de Santé a identié des sujets fondamen-
taux ayant un fort impact sur l’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins. Ces thèmes font l’objet d’une exigence
renforcée. Lors de la visite, les experts visiteurs de l’HAS mène-
ront un examen approfondi de l’atteinte de ces exigences.
Au nombre de 18, on peut les regrouper en 7 familles :
La politique et l’organisation de l’Evaluation des Pratiques
Professionnelles
L’organisation Qualité/Risques (Gestion des risques,
évènements indésirables, plaintes et réclamations, Pro-
gramme qualité et sécurité des soins)
Les vigilances (Risques infectieux et identitovigilance)
L’information médicale (Gestion du dossier du patient,
Accès du patient à son dossier).
Prise en charge du patient (continuité et coordination de la
PCP, prise en charge somatique des patients, respect des liber-
tés individuelles et gestion des mesures de restriction de liberté)
Les prises en charge spéciques des patients (Douleurs,
Soins palliatifs)
Admission non programmée
par les urgences
Admission non programmée
par une lière spécique
Accueil dans le service
Identication du patient
Douleur
Évaluation initiale et continue de
l’état de santé du patient et PPS
Examens biologie médicale
Examens d’imagerie
Examens de médecine nucléaire
Examens d’endoscopie
Passage au bloc opératoire
Prise en charge médicamenteuse
Prise en charge transfusionnelle
Education thérapeutique
Continuité et coordination
de la prise en charge
Gestion des données du patient
Droits des patients
Prévention de la maltraitance et
promotion de la bientraitance
Respect de la dignité et de l’intimité
du patient
Respect de la condentialité des
informations
Prise en compte de l’entourage
En cas de restriction de liberté
Si hospitalisation sans consentement
Information du patient sur son état de
santé et les soins
Consentement et participation du patient
Personne de conance
Quelques parcours à fort enjeu : Personnes âgées • Patients porteur
de maladie chroniques •Enfants et adolescents • Chirurgie ambulatoire
LE PATIENT TRACEUR
L’AUDIT DE PROCESS
Un processus est déni comme un enchaînement d’étapes suc-
cessives au service d’un objectif. L’audit de processus = une
méthode d’évaluation de la réalité de l’activité des établissements
de santé (HAS, novembre 2013). Il permet d’évaluer l’enchaîne-
ment des activités et la maîtrise des interfaces (entre services /
entre professionnels) dans le but de détecter les écarts entre ce
qui est prévu et ce qui est réalisé. Une majorité des processus
de notre établissement sont repris dans les 20 thématiques du
manuel de certication(2). Ils sont schématisés ci-contre dans une
« cartographie des processus ». Dès janvier 2015, les groupes
d’autodiagnostic seront mis à contribution pour la formalisation
des processus au CHPM.
Tenue du dossier patient
Délai d’envoi du courrier
de n d’hospitalisation
Traçabilité de l’évaluation
de la douleur
Dépistage des troubles
nutritionnels
Tenue du dossier
anesthésique
Réunion de concertation
pluridisciplinaire en can-
cérologie
TDP
DEC
TRD
DTN
TDA
RCP
94/100
64/100
90/100
81/100
95/100
70/100
79/100
51/100
81/100
87/100
85/100
79/100
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
DAN
DPA MCO
SSR
RPC
DPA PSY
Calendrier 2014 de recueil des indicateurs
Mots clés Intitulé Résultats
du CHPM Evolution
2012/2014 Moyenne
nationale
Résultats 2014
LIEN AVEC LA PROCÉDURE DE CERTIFICATION V2014
Compte qualité
Outil de pilotage interne + Outil de communication HAS
Extrait des thématiques :
Auteurs : Carina Le Foll et Kathia Foucher

POUR EN SAVOIR +
L’insuffisance
veineuse
La distensibilité excessive des parois vei-
neuses et l’augmentation de pression dans
les veines profondes et supercielles favo-
risent une modication du tonus veineux
responsable d’une diminution du retour
veineux.
La perte d’étanchéité des valvules entraîne
un reux dont les conséquences sont la
stase veineuse et ses diérentes compli-
cations.
Ils sont multiples et le premier est bien sûr le fait
que nous sommes les seuls mammifères qui ont
acquis la position verticale. Nous pouvons citer:
• l’hérédité,
• le surpoids,
• la sédentarité,
• les désordres et certains traitements hormonaux,
• la grossesse,
• les déséquilibres alimentaires,
• les troubles de la statique plantaire,
• la chaleur,
• certains sports,
• les antécédents de phlébite,
• l’âge...
La prévention et le traitement de la maladie
veineuse sont indissociables et complémentaires.
La prévention consiste en la correction des facteurs
de risque par :
Le traitement peut être médical et/ou chirurgical:
Ces deux traitement ne s’opposent pas mais sont
complémentaires.
Le traitement médical associe:
- Une bonne hygiène de vie veineuse,
- La prise éventuelle d’un traitement phlébotonique
qui a pour objectif de tonier les parois veineuses et
d’éviter leur inammation ; c’est un traitement symp-
tomatique dont le but est de soulager la douleur.
l’application des règles hygiéno-diététiques, une ali-
mentation équilibrée, une lutte contre le surpoids, la
mise en route d’une bonne hygiène de vie veineuse
qui stimulera les mécanismes naturels du retour vei-
neux, la pratique régulière de sports conseillés tels
la marche, le jogging sur terrain meuble avec de
bonnes chaussures, le vélo, la natation…
Et évidemment certains emplois et postes de
travail: en eet les postes de travail en position
assise ou debout prolongée et certains postes
de travail mobiles mais avec port fréquent de
charges lourdes détériorent le système veineux et
favorisent la maladie veineuse.
Ce traitement est délivré en pharmacie sans ordonnance médicale.
- Le port d’une contention veineuse adaptée qui exerce une contre pression
mécanique dégressive le long du mollet et ainsi aide au retour veineux et limite
la stase veineuse. Une contention bien prescrite, choisie en accord avec le pa-
tient et bien délivrée par le pharmacien a une action très ecace!
- La sclérothérapie: cette technique permet de traiter varicosités et varices.
Elle est ancienne et extrêmement répandue. L’injection d’un produit sclérosant
dans la veine variqueuse provoque une inammation de ses parois qui vont se
rétracter; la veine va se broser puis disparaître. Il existe diérentes méthodes:
micro sclérose pour les vaisseaux très ns, sclérose non guidée, écho sclérose,
sclérose à la mousse. La sclérothérapie permet d’oblitérer les varices troncu-
laires, réticulaires et les télangiectasies; ses indications sont très larges mais elle
a bien sûr ses limites et l’on est obligé alors de recourir à une autre technique.
Plus tard vont apparaitre des petits vaisseaux viola-
cés dénommés varicosités et des veines dilatées,
reuantes et disgracieuses appelées varices.
Les varices qui sont des veines supercielles di-
latées et reuantes entraînent à plus ou moins
long terme plusieurs complications (hypodermite
chronique, dermite ocre, ulcère variqueux…) et
favorisent la phlébite.
Varicosités Varices Oédème Eczéma
La maladie veineuse n’est pas une fatalité; la prévention et les traitements adaptés
doivent permettre de la limiter. Quand un traitement est nécessaire, quelque soit la
technique utilisée, le geste thérapeutique ne guérit pas la maladie veineuse qui est
une maladie chronique et nécessite donc un suivi phlébologique régulier.
La prévention reste primordialeau travail et dans la vie quotidienne !
Au travail: Pour limiter les risques d’insusance veineuse, il faudrait limiter
les stations debout prolongées qui représentent le premier facteur de risque,
opérer quelques déplacements, avoir quelques zones d’appui fessier, arriver
à maitriser l’ambiance thermique et fractionner le port de charges lourdes.
Cette meilleure ergonomie doit s’accompagner d’une mobilisation de cha-
cun: port d’une contention adaptée, adoption de chaussures confortables
avec appui plantaire satisfaisant, pratique de mouvements de exion-exten-
sion de la cheville, mouvements de respiration ample…
Dans notre vie quotidienne, nous pouvons, remettre de l’ordre dans notre
régime alimentaire, lutter contre le surpoids, nous battre contre la sédenta-
rité, pratiquer une activité physique adaptée : les sports conseillés sont la
marche, le jogging sur terrain meuble et avec de bonnes chaussures, la bicy-
clette, la gymnastique en évitant de sauter sur place…
Et dans notre belle région proter des bienfaits de la mer: natation,
aquagym, marche aquatique…
En conclusion
Comprend plusieurs techniques qui sont proposées
au patient selon la varice qu’il présente.
- Eveinage par stripping classique ou par invagina-
tion sur l: cette technique a pour but d’enlever les
gros troncs variqueux.
- Phlébectomie ambulatoire qui permet d’enlever
sous anesthésie locale certaines branches veineuses
inesthétiques.
- Techniques endoveineuses par laser ou radio fré-
quence qui constituent de nouvelles procédures et
pour lesquelles nous n’avons pas encore assez de
recul pour connaître les résultats à long terme.
Le traitement médical et le traitement chirurgical
ne s’opposent pas mais sont complémentaires.
A quoi servent les vaisseaux?
Les artères envoient le sang chargé d’oxy-
gène et de nutriments vers les membres
inférieurs. Les veines remontent le sang
chargé de gaz carbonique et de déchets vers
les poumons et le cœur.
Pour remonter dans les veines, contre la
pesanteur, le sang doit être propulsé par
trois pompes:
la principale pompe est le système mus-
culaire du mollet ; lors de la marche, à
chaque pas, les contractions des muscles
du mollet exercent une pression sur les
veines et ainsi font remonter le sang vei-
neux des pieds vers le cœur.
Cette pompe musculaire est ecace dès
sept pas consécutifs!
la deuxième pompe est constituée par les
valvules à l’intérieur des veines (sorte de
clapets anti-retour) qui orientent le sang
vers le haut du corps.
la troisième pompe est le système respira-
toire: chaque inspiration favorise l’aspiration
du sang veineux des pieds vers le cœur.
Quels sont les symtômes? Que faire ?
Qu’est-ce qu’une mauvaise circulation veineuse?
La maladie veineuse commence souvent de manière
anodine avec une sensation de jambes lourdes, des
crampes nocturnes, un œdème touchant le dos du
pied et les chevilles, une fatigabilité…
GRAND ANGLE N°42 - OCTOBRE 2014
7
Votre médecin traitant, le médecin du travail et le
médecin vasculaire sont là pour vous aider.
Le médecin traitant : par son interrogatoire et son
examen clinique peut faire l’ébauche du diagnostic
et commencer un traitement médical.
Le médecin du travail : le personnel hospitalier
étant particulièrement vulnérable à cette patho-
logie, le médecin du travail joue un rôle essentiel
dans la prise en charge de la maladie veineuse; sa
mission lui permet d’exercer un suivi régulier des
salariés et des professionnels de santé et il connaît
mieux que tout autre les contraintes imposées
par les postes de travail. La visite médicale avec le
médecin du travail est primordiale puisqu’elle lui
permet d’intervenir sur la prévention de la mala-
die veineuse, son dépistage et son suivi ainsi que
d’orienter le professionnel vers le bon interlocuteur
qui est souvent le médecin vasculaire.
Le médecin vasculaire eectue grâce à l’écho-Dop-
pler une exploration méthodique du réseau veineux
profond et superciel des membres inférieurs.
L’écho Doppler est une méthode d’exploration des
vaisseaux sanguins qui associe l’image (échogra-
phie) à la réexion des ultra sons sur les globules
rouges (Doppler). Cet examen écho Doppler lui
permet de connaître le trajet éventuellement pa-
thologique des veines, la qualité de leurs parois,
l’état de leurs valvules et leur caractère ou non re-
uant. Au terme de cet examen, il peut dresser une
cartographie du réseau superciel et profond
veineux qui le guidera, en association avec l’inter-
rogatoire et l’examen clinique du patient, dans le
choix du traitement le plus adapté. Le choix de ce
traitement se fait avec l’accord du patient qui doit
recevoir l’information la plus précise possible.
À qui en parler ?
Comment le sang veineux remonte t-il?
Quels sont les facteurs favorisants
de l’insusance veineuse?
VOUS SOUFFREZ DES JAMBES AU TRAVAIL, Pourquoi?
quels en sont les symPtômes? À qui en Parler? que faire?
6
Tibia
Muscle
Veine
intramusculaire
Veine profonde
Peroné
Veine
supercielle
Le sang veineux circule
dans le bon sens : de
bas en haut
Les valvules retrouvent
leur étanchéité
Valvule ouverte
Etanchéité :
Valvule fermée
Oedème
Douleur
Absence d’étanchéité :
inversion du courant
sanguin
Dilatation :
écartement des
valvules, reux
Contraction
musculaire = Eet de pompe
Artère
Examen écho-Doppler
Contention veineuse
Le traitement chirurgical
Sclérothérapie
Consultations de phlébologie au CHPM
Auteurs : Docteur Françoise CORRE et Docteur Françoise LE GALL
au CHPM, sont ouvertes à tous des consultations de phlé-
bologie assurées par les Docteurs LE GALL et BOUDIER,
médecins vasculaires qui vous proposent une prise en
charge complète en diagnostic, traitement et suivi : bilan
clinique et cartographie par écho-Doppler, microsclérothérapie
et sclérothérapie (sclérose conventionnelle, écho-sclérose
et sclérose à la mousse) ; si une intervention chirurgicale est
nécessaire, elle pourra être eectuée en chirugie ambulatoire
par le professeur GOUNY et le docteur HUYBRECHTS.

GRAND ANGLE N°42 - OCTOBRE 2014
9
8
ÉVÈNEMENT
C’est nous, les résidents,
Regard des résidents de Bélizal
Et aujourd’hui, 6 juin 2014
C’est la fête, des 20 ans, de notre Maison...
Bien sûr, Madame Le Brun et Monsieur Breban
commencent par faire un beau discours, Bien sûr, il y a également nos
« prestigieux » invités, merci à eux, mais il y a surtout nous, les résidents,
c’est pour nous que notre Maison a été créée. Nous avons donc réuni autour
de nous, les anciens, de Plourin, de Henvic… Et nous avons fait honneur à la
fête ; habillés avec coquetterie, coiés, maquillées… Il faut bien cacher un peu nos
rides, n’est-ce pas ? Bref, lorsque tout le monde fut placé, le spectacle a commencé.
On nous a dit que c’était Dimitri, mais Dimitri, nous, on connait pas !!! Et ben, je n’ai
jamais vu un artiste comme ça ! On est tous restés bouche bée : un beau garçon, je
vous dis que cela et quand il chante, on dirait que des perles sortent de sa bouche. Il
chante même des chansons que nous connaissons, alors, nous, on chante avec lui !
Et pas er du tout, notre Dimitri, il passe auprès de nous, s’assoit même à côté de
nous. Il joue d’un instrument, je ne sais pas comment il s’appelle, mais c’est beau !
Il est comme les enfants, il aime se déguiser, alors nous on rit, qu’est-ce qu’on a ri !
Par exemple, il a chanté « La tactique du gendarme » (déguisé) Puis « Les gars
de la marine » (avec son béret à pompon rouge) ou, encore des chansons
« Lyriques », d’après ce qu’on m’a dit. Il s’est transformé en oiseau et
aussi en Indien, c’est vous dire ! Pour nir, il a voulu faire danser les
« Vieux », ceux qui avaient encore la tête et les jambes, bien sûr !!!
Mais tout à une n… un bon goûter a été servi à toute l’assemblée.
Ah ! j’ai eu du plaisir pour la fête des 20 ans de chez nous.
Et nous ne sommes pas prêts d’oublier
notre Dimitri !
Auteur : Yvonne Goulme
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%