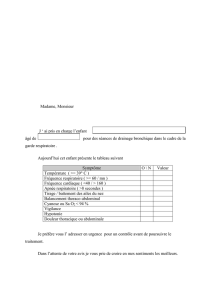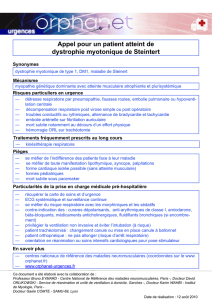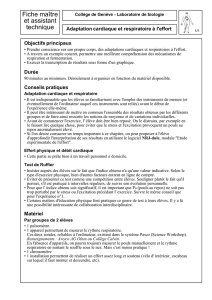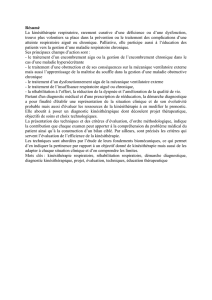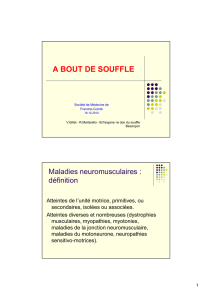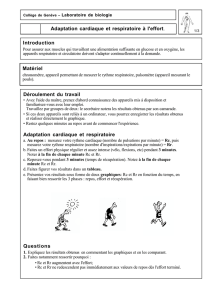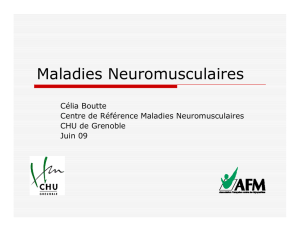Insuffisancerespiratoire aiguë et maladies neuromusculaires

H. Damak
D. Décosterd
introduction
L’insuffisance respiratoire aiguë (IRA) est la survenue brutale
d’une défaillance du système respiratoire par atteinte de
l’échan geur et/ou de la pompe. Elle se traduit par une hypoxé-
mie artérielle associée ou non à une hypercapnie artérielle.1,2
L’IRA hypercapnique traduit la défaillance de la pompe par
rupture de l’équilibre entre ses différentes composantes (figure 1) ; la commande
et la transmission nerveuses, l’action et les performances des muscles respiratoires
(tableau 1) et la charge – ou impédance – du système respiratoire.1,3,4
L’IRA peut compliquer plusieurs maladies neuromusculaires (MNM) (tableau 2)
et peut apparaître de façon plus ou moins rapide.
Deux situations sont à distinguer
:2,4-9
• l’IRA dans le cadre d’une MNM d’apparition et d’évolution aiguë et potentielle-
ment réversible (syndrome de Guillain-Barré (SGB), crise myasthénique (CM)…).
• L’IRA chez un patient ayant une MNM chronique évolutive, souvent à un stade
avancé (sclérose latérale amyotrophique (SLA), myopathie de Duchenne…).
insuffisance respiratoire aiguë et maladies
neuromusculaires aiguës (mnma)
Le SGB et la CM sont les MNMA les plus fréquemment responsables d’IRA.2,7,9-11
La défaillance respiratoire est la conséquence d’une faiblesse, voire d’une para-
lysie touchant les muscles respiratoires, avec :2,6,7,9,12
• diminution des volumes.
• Inefficacité de la toux, favorisant l’encombrement bronchique, les atélectasies
et les surinfections.
• Troubles de la déglutition, à l’origine d’une perte du contrôle et de la protection
des voies aériennes supérieures. Ils sont fréquents et risquent de précipiter l’IRA
en favorisant les micro-inhalations et les fausses routes à l’origine de pneumopa-
thies d’inhalation, et ce d’autant plus qu’ils sont associés à un déficit de la toux.
Les
signes respiratoires de gravité
(tableau 3)10,13,14 sont en général d’apparition
tardive. D’autres manifestations doivent attirer l’attention et être recherchées
énergiquement, car elles peuvent précéder la détérioration respiratoire : une po-
lypnée superficielle, une dyspnée, une orthopnée, une réduction de l’ampliation
Acute respiratory failure in neuromuscular
diseases
Neuromuscular diseases can affect all respi-
ratory muscles, leading to acute respiratory
failure, which is the most common cause of
morbidity and mortality in those patients. Two
situations must be distinguished. 1) Acute res-
piratory failure as part of a neuromuscular
dis order of acute onset and possibly rever-
sible (Guillain-Barre syndrome, myasthenic
crisis…). 2) Acute respiratory failure occurring
in a patient with an already advanced neuro-
muscular disease (amyotrophic lateral scle-
rosis, Du chenne muscular dystrophy...). This
article describes the neuromuscular acute
res piratory failure in these different aspects,
dis cusses its initial management in the emer-
gency department and identifies the parame-
ters that have to be monitored.
Rev Med Suisse 2015 ; 11 : 1809-14
Les maladies neuromusculaires peuvent affecter tous les mus-
cles respiratoires, conduisant à une insuffisance respiratoire
aiguë (IRA). Celle-ci est la cause la plus fréquente de morbidité
et de mortalité chez ces patients. Deux situations doivent être
distinguées : 1) l’IRA secondaire à une maladie neuromus culaire
d’expression aiguë avec une com posante réversible (syndrome
de Guillain-Barré, crise myasthé nique…). 2) L’IRA survenant
chez un patient connu pour une maladie neuromusculaire déjà
avancée et éventuellement évolutive (sclérose latérale amyo-
trophique, myopathie de Duchenne…). Cet article décrit l’IRA
d’origine neuromusculaire dans ces différents aspects, discute
la stratégie de prise en charge initiale aux urgences et identifie
les paramètres de surveillance.
Insuffisance respiratoire aiguë
et maladies neuromusculaires
mise au point
Drs Hassen Damak
et Dumeng Décosterd
Service de médecine d’urgence
et de sauvetage
Hôpital du Jura
Faubourg des Capucins 30
2800 Delémont
Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
30 septembre 2015 1809
33_38_38694.indd 1 24.09.15 08:25

thoracique avec sensation d’oppres sion thoracique, une
dys phagie, une dysphonie, ou des accès spontanés de toux
peu efficace (qui trahissent souvent une inhalation salivaire
avec perte des capacités d’expectoration). Toutefois, l’ab-
sence de signes cliniques ne doit nullement rassurer. Dans
ce contexte, un syndrome restrictif sévère peut être com-
plètement asymptomatique.2,6,9,12
La
réduction du volume courant
est compensée par une res-
piration rapide et superficielle, augmentant la ventilation
de l’espace mort et favorisant la fatigue musculaire et l’ap-
parition d’une
hypercapnie
. Les
atélectasies
et les
inhalations
favorisent l’apparition d’une
hypoxémie
. Néanmoins, ces per-
turbations gazométriques sont souvent tardives ; leur ap-
parition témoigne de la gravité de la situation et peut an-
noncer la survenue d’une détresse respiratoire, d’un arrêt
respiratoire, voire d’un arrêt cardiaque hypoxique.2,7,12
La quantification du déficit musculaire respiratoire repose sur
l’évaluation de la diminution des volumes pulmonaires et
de la force des muscles respiratoires par la mesure de la
capacité vitale (CV)
, ainsi que des
pressions maximales inspira-
toires (Pmi) et expiratoires (Pme)
. La surveillance répétée de
ces mesures et la cinétique de leurs variations sont indis-
pensables à l’identification des patients à risque de dé-
compensation respiratoire et de ceux nécessitant une sup-
pléance immédiate de la fonction respiratoire.2,7,9,12
La présence de signes respiratoires, associés ou non à
des troubles de la déglutition chez des patients stables et
sans signes de gravité, impose une hospitalisation et une
surveillance en milieu de soins intensifs.2,12 La présence
d’une détresse vitale ou de signes respiratoires de gravité
justifie une prise en charge immédiate aux urgences. La
principale difficulté est de savoir quand il faut procéder à
l’intubation orotrachéale (IOT) (tableau 4).2,7,9 Une ventila-
tion mécanique (VM) invasive précoce pourrait être béné-
fique, en réduisant l’incidence des pneumopathies d’inha-
lation.12 La ventilation non invasive (VNI) n’a elle pas sa
place dans la prise en charge des IRA des MNMA, en raison
de la fréquence des contre-indications dans ce contexte.2,7,12
1810 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
30 septembre 2015
Figure 1. Systèmes actif et passif de la pompe
respiratoire3,4
Cortex cérébral
Système respiratoire actif
Tronc cérébral
Centre apneustique
Centre pneumotaxique
Groupe respiratoire dorsal
Groupe respiratoire ventral
Muscles respiratoires
Inspiratoires (diaphragme +++)
Stabilisateurs de la cage thoracique
Expiratoires
Motoneurone spinal
Ventilation
Racines
nerveuses
Nerfs
périphériques
Jonction neuro-
musculaire
Jonction neuro-
musculaire
Nerfs
périphériques
Racines
nerveuses
CommandeTransmission
Action
Impédance
Système respiratoire passif
Charge contre laquelle les muscles
respiratoires doivent lutter
Régulation comportementale
Régulation chimique
Régulation mécanique
Equilibre capacité-charge
Muscles Innervation Rôle(s)
Des voies De la bouche IX et X Ouverture et dilatation des voies aériennes supérieures,
aériennes De la luette et du palais XI permettant une diminution des résistances et une
supérieures De la langue IX et XII augmentation des débits
Du larynx C1
Inspiratoires Diaphragme : muscle inspiratoire principal Nerf phrénique C3-C5 Génération du volume courant
Intercostaux externes T1-T12
Stabilisateurs Scalènes C4-C8 Muscles inspiratoires accessoires, qui assurent le maintien de
de la cage Parasternaux intercartilagineux T1-T12 la cage thoracique lors de l’inspiration
thoracique Sternocléidomastoïdiens XI et C1-C2
Trapèzes XI et C2-C3
Pectoraux C5-C7
Expiratoires Intercostaux internes T1-T12 N’interviennent qu’en expiration forcée
Grands droits T6-L1 Participent au processus de la toux
Obliques externes T5-T12 et fibres
Obliques internes du plexus lombaire
Transverses
Tableau 1. Muscles respiratoires3,4
33_38_38694.indd 2 24.09.15 08:25

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
30 septembre 2015 1811
Syndrome de Guillain-Barré
Le SGB est une maladie auto-immune secondaire à un
mimétisme moléculaire entre des antigènes viraux (CMV,
EBV, VIH) ou bactériens
(Campylobacter jejuni)
et du nerf
périphérique, aboutissant à des lésions axonales ou dé-
myélinisantes à l’origine d’une paralysie musculaire flas que,
aiguë et ascendante. Après une phase d’invasion aiguë as-
sociant des douleurs dorsales et des paresthésies distales
ascendantes, le déficit ascendant touche les quatre mem-
bres, les muscles releveurs de la tête, abdominaux, respi-
ratoires, et du carrefour pharyngo-laryngé. Les réflexes os-
téotendineux sont abolis, les nerfs faciaux et bulbaires
sont affectés dans 75% des cas et certaines formes graves
comportent des signes dysautonomiques. L’IRA touche 6 à
44% des cas dont 20 à 30% nécessitent une IOT. La ponction
lombaire met en évidence une dissociation albumino-cyto-
logique et l’électroneuromyogramme confirme le diagnostic
et permet de dif férencier les formes démyélinisantes des
formes axonales. En dehors de la prise en charge respira-
toire (tableau 5) et de réanimation, le traitement repose
sur l’admistration d’im munoglobulines (Ig) ou les échanges
plasmatiques.7,11,12,16
Niveaux de l’atteinte Exemples
Cortex cérébral • AVC
• Néoplasie
• Convulsions (état de mal épileptique)
• Traumatisme
Tronc cérébral • Sclérose en plaques (SEP)
• AVC du tronc
• Traumatisme
Ganglions de la base • Maladie de Parkinson
Moelle épinière • SEP
• Traumatisme
• Compression
• Néoplasie
• Myélites
• Tétanos
Cellules de la corne • Amyotrophie spinale progressive (SMA)
antérieure • Amyotrophies bulbo-spinales, syndrome
de Kennedy
• Poliomyélite
• Syndrome postpoliomyélite
• Sclérose latérale amyotrophique (SLA)
Niveaux de l’atteinte Exemples
Nerf périphérique • Syndrome de Guillain-Barré (SGB)*
• Diphtérie
• Polyradiculonévrites chroniques (CIDP)
• Neuropathies paranéoplasiques
• Paralysies périodiques
• Porphyrie – Porphyrie aiguë intermittente (PAI)*
• Polyneuropathies de réanimation
Jonction • Myasthénie – Crise myasthénique (CM)*
neuromusculaire • Syndrome de Lambert-Eaton
• Syndromes myasthéniques congénitaux
• Botulisme*
• Intoxications aux organophosphorés
• Envenimation par élapidés «syndrome
cobraïque»
Muscle • Myopathies acquises
– Myopathies inflammatoires (polymyosites,
dermatomyosites…)
– Myopathies des soins
– Myopathies toxiques
• Myopathies héréditaires
– Dystrophie musculaire progressive (DMP)
– Dystrophie musculaire congénitale (DMC)
– Myopathies congénitales
– Myopathies métaboliques
Tableau 2. Principales pathologies neurologiques et/ou musculaires affectant la fonction respiratoire 4-8
* Pathologies traitées dans cet article.
Signes Agitation, tachycardie, tachypnée, désaturation
d’hypoxie (SpO2) et cyanose
Signes Confusion, somnolence, astérixis, tachycardie,
d’hypercapnie HTA, sueurs profuses
Signes Balancement thoraco-abdominal, tirage et
d’épuisement utilisation des muscles respiratoires accessoires,
respiratoire battement des ailes du nez (particulièrement chez
l’enfant)
Menace vitale si Troubles de conscience, état de choc, bradycardie
hypoxique, cyanose, marbrures, bradypnée, gasps
Tableau 3. Signes de gravité en cas d’insuffisance
respiratoire aiguë10,13,14
Cliniques
• Dysphagie
• Dysphonie
• Augmentation de la faiblesse musculaire généralisée
• Respiration superficielle rapide
• Dyspnée à l’effort et au repos
• Orthopnée
• Discours interrompu (bout de souffle)
• Utilisation des muscles respiratoires accessoires
• Respiration paradoxale abdominale
• Faiblesse des muscles trapèzes et des muscles du cou : incapacité
de lever la tête du lit
• Incapacité d’effectuer un «singlebreath count» : compter de 1 à 10
dans une expiration unique (à peu près égale à une capacité vitale
(CV) forcée l 1 l)
• Toux faible
• Encombrement bronchique
• Toux après avoir avalé
• Troubles de la conscience
Paracliniques
• Désaturation nécessitant une oxygénothérapie
• Hypoxémie
• Apparition d’une hypercapnie et/ou d’une acidose respiratoire
• CV l 1 l ou 20 ml/kg
• Baisse de 50% de la CV en une journée
• Pression inspiratoire maximale l -30 cmH2O
• Pression expiratoire maximale l 40 cmH2O
Tableau 4. Signes et symptômes d’orientation et/ou
d’indication à l’intubation orotrachéale lors de
l’insuffisance respiratoire aiguë sur atteinte neuro-
musculaire aiguë2,7,9
33_38_38694.indd 3 24.09.15 08:25

Crise myasthénique
Une CM survient chez près de 2,5% des myasthéniques.
Elle consiste en une poussée responsable d’une IRA moti-
vant une IOT. La myasthénie est dans la majorité des cas
une maladie auto-immune secondaire à une anomalie de
la transmission neuromusculaire par fixation d’anticorps
(AC) circulant sur les récepteurs postsynaptiques de l’acé-
tylcholine (bloc postsynaptique). Ce bloc est à l’origine
d’une faiblesse, voire d’une paralysie musculaire flasque
dans les formes graves. Un facteur déclenchant doit être
systématiquement recherché. Le déficit est moteur pur,
fluctuant et évoluant par poussées plus ou moins régres-
sives ; il touche préférentiellement les muscles oculomo-
teurs et bulbaires. L’atteinte des membres est surtout
proximale et l’atteinte axiale est fréquente. L’atteinte res-
piratoire est souvent fruste et la fluctuation rapide peut ex-
pliquer une aggravation brutale des patients. La confirma-
tion diagnostique repose sur l’électroneuromyogramme
(qui met en évidence un décrément du potentiel à la sti-
mulation répétitive à basse fréquence (3Hz)) et sur la pré-
sence d’AC antirécepteurs de l’acétylcholine (85%) ou d’AC
antimusc (10%). La prise en charge repose sur l’assistance
respiratoire et les mesures de réanimation, associées à un
traitement par Ig ou par échanges plasmatiques, le réajus-
tement ou l’introduction de corticostéroïdes et d’immuno-
suppresseurs et le rééquilibrage du traitement anticholi-
nestérasique.7,11,12,16
Botulisme
Il s’agit d’une maladie infectieuse causée par la neuro-
toxine botulique secrétée par le
Clostridium botulinum
, qui
empêche la libération de l’acétylcholine dans la fente
synap tique (bloc présynaptique) de la jonction neuromus-
culaire, à l’origine d’une paralysie flasque symétrique et
descendante. Selon la source de l’infection, cinq formes
de botulisme sont décrites (la forme alimentaire est de
loin la plus fréquente). Le tableau clinique est polymorphe
associant des nausées, des vomissements et des douleurs
abdominales suivis par une dysautonomie (vision floue,
diplopie, bradycardie, hypotension), puis des signes neu-
rologiques et musculaires aboutissant dans les formes graves
à une paralysie flasque descendante. Une IRA complique
10% des cas. La confirmation du diagnostic repose sur l’iso-
lement de la toxine botulique (dans l’aliment consommé,
le sérum, les vomissements, le liquide gastrique ou les sel-
les) ou du
Clostridium botulinum
dans les selles des patients
et les aliments. Le traitement spécifique consiste à l’admi-
nistration de l’antitoxine équine ABE ou d’Ig du botulisme
humain le plus précocement possible dans les for mes ali-
mentaires et sur les antibiotiques et le débridement de la
plaie en cas de botulisme par blessure.16,17
Porphyrie aiguë intermittente (PAI)
La PAI est une maladie métabolique héréditaire auto-
somique dominante caractérisée par la mutation du gène
de la porphobilinogène déaminase (PBGD), à l’origine d’un
déficit enzymatique dans le processus de biosynthèse de
l’hème. Il en résulte une accumulation et une excrétion ac-
crues des précurseurs toxiques de l’hème : les porphyrines.
L’atteinte nerveuse est de mécanisme peu clair, très proba-
blement en rapport avec l’accumulation des précurseurs
et/ou le déficit en hème. Les crises aiguës neuroviscérales
sont le plus souvent déclenchées par des facteurs exo-
gènes ou environnementaux. En plus des urines rouges
porto, le tableau clinique est polymorphe et comporte : un
syndrome abdominal (douleurs abdominales sévères avec
nausées et vomissements) et un syndrome neuropsychi que
central (crises convulsives ou troubles psychiques) ou péri-
phérique (faiblesse musculaire isolée, voire paralysie flas-
que avec amyotrophie et troubles sensitifs subjectifs). Une
IRA peut survenir dans 9 à 14% des cas. L’élévation des taux
de porphobilinogène (PBG) et d’acide d-aminolévulinique
(ALA) dans les urines de 24 heures ainsi que la diminution
de l’activité plasmatique de la PBGD confirment le diag-
nostic. La prise en charge repose sur l’éradication d’un
éventuel facteur déclenchant, l’analgésie, la perfusion de
glucose 10% jusqu’à 3-4 l/jour, la perfusion d’hémine et la
correction des troubles hydro-électrolytiques (hyponatré-
mie et hypomagnésémie).18-20
insuffisance respiratoire aiguë
et maladies neuromusculaires
chroniques (mnmch)
Dans la majorité des cas, il s’agit d’une décompensation
d’une MNM déjà connue par un facteur déclenchant (ta-
bleau 6), dont l’identification est primordiale pour l’effica-
cité de la prise en charge.2,5,8 La surveillance est essentiel-
lement clinique et gazométrique. La mesure des paramètres
respiratoires (CV, Pmi et Pme) n’a que peu d’intérêt dans la
décision d’une IOT en période aiguë.2
Ces patients présentent une difficulté à la toux res-
ponsable d’un encombrement bronchique, pouvant être
1812 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
30 septembre 2015
Facteurs prédictifs de ventilation mécanique à l’admission
en réanimation
Sans mesure de la capacité Avec mesure de la CV
vitale (CV) (risque L 85% (risque L 85% si les 3 critères
si 4 critères présents) présents)
• Début des signes avant admission • Début des signes avant admission
l 7 jours l 7 jours
• Toux inefficace • Impossibilité de relever la tête
• Impossibilité de tenir debout • CV l 60% de la théorique
• Impossibilité de soulever
les coudes
• Impossibilité de relever la tête
• Cytolyse hépatique
Facteurs prédictifs de ventilation mécanique pendant le séjour
en réanimation
• Troubles de déglutition
• CV l 20 ml/kg
Critères d’intubation
• Détresse respiratoire
• PaCO2 L 6,4 kPa (48 mmHg) ou PaO2 l 7,5 kPa (56 mmHg)
• CV l 15 ml/kg
• Pression inspiratoire maximale l -25 cmH2O
• Pression expiratoire maximale l 40 cmH2O
Tableau 5. Facteurs prédictifs de ventilation méca-
nique et critères d’intubation au cours du syndrome
de Guillain-Barré12,15
33_38_38694.indd 4 24.09.15 08:25

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
30 septembre 2015 1813
majoré par une éventuelle atteinte bulbaire favorisant les
inhalations et les fausses routes. L’inefficacité de la toux
peut être objectivée par une mesure du
peak-flow
à la toux
qui est associé à une morbidité plus importante s’il est
l 270 l/min.8,9,21-23 La prise en charge précoce de l’ineffica-
cité de la toux est fondamentale et se base essentielle-
ment sur les techniques de désencombrement et d’assis-
tance à la toux
(cough-assist)
.2,24-26
La mise en route d’une ventilation se fera initialement
par VNI, qui permet de diminuer le nombre de complica-
tions et d’hospitalisations et prolonge la survie.2 Le mas que
nasal semble plus adapté ; il limite le risque d’inhalation
en permettant les aspirations oropharyngées et un désen-
combrement plus aisé. Il risque cependant de limiter l‘ef-
ficacité de la ventilation par des fuites buccales.2,5,8,9,22-24
Privilégier la gestion non invasive de l’IRA ne signifie
pas qu’il faille systématiquement écarter l’IOT chez ces pa-
tients. En présence de directives anticipées claires qui ex-
cluent le recours à la ventilation invasive, la décision est fa-
cilitée. Dans le cas contraire, une telle décision aux urgen-
ces n’est pas facile, et elle doit si possible tenir compte :
• de la MNMCh (sa nature, son stade actuel, son évoluti-
vité, son pronostic à court et moyen termes) ;
• du facteur déclenchant l’IRA (réversibilité, séquelles at-
tendues, durée du traitement) ;
• du patient (âge, autres comorbidités, souhaits).
Le projet thérapeutique doit être discuté précocement
de manière multidisciplinaire (entre l’urgentiste, l’intensi-
viste, le neurologue, le pneumologue et le médecin traitant)
avec le patient et ses proches.
L’IOT constitue en effet un tournant évolutif chez ces
patients, qui sont souvent très difficiles, et parfois impos-
sibles à sevrer du ventilateur. Ce qui les expose à la tra-
chéotomie parfois nécessaire pour le sevrage et la sortie
des soins intensifs. Par ailleurs, ces patients – qui ont peu
de réserve respiratoire – s’exposent en situation d’urgence
au risque d’une IOT parfois difficile, voire impossible, mais
aussi au risque potentiel des agents anesthésiques et/ou
myorelaxants.2,5,8,23,24
En l’absence de directives anticipées et si une décision
multidisciplinaire n’est pas possible, l’IOT est indiquée en
présence de troubles de la conscience, d’un état de choc,
d’un arrêt respiratoire ou cardiaque ou en cas de contre-
indication, d’intolérance ou d’échec de la VNI, à condition
qu’elle ait été conduite de façon optimale en y associant le
désencombrement bronchique.8,23
conclusion
Une IRA peut survenir dans le cadre d’une MNM d’appa-
rition et d’évolution aiguë, ou dans le cadre d’une décom-
pensation d’une MNM connue, souvent avancée et évolu-
tive.
Sa prise en charge aux urgences doit être énergique mais
réfléchie et repose sur l’identification des signes de gravi-
té indiquant la nécessité d’une ventilation artificielle, inva-
sive dans l’IRA MNM aiguë et non invasive dans l’IRA
MNMCh.
Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec
cet article.
Causes fréquentes
• Infections des voies aériennes supérieures
• Bronchites aiguës
• Pneumonies
• Atélectasies
Causes rares
• OAP sur insuffisance cardiaque gauche (essentiellement en cas de
myopathie)
• Abus de sédatifs
• Fausses routes avec inhalations
• Pneumothorax
• Embolie pulmonaire
• Hémorragie trachéale (chez les patients ayant une trachéotomie)
• Distension gastrique aiguë (chez les patients ayant une VNI à domicile)
Tableau 6. Facteurs de décompensation respira-
toire des maladies neuromusculaires chroniques
5,8
OAP : œdème aigu du poumon ; VNI : ventilation non invasive.
Implications pratiques
L’insuffisance respiratoire aiguë peut compliquer plusieurs
maladies neuromusculaires ; elle est la cause la plus fréquente
de morbidité et de mortalité chez ces patients
L’aggravation peut survenir brutalement et les perturbations
gazométriques peuvent être tardives ; les signes cliniques né-
cessitent donc une surveillance rapprochée et répétée
Deux grandes situations sont à distinguer :
– l’insuffisance respiratoire aiguë dans le cadre d’une mala-
die neuromusculaire d’évolution aiguë et éventuellement
réversible (syndrome de Guillain-Barré, crise myasthéni-
que, botulisme, porphyrie aiguë intermittente…) ;
– l’insuffisance respiratoire aiguë survenant chez un patient
ayant une maladie neuromusculaire déjà avancée et éven-
tuellement évolutive (sclérose latérale amyotrophi que,
myo pathie de Duchenne…)
En cas d’insuffisance respiratoire aiguë dans le cadre d’une
maladie neuromusculaire aiguë, il s’agit surtout de détermi-
ner le moment où une ventilation – le plus souvent invasive
– va être nécessaire, afin de limiter les complications (inhala-
tion notamment)
En cas d’insuffisance respiratoire aiguë dans le cadre d’une
maladie neuromusculaire chronique, la ventilation non inva-
sive et les mesures de désencombrement sont à privilégier,
afin d’éviter si possible le recours à l’intubation endotrachéale
et à la trachéotomie
Des directives anticipées doivent être systématiquement
recherchées en cas de maladies neuromusculaires chroniques
et évoluées. Elles peuvent faciliter la définition du projet thé-
rapeutique, en particulier s’il a été décidé de renoncer à la
ventilation invasive. En situa tion aiguë, une décision multi-
disciplinaire reste souhaitable, prenant en compte le stade
évolutif de la maladie de base et l’éventuelle réversibilité de
la pathologie aiguë
>
>
>
>
>
>
33_38_38694.indd 5 24.09.15 08:25
 6
6
1
/
6
100%