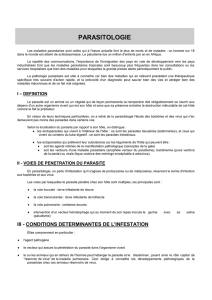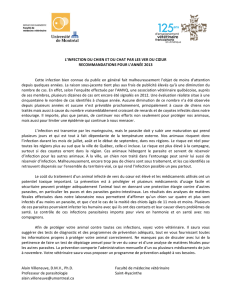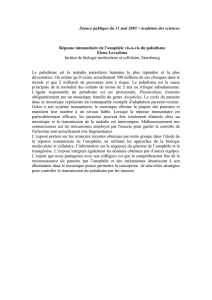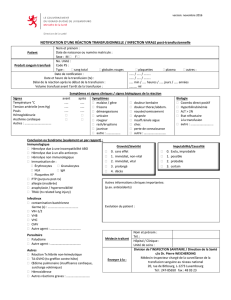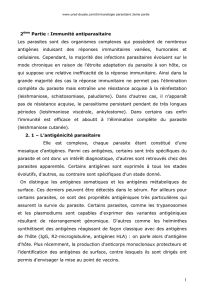Parasites et transfusion sanguine : causes et conséquences

Revue
Transfusion
Parasites
et transfusion sanguine :
causes et conséquences
Parasites and blood transfusion: causes and consequences
Marie-Hélène El Ghouzzi
1
Olivier Garraud
2,3
1
EFS île-de-France, 83-87 rue des
Alpes, 94623 Rungis Cedex
2
EFS Auvergne-Loire, 25 boulevard
Pasteur, 42000 Saint-Étienne
3
EA 3064, Faculté de médecine,
université Jean-Monnet, 45 rue
Ambroise-Paré, 42000 Saint-Étienne
Résumé.Bien qu’une étape importante ait été franchie dans la prévention des
maladies virales post-transfusionnelles, les agents infectieux peuvent franchir les
frontières du fait de la multiplication des échanges et de l’immigration. Les
maladies parasitaires à protozoaires sévissent à l’état endémique dans les pays en
voie de développement et leur introduction résulte des mouvements des populations
de ces régions vers les pays industrialisés. S’il n’y a pas de cas rapportés et
convaincants de transmission de leishmaniose post-transfusionnelle, la mise en
place de la déleucocytation systématique en a diminué encore l’impact, et a réduit
la transmission de Toxoplasma gondii. Le paludisme, la maladie de Chagas et les
babésioses peuvent être transmis par les produits sanguins labiles cellulaires. En
effet, il n’existe pas encore de méthode efficace pour éliminer des érythrocytes les
plasmodies et les babésies, et Trypanosoma cruzi, agent de la maladie de Chagas
des produits sanguins labiles. Cette revue se focalisera sur la description des
principales maladies parasitaires transmissibles par le sang, avec leur distribution
géographique, leur cycle, les principaux aspects cliniques et les moyens diagnosti-
ques disponibles, ainsi que les mesures mises en place pour prévenir la transmis-
sion du paludisme et de la maladie de Chagas en Europe.
Mots clés : paludisme, maladie de Chagas, leishmaniose, babésiose, infection
protozoale transmise par transfusion, transfusion
Abstract.An important step in the safety system of blood donations is now reached
for possible viral infectious diseases. However, infectious agents can across
international borders through immigration and travel. Among of these agents,
protozoal agents are rife in endemic way in mainly low income countries, and their
introduction has resulted of population movements in industrialised countries.
Malaria, American trypanosomiasis (Chagas disease) and protozoal tick-borne
diseases as babesiosis can be transmitted by cellular blood components. There are
few convincing reports of post transfusional leishmaniosis. The leucoreduction have
dropped in the impact of transmission of Toxoplasma gondii and Leishmania ; but,
at this moment, there do not appear to be any effective methods to eliminate
Plasmodia and Babesia in erythrocytes and Trypanosoma cruzi. So, this review
deals with the main parasite diseases that are carried by blood products and
focused on their geographical distribution, their human cycles, their main clinical
aspects, the implemented measures to prevent transfusion transmitted (TT) malaria
and TT Chagas disease in European countries, and the available tools for
diagnosis.
Keywords: malaria, chagas disease, leishmaniosis, babesiosis, transfusion
transmitted protozoal infection, transfusion
Correspondance et tirés à part :
M.-H. El Ghouzzi
Hématologie 2006 ; 12 (2) : 129-39
Hématologie, vol. 12, n° 2, mars-avril 2006
129
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Dans un passé proche, les efforts se sont
principalement focalisés sur la réduction des
risques infectieux en transfusion sanguine. La
transfusion est à présent sûre et sécurisée
bien que prescripteurs et patients redoutent
toujours le risque viral alors qu’il est devenu actuellement
rarissime [1] étant entendu que le « risque zéro » n’existe pas
[2]. C’est bien en fait actuellement le risque bactérien qui
reste le plus fréquent et le plus redoutable. À côté de ces
risques-là, viraux et bactériens, relativement bien connus,
deux autres risques infectieux commencent à être redoutés :
le premier est lié au nouveau variant de la maladie de
Creuzfeld-Jakob, à l’issue fatale, mais il est épidémiologique-
ment et statistiquement très faible [3] ; le second – paradoxa-
lement beaucoup plus fréquent et lui aussi potentiellement
mortel – est le risque parasitaire, qui semble encore large-
ment sous-évalué. En effet, en dehors des zones d’endémie, il
existe une fréquente méconnaissance des parasitoses trans-
missibles par le sang ; le diagnostic d’infection post-
transfusionnelle est difficile, ignoré, sous-estimé alors que le
pouvoir infestant des parasites transmis est très élevé chez
des hôtes receveurs fréquemment en état d’immunodéfi-
cience. De plus, la forme clinique post-transfusionnelle peut
être atypique, l’ensemble entraînant un retard au traitement
avec des conséquences cliniques graves.
En ce qui concerne le risque de transmission de parasites par
transfusion sanguine, le donneur peut être parasitémique
asymptomatique : soit qu’il se trouve en phase d’incubation
(paludisme, babésiose), soit qu’il se trouve en phase de
portage chronique oublié ou inconnu comme dans la mala-
die de Chagas ou l’une des formes d’expression clinique des
leishmanioses. Hors des zones d’endémie, le risque parasi-
taire partage avec le risque bactérien ce mode de portage
asymptomatique, mais il partage sa rareté avec le risque
« viral ». Des données récentes, cependant [4, 5], tendent à
faire redouter une augmentation de la fréquence des trans-
missions parasitaires transfusionnelles, rendant nécessaire
une meilleure identification des maillons faibles des disposi-
tifs de prévention en place et l’application de procédés de
réduction de pathogènes, dès que ceux-ci seront disponibles.
En revanche, en zones d’endémie palustre dans les pays en
voie de développement, le paludisme transfusionnel, par
exemple, n’est souvent même pas relevé tant sa probabilité
est grande.
Principaux parasites transmissibles
par transfusion sanguine
Pour qu’un parasite soit transmissible par transfusion san-
guine dans l’un au moins de ses stades parasitaires, il doit se
présenter soit sous forme libre dans le sang circulant, soit
sous forme liée à une cellule sanguine circulante (en situation
intracellulaire ou liée à un ligand de surface de la cellule
transporteuse). De plus pour que ce parasite déclenche une
infection parasitaire chez l’hôte receveur, il est nécessaire,
d’une part, que la forme parasitaire transmise soit viable
chez le receveur et n’aboutisse pas à une impasse parasitaire
et d’autre part, que le receveur n’ait pas développé un degré
d’immunité suffisant pour contrôler la multiplication du para-
site. Cette dernière condition est fréquemment rencontrée
pour le toxoplasme dans de nombreuses situations géogra-
phiques et pour les plasmodies chez l’adulte dans les régions
de forte endémie palustre. En termes de transmissibilité
transfusionnelle, les parasitoses sont très inégales. Une seule
parasitose est jusqu’à présent reconnue comme causant un
réel problème en Europe : celle à l’origine du paludisme.
Cela est dû, d’une part, à la fréquence des infections plasmo-
diales dans le monde, le paludisme étant la première endé-
mie infectieuse avant le sida et l’infection par le VIH ou les
maladies virales entériques, et d’autre part au fait que cette
parasitose est essentiellement véhiculée par les globules
rouges du sang circulant.
Les autres parasites transmissibles par transfusion sanguine
sont, par ordre d’importance : l’agent de la maladie de
Chagas (Trypanosoma cruzi), les babésies, les leishmanies,
le toxoplasme Toxoplasma gondii, les microfilaires et les
trypanosomes africains.
Cette revue se focalisera principalement : a) sur les deux
maladies parasitaires qui posent un problème en Europe par
rapport aux risques d’importation : le paludisme et la mala-
die de Chagas, et sur les raisons de la transmissibilité des
agents infectieux causals ; b) sur les dispositifs existants et à
venir pour prévenir ce risque de transmissibilité. Bien qu’il
s’agisse d’un sujet important, le risque transfusionnel lié aux
parasites dans les pays en voie de développement ne sera
pas abordé ici (pour une revue, voir [6]).
Parasitoses transmissibles
par voie sanguine
en dehors des infections
plasmodiales et chagasiques
Babésiose
La babésiose, appelée également piroplasmose par les vété-
rinaires, est une zoonose parasitaire due à plusieurs espèces
de babésies selon l’animal en cause (Babesia microti,
B. divergens, B. bovi, B. canis, B. equi...). Ces hématozo-
aires sont transmises aux animaux et à l’homme par piqûre
de tiques, le plus souvent entre mai et septembre ; la parasité-
mie peut persister tout en étant asymptomatique pendant
plusieurs mois après l’épisode aigu fébrile non diagnostiqué.
La transmission par transfusion sanguine ou lors de greffe
d’organe a souvent été rapportée en Amérique du Nord avec
des conséquences graves pour les receveurs présentant des
tableaux d’hémolyse aiguë et des complications rénales,
hépatiques et cardiaques [7]. L’ensemble des études euro-
péennes, cependant, s’accorde à penser que cette transmis-
sion ne pose pas de problème à l’échelle du « vieux conti-
nent », bien que le risque soit, comme pour le paludisme,
Hématologie, vol. 12, n° 2, mars-avril 2006
130
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

difficile à prévenir mécaniquement puisque la cible des
babésies est l’érythrocyte et que la leucoréduction des pro-
duits sanguins (mesure de réduction des risques largement
appliquée actuellement) est, à cet égard, sans efficacité. Il est
cependant nécessaire de rester vigilant.
Toxoplasmose
En ce qui concerne la toxoplasmose, la transmission du
parasite avait posé de nombreux problèmes jusqu’ilyaune
vingtaine d’années, comme en témoignait l’abondance des
publications d’alors ; la situation est devenue très différente
actuellement, probablement pour deux raisons principales :
a) la prévalence européenne actuelle reste faible, même s’il
existe un gradient différentiel Nord-Sud [8] ; b) la leucoréduc-
tion systématique des produits sanguins labiles, qui est très
efficace vis-à-vis d’un parasite essentiellement intracellulaire
(sa phase extra-cellulaire pour pénétrer une cellule leucocy-
taire cible étant extrêmement courte) [9]. Cependant, les
greffes de moelle osseuse et les profondes immunodéficien-
ces exposent les patients à des formes graves de toxoplas-
mose, notamment pulmonaires [10].
Leishmaniose
Malgré la répartition extrêmement large des leishmanioses
dans le monde où 350 millions de personnes sont exposées
aux piqûres des phlébotomes et 12 millions de sujets sont
atteints (dont 500 000 avec des leishmanioses viscérales)
[11], et malgré les cas de leishmanioses d’importation décla-
rés en France [12], seuls quelques cas sporadiques de
leishmanioses post-transfusionnelles ont été décrits dans la
littérature, car la parasitémie est extrêmement faible dans ce
type d’infection [13, 14] ; lorsqu’elle existe, cette parasité-
mie se rencontre essentiellement dans les formes initiales
cliniques viscérales chez le donneur, comme le montre une
étude américaine réalisée sur du sang prélevé chez des
militaires américains atteint de leishmaniose après l’opéra-
tion « Tempête du Désert » en Irak, étude qui démontre
également la résistance des leishmanies aux températures de
stockage des produits sanguins et notamment à 4 °C [15].
Les leishmanies sont principalement intracellulaires, avec un
temps de passage libre pour pénétrer une cellule-cible très
court, comme pour les toxoplasmes ; la leucoréduction drasti-
que à présent appliquée en Europe est également un bon
moyen de réduction de pathogènes pour ce risque infectieux.
Une étude menée dans le Sud de la France sur une popula-
tion de donneurs de sang n’a pas apporté d’argument direct
en faveur de la transmission par le sang chez les sujets
transfusés [16] à partir de cette population de donneurs
théoriquement exposés au risque de leishmaniose cutanée.
Microfilariose
Également « anecdotique » est la possibilité de transmettre
par voie sanguine transfusionnelle des microfilaires – en
principe en impasse parasitaire chez l’homme et donc résolu-
tives – ; des cas isolés ont été rapportés, mais le mode de
transmission et les procédés de préparation des produits
sanguins labiles rendent ce type de complication assez peu
probable [17].
Trypanosomose africaine
En théorie, enfin, la transmission de trypanosomes africains
– responsables de la maladie du sommeil – serait possible,
mais la rapidité d’apparition des signes cliniques prévien-
drait la candidature et/ou la présentation au don de sang ; la
transmission de trypanosomes africains par transfusion n’est
pas rapportée en Afrique, soit que ce parasite ne pose pas de
réel problème transfusionnel, soit que l’incident transfusion-
nel infectieux ne lui soit pas rapporté [6].
En Europe, une politique de « quarantaine » clinique de
durée d’ailleurs variable selon les systèmes transfusionnels, a
écarté du don du sang des voyageurs de retour de pays
endémiques pour les principaux risques transfusionnels ; la
géographie du paludisme étant très large, elle couvre en fait
la géographie de tous les autres parasites transfusionnels,
exceptés les toxoplasmes, les babésies et les leishmanies
présentes sur tout le pourtour méditerranéen ; le candidat au
don de sang est alors invité à se représenter au don à l’issue
de cette quarantaine. En pratique également, toute notion de
voyage est identifiée ainsi que la notion d’une fièvre de
quelque nature que ce soit : la candidature au don de sang
d’un sujet à risque immédiat de transmission d’une maladie
parasitaire aiguë est donc reportée. Le risque parasitaire
rémanent est celui de la parasitose chronique, que présente
la longue durée de vie d’un portage palustre ou chagasique.
Des données concernant l’ensemble de ces parasites trans-
missibles par voie sanguine ont par ailleurs été présentées
dans une revue récente des mêmes auteurs [18].
Problèmes posés par la transmission
par voie sanguine interhumaine
des plasmodies,
agents du paludisme
Endémie palustre
Le paludisme reste actuellement l’endémie majeure et proba-
blement aussi la moins bien contrôlée de la zone intertropi-
cale. Selon l’OMS, entre 200 et 500 millions d’accès palus-
tres et1à3millions de morts sont constatés chaque année,
principalement chez les enfants d’Afrique. Aujourd’hui, plus
de 2 milliards d’humains sont exposés au risque palustre.
L’Afrique est de loin le continent le plus touché, avec 90 %
des cas recensés [19]. Le paludisme est par ailleurs au
premier rang des maladies d’importation transmissibles par
le sang que l’on rencontre en France [20].
Espèces parasitaires responsables
du paludisme
Quatre espèces de parasites du genre Plasmodium sont à
l’origine de la maladie palustre chez l’homme.
Hématologie, vol. 12, n° 2, mars-avril 2006
131
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Plasmodium falciparum est l’espèce la plus pathogène et
celle responsable des cas mortels. Elle est présente dans les
zones tropicales d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie, et
elle est dominante en Afrique ; les résistances aux traitements
aggravent son impact.
Plasmodium vivax co-existe avec P. falciparum dans la plu-
part des zones infestées, exception faite de l’Afrique de
l’Ouest, et est présent dans certaines régions tempérées.
Réputée moins morbidifère que P. falciparum, cette espèce
parasitaire est cependant responsable d’un grand nombre de
cas, dont des rechutes ou des portages chroniques très longs.
Certains auteurs considèrent que la morbidité de ce parasite
est largement sous-estimée [21]. P. vivax reste le parasite
dont la répartition est la plus étendue, responsable en très
large part de la morbidité du paludisme en Asie centrale, du
Sud et du Sud-Est, et au Moyen-Orient. Sa quasi-inexistence
en Afrique de l’Ouest et centrale est liée à l’absence de
l’expression de l’antigène Duffy à la surface des globules
rouges de la population de ces régions. Cet antigène est en
effet le récepteur érythrocytaire naturel des protéines de
surface du mérozoïte de P. vivax [22].
Plasmodium ovale est principalement trouvé en Afrique de
l’Ouest mais aussi en Afrique centrale ; de pathogénicité
comparable à P. vivax, cette espèce peut entraîner des rechu-
tes4à5ansaprès la primo-infection.
Plasmodium malariae a une distribution mondiale large mais
très inégale. L’infection à P. malariae est fréquemment chroni-
que et associée à une autre espèce plasmodiale, et peut
entraîner des rechutes jusqu’à 20 ans après la primo-
infection (et donc être méconnue du porteur).
Le développement chez l’homme d’une infection plasmodiale
s’opère généralement par l’injection dans un capillaire san-
guin de la peau de formes parasitaires infestantes (sporozoï-
tes) qui ont subi un cycle de développement sexué chez le
vecteur ; en l’occurrence la femelle d’un moustique anophèle
(hématophagie gynotrophique). Ces formes parasitaires
infestantes vont encore subir un cycle de multiplication para-
sitaire, cette fois-ci chez l’homme : après une phase hépati-
que, les formes mérozoïtes vont aller infecter des érythrocytes
et s’y multiplier ; les différentes espèces plasmodiales pénè-
trent les érythrocytes en fonction de leur âge ou de leur
maturité. Après la phase d’incubation qui correspond à la
phase intra-hépatique et au premier passage des mérozoïtes
dans le sang, l’expression clinique débute par une fièvre
survenant8à30jours après l’inoculation infectieuse. Classi-
quement, des cycles typiques peuvent survenir, faisant alter-
ner les frissons avec une hyperthermie, une chaleur sèche
avec peau brûlante pendant3à4heures, suivie de sueurs et
d’urines foncées pendant 2 à 4 heures. L’accès palustre va se
répéter plusieurs fois. La périodicité de ces cycles dépend de
l’espèce du parasite en cause, et coïncide avec l’éclatement
des globules rouges et ipso facto la multiplication des parasi-
tes ; cette destruction érythrocytaire induit également l’ané-
mie. La durée entre deux accès palustres est relativement
caractéristique de chaque espèce plasmodiale : 48 heures
pour P. falciparum, vivax, ovale et 72 heures pour
P. malariae ; elle correspond au temps de maturation néces-
saire du mérozoïte en corps « en rosace » et à sa multiplica-
tion en nnouveaux mérozoïtes, nombre compris entre 6 et 32
selon l’espèce plasmodiale, P. falciparum étant le plus prolifi-
que.
Quelques formes parasitaires vont évoluer en stades sexués
qui, lorsqu’ils seront aspirés par un autre moustique femelle
lors d’un repas sanguin, pourront aller infecter un autre hôte
humain et ainsi de suite.
Principales causes de l’anémie palustre
et autres complications
Le développement des parasites chez l’homme fait éclater les
hématies parasitées, entraînant une hémolyse et une anémie
ainsi qu’une libération de produits toxiques induisant la
production de cytokines dont l’interleukine-10 (IL-10), le
TNF-a,leLT-a, etc., par les cellules mononucléées et phagocy-
taires, ces cytokines majorent l’anémie en agissant directe-
ment et négativement sur l’hématopoïèse. La survenue fré-
quente de clones lymphocytaires autoréactifs et d’une auto-
immunité représente une troisième cause d’anémie. Chacune
de ces causes est variable tant en fréquence qu’en intensité et
est également fonction de l’espèce plasmodiale. Le parasite
le plus morbidifère et le plus mortifère est P. falciparum ; seul
P. falciparum est responsable de la séquestration vasculaire
des hématies parasitées dans la rate, le placenta, le rein, le
poumon et surtout le cerveau, entraînant de nombreuses
complications sévères dont le neuro-paludisme ou paludisme
cérébral.
Examen microscopique
et diagnostic direct d’infection palustre
En hématologie et parasitologie, la réalisation d’une goutte
épaisse (GE) permet le diagnostic positif d’infection. Cette
technique dite de référence permet, en concentrant les cellu-
les, globules rouges et leucocytes, de repérer les hématies
parasitées, après lyse des éléments figurés du sang, et d’en
rapporter le nombre à celui des leucocytes. Le seuil de
détection est d’environ 10 à 20 parasites/lL. Le diagnostic
d’espèce peut difficilement être fait sur cette GE et nécessite la
réalisation d’un frottis mince coloré au May Grunwald
Giemsa, permettant d’observer la morphologie ; en contre-
partie, le seuil de détection est beaucoup plus élevé, de
l’ordre de 150 à 200 parasites/lL. Il existe des méthodes
plus ou moins automatisées permettant la réalisation de GE et
de frottis. Il est utile de prêter attention à l’apparence des
polynucléaires et des monocytes sanguins : une infection
plasmodiale sollicite fréquemment la présence de formes
jeunes mais activées par la phagocytose des hématies para-
sitées ; de plus, il n’est pas inhabituel de visualiser des
résidus ferriques sous forme d’hémozoïne... autant de signes
d’appel quand on considère que seule une identification
positive n’a de valeur pour diagnostiquer une infection palus-
tre et qu’il faut répéter les examens, en particulier en fonction
Hématologie, vol. 12, n° 2, mars-avril 2006
132
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

de l’évolution clinique, par cycles tierces ou quartes de la
maladie, même si ces cycles sont moins classiques que ne le
veulent les traités de médecine tropicale, en particulier s’il y a
eu usage de médicaments contenant de la quinine ou
d’autres agents anti-malariques d’efficacité insuffisante.
Autres tests de dépistage d’une infection
palustre
Le diagnostic par biologie moléculaire fait l’objet de nom-
breuses approches mais n’est pas encore réalisé en routine
car il est difficile en raison de l’extrême variabilité des
génomes parasitaires et des très nombreux allèles des princi-
paux marqueurs génétiques ; cette technique réalisée dans
les laboratoires spécialisés permet la détection des parasité-
mies très faibles, autour de 1 parasite/lL [23].
Différents tests utilisant des antigènes caractéristiques des
plasmodies sont disponibles et utilisés mais ils ne font pas
cependant l’unanimité parmi les spécialistes : deux types de
détection selon l’antigène dépisté, l’HPR2 (Histidin-Rich
Protein-2) pour le dépistage direct de P. falciparum et p-LDH
(Plasmodium-Lactate Dehydrogenase) permettant la détection
des différentes espèces avec une détectabilité de 100
parasites/lL et une spécificité de 90 %. Deux formats sont
disponibles : soit des tests rapides basés sur la fixation
d’anticorps monoclonaux sur des bandelettes de nitrocellu-
lose (tests inadaptés au diagnostic à grande échelle), soit des
tests de type ELISA d’utilisation adaptée dans les zones non
endémiques [24].
Le diagnostic sérologique – à la différence des méthodes
déjà citées – est un diagnostic indirect d’un contact ancien ou
plus ou moins récent avec le parasite et non de sa présence
actuelle, avec cependant quelques limites, qu’il faut garder à
l’esprit, et qui sont : le temps de latence entre l’infection et
l’apparition d’anticorps détectables, et la capacité à tromper
le système immunitaire que peuvent avoir les parasites en
masquant leurs antigènes et en imitant des antigènes voisins,
en sollicitant la production vigoureuse d’immunoglobulines
poly-réactives qui peuvent masquer la détection d’une
réponse spécifique [25]. Ces tests sérologiques ne permettent
pas de diagnostic d’espèces.
Qualification biologique des dons de sang
pour le risque palustre
Néanmoins, il est largement admis que l’usage des tests
indirects essentiellement par immunofluorescence indirecte
(IFI), ou par ELISA permet de cribler assez efficacement les
dons de sang à risque pour la transmission de plasmodies, en
particulier en application du principe de précaution. Une
revue récente détaille les interprétations possibles concernant
la sérologie palustre [26]. Une attitude possible concernant
l’acceptation d’un donneur et d’un don, pour le risque
palustre, est rapportée dans le tableau 1 [18].
Risques de transmission d’agent
du paludisme par transfusion sanguine
En termes de risque de transmission possible de parasites
d’un donneur de sang à un receveur, il existe plusieurs cas de
figure :
– Soit le donneur est en phase d’incubation clinique et en
phase biologique muette ; il ne présente alors aucun signe
apparent favorisant son auto-exclusion ou son ajournement
Tableau 1
Proposition d’une attitude concernant la prévention de transmission par la transfusion sanguine de plasmodies pouvant être responsable
d’un paludisme post-transfusionnel
Les 4 situations envisagées Les contre-indications Les tests sérologiques
1
er
cas : Antécédent de paludisme (crises) •Contre-indication définitive pour la
préparation de PSL •Pas de test sérologique
•Possibilité théorique pour le don de plasma
de fractionnement 4 mois après la fin du
traitement et en l’absence de symptômes
•Pas de test sérologique
2
e
cas : Voyage en zone d’endémie d’une
durée < 3 mois •Contre-indication de 4 mois pour la
préparation de PSL •Test sérologique du 1
er
don dans la
période 4 mois-3 ans
•Possibilité théorique pour le don de plasma
de fractionnement en l’absence de
symptômes dans l’intervalle
3
e
cas : Voyage en zone d’endémie d’une
durée > 3 mois et immigrant ; sujet
originaire d’un pays d’endémie sans
antécédents de paludisme ; asymptomatique
•Contre-indication de 4 mois pour la
préparation de PSL •Test sérologique sur chaque don dans la
période 4 mois–3 ans ; ou libération si
sérologie négative après 3 ans (1
er
don
après 3 ans)
•Possibilité théorique pour le don de plasma
de fractionnement en l’absence de
symptômes dans l’intervalle
4
e
cas : Symptômes évocateurs pendant un
séjour exposé ou dans les 4 mois qui suivent
le retour
•Contre-indication de 4 mois (après la fin
des symptômes) pour la préparation de PSL •Test sérologique sur chaque don dans la
période 4 mois–3 ans ; ou libération si
sérologie négative après 3 ans (1
er
don
après 3 ans)
Hématologie, vol. 12, n° 2, mars-avril 2006
133
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%