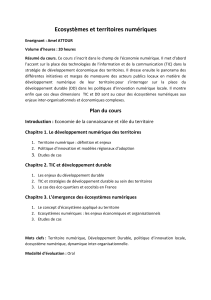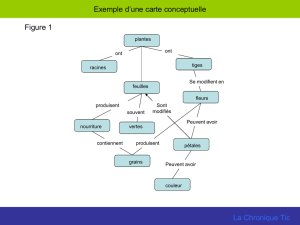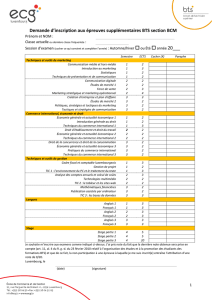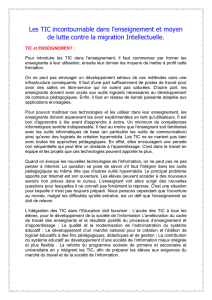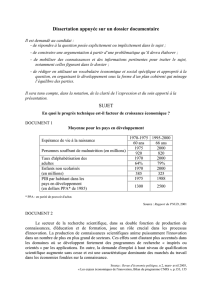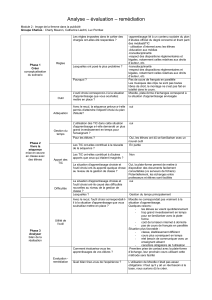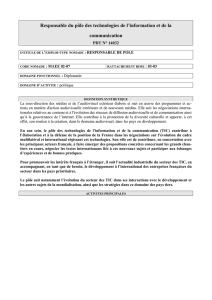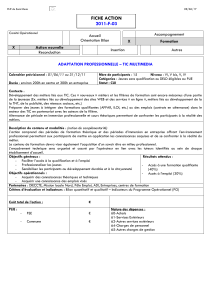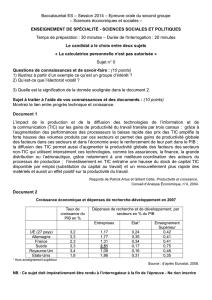La société de la connaissance à l`ère de la vie numérique

La société de la connaissance
à l’ère de la vie numérique
C O L L O Q U E D U D I X I È M E A N N I V E R S A I R E D U G E T
29 juin 2007

1
Table des matières
Eclairer l'avenir de la société de la
connaissance à l'ère de la vie numérique Francis Jutand 3
Les dilemmes de l'économie numérique 11
Les dilemmes de l'économie numérique Laurent Gille 13
Vers de nouveaux modèles d'affaires
et de chaînes de valeurs Laurent Gille 16
Quelle contribution des TIC à la compétitivité
de l'économie ? Thomas Houy 27
Compétitivité de l'industrie européenne des TIC Godefroy Dang Nguyen 37
Réel/Virtuel Michel Gensollen 44
L'écologie de l'infrastructure numérique Fabrice Flipo 55
TIC et commerce électronique :
laboratoires de la libéralisation des échanges
et des évolutions des règles d'impositions ? Philippe Barbet 65
Les enjeux de la régulation des infrastructures : Marc Bourreau
Faut-il dégrouper la fibre optique ? Denis Lescop 73
Gérard Pogorel
Les dilemmes de la propriété intellectuelle Laurent Gille 88
Les technologies d'information et de
communication et la question du lien social 95
Les technologies d'information et de
communication et la question du lien social Christian Licoppe 97
Mobiles et sociabilité interpersonnelle :
la présence connectée Christian Licoppe 99
L'usage des objets communicationnels :
l'inscription dans le tissu social Serge Proulx 104
Homo Ludens 2.0 : l'âge du Craftware Frank Beau 112
Communauté en ligne et démocratie Nicolas Auray 120
La genèse d'une nouvelle figure de migrant :
le migrant connecté Dana Diminescu 129

2
TIC et intégration sociale :
Penser les technologies de l'information et de
la communication dans une approche Annabelle Boutet
organique de solidarité André Thépaut 135
Protection des données personnelles
et confiance Annie Blandin 144
Territoires et échanges numérisés 153
Territoires et échanges numérisés Godefroy Dang Nguyen 155
Critique de la notion de territoire numérique Pierre Musso 157
Les TIC comme artefacts de médiation de la Laura Draetta
connaissance à l'échelle des territoires Valérie Fernandez 164
Innovation et territoires : les pôles
de compétitivité Godefroy Dang Nguyen 171
Mobilité, ubiquité et sociabilité Christian Licoppe 179
L'individu aux prises avec
les objets de communication 183
L'individu aux prises avec les objets
de communication Sylvie Craipeau 185
La confusion des sens Gérard Dubey 187
L'accès direct au monde/L'écran dénié Olivier Fournout
Balises pour un débat théorique autour Isabelle Garron
des médias informatisés Emmanuël Souchier 192
Travailler ensemble dans la mobilité
Quelques interrogations éthiques Pierre-Antoine Chardel 200
Le développement des TIC et l'enracinement
du paradigme de la distribution Christian Licoppe 206
Art en réseau : jeu et enjeux Annie Gentès 212
Le corps en jeu Sylvie Craipeau 218
Les jeux vidéo : un nouveau produit d'addiction ? Bertrand Seys 224
L'imaginaire des techniques Pierre Musso 233

3
Eclairer l’avenir de la société de la connaissance
à l’ère de la vie numérique
cience sans conscience ne ruine pas forcément le futur mais laisse l’homme sans recul
devant la force des technologies et de leurs empreintes sur l’évolution de l’économie et
de la société. Les technologies de l’information et de la communication constituent un
moteur d’évolution puissant, qui amplifie les ressorts fondamentaux du développement de
l’espèce humaine : communiquer en nombre et à distance, assembler et traiter des informations
en nombre et en rapidité, élaborer et transmettre les connaissances et les savoir-faire en nombre
et complexité.
L’évolution de la société humaine
L’essor technologique de la société, entamé à la fin du 18e siècle, s’est accéléré dans la première
moitié du 20e, avec notamment les deux guerres mondiales, puis a explosé durant la deuxième
moitié du 20e siècle avec l’avènement de la microélectronique et du logiciel ; les technologies de
l’information et de la communication ont permis l’émergence de nouveaux secteurs
économiques : l’informatique, l’électronique, les télécoms et les médias. A partir des années 1980,
le passage dans le monde professionnel puis du grand public des services d’information et de
télécommunication au travers des mobiles et de l’internet a provoqué une nouvelle accélération
du développement. Cette accélération se traduit par des formes d’interactions nouvelles dans les
infrastructures et les services entre les télécoms, les systèmes d’information et les médias, d’où
sont nés les médias électroniques, les moteurs de recherche, le triple puis le quadruple play et de
nombreux services associés.
C’est une sorte de prise en masse qui s’opère sous nos yeux, autour de la communication
généralisée comme le pressentait il y a plus de 15 ans Michel Serres, de la naissance d’un
cybermonde de machines et de systèmes d’information de plus en plus puissants et intelligents
comme l’ont imaginé moult auteurs de science fiction ou de scénaristes, et d’une omniprésence
des contenus multimédias dont le rôle dépasse aujourd’hui largement celui du divertissement
pour devenir le support dominant dans notre société des processus d’échange et de régulation.
Les trois sphères, celle de la communication, ou Ubisphère, celle des systèmes d’information, ou
Cybersphère, et celle des contenus et de la connaissance, ou Noosphère, se densifient, accélèrent
leur mouvement et leur synergie. Se créent ainsi les conditions d’une évolution profonde de
l’humanité, ou d’une bifurcation au sens de la systémique, pour aborder une nouvelle phase. Pour
S

4
qualifier cette nouvelle phase, nous proposons de l’inscrire dans le long mouvement de montée
de la société de la connaissance et de la dater par le concept de vie numérique.
L’évolution humaine s’est toujours opérée au travers d’une intensification progressive des
connaissances et de leurs usages, les phases temporelles de régression se terminant toujours par
des périodes de renaissance et de progrès rapide. Les technologies de la communication et de
l’information apportent une montée en puissance des connaissances qui se caractérise aujourd’hui
par une convergence technologique, économique et d’usage que nous proposons de traduire par
le concept de vie numérique. D’où le titre du colloque, que prépare ce livre vert, « La société de la
connaissance à l’ère de la vie numérique ».
Si nous avions voulu être complet, il aurait fallu y intégrer la notion de monde global ou de
monde fini. Sans doute après une première phase de peuplement progressif de l’espèce humaine
sur toute la surface de la Terre, le déploiement historique de la société s’est fait sur la base d’un
développement régional au sens du ministère des affaires étrangères : Moyen Orient, Inde, Chine,
Afrique, Asie mineure, Amériques, Europe. La colonisation basée sur les progrès dans les moyens
de transport, puis le développement industriel et technique ont ensuite été le support d’un
déploiement progressif mondial de la technologie et des valeurs européennes ; ce déploiement est
aujourd’hui pour l’essentiel en voie d’achèvement. Il va en résulter une nouvelle phase
d’évolution dans laquelle le monde va se redéployer en retour sur lui-même avec un
ressourcement apporté par chacune des différentes civilisations, et de nouvelles formes de
coopération et d’affrontement. L’internationalisation des sciences et des technologies, la
globalisation de l’économie et des marchés ainsi que l’universalisation des valeurs, sinon de leur
instanciation, sont les données de base du cadre dans lequel l’évolution de la Société de la
connaissance à l’ère de la vie numérique va s’inscrire.
Le livre vert
Le Groupe des écoles des télécommunications (GET) a un positionnement spécifique dans le
paysage national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est né de la technologie et des
communications à distance, pour lequel Estaunié inventa le nom de Télécommunication. Il s’est
développé au rythme de l’expansion des télécommunications et de leur numérisation. A la suite
du grand plan de rattrapage du retard des télécoms en France, symbolisé par le 22 à Asnières, un
groupe d’écoles était créé dans le giron du Ministère des PTT et de la Direction Générale des
Télécom. La recherche s’y est développée dans les années 80, sous la tutelle bienveillante du
CNET. D’écoles d’ingénieurs, ces écoles sont progressivement devenues des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche dans le domaine des STIC, avec le recrutement d’un
corps d’enseignants-chercheurs proche de celui des universités, mais avec la préservation d’un
modèle pluridisciplinaire lié aux contraintes de la formation d’ingénieurs et de manageurs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
1
/
240
100%