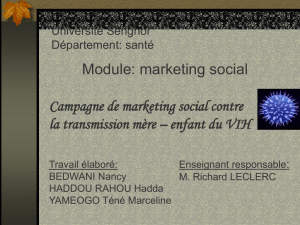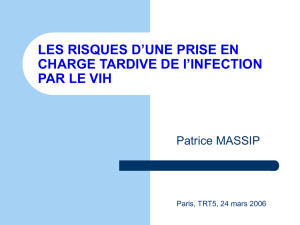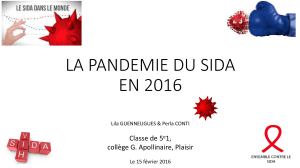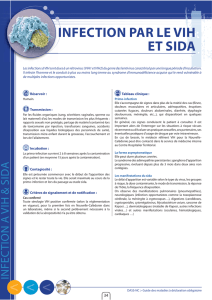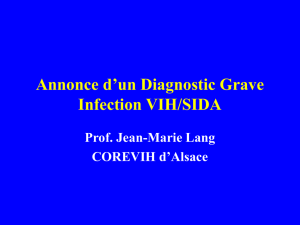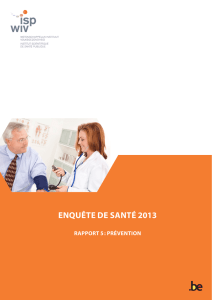prise en charge tardive de l`infection par le vih - TRT-5

1
JOURNÉE DE RÉFLEXION SCIENTIFIQUE
« PRISE EN CHARGE TARDIVE
DE L’INFECTION PAR LE VIH »
24 mars 2006
En France, actuellement,
- près de la moitié des personnes qui déclarent un Sida ignorent leur statut sérologique au
moment du diagnostic ;
- près d'un quart des nouveaux cas de Sida connaissent leur statut, mais ne sont pas suivis
médicalement.
Ces prises en charge tardives s'accompagnent par ailleurs d'une forte surmortalité pendant
les 6 premiers mois de suivi…
C’est à partir de ces constats que le TRT-5 a choisi la prise en charge tardive comme sujet
de sa journée annuelle 2006.
Nous voulions savoir qui était concerné, et quels étaient les motifs de retard au dépistage et
à la prise en charge. En fait, il s'agit d'une mosaïque de populations de toutes origines, de tout
âge, et de toute orientation sexuelle ; autant de situations diverses qui appellent le besoin
d'actions spécifiques.
Puisque la forte surmortalité pendant les 6 premiers mois suivant l’initiation des soins ne se
normalise que 4 ans après le diagnostic, nous avons également fait le point sur les difficultés
médicales (mise en route de nombreux traitements, interactions médicamenteuses,
syndrome de reconstitution immunitaire, problèmes d'observance), sur les recommandations
de traitements ainsi que sur les voies de recherche à explorer pour optimiser les conditions de
prise en charge.
Cette journée a été l’occasion de souligner la nécessité d'une prise en charge forte et
multi-dimensionnelle (médicale, sociale, psychologique et associative) pour passer le cap
décisif des premiers mois de traitement.
Enfin, elle a permis de réunir une grande palette d'acteurs dans le but d’améliorer l'information
et l'incitation au dépistage de même que l'accès aux soins pour, in fine, réduire le nombre de
ces situations. Plus de 250 personnes (personnes atteintes, associatifs, médecins, chercheurs,
soignants, institutionnels et représentants de l'industrie pharmaceutique) y ont participé.
Le comité scientifique de cette journée était composé de : Aimée Bantsimba-Keta , François
Bissuel, Dominique Costagliola, Philippe Jean, Véronique Joly, France Lert, Florence Lot,
Gilles Marchal, Emmanuel Ricard et Arnaud Veïsse.
TRT-5

Sommaire
Ouverture
Fabrice Pilorgé, Act Up-Paris, TRT-5
État des lieux
Les risques à court et long termes d’une prise en charge tardive de l’infection par le VIH,
Patrice Massip, Centre Hospitalier de Purpan (Toulouse)
Épidémiologie de la prise en charge tardive, Murielle Mary-Krause, Inserm U270 (Paris)
Résultats de l’enquête RETARD : facteurs associés au retard d’accès aux soins, Marcel Calvez,
Laboratoire de sociologie et d’anthropologie, Université Rennes 2
1ère Table ronde : État des lieux de l’accès tardif aux soins
Quelle prise en charge ?
Prise en charge tardive : traitements et suivi médical recommandés, Sophie Matheron,
Hôpital Bichat – Claude Bernard (Paris)
Interactions médicamenteuses entre médicaments du VIH et des infections opportunistes,
Bruno Lacarelle, Fédération de Pharmacologie, Hôpital La Timone (Marseille)
Les syndromes de reconstitution immunitaire (IRIS), Olivier Lortholary, Hôpital Necker-Enfants
malades et Institut Pasteur (Paris)
Accompagnement et prise en charge globale, Olivier Bouchaud, Hôpital Avicenne (Bobigny)
2ème Table ronde : Prise en charge globale en situation de prise en charge tardive
Recherche
3ème Table ronde : Prise en charge tardive et essais cliniques
Conclusion
Dominique Blanc, AIDES, TRT-5
p. 3
p. 4
p. 5
p. 7
p. 10
p. 15
p. 17
p. 23
p. 25
p. 27
p. 33
p. 37

Selon l’Institut de Veille sanitaire (InVS), en 2003, plus de 50 % des nouveaux
diagnostics de Sida étaient posés chez des personnes ignorant leur séropositivité.
Ce retard dans le recours aux soins pose des problèmes tant au niveau de la santé
publique qu’au niveau de la santé individuelle des malades concernés. Il amène à
s’interroger sur les politiques de dépistage et de prévention de la transmission du
VIH, ainsi que sur les stratégies cliniques de prise en charge de ces personnes.
Malgré l’amélioration des traitements et de la prise en charge médicale, une personne
arrivant tardivement aux soins présente un risque de mortalité 16 fois plus élevé
dans les 6 premiers mois qu’une personne prise en charge précocément. Ce constat
est inacceptable.
Cette journée n’éludera pas les questions politiques sous-jacentes à la prise en
charge tardive, mais le sujet sera abordé, en premier lieu, sous l’angle de la prise en
charge thérapeutique et de la recherche, puisque ce sont les domaines de travail
spécifiques du TRT-5.
Je tiens également à dire que nous regrettons d’être aujourd’hui contraints de
défendre avec des données scientifiques des principes qu’il était autrefois possible
de faire valoir en recourant au simple bon sens ou aux droits de l’homme. Nous
espérons que cette journée contribuera à fournir à tous des outils solides pour
défendre les positions politiques nécessaires. ❑
Ouverture
Fabrice Pilorgé, Act Up-Paris, TRT-5
3
Prise en charge tardive = Perte de chance

État des lieux
Modération : Dominique Blanc (AIDES, TRT-5, Marseille)
et Marianne L’Hénaff (Arcat, TRT-5, Paris)
Tous les jours, les praticiens accueillent dans leurs services
des patients qui auraient dû arriver plus tôt et qui vont plus
mal, du fait d’un retard dans le recours aux soins.
Aujourd’hui, la prise en charge de l’infection par le VIH
comprend un suivi biologique, mais aussi et toujours un suivi
clinique. Ce suivi clinique suppose de bâtir, avec le temps,
une relation de confiance avec le patient. En outre, on a
appris avec la prise en charge de l’infection par le VIH que
le couple médecin-malade ne suffisait pas : la prise en charge
est de plus en plus pluridisciplinaire. Elle doit permettre au
patient d’exprimer ses besoins médicaux ou non : besoins
nutritionnels, soutien social, soutien psychologique, édu-
cation thérapeutique. Ainsi, différents médecins, des acteurs
du social, des associations, des réseaux éventuellement,
interviennent autour du patient.
Lorsqu’un patient arrive dans nos services avec une mala-
die opportuniste, et qu’il découvre dans le même temps
sa séropositivité, la situation est difficile, bien sûr sur un plan
médical, mais aussi sur un plan personnel. Dans ce cadre,
l’évolution de la maladie ne sera souvent pas aussi favorable
que pour une personne ayant bénéficié d’une prise en
charge précoce.
Qu’est-ce qu’une prise en charge tardive ?
Vers 1998, on avait encore l’espoir de pouvoir éradiquer le
VIH en traitant les patients précocément dans le cours de
la maladie. Or on s’est rendu compte que les choses ne se
passaient pas comme cela : le virus n’a pas été éradiqué et,
certaines personnes, mises rapidement sous traitement,
sont devenues plus malades avec le traitement qu’elles ne
l’étaient auparavant. Aujourd’hui, en l’absence de traite-
ment permettant d’éradiquer le virus et compte tenu des
effets secondaires parfois sévères des antirétroviraux, on est
obligé d’attendre le « bon moment » pour traiter un patient.
Qu’est-ce que le « bon moment » ? Sans doute le connaît-
on mieux aujourd’hui, après avoir traité trop tôt, ou trop tard
par le passé, et en tenant compte des progrès thérapeu-
tiques. Cependant, il n’y a pas de réponse applicable à tous
les patients de manière uniforme. Il est clair pour tous les
experts qu’à moins de 350 CD4, il faut commencer à son-
ger à un traitement. À moins de 200 CD4, c’est sans doute
déjà trop tard. Toutefois, ces considérations doivent toujours
tenir compte de l’état dans lequel se trouve le patient : face
à un patient symptomatique à moins de 500 CD4, on va
éventuellement envisager un traitement.
Les risques pour le patient
Certains patients arrivent trop tardivement à l’hôpital, avec
des infections dont ils ne se remettront parfois pas malgré
la réanimation. Ils vont se heurter à des complications de
leurs infections opportunistes. Il va d’abord falloir traiter les
multiples infections, avant de s’attaquer à la cause : le VIH.
Les conséquences sont les suivantes : selon les données
(données 1997-1999 et 2000-2002) de l’Institut de Veille Sani-
taire (InVS), 9 % des patients pris en charge tardivement sont
aujourd’hui décédés versus 1 % des patients pris en charge
précocément. Le risque relatif de mortalité au cours des 6
premiers mois de soins est augmenté (6 fois plus élevé) en
cas de prise en charge tardive, et il reste élevé au-delà de cette
période (multiplié par 4) : cela signifie donc qu’il y a véri-
tablement une « perte de chance » pour les personnes
arrivant tardivement aux soins.
Ce risque va se traduire par l’apparition de complications
infectieuses classiques – pneumocystose, cryptococcose,
mycobactériose – mais également par celle de complications
néoplasiques telles que les lymphomes (qui sont une cause
importante de décès). Manifestement, le système immu-
nitaire des patients séropositifs est trop stimulé et on
observe une survenue augmentée de lymphomes, surtout
en l’absence de traitement. Une étude réalisée dans le cadre
du GECSA (Fabrice Bonnet et Col. GECSA – CID 2006-42)
a montré que le risque de décès par lymphome diminue dès
que le patient a pu recevoir six mois de trithérapie. Une
autre étude, réalisée dans le cadre de la cohorte Euro Sida
montre que l’incidence des maladies définissant le Sida
avant l’arrivée des HAART est de 30,7 par patient-année,
Les risques à court et long termes d’une prise en charge
tardive de l’infection par le VIH
Patrice Massip, Centre Hospitalier de Purpan (Toulouse)
Arriver tardivement aux soins constitue pour le patient une « perte de chance ».
Ce dernier s’expose à un risque accru de mortalité et à divers types de complications.
4

contre 2,5 par patient-année avec les traitements (Mocroft
A, Euro Sida Study, Lancet 2000;356).
Dans l’étude Mortalité 2000, réalisée par l’équipe française
de Charlotte Lewden, qui a concerné la plupart des centres
français et près de 960 patients décédés, 47 % des per-
sonnes sont décédées du Sida, dont 19 % sans avoir reçu
aucun traitement antirétroviral (Charlotte Lewden and the
Mortality 2000 Study Group. International Journal of
Epidemiology 2005-34). Ce phénomène n’est pas stricte-
ment français : une étude réalisée à Londres a aboutit aux
mêmes chiffres. Les deux études signalent bien évidem-
ment l’aspect négatif du retard de recours aux soins mais
également, souvent, l’impact des difficultés économiques et
sociales pour le patient.
Il arrive aussi que le patient, après s’être remis de son infec-
tion opportuniste et après instauration d’une trithérapie,
développe un syndrome de reconstitution immune presque
aussi dramatique que la maladie opportuniste initiale (voir
à ce sujet la présentation d’Olivier Lortholary, page 23).
Risques pour la société
Lorsque la maladie est contrôlée, on peut espérer que sa trans-
mission soit davantage contrôlée, même si ce n’est bien sûr
pas une garantie. Une prise en charge précoce apporte donc
un bénéfice tant pour la société que pour l’individu. On
peut en tirer les conséquences inverses lorsque l’infection
n’est pas prise en charge.
Une maladie toujours pas ordinaire
Le VIH n’est toujours pas une maladie ordinaire : il demeure,
encore aujourd’hui, du déni, de l’ignorance, des personnes
qui ne se considèrent pas concernées. Certaines populations
craignent particulièrement la stigmatisation liée à cette mala-
die ; tout cela contribue au retard au dépistage et à la prise en
charge. Or une prise en charge tardive est une perte de chance
pour le patient. Il est de notre rôle de tout faire pour l’éviter. ❑
Enquête VESPA
Un des objectifs de l’enquête VESPA était d’estimer la propor-
tion de dépistages VIH tardifs, d’identifier les caractéristiques
socio-démographiques des patients dépistés tardivement et de
décrire les circonstances de ce dépistage. Il s’agit d’une enquête
transversale incluant des patients qui connaissaient leur séro-
positivité depuis au moins 6 mois, âgés de 18 ans ou plus, de
nationalité française ou résidant en France depuis au moins six
mois lorsqu’ils étaient étrangers. Le recrutement s’est fait de
façon aléatoire, dans les consultations externes de 102
services hospitaliers tirés au sort. Entre décembre 2002 et
octobre 2003, 4963 sujets étaient éligibles. On a défini le
dépistage tardif pour des personnes arrivant avec des symp-
tômes classant Sida ou avec un taux de CD4<200/mm3au
moment du diagnostic de la séropositivité ou dans l’année.
Résultats
Les caractéristiques de l’enquête : sur 2932 qui ont répondu,
1077 ont été diagnostiqués depuis 1996. 68 % étaient des
hommes dont 50 % d’homosexuels ; 66 % sont de nationalité
française. Parmi les étrangers, 73 % viennent d’Afrique sub-
saharienne.
L’ enquête a montré qu’un tiers des patients étaient classés en
dépistage tardif, et sur ce tiers, près de la moitié des personnes
(42 %) ont découvert leur infection au stade Sida.
Risques liés à un diagnostic tardif
Les résultats montrent que le risque d’être dépisté tardive-
ment augmente avec l’âge au moment du diagnostic : le risque
relatif des 50-59 ans est de 2,89 fois celui des moins de 30
ans et celui des plus de 60 ans est de 4,2. Les hommes hété-
rosexuels ont 1,68 fois plus de risque que les homosexuels. Les
toxicomanes passés ou actuels présentent aussi de 2 à 3 fois
plus plus de risque. Les personnes nées à l’étranger ont, quant
à elles, 1,58 fois plus de risque que celles nées en France.
Circonstances d’un diagnostic tardif
Parmi les diagnostics tardifs (par opposition au dépistage en
phase chronique), les tests ont été plus fréquemment réali-
sés parce qu’il y avait apparition de symptômes (64 %
contre 33 %) ou à la demande d’un médecin (53 % contre
36 %) . A l’inverse, le dépistage se fait moins souvent chez
les personnes diagnostiquées tardivement :
• à l’occasion d’un test volontaire (27,5 % versus 53,3 %).
• après le diagnostic d’un partenaire (7,1 % versus 13,6 %).
• après exposition accidentelle (5,3 % versus 11,95 %).
Caractéristiques d’un diagnostic tardif en population hété-
rosexuelle
• 3,57 fois plus d’hommes que de femmes.
• 3,55 fois plus de personnes avec partenaire sexuel stable.
• Plus de risque avec l’âge.
Épidémiologie de la prise en charge tardive
Murielle Mary-Krause, Inserm U270 (Paris)
Environ un tiers des personnes séropositives sont dépistées tardivement. Mais quel est
le profil de ces personnes ? Y a-t-il des facteurs qui favorisent la prise en charge tardive,
ou au contraire, qui en préservent ? Deux études récentes tentent de répondre à ces ques-
tions : l’enquête VESPA, et l’analyse de la base hospitalière française.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
1
/
40
100%