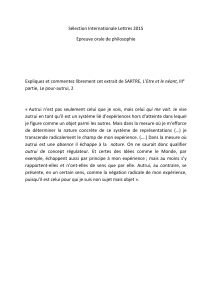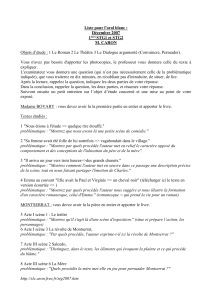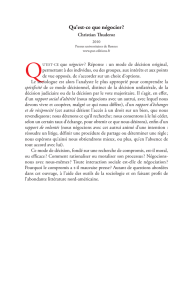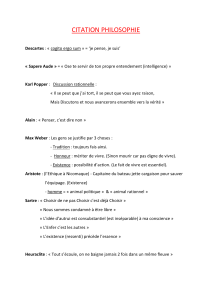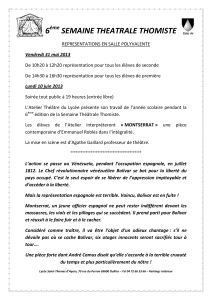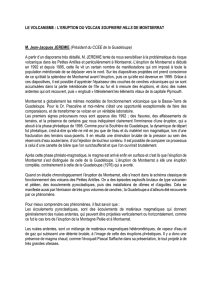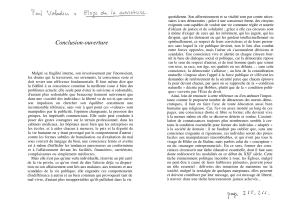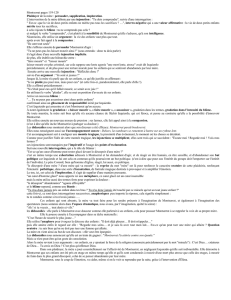P. Henry – De la méchanceté du je(u) Il y aurait « jeu », à la fois au

P. Henry – De la méchanceté du je(u)
Il y aurait « jeu », à la fois au sens d’absence de sérieux et de décalage, quand une réalité
sérieuse serait confondue avec un jeu, et c’est alors qu’on risquerait de faire de très graves
erreurs, de commettre des exactions : la guerre est l’exemple le plus terrible de ces réalités où
jeu et sérieux se mêlent inextricablement, valeurs et perversions.
La politique, en général, est confusion de désirs et de règles, de composantes ludiques et de
composantes sérieuses.
Par exemple, dans la pièce « Montserrat » d’Emmanuel Roblès : on voit à quel point les
occupants espagnols comme Izquierdo, Moralès, Antonanzas, se comportent avec leurs
victimes comme des chats avec leur souris. Ce dispositif de torture imaginé pour faire parler
Montserrat (arrêter six personnes au hasard dans la rue, des « innocents », et les exécuter au
bout d’une heure si Montserrat ne révèle pas l’endroit où il a caché Bolivar) ressemble fort à
un jeu. Or, contrairement aux jeux « habituels », il ne conduit pas à se détacher de la réalité,
pour en imaginer une autre, virtuelle : c’est la réalité.
Les bourreaux retirent, comme dans un jeu, l’humanité des participants, leur identité, mais
n’en accordent pas pour autant une existence virtuelle : les bourreaux nient tout simplement
leurs victimes. Ils disent, en gros, ceci : « toi, tu n’es rien » ; « ça n’a pas d’importance si tu
meurs, puisque tu n’es qu’un moyen pour faire parler Montserrat ». Voilà ce qu’ils pourraient
dire.
Cet état de confusion entre jeu et sérieux, entre irréel et réel, atteint son paroxysme avec les
camps. C’est la pire horreur qu’on puisse imaginer : la pseudoscience, le « jeu » qui consiste à
concevoir la possibilité de concevoir l’être humain comme une simple chose, une matière
première. Après cela, le génocide, la négation absolue de toute dignité humaine, il faut
repenser l’idée de « jeu » et celle de « savoir ». Il y a des choses avec lesquelles on ne peut
pas jouer, en particulier : la dignité et le savoir véritable, la science.
« Il n’y a pas d’idée claire et distincte en politique » : oui, sauf qu’il existe un « jeu »
politique, et que cette idée de « jeu », même si elle est obscure et confuse, on peut essayer de
la clarifier et de la distinguer. D’une certaine manière, la philosophie se comporte aussi à la
manière d’un jeu : c’est une quête, celle de la vérité, ou bien une enquête, une recherche de la
solution aux problèmes posés. Il faudrait donc différencier les jeux sains, bénéfiques pour
l’esprit, d’autres jeux, qu’on peut qualifier de « malsains ».
D’un autre côté, des jeux qui n’ont d’autre but que de procurer de l’amusement, du
divertissement, sont motivés par un désir de compétition qui, parfois, peut virer au sadisme –
même s’il ne prête pas immédiatement à conséquence, puisque ces jeux sont purement
virtuels. Cependant on peut s’interroger sur les « valeurs » que véhiculent ces jeux : ne
propagent-ils pas des idées ou des émotions qui pourraient altérer la mentalité, la personnalité,
du joueur ? – jeux d’une violence extrême, comme « Man Hunt », ou « Chasse à l’Homme »,
lequel a donné lieu à des faits divers terrifiants et sordides, en Angleterre notamment.
Positivement parlant, le jeu peut sauver, rendre acceptable le tragique de la vie : tous les
Hommes mourront un jour. La mise en scène de notre propre mort, ou de celle d’autrui, serait
par là une sorte d’exutoire. Un exemple est présenté dans le film de Benito Benigni sur les
camps : « La vie est belle ». C’est curieux de voir les réactions suscitées par ce film, souvent
contradictoires. Le contraire aurait étonné. On peut d’ailleurs se demander si c’est même
légitime de jouer avec une telle réalité, une telle inhumanité historique que fut le Génocide.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

P. Henry – De la méchanceté du je(u)
En tant que cinéaste on peut dire que Benigni a parié – il a voulu montrer au monde que la
Vie était plus forte que la bestialité destructrice, et que le jeu pouvait (au moins aux yeux d’un
enfant) rendre supportable les souffrances du monde. Le cinéma semble être une forme d’art
spéciale, pour laquelle on pourrait légitimement (ou pas) se jouer du sérieux1.
Cependant le jeu peut aussi pervertir, rendre floue la frontière entre virtuel et réel. Ce sont les
valeurs mêmes de la société qu’il faut re-questionner : compétition, domination de l’autre. Et
même des massacres, destructions de toutes sortes.
Sans même aller jusqu’au fait divers, les jeux (vidéos en particulier) modifient notre
comportement, peut-être imperceptiblement, peut-être inconsciemment. En effet, le monde
dans lequel le jeu est censé se dérouler a beau être virtuel, fictif, faux, les émotions que l’on
ressent en y jouant (peur, sadisme, angoisse, « thrill » - frisson) sont bien réelles. Leur
recherche peut se révéler addictive, à la manière d’une drogue.
Plus que les jeux, ce sont les comportements sociaux qui révèlent ces « valeurs ». Il y aurait
entre expression des jeux et de la société qui leur a donné naissance. On dit bien « jeu de
société » pour parler de ces jeux – dixit le Petit Robert – « où le manquement aux règles est
sanctionné par le dépôt d’un gage et une pénitence ». L’idée de sanction, voire de souffrance,
n’est jamais totalement absente de bien des jeux : le but étant de ne pas souffrir soi-même,
tout en prenant plaisir à voir souffrir l’autre.
A un moment donné, dans Montserrat de Roblès, une des victimes d’Izquierdo se révolte :
« Ah ! Je hais cet homme qui se sert de ma vie ! Qui joue avec ma vie ! » ; un autre texte, plus
connu encore, celui de Kafka dans « La Colonie pénitentiaire », fait appel au jeu pour décrire
le processus de l’arbitraire conduisant à la mort : « Une fois que l’homme est sur le lit et que
celui-ci se met à vibrer, la herse descend au contact du corps. D’elle-même, elle se place de
façon à ne toucher le corps que de l’extrémité de ses pointes ; cette mise en place opérée, ce
câble d’acier se tend aussitôt et devient une tige rigide. Dès lors, le jeu commence. »2 Alors
que Kafka est mort en 1924, il annonce, par son imagination morbide, les perfectionnements
technico-sadiques que les nazis mettront réellement en service. D’où vient cette perversité
« ludique » ? Tout laisse à penser qu’une des passions les plus noires, mais aussi les plus
fortes, pousse l’homme à se nier en niant ses semblables – comme le disait Bernanos – qu’il
apprend, avec soulagement, que l’âme n’est rien. Or c’est cela le plus grand péril : nier à toute
occasion la véritable nature humaine, le « cogito » ; nier la possibilité de parole à l’autre ; nier
qu’il y ait un semblable, un prochain. En ce sens, le jeu – qui fait d’autrui un « autre »
véritable – peut se révéler éminemment dangereux. Non pas parce qu’il invoque le hasard (et
les gains d’argent au passage) mais bien plutôt parce qu’il déploie en lui la machinerie d’une
implacable méchanceté.
Pour finir ces quelques pensées sur une note un peu moins sinistre, on pourrait, en première
approche, définir le jeu comme l’oubli de soi, essentiellement : le jeu, c’est oublier le « je »
véritable. « Je suis » devient « je suis un autre ». Or nous jouons tout le temps à être un autre
1 Autre exemple, Aviator ou Casino, de Martin Scorsese, sont des films qui semblent montrer tout d’abord que la
vie n’est qu’un simple jeu ; tout semble facile pour ces deux héros que sont, l’un un riche inventeur, aventurier,
producteur de cinéma, et l’autre un habile retraité des affaires maffieuses converti en directeur de palace à Las
Vegas. Cependant leur fin tragique (qui est d’ailleurs le générique de début pour cette voltige incroyable de De
Niro dans Casino – figure qu’on retrouve magnifiée dans ce crash dont Di Caprio réchappe miraculeusement).
Oui Scorsese joue magistralement du cliché, mais c’est pour démontrer que la vie est toujours tragique.
2 Kafka, « La Colonie Pénitentiaire », in « La Métamorphose » collection « Librio » n°3, p. 74
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

P. Henry – De la méchanceté du je(u)
(c’est ce que dit mieux la Pensée 126 de Pascal – Ed. Le Guern : « Divertissement ») – parce
qu’en étant nous-mêmes nous nous ennuyons, et surtout nous nous mettons en face de ce qui
nous effraie : notre Salut. Comme le disait Socrate, nous n’aurions légitimement peur que
d’une seule chose, que nous n’ayons pas été justes. Or nous passons – bien souvent – notre
temps à ne pas penser à la justice, mais bien plutôt au plaisir (et surtout à celui du corps).
Nous sommes alors celui-là qui pilote telle voiture (dont la calandre, dont le nom, dont la
carrosserie arbore telle marque, telle valeur si puissamment sociale – qu’on le veuille ou
qu’on le méconnaisse), celui-ci qui porte tel parfum ou tel costume. Ce sont nos emblèmes,
nos perruques. Aussi bien l’identité courante n’est-elle qu’un leurre, qu’une façade devant
notre être authentique – un jeu de miroirs. Je suis censé être celui qui porte tel nom, qui a telle
nationalité, tel niveau social, etc. Très tôt à nos enfants nous « enseignons » - ou plutôt nous
dressons bien inconsciemment – de porter tels beaux habits, et plus tard ceux-ci nous forcent à
leur acheter tels disques à la mode, tels téléphones portables, comme nous l’aurions fait nous-
mêmes, le « progrès » technique en moins. Bref je vis comme un joueur sur un échiquier plus
ou moins dicté par des conventions presque organiques. Tout cela ne renvoie pas à ma
véritable identité. La seule réalité véritable, mon « moi profond » comme dirait Proust, c’est
Descartes qui l’a découverte : le cogito. Nous ne pouvons être véritablement qu’un « je pense,
je suis », qu’une conscience. Or il semble que nous n’avons que des moments de conscience,
des moments de « cogitatum », dont la philosophie figure sans doute, parmi eux, comme un
moment privilégié.
Qu’a–t–on perdu pour en arriver là ? Ou bien que n’a–t–on pas gagné ? La capacité à
s’étonner. On a perdu (pas pour tout le monde, espérons-le) la possibilité de s’étonner de soi,
de la vie, d’autrui, de l’existence. Le « Pari » de Pascal, c’est en ce sens le seul jeu qui ne
consiste pas à oublier cet étonnement et cette vigueur de conscience. Au fond, toutes les
erreurs (mais quelques beautés aussi) de l’âme humaine, toutes les violences du monde,
viennent de ce qu’on se nie soi-même comme cogito, et de ce qu’on nie aussi toute possibilité
pour autrui d’être un cogito. On nie la conscience d’autrui, on joue avec lui – comme par
exemple, la propagande avec les électeurs.
On nie sa liberté, on joue de sa crédulité, de ses espérances. Jouer, en ce sens, est
fondamentalement mauvais. En revanche, ce serait le bien suprême, si philosopher n’était
qu’un jeu, le plus grand, ou le jeu des jeux. Mais le régime du « comme si », du « prendre des
vessies pour des lanternes », ne peut faire de bien à personne s’il s’agit de progresser sur le
chemin de la recherche de la vérité. Woyzeck, le simple, le trompé, le dit bien : « L’Homme
est un abîme : on a le vertige quand on regarde dedans ». Ce que veut dire Büchner, c’est que
la vérité est toujours tragique, et sérieuse. On ne peut guère jouer avec le Salut, sauf à miser
sur l’existence de Dieu (comme le fait Pascal). Mais, en réalité, ce n’est plus un jeu – c’est un
jeu sur le jeu (de l’« anti-jeu », comme dirait un journaliste sportif).
Dans la réalité, nous jouons plutôt à nous oublier nous-mêmes, plutôt qu’à parier sur
Dieu et notre Salut. En fait, on s’oublie tout le temps, on ne cesse de s’oublier. On ne peut pas
ne pas s’oublier, pour continuer à exercer sa « vie sociale », ce jeu de rôles, soi-disant si
sérieux.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
1
/
3
100%