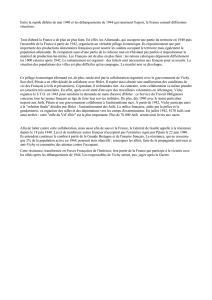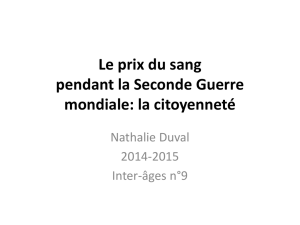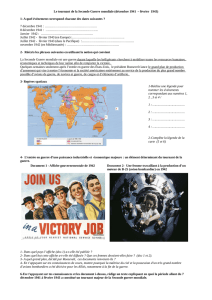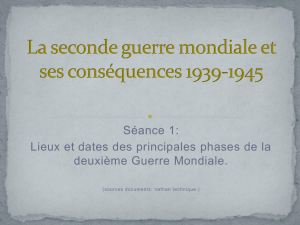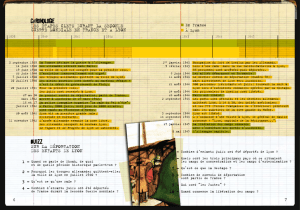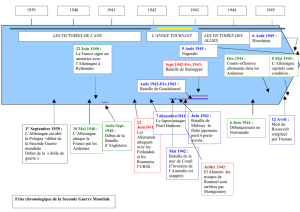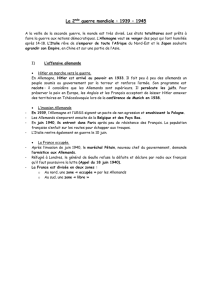Livret de l`exposition

ARCHIVES
NATIONALES
HOTEL DE SOUBISE
DU 26 NOVEMBRE 2014
AU 2 MARS 2015
LA
COLLABO
RATION
1940
1945 LIVRET
DE VISITE
Ce livret contient la liste des documents
exposés ainsi que des commentaires
sur la plupart d’entre eux.
Le pictogramme identifie les documents
qui font l’objet d’un parcours pédagogique.
(renseignements auprès du Service éducatif,
au 01 40 27 62 62)
À la fin de votre visite, nous vous remercions de
bien vouloir rendre ce livret à la caisse.
En échange, il vous sera remis un cahier du
visiteur, gratuit, qui vous permettra de garder
la trace du parcours ici proposé.
L’ouvrage accompagnant l’exposition, écrit
par Thomas Fontaine et Denis Peschanski,
commissaires scientifiques de l’exposition
et publié aux éditions Tallandier en coédition
avec le ministère de la Défense et les Archives
nationales, est également en vente à la caisse
du Musée.
Enfin, un cycle d’extraits de films de fiction
français réalisés après 1945 vous est proposé
au rez-de-chaussée de l’hôtel de Soubise
(durée du programme 30 mn environ).


1
24 octobre 1940 : l’entrevue de Montoire
Dans l’esprit du maréchal Pétain, président du
Conseil depuis le 16 juin 1940, la collaboration
est inscrite dans le choix même de l’armistice
signé le 22 juin 1940 à Rethondes. Mais c’est la
rencontre du 24 octobre 1940 entre Adolf Hitler
et le maréchal dans une petite gare du Loir-
et-Cher qui frappe les esprits et symbolise le
choix des autorités françaises. Hitler revient
d’une rencontre infructueuse avec le général
Francisco Franco, chef de l’État espagnol,
pour évoquer une alliance contre l’Angleterre.
À l’aller, dans cette même ville, il a discuté
avec Pierre Laval, vice-président du Conseil
et secrétaire d’État aux Affaires étrangères.
Pour les partisans français de la collaboration,
la France peut espérer mettre en avant ses
atouts, tels l’Empire ou la flotte, négocier un
assouplissement des contraintes allemandes
prévues par l’armistice et un retour de prison-
niers de guerre. Mais, lors de cette première
rencontre au sommet, c’est finalement surtout
le symbole qui prime. Il s’agit d’immortaliser
l’instant plus que de donner du contenu à la
politique de collaboration.
Si la rencontre de Montoire est connue, on
sait moins que quelques heures plus tôt le
maréchal Pétain retrouve avec Pierre Laval, à
la préfecture de Tours, Otto Abetz, ambassa-
deur d’Allemagne à Paris. Des photos inédites
nous éclairent sur ces heures qui précèdent la
rencontre.
2
30 octobre 1940 : discours radiodiffusé du
maréchal Pétain dans lequel il explique son
choix d’entrer
« dans la voie de la collaboration »
Le 30 octobre 1940, six jours après sa poi-
gnée de mains avec Adolf Hitler à Montoire,
le maréchal Pétain s’adresse à la nation lors
d’un discours radiodiffusé et revendique
la politique de collaboration : « C’est dans
l’honneur et pour maintenir l’unité française,
une unité de dix siècles, dans le cadre d’une
LA
COLLABO
R AT I O N
EN 20
DOCU
MENTS
3
Portrait du maréchal Philippe Pétain, affiche de Draeger
© Archives nationales, 72AJ/1033 / Atelier photo des AN

activité constructive du nouvel ordre euro-
péen, que j’entre aujourd’hui dans la voie de la
collaboration […] Cette politique est la mienne
[…] C’est moi seul que l’histoire jugera. Je
vous ai jusqu’ici tenu le langage d’un père. Je
vous tiens aujourd’hui le langage d’un chef.
Suivez-moi. »
3
Février 1941 : Louis-Ferdinand Céline, Les
Beaux draps
En février 1941, Louis-Ferdinand Céline (1894-
1961), qui s’est fait connaître avec la publication
en 1932 de son Voyage au bout de la nuit, puis
en 1936 de Mort à crédit et de divers pamphlets
entre 1936 et 1938 (Mea culpa, Bagatelles pour
un massacre, L’École des cadavres) publie aux
Nouvelles Éditions françaises son nouveau
pamphlet antisémite, Les Beaux draps. L’un
des plus grands romanciers du XXe siècle ou
l’un des collaborationnistes les plus radicaux
et les plus racistes ? Question récurrente mais
qui n’a guère de sens, car Céline se trouve
être les deux à la fois, comme le montre le
passage présenté des Beaux draps : « C’est
pas mon genre l’hallali, j’ai pas beaucoup
l’habitude d’agresser les faibles, les déchus,
quand je veux me faire les poignes sur le Blum
je le prends en pleine force, en plein triomphe
populaire, de même pour les autres et Mandel.
J’attends pas qu’ils soyent en prison. Je fais
pas ça confidentiellement dans un petit journal
asthmatique. Je me perds pas dans les faux-
fuyants, les paraboles allusives. C’est comme
pour devenir pro-allemand, j’attends pas que
la Commandantur [sic] pavoise au Crillon. »
4
Mai 1941 : compte rendu des réunions dites
des « protocoles de Paris », négociations
pour l’utilisation par les Allemands des
bases aériennes et navales françaises en
Afrique du Nord et en Syrie
Le 21 mai 1941 s’ouvrent à Paris des négocia-
tions entre les Allemands et l’amiral François
Darlan, nouveau vice-président du Conseil
depuis février 1941. Celui-ci a rencontré Adolf
Hitler à Berchtesgaden le 11 mai 1941, et voit
l’opportunité d’imposer la France comme
grande puissance dans une Europe nécessai-
rement allemande. Les protocoles de Paris –
trois accords militaires et un complémentaire,
politique –, sont signés le 28 mai 1941 et
représentent un nouveau pas dans le sens de
la collaboration militaire. L’accord vaut pour
la Syrie et l’Irak, l’Afrique du Nord et l’Afrique
occidentale et équatoriale ; la France s’enga-
geant dans les trois cas à un soutien logis-
tique – la mise à disposition d’aérodromes, la
fourniture de matériel et de vivres à l’Afrika
Korps, l’utilisation du port de Bizerte et de la
voie ferrée Bizerte-Gabès pour acheminer
du ravitaillement vers la Libye. Dans un pro-
tocole additionnel, signé d’Otto Abetz, l’ami-
ral François Darlan obtient la contrepartie
politique qu’il recherche, sans toutefois que
celle-ci soit précisée : « Le gouvernement
allemand fournira au gouvernement français,
par la voie de concessions politiques et éco-
nomiques, les moyens de justifier devant l’opi-
nion publique de son pays l’éventualité d’un
conflit avec l’Angleterre et les États-Unis ».
Mais, le maréchal Pétain veut la collaboration
politique sans la guerre. Côté allemand, Adolf
Hitler et Joachim von Ribbentrop, le ministre
des Affaires étrangères du Reich, demeurent
méfiants et ne partagent pas plusieurs vues
optimistes de leur ambassadeur à Paris. Les
défaites en Irak, puis en Syrie et au Liban en
juin-juillet, rendent caduques tout ou partie
des Protocoles.
4

5
2 juin 1941 : recueil établi par le
Commissariat général aux questions juives
des textes officiels concernant le statut des
Juifs
Le second statut des Juifs publié au Journal
officiel le 2 juin 1941 remplace le statut du
3 octobre 1940. Il est l’œuvre du nouveau
Commissaire général aux questions juives
(CGQJ), Xavier Vallat, nommé fin mars 1941.
Avec ce texte, l’antisémitisme d’État franchit
une nouvelle étape, et, à l’inverse de l’au-
tomne précédent, prend aussi en compte les
initiatives allemandes. Ce texte ajoute des
critères religieux à ceux, raciaux, du premier
statut, précise, en l’élargissant, la définition
de la fonction publique fermée aux Juifs et
multiplie les interdictions professionnelles ;
les contrevenants sont punissables d’interne-
ment administratif. De plus, alors que l’aryani-
sation a été engagée par les Allemands depuis
l’automne 1940, il est également évident pour
Vichy que l’exclusion sociale doit aller de pair
avec l’exclusion économique. L’ambition du
CGQJ est d’accélérer « l’assainissement de
l’économie nationale », tout en marquant, dans
ce domaine comme dans tous, la souveraineté
du gouvernement.
6
28 juillet 1941 : protocole Bergeret-Udet,
directive pour l’exécution d’un pro-
gramme franco-allemand de construction
aéronautique
Par le protocole signé le 28 juillet 1941 par
le général Jean Bergeret, secrétaire d’État à
l’Aviation, et le général Ernst Udet, ministre
de l’Air du Reich, la France et l’Allemagne
s’engagent dans un programme commun de
construction aéronautique, sur la base d’un
avion français pour cinq avions allemands.
Celui-ci doit permettre de relancer ce secteur
stratégique, durement touché par la défaite
et l’armistice, tout en apportant aux Français
des contreparties. Cet accord illustre la col-
laboration « constructive » alors voulue par
le gouvernement de Vichy dans le domaine
économique.
7
Septembre 1941 : lettre de dénonciation
reçue par Robert Peyronnet, animateur de
l’émission La Rose des vents sur Radio-Paris,
et son enveloppe
L’émission La rose des vents débute sur Radio-
Paris, la radio de l’occupant, en décembre 1940.
Elle connaît un grand succès, grâce à la forme
d’interactivité établie entre Robert Peyronnet
et ses auditeurs, qui sont invités à lui écrire.
Ces lettres sont lues à l’antenne, avant l’édi-
torial du journaliste. L’émission fait de la déla-
tion son matériau principal. Les informations
recueillies sont transmises au Commissariat
général aux questions juives et aux services
allemands. La Propaganda-Abteilung du minis-
tère de la Propagande du Reich peut en outre
utiliser les 20 000 adresses de Français ainsi
collectées. L’auteur de la lettre présentée
n’hésite pas à la signer, pour dénoncer deux
« juifs » et « francs-maçons ». En fait, la pre-
mière personne citée est l’ancien amant de
la dénonciatrice. Il ne subvenait plus à ses
besoins depuis plusieurs semaines. Le second
est son neveu. Ni l’un ni l’autre ne sont Juifs et
francs-maçons.
8
Septembre 1941 : liste allemande énu-
mérant les écrivains français pressentis
pour participer au voyage en Allemagne
d’octobre 1941
En octobre 1941, à l’occasion des « rencontres
poétiques » (Dichtertreffen) de Weimar, et à l’in-
vitation du ministre de la Propagande du Reich,
Joseph Goebbels, créateur de ces journées, un
groupe d’écrivains français effectue un voyage
en Allemagne, avec d’autres auteurs de plu-
sieurs nationalités. Début septembre, la liste
des participants est établie précisément par le
Gruppe Schrifttum (« groupe Littérature ») de la
Propaganda-Abteilung : Paul Morand, Jacques
Chardonne, Marcel Arland, Pierre Drieu la
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
1
/
68
100%