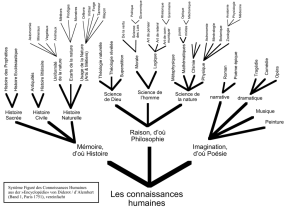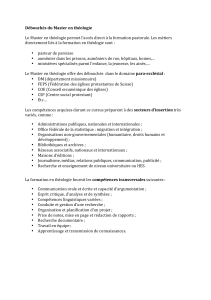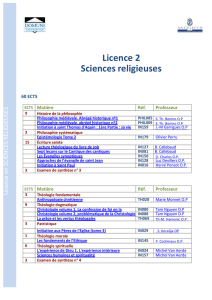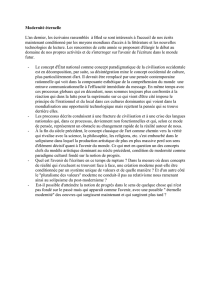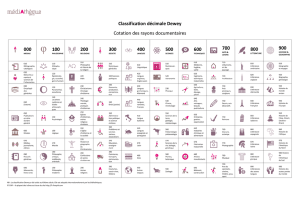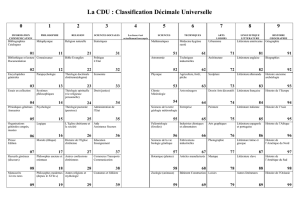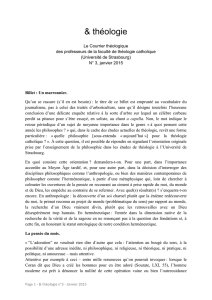introduction generale



MODERNITÉ ET CHRISTIANISME
La question théologico-politique
chez Karl Löwith, Carl Schmitt
et Hans Blumenberg

Du même auteur
Religion et politique. La question théologico-politique chez Karl Löwith
et Hans Blumenberg, Éditions L’Harmattan, 2010.
© L’Harmattan, 2010
5-7, rue de l’École-polytechnique ; 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmatt[email protected]
ISBN : 978-2-296-13889-6
EAN : 9782296138896

Albert Dossa OGOUGBE
MODERNITÉ ET CHRISTIANISME
La question théologico-politique
chez Karl Löwith, Carl Schmitt
et Hans Blumenberg
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%