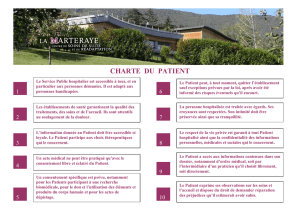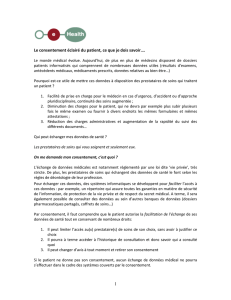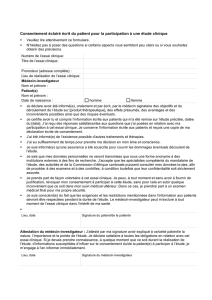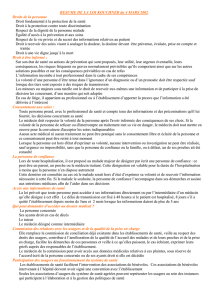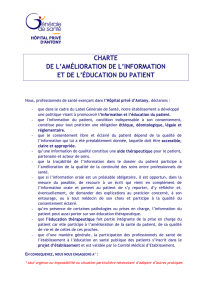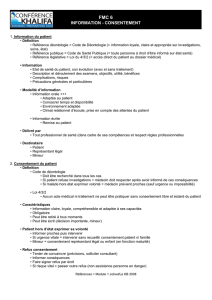Télécharger huriet - Institut Maurice Rapin

La loi Huriet, après 10 ans d'application
F Lemaire
Introduction :
La loi Huriet était nécessaire ; elle est appliquée depuis une dizaine d'années, et il
ne fait aucun doute que tout en autorisant et en légitimant la recherche sur l'homme,
malade ou non, elle en a aussi organisé la protection. Cependant, des difficultés
importantes ont existé dès le début de sa mise en œuvre, difficultés qui perdurent et qu'il
est important de reconnaître, d'analyser, pour en proposer des solutions.
La loi du 20 décembre 1988, ainsi que la réglementation qui en a découlé, a mis en
place une procédure complexe et rigide, mal adaptée à l'immensité et à la diversité des
situations que recouvre la recherche clinique. Ces difficultés, dénoncées dans
d'innombrables textes, rapports, articles(1), paraissent avoir deux explications majeures,
qui remontent toutes deux à l'origine de la loi : la première est qu'elle avait été avait été
initialement prévue pour la mise au point et l'enregistrement des médicaments et qu'elle
n'a pas été adaptée lorsque son champ d'application a été élargi à toute la recherche
biomédicale. La deuxième difficulté est que l'accent mis sur le consentement des patients
est certes en conformité avec les grands textes éthiques internationaux (Nuremberg,
Helsinki-Tokyo), mais que celui-ci ne s'insère pas facilement dans la tradition juridique
française, attachée surtout, elle, à la protection du corps humain ("indisponible" et
"inviolable".
En résultent l'extrême difficulté à réaliser des études sans bénéfice individuel direct
(SBID), qui devient une impossibilité en l'absence de consentement direct du patient,
l'inadaptation de la procédure mise en place par la loi et ses décrets d'application pour les
comparaisons de pratiques, et l'absence de reconnaissance du patient incompétent.
I – Aux origines de la loi :
a) Une loi décalquée des Bonnes pratiques cliniques :
Avant 1988, la mise au point d'un médicament imposait des essais sur le volontaire
sain (circulaire de décembre 1975), mais les investigateurs étaient susceptibles d'encourir
des poursuites pénales (article 318 du Code Pénal). Le besoin, légitime, de permettre aux
industriels français de rester compétitifs en leur permettant de réaliser des essais de
phase I et II sur notre territoire a été une forte motivation de la loi, bien exposée par le
Sénateur Claude Huriet devant la commission des affaires sociales du Sénat en 1988: "…
le texte de la proposition de loi qui est soumis aujourd'hui à votre examen répond à un
triple souci. Il s'agit de mettre fin à une situation juridique paradoxale, qui, en France,
n'assure pas la protection de l'individu, place le médecin dans une situation illégale et qui
plus particulièrement porte préjudice à l'industrie pharmaceutique" (2.Mais ce texte
proposé initialement ne concerne que "les essais chez l'homme d'une substance à visée
diagnostique ou thérapeutique, destinée à faire l'objet d'une demande d'autorisation de
mise sur le marché". C'est en séance qu'il a été décidé d'élargir son champ d'application à
la totalité de la recherche biomédicale, ce qui était d'ailleurs parfaitement logique. Les
difficultés que les cliniciens ont rencontré par la suite viennent de ce que l'architecture du
texte n'a pas été modifiée en fonction de cet élargissement ; l'exemple le plus éclairant est
F. LEMAIRE 1

constituée par l'ensemble des articles consacrés à la recherche sans bénéfice individuel
direct :celle-ci est certes reconnue, identifiée et autorisée, ce qui est une avancée
majeure, mais à travers un dispositif exclusivement conçu pour le volontaire sain. La
simple énumération des dispositions prévues dans le titre IV de la loi du 20.12.1988
(tableau 1) montre assez que la possibilité qu'une recherche physiopathologique ou
cognitive soit désormais appliquée à des malades n'a simplement pas effleuré les
rédacteurs de la loi.
b) la tradition juridique française et le consentement éclairé :
Dans les premiers commentaires qu'ils ont consacré à la loi de 1988, les juristes ont
d'emblée rappelé la prééminence dans la jurisprudence française de l'inviolabilité du
corps humain (nul ne peut y porter atteinte) et de son indisponibilité (on ne peut "disposer"
de son corps, même du sien ; le corps ne peut faire l'objet de conventions, qui s'appliquent
aux choses, car le corps est indissociable de la personne). La seule justification de l'acte
médical, qui, clairement porte atteinte au principe de l'inviolabilité du corps humain, est sa
finalité thérapeutique : c'est pour le bien du patient et à sa demande, bien qu'elle soit le
plus souvent implicite, que le praticien va être autorisé à intervenir sur son corps. Ce n'est
que tout récemment que la jurisprudence de la Cour de Cassation a mis l'accent sur le
consentement "éclairé" aux soins. Le consentement ressort en effet bien plus de la
tradition anglo-saxonne et de son respect de l'autonomie individuelle, qui remonte sans
doute à l'"habeas corpus" anglais (3). Un des 9 juges de la Cour Suprême, "justice"
Cardoso, n'a-t-il pas dit : "ever human being of adult years and sound mind has a right to
determine what will be done with his own body…" (4). Ce concept est devenu la véritable
pierre angulaire de la recherche clinique, présent dans tous les grands textes
internationaux, du Code de Nuremberg (1947) à la convention bioéthique de Strasbourg
(1997), en passant par la déclaration d'Helsinki-Tokyo (1956-1975) et les
recommandations de la CIOMS (1993). "Universel" depuis le code de Nuremberg sous la
forme "le consentement du sujet est absolument essentiel", ce principe avait en fait été
inclus dans une déclaration de l'American Medical Association de décembre 1946 pour
être proposé quelques semaines plus tard au tribunal de Nuremberg par le Pr. Ivy,
physiologiste renommé de Chicago, qui l'avait rédigée (5).
Or, à la différence du droit anglo-saxon, le consentement dans la tradition juridique
française n'est pas au premier plan : la victime peut être consentante, ce qui n'exonère
certainement pas son bourreau de sa responsabilité. Cette limitation s'applique également
à la médecine, comme la Cour de Cassation l'avait exprimé dans l'arrêt dit des "stérilisés
de Bordeaux" (2). Ainsi s'explique que le législateur français ait autorisé la recherche sans
consentement dans les situations d'urgence, à condition (article 209-9) qu'on puisse en
"attendre un bénéfice direct et majeur (pour les sujets qui seront sollicités)". Une
autorisation en apparence si surprenante de la recherche sans consentement était déjà
présente dans le rapport du Conseil d'Etat, "de l'éthique au droit" (6), en 1988, alors qu'il
n'a été autorisé par la FDA Nord-Américaine qu'en 1996 (7). Cette justification de la
recherche médicale par l'existence d' un BID a été encore renforcée dans la convention
bioéthique de Strasbourg (8). Elle traduit pourtant une incompréhension majeure et
obstinée du législateur sur la nature profonde de la recherche médicale, qui est de
"produire de la connaissance généralisable", et non d'en faire bénéficier le patient
individuel qui y est soumis (9).
Le corollaire est évidemment que la recherche sans BID, tenue en haute suspicion,
est sévèrement encadrée même lorsqu'elle s'accompagne d'un consentement. Elle est
impossible pour certaines populations "vulnérables", les détenus, les patients en situation
d'urgence. Pour les autres, l'exigence du consentement est essentielle. Cette difficulté est
évidemment aggravée par l'incapacité de notre droit à reconnaître l'existence du patient
"incompétent" (sédaté, comateux, encéphalopathe, dément, etc.), bien que capable
juridiquement.
F. LEMAIRE 2

II – Difficultés
a) le patient incompétent
Les réanimateurs connaissent bien ce problème. Leurs patients sont le plus souvent
inconscients ou sédatés, stressée et/ou dépendants, ils ne peuvent être valablement
informés et ne peuvent donc consentir. Dès 1987, une déclaration officielle de la Société
de Réanimation de Langue Française attirait l'attention sur cette particularité de notre
discipline (10). La solution proposée alors pour résoudre le problème des patients
incompétents (demander la levée de l'obligation de consentement et soumettre le
protocole à un comité d'éthique indépendant) n'a pas été retenue dans la loi qui allait être
votée quelques mois plus. En revanche, pour les patients "en situation d'urgence" (article
L 209-9), la recherche devenait possible, même sans consentement. Le débat
parlementaire de 1988 ne laisse aucun doute sur l'assimilation faite à l'époque entre
réanimation et urgence, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée Nationale.
Il est évident néanmoins que de nombreux patients de réanimation incapables de
consentir ne sont pas pour autant en "situation d'urgence", ce qu'un bon avocat ne
manquerait pas de relever en cas de contentieux. De plus, la loi permet certes de faire des
recherches sur les patients en situation d'urgence, mais seulement à la condition expresse
d'un bénéfice individuel indirect. Toute recherche cognitive dans ce cas est interdite
depuis la révision de la loi de 1994 (article L 209-9).
b) la recherche SBID sans consentement :
Elle n'est pas autorisée, ce qui signifie qu'une recherche de type physiopathologique
est impossible dans des affections aussi sévères que les démences, la maladie
d'Alzheimer, les états comateux, une grande partie de la neurologie et de la psychiatrie,
en fait les formes "aiguës" de la plupart des pathologies, (1)
(encart 1)
A l'origine de cette interdiction, nous l'avons vu, se trouve l'assimilation implicite
contenue dans la loi entre la recherche sans bénéfice et les essais de phase I sur le
volontaire sain, mais aussi la répugnance du législateur français à concevoir la nature et
l'importance de la recherche sans bénéfice direct
(encart 2).
c) la recherche SBID et sans risque :
A l'autre extrémité du spectre se trouve la recherche SBID sans aucun risque, tel le
prélèvement d'échantillon sanguin, soit isolément, soit lors d'intervention diagnostique ou
thérapeutique (= "les fonds de tube"). Même si ce type de recherche est possible à
condition de recueillir le consentement de la personne qui y sera soumise, c'est dans ce
cas la lourdeur de la procédure qui s'est révélée à l'usage totalement dissuasive. Le
dispositif retenu par la loi, évidemment légitime pour des essais de phase 1 , 2 ou 3
portant sur des médicaments nouveaux, essayés chez des volontaires sains, est
totalement inadapté dans le cas de la recherche cognitive sur le malade hospitalisé.
d) la recherche avec ou sans bénéfice individuel direct
Une distinction fondamentale a été introduite dans la déclaration d'Helsinki entre "la
recherche médicale dont le but est essentiellement diagnostique ou thérapeutique pour le
patient" et la recherche dont l'objet "est purement scientifique et sans valeur diagnostique
ou thérapeutique pour la personne qui y est soumise". Cette différence conceptuelle n'a
cependant pas été transposée en termes opérationnels dans les textes qui réglementent
la recherche clinique aux Etats-Unis(9 ). En revanche, elle a été reprise avec force en
France dans le rapport Braibant (6 ) qui opposait les essais "à but thérapeutique …
justifiant seuls la violation du principe de l'impossibilité de porter atteinte au corps humain",
et les essais sans justification thérapeutique, telles les recherches cognitives, dont "les
F. LEMAIRE 3

sujets ne retirent aucun bénéfice personnel". La loi Huriet-Sérusclat a repris cette
distinction, en définissant les essais avec et sans bénéfice individuel direct (BID et SBID).
On en voit bien aujourd'hui les inconvénients. D'une part les Comités de protection
(CCPPRB) éprouvent parfois de la difficulté à tracer une limite nette entre les deux: les
études diagnostiques (l'intérêt du catheter de Swan-ganz dans les états de choc?) Sont-
elles avec ou sans BID? Les études médico-économiques sont plutôt SBID, mais elles
peuvent porter sur des thérapeutiques (deux durées d'antibiothérapie dans les
pneumopathies nosocomiales. Dans ces cas, certains CCPPRB ont accepté, de façon
pragmatique, de considérer qu'il s'agissait d'essais avec BID, puisqu'ils concernaient des
traitements. Et qu'en est-il des études d'équivalence? A prurit, elles sont toutes SBID. La
remarquable étude de Sloan et col. (11 ) qui avaient montré l'intérêt de maintenir chez les
les patients de réanimation un certain degré d'anémie ( 7g versus 11g d'hémoglobine)
n'aurait pu être réalisée chez nous, parce qu'elle est sans bénéfice, et qu'elle concerne
des patients en situation d'urgence.
Mais, surtout, l'introduction dans la loi de la distinction entre les deux types de
recherche en a artificiellement accentué la différence. D'un côté, la diabolisation de la
recherche SBID l'a rendue impraticable ou impossible, de l'autre, l'accent excessif sur le
bénéfice individuel que les patients pourraient en retirer peut entraîner les investigateurs,
les CCPPRB et les patients (ou leur famille) eux-mêmes à accepter des risques
inconsidérés (en anglais, la "therapeutic misconception"). L'isolement par la loi d'une
catégorie de recherche particulière sans bénéfice individuel direct devait inévitablement
exposer les patients qui y seraient soumis à une surprotection mécanique et aveugle. On
peut regretter que l'exercice consistant à tracer la frontière entre BID et SBID ait alors
remplacé l'évaluation de la balance risques/bénéfices du protocole lui-même. Mais il est
intéressant de relever que la dernière révision de la déclaration d'H elsinki a supprimé
cette distinction.
e) la comparaison de pratiques validées :
Le tableau 2 liste les comparaisons de pratiques, qui entrent clairement dans le
domaine de la recherche, car visant à "produire de la connaissance généralisable",
comportant un protocole préalable, une randomisation, une surveillance spécifique, etc…,
mais qui concernent des procédures ou des traitements utilisés en routine, parfois même
depuis plusieurs décennies. Dans le cas des médicaments, ceux-ci peuvent avoir obtenu
leur AMM depuis fort longtemps. La procédure univoque prévue par la loi s'est révélée ici
inadaptée, et donc rapidement dissuasive. La conséquence, qu'on ne peut évidemment
mesurer, est que ces recherches sont encore faites clandestinement, ou que les pratiques
concernées sont utilisées sans validation.
Robert Truog, réanimateur pédiatre et bio-éthicien Nord Américain de renom, a listé
dans un article récent du New England Journal of Medicine (12) les conditions qui, à ses
yeux, peuvent justifier un abord particulier (tableau 3).C'est pour ce type de comparaison
qu'une procédure "allégée" avait été recommandée dans l'avis n° 58 du CCNE (13 ). En
effet, ce n'est pas tant l'information ou l'obtention du consentement du patient qui pose ici
problème, mais bien la lourdeur inadaptée de la procédure mise en place par la loi et la
réglementation (tableau 4).
CONCLUSION :
La loi Huriet a certainement rempli sa mission initiale qui était de légitimer et
d'organiser les essais médicamenteux. Il est hors de doute que leur qualité a été
grandement améliorée, renforçant la compétitivité de la France dans ce domaine. En
revanche, la recherche dite "institutionnelle" ou académique (c'est-à-dire promue par un
établissement de santé ou un organisme de recherche, ou encore une association) se dit
aujourd'hui sévèrement pénalisée. Les perspectives d'évolution de la loi ou de la
F. LEMAIRE 4

réglementation dans un sens plus favorable paraissent cependant bien faibles aujourd'hui.
L'exigence sociétale croissante de sécurité ne va guère dans le sens d'une souplesse
accrue. Surtout, la loi Huriet va continuer d'être une anomalie dans l'ensemble juridique
français (inviolabilité et indisponibilité du corps versus consentement éclairé). Claude
Huriet avait souhaité en 1988 faire inscrire dans le Code Civil les besoins de la recherche
("les circonstances prévues par la loi") à côté de la nécessité thérapeutique comme
dérogation légale au principe de l'inviolabilité du corps humain. Son échec n'était
évidemment pas de bon augure.
F. LEMAIRE 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%