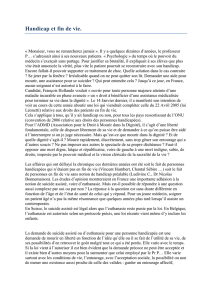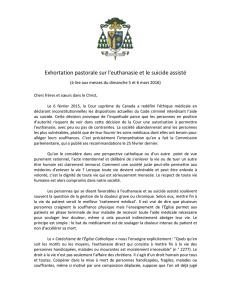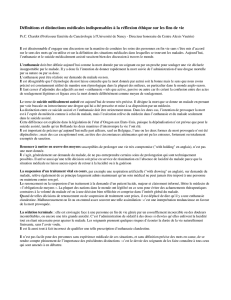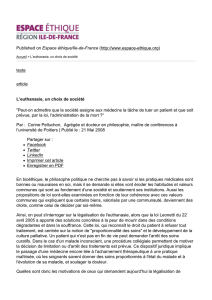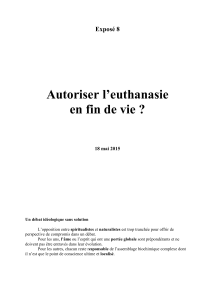Etude sur l`euthanasie

Dossier présenté par le GEA
Groupe d’Etude des Assemblées et Eglises
Evangéliques en Suisse Romande
Introduction
Clarification de la terminologie
I. Résumé historique a) dans l’histoire de l’Eglise
b) en Suisse
II. Questions juridiques
III. Questions médicales
IV. Questions théologiques
V. Lignes d’éthique chrétienne
Conclusions
Documents annexés (réf. net)
Références utiles
Texte préparé par Anne-Lise Gagnebin, mai 2003

GEA - Euthanasie Page 1 sur 16
GEA –ETUDE SUR L’EUTHANASIE
INTRODUCTION
L’évolution de la médecine a apporté de nombreux changements durant le vingtième siècle. Elle
a suscité beaucoup de nouveaux débats éthiques, en particulier autour de la question de la mort.
En effet, les progrès de la science ont permis de traiter des maladies mortelles il y a encore
quelques décennies et de prolonger la vie des patients. Cependant, ces nouvelles techniques ont
parfois été la source de beaucoup de souffrances pour les malades et leur entourage. On a
commencé alors à parler d’acharnement thérapeutique, puis du droit à mourir dans la dignité, du
droit à choisir sa mort, et finalement du droit à recourir à l'euthanasie. Parallèlement à ces
diverses revendications, la seconde moitié du vingtième siècle a aussi vu la naissance et le
développement des soins palliatifs.
Il est tout d’abord important de donner quelques définitions afin d’éviter toute confusion.
Terminologie :
Euthanasie : Etymologiquement, euthanasie signifie « bonne mort ».
Euthanasie active directe : acte de tuer quelqu’un à sa demande. Selon l’article 144 du code
pénal suisse, le meurtre sur demande de la victime est punissable. Aux Pays-Bas, il est non
punissable sous certaines conditions.
Assistance au suicide : aide une personne à se suicider, par exemple en lui procurant une arme,
un poison mortel, un appareil pour injecter un tel poison. Cette personne effectue elle-même le
geste décisif, c’est donc bien un suicide et non un meurtre.
L’assistance au suicide n’est pas punissable en Suisse, pour autant qu’un motif égoïste puisse être
exclu. L’assistance au suicide est pratiquée par EXIT par exemple.
Euthanasie involontaire : euthanasie sans la demande explicite et répétée du malade.
Un tel meurtre sans demande de la victime est punissable dans tous les pays, mais souvent ces cas
ne parviennent pas à la connaissance des autorités.
Euthanasie passive : renoncement à mettre en œuvre des mesures médicales visant à prolonger
la vie. Ce terme, en usage en Suisse, est en général rejeté, au profit du terme : « arrêt des
traitements », ou d’un autre terme analogue.
Le droit de refuser un traitement ou d’en demander l’arrêt fait partie des droits du patient. Si l’on
va à l’encontre de cette volonté, on se rend coupable d’atteinte à l’intégrité de la personne, ce qui
est punissable.
Euthanasie active indirecte: acte d’administrer, pour soulager des souffrances, des substances
dont les effets secondaires peuvent réduire la durée de vie. Cette définition peut prêter à
confusion car elle utilise le terme d’euthanasie pour un acte médical qui ne consiste qu’à soulager
les souffrances et non à donner la mort.
Acharnement thérapeutique : obstination thérapeutique déraisonnable refusant de reconnaître
que le patient est voué à la mort et qu’il n’est pas curable.
Soins palliatifs : soins destinés à soulager la souffrance d’une personne en fin de vie et à assurer
son confort plutôt qu’à la guérir.
Soins terminaux : soins offerts à une personne pour qui la médecine est impuissante à prolonger
la vie et qui demande à s’éteindre.

GEA - Euthanasie Page 2 sur 16
Notre étude conduit à approuver et encourager les soins palliatifs et les soins terminaux. En
revanche, l’euthanasie active directe et l’aide au suicide sont des pratiques que nous mettons en
question : voilà pourquoi elles sont au centre de nos recherches. Lorsque, dans ce qui suit, le
terme d’euthanasie est utilisé sans précision, il se réfère à ces deux pratiques.
I. RESUMÉ HISTORIQUE
a) Dans l’histoire de l’Eglise (d’après E.J. Larson & D.W. Admundsen, A Different Death)
Suicide et euthanasie dans l’Antiquité
Dans le monde antique, la vie humaine n’était pas universellement reconnue comme une valeur
intrinsèque. Elle ne faisait pas l’objet d’un respect particulier. Toutefois, quelques philosophes tel
Hippocrate font exception, de même que le judaïsme.
L’Ancien Testament proclame sans équivoque la souveraineté de Dieu sur la vie et la mort. C’est
le cas dans les récits de la création : Ge 2 : 7, 2 : 17, 3 : 19, 4 : 10-11, 9 : 6, Nb 35 : 33.
C’est ensuite répété avec insistance dans le Pentateuque, les textes prophétiques et les autres
Ecrits : Dt 32 : 39, 1S 2 : 6, Jb 12 : 10, Ps 90 : 3, Ps 104 : 29, Ec 8 : 8, 12 : 7, Ez 18 : 4.
La Bible souligne la souveraineté de Dieu sur la vie et la mort et, paradoxalement, elle relève que
Dieu est aussi très affecté par la mort de ses enfants: Ps 116 : 15, Dt 30 : 19-20.
Chez les Juifs, c’est un devoir sacré de sauver chaque vie (pikku’ah nefesh). Cette obligation
inclut le devoir de préserver sa propre vie dans la plupart des circonstances. Cependant, un Juif
devait mourir plutôt que de violer la loi ; il fallait sanctifier le Nom de Dieu plutôt que le diffamer
(kiddush ha-Shem plutôt que hillul ha-Shem).
Suicide et euthanasie aux premiers temps du christianisme
La condamnation du suicide par les premiers chrétiens est plutôt rare et équivoque. Les sujets en
débat étaient: l’avortement, l’infanticide, les combats de gladiateurs, l’immoralité sexuelle, etc.
De plus, la question du suicide était ambiguë : comment définir le suicide ? Quelles sont les
limites entre suicide et ascétisme et entre martyre et suicide ? De nombreux textes parlant de la
Résurrection, exhortent à ne pas craindre la mort, à s’en réjouir ou à ne craindre que la mort
spirituelle. Certains auraient pu alors chercher à jouir plus rapidement de ces bénédictions.
Cependant, les premiers chrétiens n’étaient guère tentés par le suicide sachant que le sens de la
vie chrétienne est de faire la volonté de Dieu. Le résumé de la loi est d’aimer Dieu de tout son
cœur, de toute son âme et de toute sa pensée et d’aimer son prochain comme soi-même.
Il n’y a aucun texte biblique qui permettrait ou encouragerait le suicide face à l’épreuve. Dans
l’Ancien Testament, plusieurs personnes ont souhaité la mort (Moïse, Elie, Jonas et bien sûr Job).
Mais aucun d’eux n’a envisagé le suicide. Saül a certe demandé la mort, mais c’est
l’aboutissement de son rejet en tant que roi et oint de Dieu (1S 31 :4).
Le Nouveau Testament relève clairement que la souffrance est présente dans la vie des chrétiens.
Beaucoup de textes parlent de la souffrance comme d’une école de discipline, d’obéissance, un
apprentissage de la patience et de la maîtrise de soi. Les chrétiens devraient y trouver un sujet de
joie : la façon de répondre à certaines formes de souffrances est une preuve qu’ils sont enfants de
Dieu. De plus, l’expérience de la souffrance permet une croissance spirituelle. Enfin, celui qui a
traversé certaines souffrances peut apporter consolation aux personnes éprouvées (voir par ex. 2
Co 1 :3-7).

GEA - Euthanasie Page 3 sur 16
Les Pères de l’Église considéraient la souffrance comme un aspect essentiel de la sanctification.
Cette conviction, combinée à l’assurance de la souveraineté de Dieu et la confiance qu’Il fait
toute chose pour notre bien final, les a amenés à prêcher la persévérance dans les afflictions.
Ainsi, il n’y a aucun récit de suicide de malade chez les Pères de l’Église.
Dans le Nouveau Testament la santé du corps est associée au concept de réconciliation. La santé
du corps n’est pas un bien absolu, ni une fin en soi, même si les guérisons effectuées par le Christ
sont un sujet de réjouissance. La maladie est le signe d’un monde perturbé par le péché originel,
et les guérisons miraculeuses de Jésus font entrevoir l’accomplissement eschatologique dans
lequel le corps aussi bien que l’âme sera racheté. La santé est une bénédiction, quelque chose de
désirable, mais elle n’est pas indispensable au bien-être. La maladie n’est pas pour autant
imputable à un péché que le malade aurait commis.
La terminologie concernant la maladie et les dysfonctionnements physiques est vaste et peu
précise dans le Nouveau Testament et les écrits des Pères de l’Église. Il n’est donc pas possible
de faire des interprétations médicales de ces textes. Les récits de guérison ont une portée
théologique. Ils révèlent la nature des relations entre la personne malade et Dieu. Ces récits ne
peuvent pas être approchées d’un point de vue médical. Ce n’est pas la nature de la maladie, son
développement ou son traitement qui attirent l’attention, mais la maladie est envisagée comme un
événement significatif de l’histoire du patient dans la perspective générale du message du salut1.
Les évangélistes considéraient les miracles de Jésus comme des signes qui authentifiaient Jésus
comme Messie, tout en affirmant que le signe de Jonas était encore plus grand. Par ailleurs, si de
nombreuses guérisons ont été accomplies par Jésus et ses disciples, il y a aussi plusieurs cas de
non-exaucements dont le plus connu est la maladie de l’apôtre Paul, l’épine de sa chair.
L’idée que les souffrances individuelles sont le résultat de péchés individuels est une notion
rejetée par Jésus. Le péché est présent en arrière-fond des souffrances et des maladies, mais il est
impersonnel. Dans le Nouveau Testament, la maladie est surtout regardée en fonction de son but
et de sa signification, et non pas en raison de sa cause ou de son origine (par ex. Jean 9 :1-3, Jean
11 : 4).
Paul et les Pères de l’Église ont aussi beaucoup écrit au sujet des bénéfices spirituels potentiels de
la maladie (par ex. 2 Cor 12 :1-10).
Dans le christianisme primitif, même si l’âme était considérée comme plus importante que le
corps, il n’est pas affirmé que l’âme soit fondamentalement bonne et le corps fondamentalement
mauvais. Les textes de cette époque encouragent à prendre soin du corps, comme étant le temple
de Dieu. Pour le Pères de l’Eglise, il y a trois causes possibles pour les maladies, qui d’ailleurs ne
s’excluent pas : Dieu, les démons et les causes naturelles. Les soins dépendront de la cause
discernée. Ceux-ci seront alors soit la prière, soit le recours à la médecine ou encore l’exorcisme.
Le recours aux pratiques occultes est bien sûr interdit. Contrairement à la conception
prépondérante actuellement dans les milieux chrétiens selon laquelle toute guérison provient de
Dieu, les Pères de l’Église croyaient sans équivoque que Satan et les démons étaient capables de
guérir. Ils ne mettaient pas en doute l’efficacité des pratiques magiques.
Le recours à la médecine était admis pour un chrétien. Toutefois, le chrétien dépend de Dieu seul,
et non pas d’un élément de sa création, même parfaitement approprié. Dans leurs commentaires
sur le recours à la médecine, les Pères de l’Église se prononçaient sur un recours limité aux
médecins, car ils pensaient que les chrétiens doivent compter sur Dieu seul, qui peut choisir de
donner ou non la guérison.
1 H.Roux, « Sickness » in A companion to the Bible, ed. JJ von Allmen

GEA - Euthanasie Page 4 sur 16
Ils pensaient qu’il est juste de rechercher la santé, mais qu’un souci excessif de son corps ou le
fait de s’accrocher désespérément à la vie sont contraires aux valeurs chrétiennes. Et en tout cas,
les soins de l’âme devaient primer sur ceux du corps.
L’espérance chrétienne est basée sur l’amour de Dieu. L’amour du prochain est le
commandement qui en découle; il faut donc s’occuper de ceux qui souffrent (Mt 25 : 35-36, 40).
L’engagement des chrétiens pour les soins des malades a été intense au troisième siècle, durant
les épidémies de peste. Le quatrième siècle voit la fondation d’hôpitaux, orphelinats et homes
souvent associés à des monastères. Ces institutions, en prenant soin d’étrangers aussi bien que de
leurs propres membres, ont beaucoup contribué à la diffusion du christianisme. En effet, le
christianisme amenait là un changement d’attitude radical : l’obligation morale non pas de guérir,
mais de prendre soin. Or les médecins de l’antiquité ne se reconnaissaient aucun devoir à prendre
soin d’un cas désespéré. Contrairement aux institutions païennes, les activités de ces hospices
chrétiens étaient basées sur un respect fondamental de la valeur de la vie. Ce respect de la vie
n’était plus basé sur le fait d’être membre d’un peuple, comme c’était le plus souvent le cas chez
les Juifs, mais sur le fait d’avoir été créés à l’image de Dieu.
Le seul récit de suicide dans le NT est celui de Judas. Il n’est accompagné d’aucun commentaire.
Il y a aussi un récit de suicide évité, celui du gardien de Paul et Silas (Actes 16 : 25-34).
Avant saint Augustin, il y a relativement peu de commentaires qui développent ce sujet dans la
littérature chrétienne. On relève toutefois une douzaine de Pères de l’Église, qui condamnent le
suicide.
Ecrits de saint Augustin
Les condamnations du suicide ont été reprises et développées par saint Augustin qui a exercé une
immense influence dans le christianisme occidental. Saint Augustin écrit la Cité de Dieu à
l’époque du sac de Rome. C’est dans ce contexte que l’auteur discute la question du suicide : il
mentionne quelques motivations qui pourraient amener au suicide : désir d’échapper à des
problèmes temporels, désir d’échapper au péché d’autrui (Augustin y inclut le souci d’échapper
au viol), culpabilité pour un péché passé, désir d’une vie meilleure (vie éternelle), désir d’éviter
de pécher. Augustin désapprouve toutes ces motivations, en particulier la dernière. Il considère,
tout comme ses prédécesseurs, que le suicide est un crime. Son argumentation repose sur les
points suivants :
• Jamais les Écritures ne le préconisent pour atteindre l’immortalité, ni pour échapper au mal.
• Le suicide est inclut dans l’interdit du sixième commandement : «Tu ne tueras point ».
• Se tuer soi-même est assimilé à un homicide.
• Le fait de se suicider n’offre plus aucune possibilité de repentance.
Dans ses écrits contre les Donatistes, saint Augustin condamne aussi bien le fait de rechercher le
martyre que les suicides héroïques.
Euthanasie et suicide au Moyen Age
Les arguments de Thomas d’Aquin concernant le suicide sont les suivants :
• Il est contraire à la nature qui fait tout pour maintenir la vie.
• Il est un manque de charité parce que toute personne doit s’aimer elle-même.
• Il est une offense et une blessure à la communauté à laquelle nous appartenons
• Il est une usurpation du pouvoir de Dieu qui donne et reprend la vie.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%