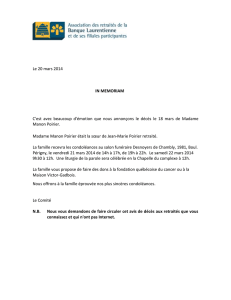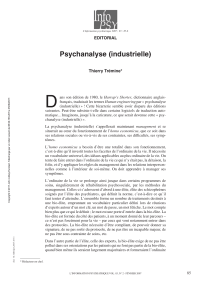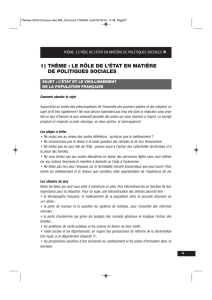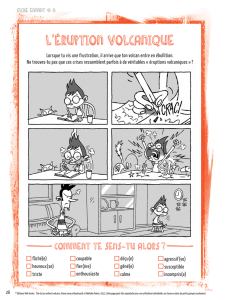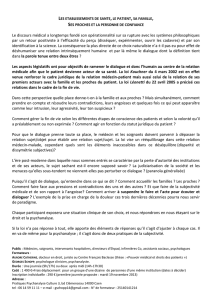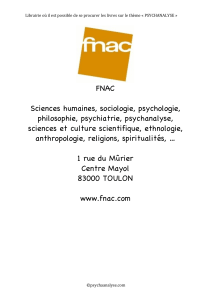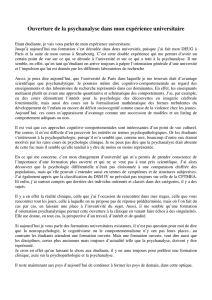E´ditorial - John Libbey Eurotext

E
´ditorial
L’expérience d’un médecin est
merveilleusement riche, mais toujours
trouble et ambiguë. Il arrive donc ceci
que ceux qui seraient les mieux placés
pour faire avancer la science ne
possèdent à la fin qu’un art mélangé de
savoir et de sorcellerie. C’est pourquoi la
médecine, semblable en cela à la
politique, ne peut avancer que par les
travaux de ceux qui ne pratiquent point.
Alain
Propos
Cette citation tirée du passionnant ouvrage de
Jacques Poirier La médecine est-elle un art ou
une science ? [1], est une bonne introduction à
ce numéro dans lequel paraît, pour la première fois
depuis la création de ce journal, un article de neuro-
science. Nous engageons vivement les lecteurs à faire
l’effort de lire l’excellente synthèse d’Anne Marcilhac
sur l’apoptose dans les maladies neurodégénératives.
Nul doute que, pour beaucoup d’entre eux, la lecture de
cet article, pourtant particulièrement clair, demandera
un effort. Mais cet effort n’est pas plus grand que celui
que nécessite, pour un gériatre ou un neurologue, la
lecture d’un article tout aussi clair concernant la psycha-
nalyse, comme celui de Bertand Claudel, ou la neuro-
psychologie, comme la synthèse de Louis Bherer et al.
Le propre d’une revue transdisciplinaire est bien d’inci-
ter chacun à dépasser les limites de sa propre discipline
et cela ne peut être atteint sans effort. Anne Marcilhac
nous montre que le rôle et les mécanismes de l’apop-
tose, cette mort cellulaire programmée, mais soumise à
des influences extérieures comme intérieures, varient
selon la pathologie dégénérative en cause. Le concept
de maladie dégénérative est, en réalité, un cache-
misère. Les maladies dites dégénératives n’ont pas
grand-chose en commun (ni la pathologie, ni la symp-
tomatologie, ni le pronostic), sinon leur évolution insi-
dieuse et progressive et l’implication dans leur genèse,
pour la grande majorité des cas, d’une association mal
précisée de facteurs génétiques et environnementaux.
Le terme de dégénérescence s’applique, selon le dic-
tionnaire, à la perte des qualités de la race (!) ou, en
médecine, à une altération cellulaire. Le temps n’est pas
si loin où nous devions apprendre à côté de la pneumo-
nie franche lobaire aiguë, par exemple, les « formes
du taré » : femme enceinte, diabétique, vieillard. Per-
sonne, aujourd’hui, n’admettrait de nommer taré un
diabétique ou une femme enceinte, ou dégénéré un
patient atteint de maladie d’Alzheimer ou de Parkinson.
Et pourtant, nul n’est choqué par le terme de maladie
dégénérative ! Sans doute la raison en est l’acception
médicale de la dégénérescence, l’altération cellulaire.
Mais peut-on prétendre qu’une définition aussi large
permette de désigner une classe pathologique spécifi-
que ?
L’article de Florence Lebert sur la dépression vascu-
laire montre bien que, lorsqu’une pathologie n’est défi-
nie que par ses caractères cliniques, les limites en sont
floues et les conceptions pathogéniques assez arbitrai-
res. La problématique des dépressions tardives a été
développée dans un numéro spécial coordonné par
Jean-Pierre Clément, récemment publié. Il est quelque
peu paradoxal d’affirmer que les critères de dépression
sont indépendants de l’âge et de décrire des variétés de
dépression spécifiques du sujet âgé. Ces présentations
particulières, avatars de la mélancolie d’involution,
sont-elles liées à l’âge, au contexte, à la pathologie
associée, au regard du praticien sur le vieillissement ou
le simple témoignage d’une pratique orientée par l’ex-
périence ou l’idéologie des spécialistes ?
La médecine est-elle un art ou une science ? La
tentation peut être grande d’opposer les neurosciences,
en constant développement, et la pratique médicale qui
en demeure bien éloignée. Certains ont accusé le déve-
loppement scientifique et technique de la médecine de
la rendre « moins humaine » et engagé les futurs méde-
cins à se retourner vers les humanités, le grec et le latin.
Ceux d’entre nous qui ont fait des études de lettres
classiques peuvent-ils se targuer d’avoir une pratique
« plus humaine » que celle des générations
d’aujourd’hui de formation scientifique du fait de la
pratique du grec et du latin ? Ce que demandent, en
définitive les malades, nous dit Jacques Poirier, est
d’être bien traités, c’est-à-dire, à la fois, de recevoir des
soins basés sur les connaissances les plus récentes et
les mieux établies, mais aussi d’être considérés comme
des individus responsables. Le refus du paternalisme
traditionnel et la juste demande de plus en plus affirmée
des patients d’être considérés comme des adultes res-
ponsables ne doivent pas nous faire oublier que la
relation médecin-malade (ou, plus largement soignant-
malade) est, au départ, une situation d’inégalité
puisqu’un sujet diminué par la souffrance ou la maladie
vient demander de l’aide à un autre qui est censé alléger
sinon supprimer son fardeau. Ignorer cet aspect spéci-
fique est source de confusion. La relation médecin
(soignant)-malade est une dynamique qui doit être ba-
sée sur le respect plus que sur une fausse égalité. Le
respect impose la compréhension de l’autre et de ses
réactions, mais également la nécessité de prendre cons-
cience de nos propres sentiments et réactions face à la
maladie et aux patients. L’apprentissage de la relation,
de la communication, bénéficie aujourd’hui de techni-
Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2, n° 3 : 165-6 165
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

ques qui sont enseignées, notamment, aux travailleurs
sociaux (et aux commerciaux !). Peut-on accepter que le
diplôme de docteur en médecine et le serment d’Hippo-
crate, au nom d’une idéologie qui se prétend huma-
niste, nous dispense de cet apprentissage ? Dans la
réalité, chacun doit faire face à des situations comple-
xes, souvent dramatiques, de façon purement empiri-
que, en fonction de ses croyances et de son fonctionne-
ment psychique propre. Il n’est donc pas étonnant de
retrouver comme un leitmotiv, dans toutes les enquêtes
menées auprès des patients ou de leurs familles, des
revendications concernant le défaut de communication
et la piètre qualité relationnelle des médecins. Il n’est
pas étonnant, non plus, que les études d’intervention
nous montrent que l’amélioration de la communication
bénéficie au patient et soulage le fardeau des aidants,
familiaux ou professionnels. L’apprentissage de la com-
munication, en gardant l’aspect spécifique de la relation
soignant-malade, doit donc aller de pair avec la forma-
tion scientifique des soignants. À l’adage célèbre
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »,
on peut rétorquer que « conscience sans science » n’est
que charlatanisme innocent, selon l’expression de Jac-
ques Poirier. Avec lui, nous pouvons conclure que la
médecine n’est ni une science ni un art : c’est, avant
tout, une pratique ou plutôt des pratiques. La diversité
même de nos pratiques est un enrichissement pour la
compréhension du vieillissement et des affections qui
lui sont associées, mais cela nécessite que chacun res-
pecte la pratique des autres et fasse un effort pour la
comprendre. Pour clore ce sujet, je voudrais livrer à la
réflexion des lecteurs, la réponse que me fit Daniel
Widlöcher, un jour que je l’interrogeais sur le statut
épistémologique de la psychanalyse : « La psychana-
lyse n’est pas une science, c’est une grande décou-
verte. »
Christian Derouesné
Référence
1. Poirier J. La médecine est-elle un art ou une science ? Collection
Mémoire de la science, numéro 4. Paris, Académie des sciences
2004.
C. Derouesné
Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2, n° 3 : 165-6166
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.
1
/
2
100%